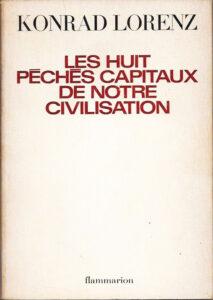Konrad Lorenz (1903-1989) est un biologiste autrichien, titulaire du prix Nobel de médecine, rendu célèbre pour ses travaux sur le comportement des animaux, et pour la discipline dont il fut l’un des pionniers, l’éthologie moderne. En 1973, il publie un ouvrage intitulé Les huit péchés capitaux de notre civilisation. Cet opuscule expose avec une brillante acuité les huit « plaies d’Égypte » d’une civilisation devenue malade.
Comme Bernanos, Konrad Lorenz fait le constat que les récents développements de l’humanité ressemblent moins à ceux d’un organisme sain qu’à ceux d’un organisme atteint d’une forme de cancer particulièrement pernicieuse. D’ailleurs, le terme de « crise », généralement employé pour évoquer ce à quoi l’humanité moderne est aujourd’hui confrontée, est, par définition, la manifestation violente d’un état pathologique. Le travail de Lorenz est celui d’un biologiste et d’un médecin vigilant. Il se penche sur l’humanité moderne comme sur un patient malade dont il s’agit de faire le diagnostic.
Cinquante ans plus tard, les phénomènes dénoncés par Lorenz ont pris des proportions de plus en plus dangereuses. Poussé dans une pente mortelle par les « péchés » dénoncés dans l’ouvrage, « l’homme est menacé de faire ce qui n’arrive presque jamais aux autres systèmes vivants, à savoir s’autodétruire ».
Le premier péché que le biologiste autrichien dénonce est celui de la surpopulation. Lorenz constate que la promiscuité a conduit l’homme à « diluer » les sentiments chaleureux qu’il éprouve d’ordinaire envers ses pairs. En effet, l’homme est par essence incapable de ressentir pour le monde entier l’amour qu’il éprouve pour son entourage proche, sa famille et ses amis. Cette impossibilité force le citadin à « tenir à distance » émotionnellement des personnes qui seraient tout aussi dignes de son amitié. Mais cette mise à distance est également un signe d’inhumanité. Elle peut, dans un cas extrême, produire une certaine forme d’apathie. « Plus la promiscuité est importante, plus le besoin de « ne pas s’impliquer » devient urgent pour l’individu ; ainsi aujourd’hui, surtout dans les plus grandes villes, le vol, le meurtre et le viol peuvent avoir lieu en plein jour et dans des rues bondées sans l’intervention d’un passant. »
La promiscuité induit également un comportement plus agressif. Plusieurs expériences sur les animaux ont montré que la proximité suscite l’agressivité intra-spécifique. Toute personne qui s’intéresse à l’écologie connait les effets de la proximité chez, par exemple, le criquet pèlerin. Dans une situation de densité inhabituelle, le contact du criquet avec ses congénères déclenche une soudaine poussée de sérotonine, modifiant brusquement sa couleur, sa morphologie, sa physiologie, son comportement et sa biologie. Aussi, chez l’être humain, explique Lorenz, « l’hostilité générale, flagrante dans les grandes villes, est nettement proportionnelle à la densité de population dans certains endroits ». Or il est impossible, selon lui, en dépit de tout « conditionnement », de fabriquer une espèce d’êtres humains immunisés contre les effets néfastes de la surpopulation.
Cités-dortoirs et cellules tumorales
Pour Lorenz, sensibilité esthétique et droiture morale sont étroitement liées : « La beauté de la nature et la beauté de l’environnement culturel créé par l’homme sont éminemment nécessaires pour garder l’homme sain mentalement et spirituellement. » Lorenz évoque donc avec horreur les cités-dortoirs, ces « bâtiments d’élevage », à peine tolérables pour les animaux, et pourtant parfaitement tolérés lorsqu’il s’agit d’y parquer des êtres humains. Il compare les banlieues modernes, ces successions de grands ensembles, à des cellules tumorales. En biologiste, il note les similitudes entre les photographies aériennes des périphéries urbaines, ces « habitations monotones, conçues par des architectes sans inspiration, sans recherche esthétique », et les images histologiques des cellules cancéreuses. Ainsi, les habitations des cités-dortoirs « ne peuvent être distinguées les unes des autres si ce n’est par leur nombre et méritent à peine le nom de « maisons », puisqu’elles sont, au mieux, des bâtiments d’élevage pour personnes utiles ».
Si un tel traitement est admis pour un animal, élevé et domestiqué pour tolérer ce mode d’existence, il est en revanche inhumain dans le sens littéral du terme. L’homme est contraint de se leurrer lui-même afin de ne pas se rendre compte de son propre avilissement. « L’habitant du bâtiment d’élevage n’a qu’un seul moyen de garder son estime de soi : c’est de bannir de sa conscience l’existence de nombreux compagnons d’infortune similaires et de s’isoler de ses voisins. Dans de nombreux immeubles résidentiels, des cloisons sont élevées entre les balcons des appartements, ce qui rend les voisins invisibles. On ne peut pas et on ne veut pas socialiser avec lui « par-dessus la barrière » car on a trop peur de voir se refléter en lui sa propre image désespérée. »
Il n’était pas écrit que l’homme décide un jour de s’installer dans des villes surpeuplées, de s’entasser dans des bâtiments d’élevage, et de s’astreindre à un travail et à des loisirs qui contribuent à sa propre aliénation. Mais l’homme, ou plutôt notre ancêtre du Néolithique, s’est domestiqué lui-même, pour reprendre la thèse de James C. Scott dans son ouvrage Homo domesticus.
Selon Lorenz, cette domestication est la cause de plusieurs altérations héréditaires. La première est une plus grande précocité sexuelle, responsable de l’accroissement de la fécondité. La seconde est la persistance à l’âge adulte de traits juvéniles, la « néoténie ». Lorenz évoque les dangers de cette infantilisation génétique, qui fabrique des générations d’individus immatures. « Une personne dont le comportement social n’a pas mûri et qui reste dans un état infantile devient nécessairement un parasite de la société. » Hostile à l’ordre social institué par ses aînés, le « rebelle » s’attend pourtant à être pris en charge par la société qu’il abhorre. Un grave danger nous guette, alerte Lorenz, si l’origine de cet infantilisme déraisonnable s’avère génétique. Pour empêcher ce déclin, le biologiste autrichien propose donc une parade : le choix d’un partenaire qui soit d’une probité exemplaire, un homme ou une femme « de bien ».
Le remède semble assez faible comparé à la menace évoquée. Quoi qu’il en soit, une « régénération » génétique par l’apport d’un sang barbare, comme cela a pu se produire au cours de l’histoire de l’humanité, ainsi que l’a montré Gabriel Martinez-Gros dans sa Brève histoire des empires, est désormais peu probable. « Le secours, constate également Jacques Ellul, ne peut plus venir des grands barbares blonds qui ont submergé l’Empire romain ni des Mongols et des Mandchous qui en firent autant pour l’Empire du Milieu, et qui ce faisant leur apportaient du sang neuf, une ardeur de vivre, un sens inclus, une vertu renouvelée, un langage évident, un poids et un prix pour la vie humaine. (…) Rien de décisif ne se produit – qui puisse renouveler pour l’homme ses vertus épuisées. » (L’espérance oubliée).
La prison dorée des hédonistes
Lorenz est également peu clément envers l’esprit hédoniste moderne. Il consacre un chapitre à un phénomène qu’il nomme la « mort thermique de la sensibilité » (Wärmetod des Gefühls). Le terme de « mort thermique » fait référence à l’état d’un système thermodynamique ayant atteint son entropie maximale, rendant toute énergie indisponible.
Après avoir expliqué l’importance du mécanisme de la récompense et de la punition dans l’histoire de l’évolution, le biologiste rappelle qu’un organisme vivant est généralement contraint d’endurer une souffrance momentanée en vue d’un plaisir futur. Il donne ainsi l’exemple du prédateur, contraint de courir à travers des broussailles et de s’exposer à de multiples dangers avant d’atteindre et de se délecter de sa proie. Ce mécanisme contraint l’animal à ne pas produire des efforts superflus pour des gains minimes, et, inversement, à consentir des sacrifices considérables lorsque sa survie est en jeu. L’homme primitif avait des contraintes similaires. Sa vie était celle d’une bête de proie, difficile et dangereuse.
Par conséquent, certains comportements considérés aujourd’hui comme « immoraux » étaient parfaitement adaptés à une stratégie de survie. Par exemple, manger avec excès, pour survivre à des périodes de disette, ou dépenser le moins d’énergie possible. De fait, « nos ancêtres n’avaient pas besoin de rechercher les difficultés de l’existence de manière « virile » ou « chevaleresque », car les dangers s’imposaient d’eux-mêmes ». Or, dans les conditions de la vie moderne, deux éléments contribuent dangereusement à l’éviction générale de la sensation de douleur : la pharmacologie et la technologie. Rendu asthénique par un monde de plus en plus confortable, l’homme moderne est devenu démesurément sensible à la douleur et insensible au plaisir. L’intolérance croissante à la douleur a rendu l’homme incapable de produire des efforts importants pour des objectifs à long terme, pour des entreprises qui ne donnent du plaisir qu’ultérieurement. De surcroît, la publicité, le modèle économique consumériste, et les facilités de paiement, encouragent un type de comportement hédoniste, la satisfaction immédiate de tous les désirs.
Dans le domaine sentimental, cette évolution conduit à mise au pinacle de « l’accouplement instantané », un type de comportement qui est d’ordinaire celui des animaux domestiqués. L’idée fausse selon laquelle l’amour serait quelque chose d’« agréable » et d’inaccessible à la souffrance, mène la jeunesse dans une impasse. Par ailleurs, l’éviction de la douleur et l’émoussement du plaisir procurent une existence monotone, sans déplaisir, mais également, par effet de contraste, sans joie. « Bref, cela crée un ennui mortel », conclut Lorenz.
Selon lui, « vouloir éviter la souffrance, c’est échapper à une partie essentielle de la vie humaine ». D’ailleurs, l’homme moderne semble désormais trop faible, trop émoussé par cette « mort thermique » de la sensibilité, pour développer un vice remarquable. Dans le Gorgias de Platon, c’est également un argument de Calliclès contre ceux qu’il considère comme « les plus faibles », c’est-à-dire les hommes qui n’incarnent pas son idéal homérique et chevaleresque. L’accoutumance aux stimulations agréables conduit les individus blasés à rechercher de nouvelles stimulations, un phénomène que Lorenz nomme la « néophilie ». Dans le roman Fight Club de Chuck Palahniuk, le narrateur est ainsi à la recherche du dernier meuble Ikea qui comblera l’incomplétude de son existence. Lorenz affirme que l’obsolescence programmée, imposée par les grandes compagnies industrielles, ne fait qu’accentuer ce phénomène.
Contre l’amollissement général de la jeunesse, et le sentiment d’ennui qui accable les jeunes gens blasés, Lorenz donne l’exemple de plusieurs méthodes qui se sont révélées efficaces. Ainsi ces individus envoyés sur le littoral pour effectuer du sauvetage en mer, ou leur mise face à des « situations limites » qui les frappent par leur caractère extrêmement dangereux. Lorenz admet qu’il s’agit d’un pis-aller, mais également que ce « faute de mieux » peut en sauver quelques-uns du suicide. Il note que les personnes qui ont tenté de se brûler la cervelle, et qui ont survécu, ne tentent généralement pas l’entreprise une seconde fois. Le fait d’avoir surmonté un obstacle considéré comme insurmontable, redonne, a priori, le goût de l’existence, et permet de développer par la suite une personnalité équilibrée.
« Surtout ne pas penser »
En s’accaparant la maîtrise de son environnement immédiat, l’homme moderne se condamne à subir les effets de la seule sélection intra-spécifique. Or, la sélection intra-spécifique produit des changements dans le génome qui n’augmentent pas les chances de survie, bien au contraire. Dans le cas de l’argus mâle, l’augmentation disproportionnée de son organe de parade le rend quasiment incapable de voler. Konrad Lorenz cite son homologue Oskar Heinroth, pour qui « après les ailes de l’argus mâle, le rythme de travail de l’homme moderne est le produit le plus stupide de la sélection intra-spécifique ».
Lorenz note avec effroi les méfaits causés par la course de l’humanité contre elle-même. Il constate que « l’écrasante majorité des individus ne perçoit désormais comme valeur que ce qui réussit dans une compétition impitoyable et ce qui permet de surpasser ses semblables ». L’argent est érigé en valeur, et le sentiment qui domine est la peur, « la peur d’être dépassé dans la course, la peur de la pauvreté, la peur de prendre les mauvaises décisions et de ne plus être capable de suivre le rythme des événements ». Seul ce sentiment peut expliquer la course déraisonnable de l’homme contre lui-même, qui le conduit, au profit d’une hypothétique supériorité sociale ou financière sur ses semblables, à négliger jusqu’à sa propre santé.
Enfin l’homme moderne se prive d’une de ses capacités essentielles, celle de penser. Il se noie dans le bruit parce qu’il a peur de s’entendre lui-même. Il a peur d’être confronté à lui-même comme s’il devait faire face à l’horrible reflet décrit par Oscar Wilde dans son Portrait de Dorian Gray. Il préfère les publicités télévisées ineptes à sa propre compagnie, parce que cela l’aide à chasser ses pensées. À l’époque où écrit Lorenz, en 1973, les moyens, ou plutôt les « méthodes » d’abrutissement modernes sont balbutiantes. Mais les techniques ont évolué depuis et le phénomène s’est considérablement amplifié. Toute forme d’introspection, de méditation, de conversation avec soi-même est désormais bannie. Confronté à cette conspiration de la Technique contre toute forme de vie intérieure, l’homme devient ce monstre froid dont parlait Bernanos, un robot sans âme capable d’obéir aux plus effroyables injonctions. En effet, « un être qui cesse de réfléchir est menacé de perdre tout ce qui fait de lui un être humain », rappelle tristement Lorenz.
Le mythe de la tabula rasa
Lorenz rappelle que les êtres humains ont droit, à juste titre, à des chances égales de développement, mais qu’il est incorrect d’affirmer que tous les hommes sont égaux. Or, la doctrine béhavioriste s’engage résolument dans cette direction en affirmant que l’homme est une sorte de tabula rasa capable d’être « reconstruite » grâce à un conditionnement adéquat. Pour rappel, le béhaviorisme est une approche de la psychologie d’origine anglo-saxonne selon laquelle le comportement d’un individu repose essentiellement sur un conditionnement et exclut toute influence, par exemple, génétique. C’est l’approche employée pour guérir le comportement déviant du jeune Alex DeLarge dans le film Orange mécanique.
Pour les dirigeants des États communistes ou capitalistes, comme la Chine ou les États-Unis, un conditionnement de ce type est hautement souhaitable. Il est bienvenu par le producteur capitaliste, pour qui son intérêt est de transformer les individus en sujets, en masses dociles, de les rendre incapables de résister à toutes les sommations et les suggestions. De fait, les moyens employés par les propagandistes et les publicitaires sont désormais colossaux. « Jamais auparavant la suggestion de masse n’avait été aussi efficace, jamais auparavant les manipulateurs n’avaient eu en leur pouvoir une technique publicitaire basée sur la science expérimentale, jamais auparavant ils n’avaient eu à leur disposition de médias de masse aussi puissants qu’aujourd’hui. » Lorenz constate que les moyens publicitaires et de propagande employés de part et d’autre du rideau de fer sont exactement les mêmes. L’individu est contraint par les grands producteurs de manger un certain type de nourriture et de porter certains vêtements, en fonction de ce qui lui est imposé, et cela sans vraiment s’en apercevoir.
Le biologiste analyse ensuite le rôle de la mode. Celle-ci avait à l’origine un rôle régulateur et conservateur, et ses lois étaient dictées par les aristocrates et les patriciens. Devenue un jouet entre les mains du producteur capitaliste, elle s’est transformée en un moyen d’écouler le plus grand nombre possible de marchandises. Mais le principal danger de ce phénomène réside selon Lorenz dans la mise en avant de « théories scientifiques à la mode ». La volonté d’être dans l’air du temps conduit la curiosité scientifique de trop nombreux chercheurs dans une direction opposée à « l’objectif réel de tous les efforts humains en vue de la connaissance », à savoir la meilleure connaissance de soi-même, et donc de l’homme. Ce penchant général de la science, qui fait parfois oublier que les « particules élémentaires » étudiées sont des êtres humains, et non des neutrons, est également qualifié par Lorenz d’inhumain.
L’ouvrage de Lorenz s’achève sur le sujet de l’arsenal nucléaire. Cette menace apparait aux yeux de Lorenz comme la plus dangereuse mais également la moins probable (ou plus exactement la plus « évitable »). Il semble évident que l’humanité ne devrait, pour son propre intérêt et surtout pour sa survie, ni la fabriquer ni l’utiliser. Pourtant, « compte tenu de l’incroyable stupidité collective de l’humanité, cela reste difficile à réaliser », constate Lorenz de manière sarcastique.
En fait, l’anxiété liée à la bombe nucléaire, l’« ambiance apocalyptique » générale, est peut-être plus néfaste encore que son emploi éventuel. Le fait d’être incapable de savoir combien de temps le monde va rester debout ramène l’homme à son aspiration infantile pour la satisfaction de ses désirs immédiats. Sa croyance au mythe de l’effondrement nucléaire l’empêche de se sentir responsable de quelque chose situé dans un avenir plus lointain.
L’œuvre de Lorenz prend le contrepied parfait de la fausse science qu’il dénonce, en faisant l’effort d’étudier l’homme de près. Il rappelle, en citant plusieurs expériences scientifiques, que l’étude des perturbations pathologiques d’un organisme, d’un organisme en « crise », est parfois la clé de sa compréhension. En effet, comme l’affirmait Bernard de Clairvaux, il est parfois bien meilleur et plus louable de se connaître, que, en se négligeant, de connaître « le cours des astres, les propriétés des herbes, la complexion humaine, la nature des êtres vivants, et la science de tous les êtres célestes et terrestres ». Une façon, en quelque sorte, scientifique et « moderne », d’employer la célèbre maxime delphique Connais-toi toi-même.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.