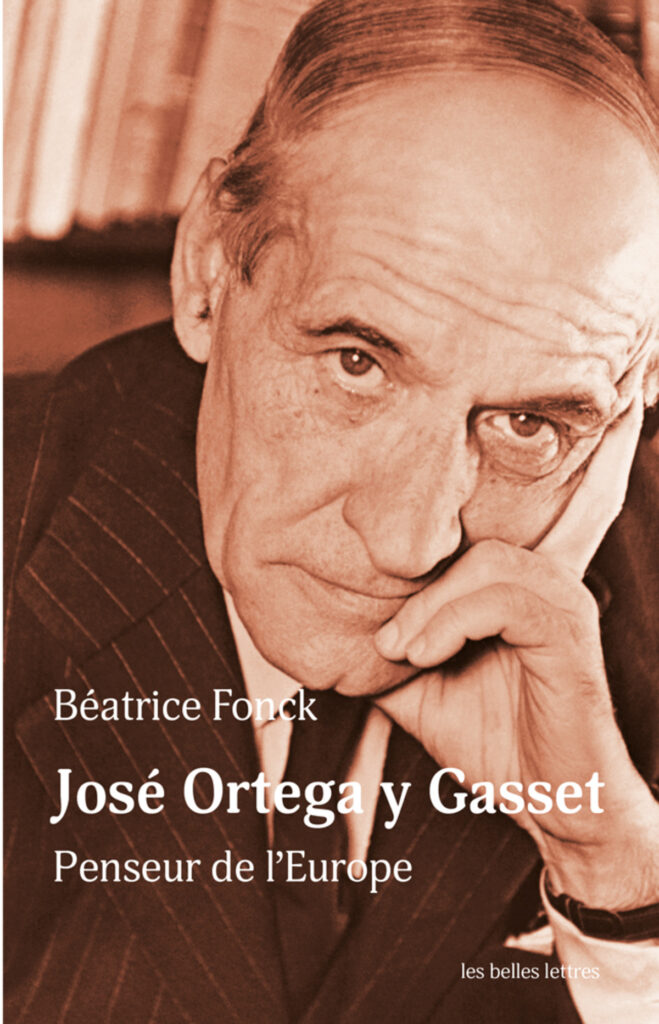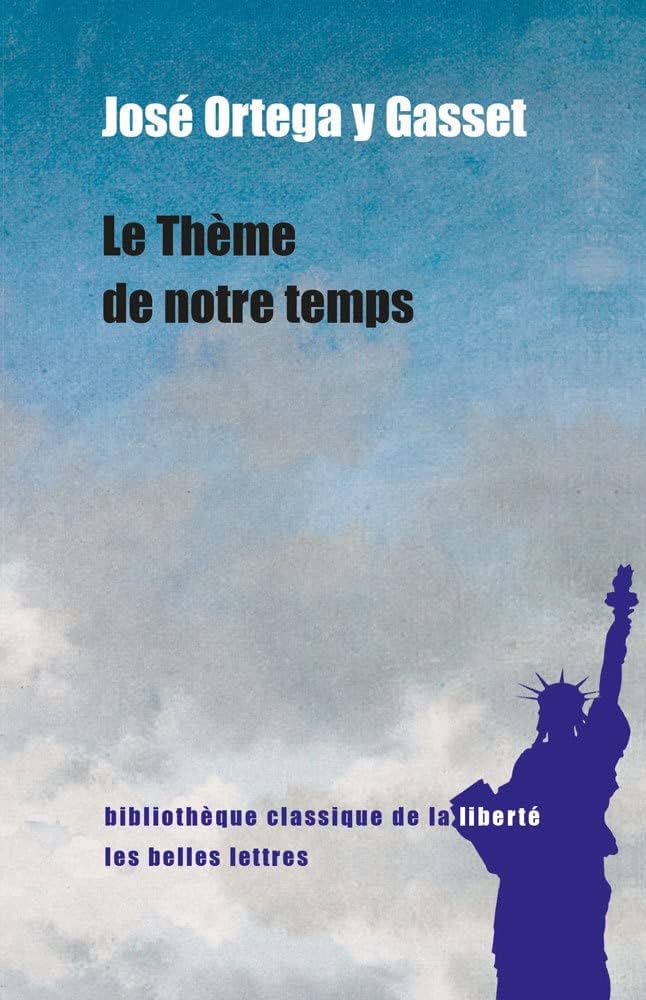Professeur émérite de civilisation espagnole à l’Institut catholique de Paris, Béatrice Fonck publie aux Belles Lettres José Ortega y Gasset. Penseur de l’Europe, une biographie de référence qui permet de découvrir plus amplement le philosophe espagnol, souvent réduit, en France du moins, à son livre phare La Révolte des masses.
PHILITT : De quel milieu sociologique est issu José Ortega y Gasset et qu’est-ce qui le pousse à embrasser la carrière qui fut la sienne ?
Béatrice Fonck : Il est issu d’une famille de la haute bourgeoisie madrilène, à la fois ancrée dans le journalisme, la littérature et la politique. Son père est un homme de lettres et le directeur d’un journal très important d’obédience libérale El Imparcial. Sa mère est quant à elle la sœur d’un ministre libéral chargé, à plusieurs reprises, du développement du territoire. Il dispose donc de tous les atouts pour exercer une carrière publique. Son père le destinait à la politique, mais il abandonne ses études de droit pour des études de philosophie. Ortega a aussi des dons littéraires. Ses essais sur des écrivains espagnols ou étrangers (Proust par exemple) sont d’un grand intérêt et son style est d’une grande finesse. Tous les Espagnols reconnaissent la qualité de plume d’Ortega. Il a d’ailleurs été sollicité pour devenir membre de l’Académie royale espagnole en 1935. Il a néanmoins décliné cette proposition sans doute pour éviter toute relation avec les institutions officielles de l’époque. Particulièrement préoccupé par l’avenir de son pays, Ortega tente de concilier son parcours de philosophe avec celui d’un intellectuel impliqué dans le futur de l’Espagne et de l’Europe.
Journaliste, philosophe, un temps homme politique… Ortega est-il, par excellence, ce qu’on appelle un intellectuel ?
Oui, il est emblématique de ce qu’est un intellectuel. Il est à la fois dans le monde – son œuvre est inscrite dans son temps – et « engagé ». Il entre en politique en 1914 et en 1931 il est élu député républicain. Cependant, il a toujours critiqué la conception sartrienne de l’engagement. Ortega n’a jamais voulu adhérer à un parti, en revanche il estimait pouvoir animer des groupes d’influence. C’est un homme de pensée et de réflexion, certainement pas un homme d’appareil.
Dans L’Espagne invertébrée, Ortega est très sévère vis-à-vis de ses compatriotes et dresse un portrait pessimiste de l’histoire de son pays. Pour quelles raisons ?
Ortega est particulièrement mécontent de la situation dans son pays après la Première Guerre mondiale, notamment après les trois années de grèves révolutionnaires recensées en Espagne et en Europe (1918-1920). Il estime que son pays est incapable d’aller de l’avant et retombe toujours dans ses ornières. Les changements fréquents et infructueux de gouvernement ainsi que le nouvel échec de l’armée espagnole au Maroc à la bataille d’Anoual motivent la sévérité de son diagnostic. L’écriture du chapitre « Puissance du processus de nationalisation » est contemporaine de cette défaite coloniale. Ortega y utilise un vocabulaire qui a pu être considéré par ses détracteurs comme un discours nationaliste et militariste inspirateur de la phalange espagnole notamment, alors qu’il se veut un questionnement sur la nation, un quid divinum dont il cherche à expliquer le délabrement et la marginalisation internationale. Il décrit un phénomène de cloisonnement de la société espagnole, un « particularisme » on dirait aujourd’hui une « archipélisation », l’inverse d’une quête d’énergie nouvelle pour une nation réconciliée avec elle-même. Ainsi, dans le chapitre « l’absence des meilleurs », Ortega défend la thèse d’une Espagne incapable de produire des élites depuis le Moyen Âge. Pour lui, le fait que son pays n’ait pas connu la féodalité (contrairement à la France) a constitué un frein à la construction nationale. D’un côté, il refuse la légende noire (celle d’une Espagne arriérée soumise à l’Inquisition) diffusée par les pays étrangers notamment depuis l’époque moderne. Mais d’autre part, il refuse le discours historique officiel sur la grandeur de son pays (Reconquista, Découverte de l’Amérique) qui l’enferme dans son passé et l’empêche de progresser. Pour lui, au XVIIe siècle, l’Espagne, coupée de la modernité, a commencé à reculer. Il lui semble essentiel de comprendre pourquoi son pays a été incapable de s’inscrire dans le mouvement général de modernisation et pour cela il lui faut revisiter l’histoire de son pays depuis le Moyen Âge.
Ortega semble entretenir une sorte de complexe vis-à-vis de la France et de l’Allemagne…
Formé en Allemagne et imprégné de sa culture, il garde un intérêt majeur pour la culture française. Son éducation à la française lui permet de parler et lire le français. Il a d’ailleurs lu Proust en français. Cependant, il a privilégié la traduction d’ouvrages allemands car il savait que l’élite espagnole pratiquait beaucoup moins l’allemand que le français. Vis-à-vis de la France, la voisine avec qui l’Espagne a des liens historiques, il garde une distance critique non dénuée d’estime à l’égard de sa culture en regrettant néanmoins sa tendance à parler urbi et orbi. En revanche, il admire la construction nationale de l’Allemagne au XIXe siècle mais son admiration s’amenuise en 1915 quand les intellectuels allemands prennent fait et cause pour la guerre. Il s’en éloigne plus fortement encore à partir de 1933 dès l’avènement du nazisme, sans pour autant cesser de s’intéresser à la pensée allemande. Précisons qu’il fait traduire les grands penseurs de son temps : Freud, Spengler, Einstein, Husserl… et que les traductions de Freud et Spengler en espagnol sont antérieures aux traductions françaises.
Il a aussi beaucoup agi pour le redressement culturel et politique de son pays. Quels étaient ses objectifs et quels leviers a-t-il utilisé ?
Ortega avait à cœur d’améliorer le niveau culturel général de son pays. Il a tout de suite compris l’importance qu’avaient déjà et qu’allaient avoir, à terme, la presse et les nouveaux moyens de communication. Il a contribué à la création de nombreuses revues dont la Revista de Occidente, encore diffusée aujourd’hui. Il a fondé le quotidien El Sol, devenu une tribune de référence jusqu’à la République. De ce point de vue, Ortega est un pionnier. Il a aussi une activité de conférencier et d’universitaire. Il occupe la chaire de métaphysique à Madrid, chose paradoxale en 1910 pour un agnostique en Espagne. Sous la République, il a participé à la réforme des universités et des contenus universitaires. Après sa disparition, ses enfants Soledad et José ont largement contribué à la diffusion de son œuvre et à la création d’une fondation universitaire à Madrid ainsi qu’à Buenos Aires et Mexico. Son fils José Ortega Spottorno est à l’origine de la fondation du quotidien actuel El Pais. C’est dire l’héritage culturel de notre philosophe jusqu’à nos jours.
Ortega se revendiquait du libéralisme politique, mais, dites-vous, « non pas du libéralisme économique effréné que nous connaissons ». Quelle était la spécificité de son libéralisme ?
Dans sa jeunesse, Ortega affirmait que les partis libéraux devaient être « frontaliers » de la révolution. Il voulait que le parti socialiste espagnol s’assimile au parti social-démocrate allemand qu’il avait pu observer pendant ses études. Il souhaitait rallier l’opinion ouvrière à une élite éclairée, qui participerait à l’élévation culturelle de la société. Il a lu Marx mais n’adhère pas à sa conception matérialiste de l’histoire ni à la lutte des classes. Il préconise l’instauration d’une « politique de la participation » des ouvriers aux bénéfices de l’entreprise. Ortega est soucieux de la circulation du capital. C’était un libéral humaniste. Il a lu Saint Simon, Lasalle, Bernstein, invité Keynes en Espagne. Mais sa préférence va aux libéraux du début du XIXe siècle comme Tocqueville ou Guizot.
Dans Le Thème de notre temps, le philosophe pose les bases de son ratio-vitalisme. Que signifie une telle notion ? Ortega cherche-t-il à concilier les idéaux classique (raison) et romantique (vie) ?
Il cherche en effet une voie moyenne entre un rationalisme abstrait et une réalité vitale concrète. Il ne rejette pas la raison mais le rationalisme en mettant l’accent sur une autre manière d’appréhender la réalité, c’est-à-dire le simple fait de vivre. Il est habité par le souci très espagnol, hérité de Don Quichote, de l’homme qui affronte au quotidien la réalité, même si cette réalité n’est pas conforme à ses rêves. Il s’agit d’accepter cette contradiction, non pas de la combattre, mais de l’embrasser au nom de la créativité.
La Révolte des masses est le livre le plus célèbre d’Ortega. Quelle est sa définition des masses ? Et en quoi le « barbare spécialiste » est-il un danger pour l’intelligence ?
Pour Ortega, les « masses » ne sont pas le « peuple ». Il aurait dû davantage insister sur ce point me semble-t-il. La masse, c’est la foule, ce sont les gens, d’où le titre de l’une de ses œuvres L’homme et les gens. Ortega fait le constat d’une démographie galopante et estime que la société industrielle se retrouve face à un nouveau défi. Il décrit un homme nouveau incapable d’être à la hauteur de son temps, qui ne mesure pas la chance de vivre, non pas comme un barbare, mais comme un homme civilisé. L’homme-masse est un individu sans éducation et sans passé qui a tendance à devenir un enfant gâté. Le barbare spécialiste est le phénomène révélateur des nouveaux défis de la connaissance dont le développement implique une spécialisation croissante de la recherche. Le reproche qu’Ortega fait à certains scientifiques est d’être à la fois imbus de leur science, parce que bénéficiaires du privilège que la modernité accorde au progrès scientifique, et inconscients du fait qu’ils opèrent dans un domaine restreint. Ce qui est barbare, c’est qu’ils pensent pouvoir adapter leurs connaissances particulières à l’ensemble du monde connu et parler en toute autorité de ce qu’ils ignorent.
Ortega a cherché à penser une forme de déclin de l’Occident, mais en se distinguant de penseurs comme Spengler. Dès lors, de quelle nature est son déclinisme ?
Ortega parle de déclin surtout au moment de la guerre civile. Qui ne penserait pas au déclin dans un tel contexte ? De plus, la question du déclin est devenue centrale chez les intellectuels de son époque. Mais, du fait qu’il est espagnol, il ne se résout jamais à ce que ce déclin soit inévitable. Il y a chez lui une dose d’espérance : il croit fondamentalement en l’homme, à l’historicité du vivant dans toute sa complexité et sa force de renouvellement.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.