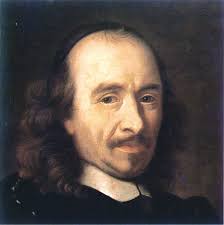Professeur émérite de littérature française à Sorbonne Université et père de la « génétique théâtrale », Georges Forestier est le plus grand spécialiste français des dramaturges du Grand Siècle : Corneille, Racine et surtout Molière, dont il a codirigé la réédition des œuvres complètes à La Pléiade. Il a récemment publié Molière, le mystère et le complot, aux éditions Hermann, dans lequel il revient sur la thèse selon laquelle Molière n’aurait pas écrit ses pièces – livrant par la même occasion une analyse des mécanismes par lesquels les « théories alternatives » naissent, se développent et prospèrent.
PHILITT : Où et comment naît « le cas Molière », cette théorie selon laquelle Molière ne serait pas l’auteur de ses pièces ?
Georges Forestier : C’est d’abord Shakespeare qui, notamment à partir du XIXe siècle, a fait l’objet d’une telle remise en question en Angleterre. La théorie selon laquelle Shakespeare ne serait pas l’auteur de ses sonnets et de ses pièces, et ses multiples ramifications attribuant à telle ou telle personne la paternité de ses œuvres, est d’ailleurs toujours très en vogue aujourd’hui.
En France, une théorie similaire émerge à l’encontre de Molière au début du XXe siècle. C’est le poète Pierre Louÿs qui sonne le premier la charge en 1919 en publiant coup sur coup deux articles : Corneille est-il l’auteur d’Amphitryon ? paru dans L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, et L’Imposteur de Corneille et Le Tartuffe de Molière paru dans Comœdia. Sa théorie est simple : Corneille serait l’auteur des pièces de Molière, et les deux hommes auraient en quelque sorte conclu un « pacte ».
Pour Molière, l’intérêt est évident. Comédien reconnu mais supposément incapable d’écrire de tels chefs-d’œuvre, il y aurait trouvé l’assurance du succès et de la postérité. Pour Corneille, cet arrangement aurait été dicté par le souci de ne pas écorner son image de grand auteur de tragédies en publiant des farces et des comédies, et par la liberté qu’aurait permis ce système de prête-nom.
La théorie de Pierre Louÿs se développe dans un terreau fertile. Elle trouve en effet un écho auprès d’un petit nombre d’intellectuels déjà sensibles à ce genre de thèses, parmi lesquels l’historien de la littérature Abel Lefranc. Celui-ci était déjà l’auteur d’un essai entièrement consacré à Shakespeare, dont la conclusion attribuait finalement les œuvres à un certain William Stanley, comte de Derby. Quant à Pierre Louÿs lui-même, il s’est fait connaître en publiant les Chansons de Bilitis, un recueil de poèmes qu’il avait fait passer pour une traduction d’originaux grecs. Habitué des pseudonymes, il montre un certain goût, voire une fascination, pour le faux et la supercherie.
Dès l’époque, l’entourage de Pierre Louÿs semble conscient que sa théorie ne tient pas la route – sans pour autant le lui faire savoir. Elle connaît un regain d’intérêt dans les années 1950, relancée par le romancier Henry Poulaille, puis, dans les années 1990, par un avocat belge qui en tire une pièce de théâtre… La trajectoire de cette thèse farfelue est ainsi marquée par des cycles et des récurrences, au gré desquels elle refait surface dans le débat public, avant de disparaître de nouveau…
Quels sont les arguments avancés pour étayer cette théorie ?
Le principal argument repose sur la proximité stylistique supposée entre les pièces de Molière et de Corneille. Proximité du vocabulaire, constructions analogues, usage des mêmes procédés… Pierre Louÿs note par exemple l’emploi récurrent chez Corneille du « je » à la septième syllabe du vers – caractéristique que l’on retrouve également sous la plume de Molière. À partir de ces différentes comparaisons, l’évidence s’impose peu à peu : on reconnaîtrait la plume de Corneille derrière celle de Molière.
Cet argument, les partisans de la théorie selon laquelle Corneille serait l’auteur des pièces de Molière ont cru lui trouver une validation définitive au début des années 2000, avec une étude statistique conduite par le chercheur grenoblois Dominique Labbé. Cette étude repose sur une méthode simple : on demande à un ordinateur de procéder à une analyse syntaxique et lexicale des textes pour calculer la distance existante entre eux. Si tous les mots sont employés à la même fréquence, la distance est de 0. Si les deux textes ne comportent aucun mot commun, elle est de 1. L’algorithme s’est montré formel : avec une distance inférieure à 0,25, il est possible d’attribuer au moins seize des dix-huit comédies de Molière à Corneille.
Or, il faut bien comprendre que cette méthode comporte des biais colossaux. Si l’on ne fonde sa recherche que sur des mots et des expressions, sans aucune contextualisation ni modalisation, on finit par trouver ce que l’on veut chercher. Lorsque l’on teste, avec ce même algorithme, les pièces d’un auteur dramatique de la même période, Dancourt, le résultat est étonnamment le même : ses œuvres sont attribuables à Corneille. Évidemment, la réfutation est moins vendeuse, et les médias préfèrent faire leurs gros titres sur une prétendue « imposture Molière »…
Ce qui est important selon moi, c’est de se pencher sur l’incompréhension derrière l’argument de la proximité textuelle – qui était déjà celle de Pierre Louÿs. Elle passe en effet à côté de l’essentiel : la plupart de ces procédés sont extrêmement courants à l’époque. Elle néglige ne tout ce qui relève de la pratique normale de l’alexandrin. Le « je » à la septième syllabe se retrouve chez de très nombreux auteurs. De la même manière, l’emploi de certains termes dans une acception qui peut sembler singulière, comme « hymen » pour « mariage », est tout à fait commun au Grand Siècle…
Il s’agit donc moins d’un procédé malhonnête que d’une incompréhension sincère ?
Dans le cas de Pierre Louÿs, tout à fait. Le crédit qu’il accorde à sa propre théorie nous renseigne d’ailleurs sur lui et sur sa propre vision de la littérature. Il lit Molière et Corneille à la manière romantique, s’étonne de certaines choses et oublie d’en relever d’autres… Il passe ainsi à côté de ce qui fait la spécificité de ces deux grands auteurs, en calquant ses propres conceptions esthétiques sur des textes qui répondent à d’autres logiques.
Pour Pierre Louÿs, comme sans doute pour bien d’autres personnes qui aiment croire au « complot Molière », la littérature est la vie. L’œuvre reflète le vécu de celui qui l’a écrite. L’inspiration vient de l’expérience. Il y aurait toujours du « je » dans tout écrit littéraire. C’est la raison pour laquelle Pierre Louÿs ne conçoit pas une seconde que l’idée des Maures remontant le fleuve, dans Le Cid, puisse avoir été puisée par Corneille dans des sources historiques, ou tout simplement dans son imagination. Non, pour lui, cette scène doit provenir d’un phénomène que le dramaturge aurait lui-même observé, en l’occurrence lors du blocus anglais de la Seine…
Cette approche est à l’origine de bien des malentendus dans l’histoire littéraire, et Molière, au-delà de la théorie selon laquelle il n’aurait pas écrit ses pièces, en a particulièrement fait les frais. C’est le « syndrome de Démodocos », cet aède aveugle qui apparaît dans l’Odyssée et dans lequel la postérité a vu la preuve de la cécité d’Homère lui-même – alors même que rien d’autre n’indique qu’Homère ait été aveugle ! De la même manière, on a voulu croire que Molière était misanthrope, puisqu’il avait écrit Le Misanthrope. S’il a écrit sur la jalousie amoureuse, c’est qu’Armande Béjart, comédienne et coquette de surcroît, devait le tromper…
C’est une tendance assez naturelle, chez de nombreux lecteurs, de vouloir trouver une grande parenté entre l’œuvre et son auteur…
Tout à fait, et c’est la raison pour laquelle le rôle de la recherche est de se détacher de ces modes de lecture, de ces engouements passagers. L’étude attentive des textes et de leur généalogie permet d’éviter des confusions grossières.
Lorsque l’on dit que Molière devait être misanthrope car il a écrit Le Misanthrope, on néglige des éléments essentiels que l’histoire littéraire a pourtant très bien établis. Le titre de la pièce a été choisi de manière bien postérieure. Molière a dans un premier temps écrit un « Atrabilaire amoureux » – un titre qui dit bien autre chose. Le titre que nous connaissons aujourd’hui a été choisi plus tard, pour créer une continuité avec ces grands défauts qui avaient donné leur nom aux pièces précédentes : Le Tartuffe, L’Avare…
Cela étant dit, il faut dire que dans le cas de Molière, cette tendance à assimiler la vie de l’auteur à son œuvre est ancienne. À peine une trentaine d’années après sa mort, Grimarest lui consacre une importante biographie, qui va durablement contribuer à fixer l’image que nous en avons encore aujourd’hui, et qui recourt en grande partie à ces procédés. Or l’écriture biographique à l’époque ne répondait pas aux mêmes exigences. On recourait volontiers à la glorification ou au dénigrement, en saupoudrant le tout d’anecdotes véridiques… Grimarest est une source à manier avec prudence. Certains contemporains en avaient déjà amplement conscience, parmi lesquels Boileau, qui disait de la biographie de Molière : « Ce livre ne vaut même pas la peine qu’on en parle. »
Qu’est-ce qui explique le succès durable de ces théories ?
Je crois qu’elles reposent sur des mécanismes efficaces, rappelant par certains aspects ceux des « théories du complot », à commencer par leur caractère très simple. Elles apportent une explication facile, généralement monocausale et capable de tout expliquer, de combler tous les trous et de résoudre toutes les contradictions apparentes. Il y a des centaines de sujets d’étude passionnants au sujet de Molière. La réponse la plus radicale à y apporter, c’est au fond de dire « Molière n’a de toute façon pas écrit ses pièces ». Ironiquement, cela ne fait que déplacer le problème…
Autre mécanisme intéressant : tout part d’un doute premier. Un fait qui est jugé « peu crédible », et qui remet en cause tout le reste, par effet de chaîne. Dans le cas de Molière, c’est la basse condition de ce comédien, fils de drapier, qui sert de remise en cause à tout le reste. Comment aurait-il pu, à trente ans passés, devenir un grand dramaturge ? Il est intéressant de noter qu’il existe un parallèle assez fort avec Shakespeare, dont le père était gantier.
Il existe d’autres parallèles entre le cas Molière et les « théories du complot », comme le caractère transgressif d’une vérité cachée, dont la révélation met à mal une figure sacrée. S’en prendre à Molière a quelque chose de sulfureux et d’attirant, puisque l’on remet en question un certain ordre établi, un mythe autour duquel s’est construit une certaine grandeur des lettres française. Autre caractéristique intéressante : le recours à une prétendue scientificité, qui vise à apporter la démonstration rationnelle d’une théorie non scientifique. Tout cela est en grande partie permis par la rareté des sources premières, qui ouvre la porte à tous les raisonnements par l’absurde.
Nous ne possédons aucune source première au sujet de Molière ?
Nous n’avons rien conservé de Molière. Ni lettre, ni manuscrit. Il n’en faut pas plus pour que certains en viennent à douter. Pourtant, là encore, la connaissance du contexte historique nous apporte des réponses précieuses. Il n’était pas d’usage, au XVIIe siècle, de conserver les manuscrits une fois l’œuvre imprimée.
Une comparaison avec Racine s’impose. Nous savons que celui-ci a écrit entre 30 000 et 40 000 lettres. C’est une correspondance considérable dont nous ne conservons qu’environ 200 lettres… et ce alors même que ses héritiers directs, ses deux fils, se sont attachés à conserver autant de manuscrits que possible, admiratifs qu’ils étaient de leur père. Nous ne possédons plus qu’un seul manuscrit de pièce de Racine, l’ébauche d’un Iphigénie en Tauride.
Dans le cas de Molière, il faut s’imaginer que le nombre de manuscrits initial est bien inférieur… et que celui-ci n’a eu qu’un enfant, une fille, qui s’est tournée vers la religion en rejetant le théâtre. La probabilité de conservation des écrits est malheureusement très faible. Lorsque son épouse se remariera à Guérin, elle donnera à ce dernier un fils, qui se piquera lui aussi de théâtre. En quête d’une trame, il dira avoir cherché dans les papiers de Molière, sans rien y trouver d’inspirant. Il existait donc bien des documents.
N’est-ce pas aussi l’évolution des mises en scène qui contribue à nous éloigner avec le temps du « vrai Molière » ?
Chacun est libre de faire ce qu’il veut des pièces de Molière, dans leur interprétation comme dans leur mise en scène, et c’est très bien ainsi ! Mais il y a un point essentiel selon moi : quoi que vous fassiez, sachiez d’où cela vient. Sachez ce qu’est le texte, ce qu’il dit. Sachez quelle est son origine. Cela évitera des contre-sens terribles et des innovations sans doute originales, mais dénuées de tout fondement.
Pendant plusieurs décennies, des générations de spectateurs se sont ennuyés au théâtre, avec des mises en scènes sans relief, qui s’enfonçaient dans la reproduction de ce qui avait déjà été fait, sans réflexion quant au texte. À l’inverse, la tendance consistant à vouloir à tout prix dépoussiérer le texte, à vouloir le réactualiser en lui appliquant les formes contemporaines, à vouloir à tout prix en montrer la « brûlante actualité », ne me paraît pas beaucoup plus féconde. Il se créer une distorsion entre ce que l’on entend ou ce que l’on voit d’un côté… et ce que dit véritablement le texte de l’autre.
Pour ma part, la découverte d’Eugène Green et de ses recherches sur la déclamation ont été une véritable révélation. J’avais l’impression de voir ce que je n’avais jamais vu avec les mises en scène contemporaines, qui plaquent un jeu actuel sur un texte qui ne s’y prête pas. Ce retour aux sources de l’interprétation, de la diction… Pour la première fois, le texte ressortait dans toute sa richesse. Les mots prenaient la résonance pour laquelle ils ont été écrits. Aujourd’hui, ce travail vit notamment avec la troupe Théâtre Molière Sorbonne, grâce à laquelle des étudiants comédiens s’appliquent à reproduire les costumes, les décors, la gestuelle, ou encore la diction de l’époque. C’est un travail à la fois littéraire, dramatique et scientifique passionnant – pas parce qu’il « revient aux sources », mais précisément parce qu’il donne à voir et à entendre ce qui confère aux grandes œuvres, y compris pour le spectateur contemporain, son universalité.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.