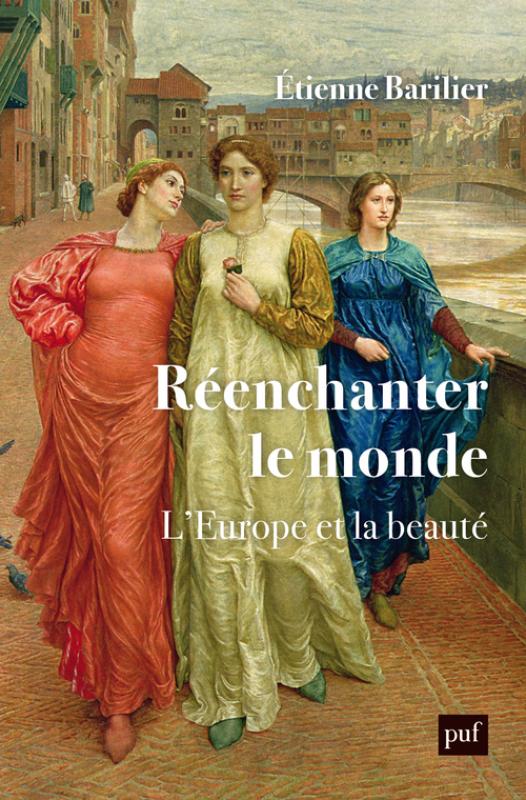L’écrivain et philosophe suisse Étienne Barilier publie Réenchanter le monde. L’Europe et la beauté (PUF), un essai remarquable qui interroge avec érudition et finesse la triple identité du Beau, du Bien et du Vrai héritée de Platon. Occasion de revisiter les grandes œuvres de la culture européenne, de Dante à Céline en passant par Claude Lorrain ou Wagner, à partir d’une problématique particulièrement stimulante : ce qui est Beau fait-il nécessairement signe vers le Bien ou le Vrai ?
PHILITT : À quel moment la civilisation européenne a-t-elle commencé à remettre en question la triple identité platonicienne du Beau, du Bien et du Vrai ?
Étienne Barilier : Cette mise en question survient certainement chez Platon lui-même, c’est-à-dire dès lors que l’identité (ou du moins la fraternité) de ces trois Idées est posée. Donner des noms différents au Bien, au Beau, au Vrai, c’est les distinguer dans le geste même de postuler leur union. Trois n’est pas un. Le Socrate du Banquet de Platon, en désignant le Beau comme l’Idée la plus immédiatement sensible, le distingue ipso facto du Bien et du Vrai. Il ouvre ainsi la voie à la question de leur identité, ou de leur différence. On pourrait dire en d’autres mots que la civilisation européenne a fait du Beau une Idée (même si c’est, sans jeu de mots, une Idée lumineuse) puis un concept, qui forcément se distingue des concepts voisins, celui du Vrai, celui du Bien.
Au contraire, pourquoi les cultures musulmanes et bouddhiques doutent-elles moins de cette équivalence ?
Parce qu’elles n’ont pas posé cette trinité conceptuelle. Ou pour mieux dire, parce qu’elles n’ont pas fait du Beau un concept. Elles ne l’ont pas abstrait. J’ai été frappé, à cet égard, par un exemple que je ne cite pas dans mon livre, mais que je peux donner ici, même s’il ne concerne pas directement le mot « Beau ». Il s’agit de la traduction arabe d’un mot important s’il en est dans la philosophie grecque puis occidentale, le mot οὐσία (ousia, devenu essentia en latin, puis essence en français). Or ce même mot d’οὐσία fut traduit en arabe par jawhar : littéralement « joyau », « pierre précieuse ». C’est magnifique, et révélateur : d’une certaine manière la langue arabe répudie l’abstraction philosophique, au profit d’une approche poétique du monde. S’agissant du Beau lui-même, la pensée des mystiques musulmans affirme que Dieu est beau, ce qui signifie immédiatement que le Bien et le Vrai sont Beaux. On n’a pas à distinguer ce qui est un en Dieu.
Du côté de l’Extrême-Orient, je me suis appuyé sur les réflexions de François Jullien, qui affirme que l’association beauté-bonté n’est qu’un « piège platonicien » dans lequel les penseurs chinois ou japonais d’aujourd’hui se croient tenus de tomber, alors que leur propre tradition ne joue pas avec ces Idées. Mais c’est surtout ma lecture des grands romanciers japonais qui m’a suggéré la toute-puissance muette de la Beauté, en deçà ou au-delà de tout concept qui permettrait de l’articuler au Bien ou au Vrai. Bien sûr, tout cela devrait être nuancé de mille manières, mais on ne peut nier, il me semble, que la trinité conceptuelle Beau-Bien-Vrai demeure propre à l’Occident.
L’éclatement de la triade platonicienne aboutit selon vous au désenchantement du monde. Comment se manifeste ce dernier ?
Si le Beau est complètement détaché du Bien et du Vrai, il procure tout au plus un plaisir esthétique, et l’art ne peut plus prétendre à dire le réel dans sa plénitude. Durant des siècles, l’Europe platonicienne a médité sur l’union ou la désunion de la « trinité » Beau-Bien-Vrai, mais c’est seulement dans la modernité qu’elle a cessé de croire à cette trinité. Les deux guerres mondiales sont sans doute largement responsables de ce désenchantement. La figure du nazi amateur de Mozart et de Schubert est à cet égard emblématique : qu’est-ce que l’art, qu’est-ce que la beauté, s’ils sont incapables de contenir l’horreur, et si le culte du beau peut cohabiter avec l’inhumanité ? Il est vrai que cette question ne fait que porter à l’incandescence une interrogation qui a traversé toute l’histoire européenne. Mais la différence est qu’on lui a donné, au XXe siècle, la plus tranchée et la plus sinistre des réponses (qui, je l’espère, n’est pas définitive) : l’art n’est rien, le beau n’est rien s’ils sont impuissants devant l’inhumain.
Vous faites de l’Acis et Galatée de Claude Lorrain un tableau emblématique du désenchantement du monde, notamment en vous appuyant sur des analyses de Dostoïevski. Pourquoi cette œuvre éclaire-t-elle selon vous la problématique du livre ?
Ce qui m’a d’abord frappé, c’est à quel point ce tableau, et plus largement l’œuvre de Claude Lorrain, illustre ou plutôt incarne, pour de grands penseurs et de grands artistes (Dostoïevski, mais aussi Goethe, Nietzsche… et Céline), un monde parfait, un Éden, un âge d’or trop beau pour être vrai, et dont on ressent la merveille, la perte ou le mensonge. Chez Dostoïevski, les personnages de Stavroguine ou de Versilov déplorent la disparition irrémédiable de cette innocence heureuse. C’est un paradis qui leur révèle leur enfer. De son côté, et paradoxalement, Nietzsche ressent Claude Lorrain comme celui qui révèle la beauté du monde réel, révélation si douloureuse qu’elle le fait sangloter. Mais en somme, Acis et Galatée ouvre un monde aussi inaccessible à Nietzsche qu’aux personnages de Dostoïevski. Quant à Céline, il dénonce le mensonge de ce monde édénique, ce qui est une autre manière de constater qu’on ne peut l’atteindre en réalité.
Vous consacrez un chapitre aux « beautés du diable », des figures féminines qui allient un charme physique certain et une âme maléfique (la Marianne Charpillon de Casanova, la duchesse de Langeais de Balzac, la Milady de Dumas). Associer ainsi la beauté des femmes et le mal est-il quelque chose de révolutionnaire dans l’art ?
Ce n’est pas d’aujourd’hui ni même d’hier qu’on trouve dans la littérature des exemples de femmes belles et mauvaises, redoutables à cause des pouvoirs que leur beauté leur donne sur les hommes. À cet égard, je mentionne le personnage de la fée Alcina chez l’Arioste. Alcina est le parangon de la femme belle et diabolique. Ce qui est remarquable, c’est que l’Arioste sauve, in fine, l’identité Beau-Bien, tout simplement en nous apprenant qu’Alcina, en réalité, est une horrible vieille femme, qui se fait passer pour belle à coups de sortilèges. Autrement dit, le mal n’est qu’apparemment lié au beau, il ne l’est pas essentiellement.
Mais la littérature ne s’en tient pas toujours à ce genre de solution miraculeuse. La Milady de Dumas est irrémédiablement mauvaise, quoique belle. La duchesse de Langeais est un personnage complexe, qui, visitée par l’amour, renonce à sa méchanceté, mais in extremis. Plus terrible est le cas de la belle inconnue dont tombe amoureux, dans La Perspective Nevski de Gogol, le jeune peintre Piskariov : elle est d’une beauté sublime, et c’est une prostituée cruelle, qui se moque de son soupirant idéaliste et le pousse au suicide. Pas de happy end. Dans le cas de la Charpillon de Casanova, qui n’est pas une fiction, la beauté reste indissociable du mal.
Le thème de la beauté méchante est presque banal dans la littérature, mais ce qui me paraît intéressant, c’est la façon dont il est traité ; c’est l’interrogation qu’il suscite, un peu comme fait l’univers de Claude Lorrain : comment cela est-il possible ? La beauté est-elle vraiment totalement indépendante du bien et du vrai, au point d’en devenir le contraire ? Si mensonge il y a, où est-il ? Dans la beauté même ou dans l’être qui s’en fait une arme ?

Vous consacrez des pages passionnantes à Céline et Wagner et refusez la séparation entre « l’artiste génial » d’un côté et « l’homme méchant » de l’autre. Vous estimez plutôt que l’ambiguïté fondamentale de ces artistes est à chercher dans leur œuvre et, en particulier, dans leur conception de la beauté. Pouvez-vous revenir sur ce point ?
J’essaie en effet de suggérer que c’est dans l’œuvre même que sont présentes les forces négatives. Soit la beauté est indissociable de la mort (chez Céline), soit elle est un instrument du pouvoir (chez Wagner). Je simplifie, bien sûr… Mais on comprend que Thomas Mann ait pu écrire qu’il décelait un élément nazi non seulement dans les écrits de Wagner, mais aussi dans sa musique. Or si cela est possible, c’est que cette musique exerce une manière d’envoûtement, d’emprise sur les âmes et les esprits. Ce magicien qu’est le compositeur de Parsifal prend ainsi possession des auditeurs, pour le meilleur et pour le pire. Quand Baudelaire confesse avoir été « vaincu » par la musique de Wagner, il ne s’avise pas que la musique n’est pas faite pour « vaincre », mais que si elle emporte l’âme, elle ne cesse pas pour autant (ou ne devrait pas cesser) de garder l’esprit dans le plus haut éveil.
Quant à Céline, fervent amant de la beauté, je tente de montrer que cette beauté, chez lui, est toujours associée au désir de mort, y compris et surtout lorsqu’il décrit de sublimes danseuses éthérées. Céline dit et répète son désir de mourir de beauté. Mais justement, c’est la mort, et non la beauté, qui prévaut dans son œuvre. « Je veux périr par la plus belle », s’écrie-t-il. Or la plus belle, qui est porteuse de mort, est elle-même vouée à la mort. La Virginie de Guignol’s Band, source d’extases dansantes pour Ferdinand, aura le sort le plus terrible. Même certaines pages de Bagatelles pour un massacre sont capables de nous ravir de beauté, mais elles révèlent derrière cette beauté, pour ne pas dire en elle, l’horreur de la mort. Elles sont l’Alcina de l’Arioste.
De quelle manière les artistes modernistes ont-ils redéfini la notion de Beau au début du XXe siècle ? Et pourquoi Picasso, malgré certaines prises de position, n’a-t-il pas réussi à s’en affranchir ?
Ce qui m’a vivement frappé, c’est à quel point le mot de beauté, et sa notion, restent présents chez les grands artistes du XXe siècle. Ils veulent, explicitement ou non, les redéfinir, mais ils ne veulent pas l’abandonner. Et si l’on va voir du côté des grands abstraits, Kandinsky, Mondrian, Malevitch, ils y recourent tous les trois. Chez Kandinsky, le mot et le concept sont absolument centraux. Toute la question sera pour eux d’intérioriser en quelque sorte la beauté, d’en faire la reine d’un monde intérieur et non plus la mimésis du monde naturel. Plus près de nous, un Francis Bacon ou un Mark Rothko ne renient pas non plus l’idée de beauté.
Mais évidemment, dès lors que l’art s’abstrait du monde extérieur, ou du moins soumet ce monde à une vision subjective qui le déforme et le reforme (le cubisme, Picasso…), se pose la question de l’universalité de cette beauté, et de son lien avec notre expérience du monde naturel. À cet égard, la réflexion de Malraux est essentielle mais discutable. Il affirme en substance que la modernité a quitté le monde de l’« illusion », c’est-à-dire d’une ressemblance simpliste avec le monde extérieur, pour devenir création plus pure. Ainsi le Manet de l’Olympia n’aurait pas voulu peindre de la chair mais peindre un tableau, et la vraie métamorphose de la modernité se serait produite au moment où « l’art n’eut plus d’autre fin que lui-même ». Or il me semble que cette vision de Malraux, si elle saisit à coup sûr un aspect essentiel de la modernité, confond trop vite la mimésis avec l’illusion et fait bon marché du rapport qu’une œuvre d’art entretient avec notre expérience du monde naturel, des êtres et des choses. Que nous importe un art qui n’a « d’autre fin que lui-même » ?
Vous dites ne pas rêver d’une « callocratie » (littéralement le pouvoir du beau). Mais dans quelle mesure la beauté a-t-elle un rôle politique à jouer ?
Un rôle politique ? Pourquoi pas, mais au sens le plus large de ce terme : un rôle dans la conscience que la collectivité prend d’elle-même, au miroir de ses œuvres. Je crois que le grand art parle de l’humain, tout simplement, et que rien de ce qui est humain, voire inhumain, ne lui est étranger. Je l’ai suggéré par l’exemple, vraiment extraordinaire, de deux très grands témoins des horreurs du XXe siècle, Vassily Grossman et Varlam Chalamov, et de leur réaction devant la Madone Sixtine de Raphaël. Ce tableau d’une Vierge à l’Enfant leur parle de Stalingrad et des camps de la mort. Ils y voient, non point en beauté seulement, mais aussi en vérité, la souffrance humaine et l’espérance humaine. Ce n’est pas que la beauté ait pris le pouvoir, c’est que, comme elle a toujours fait, elle nous révèle à nous-mêmes.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.