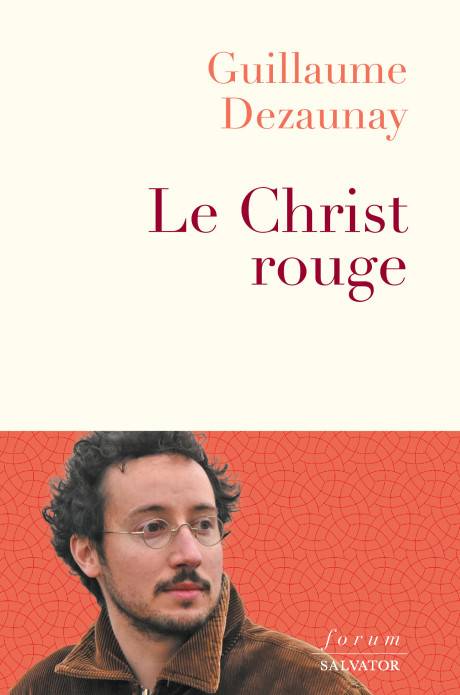Le philosophe Guillaume Dezaunay publie Le Christ rouge (Salvator), un essai qui fonde l’anticapitalisme sur l’interprétation des Saintes Écritures et des textes traditionnels des Pères et Docteurs de l’Église. La spiritualité chrétienne s’y laisse découvrir, en amont de ses concessions mondaines, comme une spiritualité de la désappropriation et de la mise en commun, qui incite à convertir notre modèle de la propriété privée et de l’accaparement au modèle, visible dans la vie des saints, de l’intendance et du partage.
PHILITT : Votre prière terminale au « Christ rouge », qui donne à votre livre son titre, évoque les représentations révolutionnaires du Christo de Los Pobres de l’ancien président vénézuélien, Hugo Chavez, brandie par les militants de la Faucille et de la Croix. Votre démarche s’inscrit-elle dans le courant de la théologie de la Libération née en Amérique latine ?
Guillaume Dezaunay : Si je pouvais participer, à ma modeste échelle, à construire une théologie de la libération « à la française », conforme aux exigences et aux conditions de notre époque et de notre culture, j’en serais certes ravi. J’aime particulièrement le fait que la théologie de la libération est née d’une méditation collective des chrétiens ordinaires, qui cherchaient à lire et à interpréter les textes évangéliques à la lumière de leurs besoins présents. En effet, la véritable signification de l’Incarnation, qui est un événement temporel, est historique. Incarner le Christ, être imitateur de Jésus, ce n’est pas parler l’araméen, se vêtir à la manière de Jésus et porter sa barbe : c’est méditer la manière avec laquelle le Verbe parle à la présente époque, dans le cœur de tous les chrétiens. En revanche, puisque vous parlez de « la Faucille et de la Croix », ma réserve est que la théologie de la libération a parfois servi à justifier la violence révolutionnaire, ce qui n’est nullement la direction que je souhaite suivre. Je préfère m’en tenir à la position de l’un des plus éminents représentants de la théologie de la libération, Mgr Óscar Romero, qui condamnait l’ensemble des violences, non seulement révolutionnaires, mais aussi non-révolutionnaires, qui précèdent en réalité la colère des petites gens. La démarche révolutionnaire non-violente consiste à suivre une voie étroite, celle d’une lutte contre les causes de l’oppression sociale, qui implique de s’opposer à ceux qui mésusent de leur pouvoir politique et financier, sans sombrer pour autant dans la haine des ennemis et l’utilisation de moyens en contradiction avec la fin poursuivie.
Péguy disait que « la révolution sociale sera morale ou ne sera pas ». Pour vous, quelle est la force propre à la religion dans la lutte sociale ?
Je suis convaincu, avec Marcello Tarì, qu’une révolution des structures sociales qui ne s’accompagne pas d’une révolution intérieure ne peut qu’échouer, car les structures de domination ne peuvent que se rétablir comme elles étaient après la phase révolutionnaire si celle-ci ne s’est pas accompagnée d’une profonde transformation des consciences. Si j’essaie de proposer une lecture politique de l’Évangile, ce n’est pas pour nier mais pour affirmer, dans l’ordre politique, cette vérité fondamentale que tout part du cœur humain, qu’il est la racine du bien comme du mal. Il faut comprendre que la vie intérieure est une composante essentielle de toute politique sociale, car la lutte contre l’appropriation implique aussi de lutter contre ses propres tendances appropriatives, qui se développent dès l’enfance. Par ailleurs, outre ce critère de transformation intérieure que permet la religion dans sa dimension spirituelle, j’ajoute que son bénéfice est d’apporter de l’espérance et de la joie à ceux qui luttent : face à l’ampleur des injustices, les militants peuvent être découragés et finir par épuisement à s’enfermer dans une attitude de haine totale qui ne permet pas de discerner clairement les enjeux du problème auquel on est confronté et de construire quoi que ce soit durablement.
Vous défendez un effort spirituel contre notre tendance à vouloir nous approprier égoïstement les biens. Pourtant, une éminente philosophe du courant anarcho-syndicaliste, Simone Weil, explique dans L’Enracinement que « la propriété est un besoin vital de l’âme » : « l’âme est isolée, perdue, si elle n’est pas dans un entourage d’objets qui soient pour elle comme un prolongement du corps. » L’appropriation n’est-elle pas naturelle à l’homme, dissociable de l’accaparement ?
Simone Weil justifiait la propriété privée pour préserver la pensée sociale des dangers dans lesquels tombaient la Russie soviétique dont elle était contemporaine : l’État totalitaire s’appropriait tout, jusqu’aux consciences, et ne laissait pas d’espace pour respirer. Par ailleurs, sa conception anarchiste de la politique lui faisait reconnaître à l’individu une dignité supérieure et irremplaçable par rapport à la collectivité. Quant à ce qui concerne la propriété, il faut distinguer deux choses. Tous les êtres humains ont, à peu près, les mêmes besoins fondamentaux, et parmi ces besoins se trouve la nécessité de se loger, se nourrir avec des aliments de bonne qualité, de se chauffer correctement. Là où la propriété devient illégitime et aliénante, c’est lorsque la propriété dépasse largement les besoins humains. L’appropriation devient un accaparement lorsqu’elle s’étend en particulier aux moyens de production, puisque la vie collective est alors engagée. À ce niveau, ce sont les riches eux-mêmes qui volent le droit à la propriété des plus pauvres, comme l’expliquent les Pères de l’Église.
Quelle critique formule la patristique à l’égard de cette autonomisation de la propriété privée par rapport à la propriété collective, pour reprendre une distinction chère à Simone Weil ?
La pensée sociale des Pères de l’Église a une radicalité qui ne peut que nous faire pâlir devant la tiédeur de notre rapport aux plus démunis. Ces théoriciens et praticiens de la spiritualité du Christ, aux premiers siècles de l’ère chrétienne, enseignaient qu’un nécessiteux volant un riche ne fait que récupérer son dû. Par exemple, « ne pas partager nos biens avec les pauvres, c’est les leur voler et les priver de vie », enseigne saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Au Moyen Âge aussi, saint Thomas d’Aquin reprend leur enseignement : il estime que, dans la mesure où « les biens que certains possèdent en surabondance sont dus, de droit naturel, à l’alimentation des pauvres », alors, « si la nécessité est tellement urgente et évidente que manifestement il faille secourir ce besoin pressant avec les biens que l’on rencontre […], alors quelqu’un peut licitement subvenir à sa propre nécessité avec le bien d’autrui. » Il n’y a alors « ni vol ni rapine à proprement parler » lorsqu’un miséreux vole pour survivre (Somme Théologique, III, q. 66, a. 7, resp.). En effet, tout ce que nous avons, nous l’avons reçu, de sorte que la circulation des dons devrait être normale dans la collectivité dans laquelle a lieu les échanges. C’est ce que rappelle le principe de la « destination universelle des biens » dans la Doctrine sociale de l’Église. Les pauvres devraient pouvoir être propriétaires de ce qui est nécessaire à leurs besoins. La petite propriété n’est pas contraire à la moralité, l’injustice commence lorsqu’on garde pour soi trop de richesses qui sont censées être destinées universellement à tous nos frères.
On pourrait pourtant vous objecter que dans l’Évangile, Jésus semble nous mettre en garde contre une forme de réductionnisme humanitaire de la charité : « Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours » (Marc XIV, 7, Jean XII, 8). Judas n’a-t-il pas choisi de trahir Jésus après l’avoir vu être recouvert par Marie Madeleine d’un parfum luxueux, qu’il aurait préféré vendre pour en reverser les bénéfices aux pauvres (Jean XII, 1-8) ?
Il y a deux interprétations possibles de ce verset. La première, selon laquelle la lutte contre la misère serait secondaire, me semble doublement fausse. D’une part, parce que la vraie raison de l’indignation de Jean nous est donnée dans le verset 6 : « En réalité, Judas ne se souciait pas des pauvres, mais il volait ; comme il portait la bourse du groupe, tout ce qu’on y mettait passait par ses mains. » Judas ne trahit pas à cause de sa générosité à l’égard des nécessiteux, mais à cause de ses velléités d’accaparement. C’est pourquoi, d’autre part, il faut comparer le verset que vous citez à la parabole du bon grain et de l’ivraie, qui en éclaire le sens : le Grand Soir qui balayera d’un coup toutes les injustices n’aura pas lieu, il y aura toujours quelque chose de tragique dans la vie et le monde social que les actions humanitaires, aussi durables soient-elles, n’effaceront jamais. Enfin, ce verset nous apprend qu’un certain détachement vis-à-vis de la richesse peut permettre davantage de libéralité dans l’usage des biens. Comme en de très nombreux endroits des Évangiles, Jésus cherche à nous libérer de la logique calculatoire : tout en justifiant la distribution équitable et précise des richesses dans sa parabole de l’ouvrier de la onzième heure (Matthieu XX, 1-16), il relativise aussi la nécessité des « bons comptes » en nous rappelant, dans cet épisode du parfum d’albâtre que vous citez, que le souci de redistribution ne doit pas nous interdire, quand l’occasion se présente, de faire preuve de générosité à l’égard de notre prochain, qui est un visage du Christ (Proverbes XIV, 31 ; Matthieu XXV, 45).
On reproche parfois à la nouvelle pastorale d’insister sur les enjeux humanitaires au détriment du discours sur les fins dernières : péché, Enfer, annonce du Royaume. Or, vous mentionnez dans votre livre la théorie des « structures sociales du péché » formulée par le pape Jean-Paul II, de sorte que le capitalisme doit raisonnablement être considéré comme étant l’une des principales matrices sociales du péché. Dans ces conditions, ne devrait-on pas enseigner aux fidèles, par exemple, que l’investissement dans des banques financées sur les énergies fossiles, le tabac, la pornographie et l’industrie de guerre, est un péché mortel ?
Je fais un constat inverse : l’Église n’enseigne pas assez aux fidèles les motifs et les urgences de l’action sociale. J’ai le sentiment que beaucoup de ces catholiques embourgeoisés qui estiment que le discours humanitaire prend trop de place dans les sermons, le font pour cacher leur tiédeur et leur manque de charité. Pour le reste, je suis un peu dubitatif sur le discours relatif au péché et aux fins dernières, dans le sens où il a souvent été utilisé de manière plus religieuse que spirituelle, pour affermir le pouvoir ecclésial sur les personnes. Cela a été tellement détourné que pour la plupart des gens, la notion de péché revêt une signification exclusivement sexuelle. Le sens premier du péché, en réalité, est au fond celui de « mauvaise habitude », par laquelle l’individu s’enferme dans le mal et ne parvient ensuite plus à s’en sortir ; et il est vrai qu’il y a de mauvaises habitudes sociales. Pour cette raison, j’admets qu’il serait intéressant de réemployer ces notions, d’en revisiter la pertinence et l’efficacité, à condition de toujours les interpréter spirituellement et de les incarner dans le temps présent. On pourrait, à ce titre, parler de péchés sociaux et de fautes contre la charité à des niveaux politiques.
Quel est votre avis sur l’engagement politique de l’actuel Pape François, de sa première encyclique jusqu’à sa dernière exhortation apostolique Laudate Deum sur « la crise climatique » ?
J’apprécie la manière avec laquelle l’encyclique Laudati si’ (du 24 mai 2015) commence en s’incarnant dans les coordonnées du temps présent, en prenant d’abord appui sur les données scientifiques pour ne passer que dans un second temps à l’interprétation des textes. L’herméneutique biblique doit se déployer à partir de la réalité vécue. En revanche, je regrette que la seconde encyclique, Fratelli tutti (3 octobre 2020), malgré une très bonne interprétation de la parabole évangélique du bon Samaritain, reliant charité interpersonnelle et justice structurelle, se limite plus à des intuitions qu’à une véritable élaboration théorique. Je regrette que nous n’ayons pas, pour notre temps, un texte aussi exhaustif et théoriquement structuré que le texte fondateur de la doctrine sociale de l’Église, l’Encyclique Rerum novarum du pape Léon XIII (15 mai 1891). Son actualisation n’est pourtant pas une impossibilité, puisque cette encyclique a bien été mise à jour quarante ans après par l’Encyclique Quadragesimo anno du pape Pie XI (15 mai 1931), qui mêle à la fois des critiques très fermes contre le fascisme, le communisme soviétique et le capitalisme. Je pense pour ma part qu’il faut aller encore plus loin dans la critique du capitalisme, en ne nous contentant pas de dénoncer le capitalisme outrancier et néolibéral, mais en portant la critique jusque dans ce qui fonde le système capitaliste lui-même. Je souhaite que l’Église radicalise sa critique en proposant comme alternative une décroissance forte et une démocratie radicale fondée, non sur le seul système électoral actuel qui est défaillant, mais sur le discernement collectif. À ce titre, j’apprécie tout particulièrement l’esprit synodal défendu par le pape François, qui met en œuvre des initiatives destinées à faire émerger les orientations ecclésiales, non seulement des clercs, mais des fidèles eux-mêmes, en prenant pour point de départ le discernement autonome des pauvres et des petites gens.
À propos de la décroissance, vous citez le sermon 11 de Maître Eckhart qui enseigne que « tant que le “plus, toujours” est en toi, Dieu ne peut ni habiter ni opérer en toi », que l’on peut d’ailleurs associer à cette parole de saint Jean le Baptiste : « Il faut qu’Il croisse et que je diminue » (Jean III, 30). Néanmoins, ne pensez-vous pas qu’une décroissance économique pourrait entraîner une vaste paupérisation du peuple ? N’y a-t-il pas une incompatibilité entre la décroissance et l’amélioration des conditions matérielles des pauvres ?
Le lien entre l’Évangile et la décroissance est fort, en effet : il s’articule à une critique vigoureuse de l’illimitation, que l’on peut particulièrement vérifier dans la puissante parabole du riche qui veut détruire ses greniers pour en construire de plus grands afin de produire et d’amasser toujours plus de richesses (Luc XII, 16-21). Je pense que nous devons vraiment mettre en avant, en tant que chrétiens, cette critique décroissante. Maintenant, il faut bien sûr réfléchir à la forme de cette décroissance que nous pourrions mettre en œuvre. Si nous ne préparerons pas cette décroissance et que nous la laissons arriver comme une conséquence subie d’un effondrement économique (et écologique) que l’on peut très raisonnablement redouter, alors il est évident qu’elle s’accompagnera d’une violente paupérisation. Au contraire, les « décroissants » élaborent cette théorie, assurément complexe, pour réfléchir aux meilleures conditions possibles de sa mise en place. Pour prendre un exemple concret : nous utilisons beaucoup de machines qui consomment trop d’énergie. Il est par conséquent nécessaire d’en produire et d’en utiliser moins, mais on peut imaginer des manières de faire qui ne signifieraient pas un appauvrissement généralisé en la matière. Par exemple, on peut imaginer ici l’établissement de bibliothèques d’outils que l’on puisse emprunter plutôt que d’en acheter chacun individuellement : ce qui est déjà observable pour les machines à laver avec les laveries, pourrait s’étendre aux perceuses et à toutes les machines dont nous nous servons. Tous les besoins seraient satisfaits, avec moins de machines.
La décroissance doit donc se fonder sur le partage, qui signifie l’enrichissement mutuel. Au contraire, ce qui nous appauvrit, c’est la privatisation de tous les domaines de l’existence ainsi que les contraintes qui pèsent sur la possession des biens. Ivan Illich prend à ce sujet l’exemple de l’automobile : son expansion dans l’ensemble de la population a contraint tous les individus à travailler plus loin de chez eux, à se servir de la voiture pour subvenir à leurs nouveaux besoins économiques et, partant, à souffrir de nouvelles dépenses liées à l’achat et à l’entretien de leurs voitures, qu’ils doivent utiliser davantage encore pour aller travailler afin de rembourser le prêt contracté à l’achat de la voiture. Le « modèle » capitaliste de la croissance et de la privatisation du monde nous a enfermé dans un cercle vicieux à tous les niveaux : économique, écologique et politique, dont on ne peut sortir qu’en optant pour la décroissance, le partage, l’économie circulaire, la coopération et la promotion de la valeur d’usage.
Pour lutter contre le capitalisme et ses logiques d’accaparement, l’Église n’a-t-elle pas intérêt à revaloriser le rôle de la liturgie, afin de nous détourner de l’appétit pour les choses matérielles, que René Guénon appelait un « matérialisme pratique », et de réorienter ainsi notre regard vers les choses spirituelles, qui ne se comptent ni ne se pèsent, qui ne s’achètent ni ne se vendent ?
Je ne nie pas le rôle important que la liturgie peut jouer dans l’édification de la charité, mais je ne poserais pas le problème dans les mêmes termes que vous. En effet, je crois qu’il ne faut surtout pas séparer l’esprit de la matière. Il y a un bon et un mauvais matérialisme : le bon matérialisme est celui qui s’intéresse aux conditions matérielles de vie de tous et en particulier des plus pauvres. La spiritualité consiste précisément dans la mise en pratique de ce matérialisme moral et charitable. Quant au mauvais matérialisme, effectivement, c’est cet appétit immoral pour l’accaparement des biens pour soi à l’exclusion des autres. Dans ces conditions, à mes yeux, une spiritualité qui s’éloignerait de la matière pour, métaphoriquement, quitter le sol où nous vivons comme l’encens qui s’élève dans les hauteurs de la nef, serait une fausse spiritualité. C’est pourquoi, je me mets plutôt à l’école de la mystique et assistante sociale Madeleine Delbrêl, qui raconte magnifiquement combien la parole de Dieu peut surgir de nulle part, comme « le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va » (Jean III, 8). Par exemple, témoigne-t-elle, l’Esprit de Dieu peut apparaître dans un simple café à Ivry, le café Le Clair de Lune : dans cet endroit populaire, Madeleine narre comment de simples rencontres et de simples conversations peuvent être l’occasion du surgissement de l’essentiel.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.