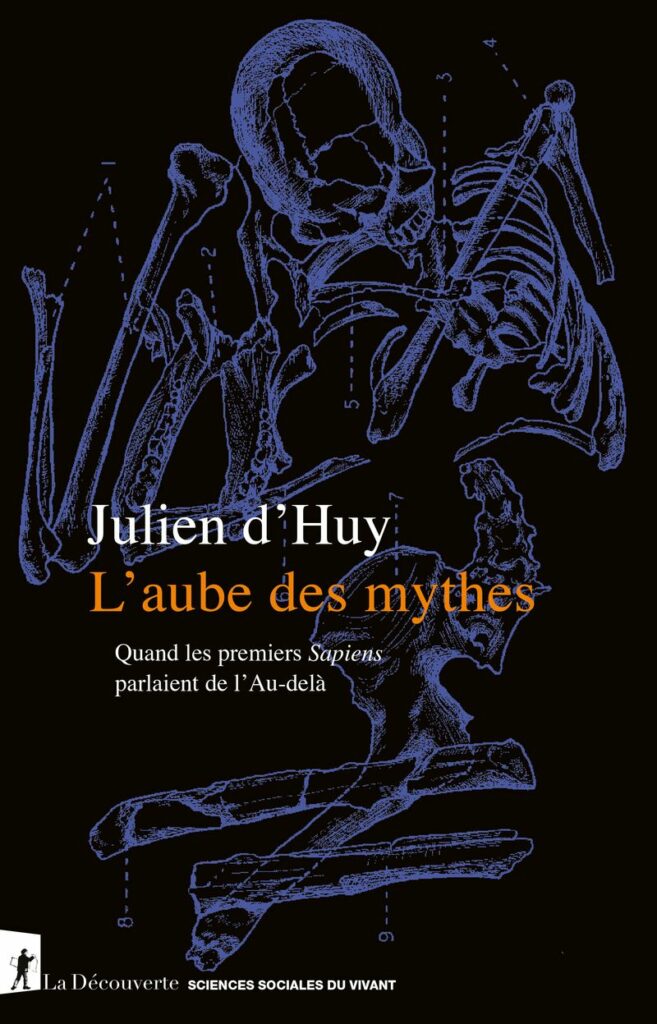L’historien Julien d’Huy, affilié au Laboratoire d’anthropologie sociale (Collège de France, CNRS, EHESS, EPHE), s’est d’abord fait connaître avec son livre Cosmogonies en 2020, pour sa justification de la phylomythologie comme méthode retraçant la généalogie des mythes qui nous sont connus. Désormais, dans sa nouvelle étude sur L’Aube des mythes : quand les premiers Sapiens parlaient de l’Au-delà (éd. La Découverte), il reconstitue les rapports des premiers Hommes à la mort et à l’au-delà. Loin d’être un phénomène tardif, le mythe fonde dès le paléolithique une part essentielle de la vie sociale sur la relation des hommes au surnaturel.
PHILITT : Les statistiques occupent une place très importante dans votre approche « phylomythologique ». Or cette approche quantitative peut surprendre par rapport au caractère spirituel que l’on attribue à la mythologie. Comment définissez-vous le mythe ?
Julien d’Huy : Les anthropologues et les ethnologues définissent le mythe comme un récit fondateur, qui prétend expliquer le monde tel qu’il est actuellement et auquel un certain nombre de personnes adhèrent. Le mythe ne se borne cependant pas à expliquer l’état actuel du monde et son origine : il permet aussi d’expliquer et d’organiser les règles sociales, de justifier des rituels et l’usage de tabous. À propos des rituels, il ne faut donc pas mésestimer la fonction pratique du mythe, qui n’est pas un récit purement théorique mais une histoire dont la narration dans certaines conditions données de temps et de lieu est tenue pour avoir des effets sur le monde. Par exemple, certaines cultures considèrent que raconter un mythe à un moment opportun peut permettre que tombe la pluie ou que le maître des animaux oublie ses protégés. Cependant, pour revenir à l’essentiel du mythe, il faut savoir que sa conception diffère en fonction des disciplines qui le prennent pour son objet propre : est par exemple très éloignée de son sens anthropologique, puisqu’en littérature la notion de « mythe littéraire » est mobilisée pour désigner des récits antiques aussi bien que des comédies modernes tels que Don Juan de Tirso de Molina et ses différentes versions. Or, de la même manière, la notion de mythe prend en philosophie des colorations différentes en fonction de ses interprétations. Typiquement, l’emploi de la catégorie de « sacré » ne me satisfait pas dans ma propre méthode de travail anthropologique, tant cette notion apparaît large et non dénuée d’équivoque : où placer la frontière entre sacré et profane, et celle-ci est-elle seulement stable, voire tangible ? Le sacré désigne-t-il une réalité qui est au-dessus de notre monde au point d’en être séparé ? S’agit-il au contraire de la perception d’une réalité englobante à laquelle nous pourrions avoir accès ? Signifie-t-il plutôt le « sublime » au sens kantien du terme, ou le « numineux »de Rudolf Otto, lui-même très influencé par les monothéismes et y voyant une réaction spontanée de la conscience face au terrible mais fascinant Tout-Autre ? Ces mêmes monothéismes rendent d’ailleurs fortement compliqué l’emploi de la notion de religion, qui ne peut pas s’appliquer rigoureusement à une quantité de mythologies anciennes dont les caractéristiques diffèrent beaucoup des religions telles que le judaïsme, le christianisme et l’islam. De la même façon, la notion de dieu peut désigner des choses aussi incomparables que des entités mortelles et anthropomorphes des mythes pré-chrétiens, ou l’entité immortelle et infinie que l’on peut trouver dans le monothéisme.
Vous employez pourtant dès le sous-titre de votre livre le mot d’« au-delà » : comment nommer cette réalité à laquelle les mythes anciens relient leur devenir posthume ?
L’idée de « surnaturel » me semble bien convenir. L’emploi général de cette notion permet de ne pas se prononcer sur la possibilité, l’essence et les modalités d’une communication avec l’au-delà, mais simplement de signifier que dans l’ensemble des mythes étudiés, il est fait référence à une réalité qui n’est pas limitée à ce qu’on en constate communément ; il y a quelque chose en plus, accessible sous certaines conditions, à quoi on ne se réfère que par la réception et la transmission d’un récit fondateur qui en parle, à savoir le mythe et ce qui s’y rattache.
Selon quelle méthode votre approche « phylomythologique » remonte-t-elle jusqu’aux origines préhistoriques des croyances humaines ?
Je m’appuie sur des mythes très variés, transmis dans les temps historiques, qu’il s’agisse de documents écrits ou bien de narrations orales recueillis par des chercheurs mais aussi par des missionnaires ou des colons. Ce qui caractérise ces mythes, c’est qu’ils forment des enchaînements d’actions dont la narration peut aussi bien tenir en deux phrases que courir sur plusieurs pages mais qui, en tout cas, se retrouvent dans plusieurs récits différents. Plus ils se ressemblent, plus les probabilités qu’ils possèdent une source antérieure commune augmente. La manière dont ces mythes s’enrichissent de détails et de singularités selon la tradition considérée nous autorise à parler de plusieurs complexifications d’un même mythe à travers l’histoire, ce que les anthropologues appellent « écotype ». Au fur et à mesure de leurs adaptations successives, les mythes divergent. La différence des récits ne correspond donc pas à une différence de mythes. D’ailleurs, de la même manière qu’un enfant serait capable d’identifier plusieurs versions du Petit Chaperon rouge, nous percevons souvent des traits communs, un « air de famille » plus ou moins précis, entre des récits appartenant à des cultures différentes mais possédant une origine commune. c’est-à-dire des « airs de famille » plus ou moins précis entre ces récits – . Par exemple, on observe une même occurrence mythologique du « Soleil chassé » et attrapé dans un piège à travers des récits d’Afrique, d’Inde, d’Océanie et d’Amérique. Seulement, ce même motif est adapté différemment selon les cultures qui l’ont adopté : ainsi, le Soleil peut être libéré de son piège par une souris (Amérique du Nord) ou encore avoir les jambes ligotées et être relâché par le héros lui-même, en échange de la promesse qu’il effectuera plus lentement sa trajectoire céleste (Océanie). La phylomythologie consiste à découper en petites unités les différentes versions d’un même mythe, afin de comparer leur ressemblance globale et d’établir statistiquement des arbres et des réseaux permettant de retracer leurs évolutions.
Vous rejetez l’hypothèse de Mircea Eliade selon laquelle de telles correspondances mythiques attestent de l’existence d’archétypes universels. Comment expliquez-vous alors la conservation de motifs mythiques similaires à travers les variations historiques et géographiques ?
S’il existe des motifs simples qui sont universels, il n’existe pas, en revanche, de motif complexe qui le soit. Reprenons l’exemple du Soleil chassé. Celui-ci ne se retrouve ni en Amérique du Sud ni en Eurasie. Il ne me semble donc pas que l’on puisse le considérer comme un archétype intemporel. Il en est de même pour tous les mythes suffisamment complexes, dont la récurrence des motifs suit des itinéraires différents dans le temps et dans l’espace que l’on peut retracer. Plus que dans les approches structuraliste ou fonctionnaliste en anthropologie, je m’inscris dans la tradition diffusionniste, récemment renouvelée par divers chercheurs, comme le philologue et indianiste allemand Michael Witzel, l’archéologue russe Yuri Berezkin ou le préhistorien français Jean-Loïc Le Quellec. Me concernant, j’ai essayé d’enrichir cette approche par une méthode plus statistique : en comparant différents types de mythes ou différentes traditions et en recoupant leurs différentes versions à travers le monde, j’ai reconstruit statistiquement des arbres et des réseaux phylogénétiques qui m’ont permis de remonter à des sources communes dans le passé. Bien que ces sources ne soient pas données comme telles, les rapprochements opérés forment un ensemble d’indices par lesquels il m’a été possible de calculer la probabilité qu’avait tel ou tel trait d’avoir existé à tel ou tel moment de l’histoire du mythe, et donc de reconstituer des proto-récits. Ce conservatisme des mythes peut s’expliquer par une tendance humaine à reprendre plus ou moins consciemment la parole des anciens. J’insiste sur le fait que cette reprise n’est pas nécessairement consciente car nombre de motifs mythiques se retrouvent, de manière plus ou moins latente, dans les multiples composantes de la vie sociale . Par ailleurs, il me semble que des points communs structurels entre certains contenus mythiques appartenant à des types de récits différents − par exemple, pour les mythes d’apparition de la mort, l’existence récurrente d’un lien entre la disparition d’un état primitif d’immortalité ou d’amortalité et une faute commise −pourraient s’expliquer par une causalité sociale, qui concerne le rôle du mythe : celui de fournir des croyances nécessaires aux sociétés pour se structurer et organiser la vie commune. Les particularisations mythiques ne sont donc pas universelles, mais la fonction du mythe, quant à elle, le serait.
Pourtant, comme vous venez de le relever, il semble exister un enseignement universel à travers la comparaison des récits mythiques sur la mort : les premiers hommes considéraient que « si la mort survint, ce fut à la suite d’une erreur humaine », comme l’exprimera bien plus tard, à sa manière, le mythe judéo-chrétien de la Genèse et du péché originel. Cet « invariant », qui suppose que l’humanité n’était pas mortelle à l’origine, contredit pourtant toute notre expérience commune : le consensus des mythes sur cette origine de la mort ne s’expliquerait-il pas en fin de compte par une révélation primordiale ?
Le premier problème concerne les limites de la méthode phylomythologique : nous ne disposons d’aucun document mythologique nous permettant de reconstituer des récits antérieurs à la période précédant immédiatement la première sortie d’homo sapiens hors du continent africain, il y a 185 000 ans. Or, puisque l’homme moderne a vécu des milliers d’années sur ce continent avant de le quitter, le fait est que ne nous ne pouvons alors rien dire sur ces premiers mythes de cette humanité. Je me méfie beaucoup des notions de « révélation » et d’ « origine » dans la mesure où ce sont des mots qui impressionnent et qui magnétisent, et qui ne vont pas sans questionnement : quand bien même atteindrait-on à cette origine souhaitée, ne faudrait-il pas alors trouver une origine à l’origine ? Remonter à l’humain d’avant homo sapiens ? Il existe au fond une sorte de « mur de Planck » de la mythologie : il apparaît difficile voire impossible de remonter au-delà d’un certain seuil. D’ailleurs, l’intérêt de l’approche statistique est de ne pas avoir besoin d’une intentionnalité extérieure comme celle d’une révélation : je me passe méthodologiquement le plus possible de la question du sens, non seulement parce que ce sens prend toujours place dans un contexte historique déterminé, mais aussi par un souci cohérentiste consistant à ne formuler de conclusion que lorsque l’ensemble des éléments vont dans le même sens. Or, quand on s’aventure dans l’interprétation des mythes, les significations divergent beaucoup. Laissons aux philosophes, aux psychologues, aux artistes, le soin d’interpréter et de répondre aux questions ontologiques ou existentielles qui ne manquent pas de se poser.
Qu’est-ce que ces premières croyances sur la mort nous disent sur la représentation que les Hommes préhistoriques avaient d’eux-mêmes ?
Il est possible de reconstituer une croyance antérieure à la sortie d’Homo sapiens d’Afrique, selon laquelle l’homme cheminerait après sa mort par la Voie lactée pour rejoindre le monde des morts. Ce motif mythologique montre que les premiers hommes considéraient qu’ils avaient une place à part dans le monde, puisque seul l’humanité le quittait, les animaux paraissant plutôt ressusciter à partir d’un vestige d’eux-mêmes. De la même façon, le proto-récit du mythe du cyclope Polyphème dans le chant IX de L’Odyssée, que j’ai reconstitué dans mon précédent livre Cosmogonies, montre que les premiers hommes avaient conscience de leur spécificité parmi les vivants, puisqu’ils s’imaginaient qu’il existait des maîtres des animaux sauvages et qu’ils leur étaient possible de négocier avec eux. Ces éléments vont plutôt à l’encontre de l’hypothèse rousseauiste d’un « état de nature » : il semble que les Hommes ont toujours eu conscience, plus ou moins, de leur originalité. Je pense que pour les premiers Sapiens, les mythes fournissaient la « recette » du monde, la façon dont celui-ci devait fonctionner, et que les rites associés à ces mythes étaient perçus comme susceptibles de stabiliser ce monde ; aussi l’homme devait-il se représenter comme un être essentiel à la bonne marche de l’univers.

Les paléoanthropologues ont pu souvent être amenés à expliquer de manière utilitariste et matérialiste l’origine des sociétés humaines. Au contraire, vous montrez que la croyance des premiers hommes dans une existence posthume a joué un rôle important dans la domestication des animaux. Cela ne nous montre-t-il pas qu’homo sapiens est plus un homo religiosus qu’un homo faber ?
Pour éviter l’étroitesse et l’équivocité du vocabulaire religieux pour ces sujets, je parlerai plutôt, à la suite de l’ethnologue Kurt Ranke ou de Walter R. Fisher, d’homo narrans, ou bien encore d’homo mythologicus. En effet, pour un certain nombre de domestications, la part du mythologique a probablement été très importante. Il est ainsi possible de montrer, en étudiant l’aire de diffusion de certains mythes et en réalisant des régressions statistiques, que les premiers chiens étaient considérés comme des êtres psychopompes. Cette fonction de conduire l’âme vers l’au-delà concernait sans doute également leurs ancêtres, les loups qui, tout comme leurs descendants canins, ont été enterrés rituellement dès le Paléolithique. La domestication de ces animaux dangereux implique un effort de sélection sans doute associée à l’investissement d’une certaine valeur mythologique. Beaucoup de premiers motifs mythologiques signalent d’ailleurs le devoir de bien se comporter avec le chien de son vivant afin d’en recueillir le bénéfice posthume. La mort étant l’une des grandes affaires de l’être humain, celui-ci a tenté d’y associer les non-humains qui l’entouraient. De la même manière, les ovins font partie de ces animaux héliophores – associés au symbolisme du soleil – dont mes recherches ont précisément démontré l’existence avant la sortie d’Homo sapiens hors d’Afrique. Des facteurs non utilitaires dans leur domestication sont d’autant plus probables qu’entre autres choses, les moutons sauvages ne fournissaient pas de grandes quantités de laine. Pour se garantir un bon chemin vers l’au-delà ou maîtriser de grands phénomènes réglant leur vie, les premiers humains passaient ainsi des contrats avec les non-humains, ce qui relativise beaucoup le rapport de séparation et d’infériorisation que nous avons établi ces derniers siècles avec les animaux avant de les reconnaître, depuis peu, comme sujet de droit.
Votre étude comparative des mythes a-t-elle finalement modifié votre représentation initiale du monde ?
Mes recherches sur la mythologie, de façon générale, me conduisent moins à des réponses nouvelles sur le monde, puisque je ne travaille pas sur le sens interprétatif des mythes mais sur leurs structures de diffusion, qu’à des questions sur notre espèce. Quel est le propre de notre espèce ? Ce qui nous rapproche, n’est-ce pas tant nos gènes que le fait que nous partageons des histoires ? L’homme ne se définit pas seulement biologiquement, il appartient aussi à une communauté langagière. L’étude comparée des mythes montre que l’héritage humain n’est pas seulement génétique mais aussi culturel. Métaphoriquement, je dirais que la planète est veinée de routes de mots et de concepts qui circulent et nous relient tous, sans même que nous en ayons conscience. Par certains récits auxquels adhèrent des Européens, ceux-ci se retrouvent liés, à travers le temps et à travers l’espace, avec des Khoïsans ou des Aborigènes d’Australie. Il ne serait pas inintéressant, pour articuler les problématiques de la laïcité aux savoirs de la culture, de montrer à l’école comment les croyances monothéistes trouvent leurs échos mythologique à travers le monde et s’inscrivent dans une histoire. Par ailleurs, l’un des principaux intérêts de l’étude des diffusions des mythes réside dans la question de savoir comment une parole se stabilise dans le temps et se transmet de génération en génération, entre longues périodes de répétitions et brèves périodes d’intenses recréations. On pourrait aussi se demander si nous avions à répéter, même malgré nous, certains mythes, qui font partie intégrante de nous-mêmes, où s’arrêterait notre identité individuelle ? Pensons-nous vraiment librement ? La prise de conscience de cette imprégnation de nombreux mythes dans notre vie et nos pensées doit-elle nous amener à nous en défaire, et encore le fait de nous en débarrasser ne reviendrait-il pas à nous détourner de ce qui fait notre humanité et à nous désunir ?
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.