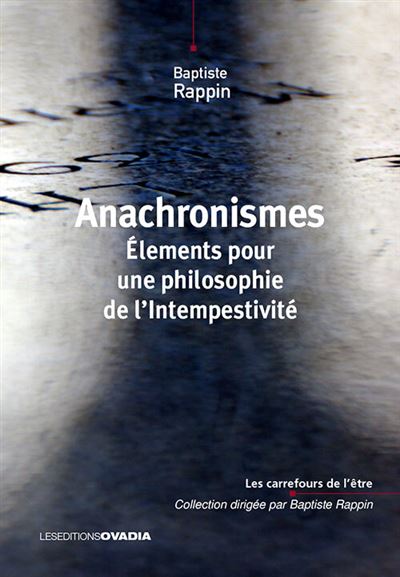Dans Anachronismes. Éléments pour une philosophie de l’intempestivité (Ovadia), le philosophe et universitaire Baptiste Rappin explore, au sein de plusieurs disciplines, des possibilités d’enrayement de la marche technocapitaliste. De la biologie à la théologie politique, de Walter Benjamin à Hartmut Rosa, l’auteur nous permet d’explorer de vastes pans de la pensée qui sont autant de tentatives de résistance à la modernité.
PHILITT : Le titre de votre ouvrage ne va pas de soi. Quel sens donnez-vous à la notion d’« anachronisme » ?
Baptiste Rappin : Il est vrai que l’anachronisme a plutôt mauvaise presse et l’on fustige assez volontiers ceux qui se livrent à cette erreur que le grand historien Lucien Febvre considérait être, selon ses termes, un « irrémissible péché ». Lui-même s’évertuait en effet, par exemple dans son génial Problème de l’incroyance au XVIe siècle, à éviter le piège de la projection des représentations contemporaines sur une époque antérieure, biais psychologique et épistémologique qui conduit à de nombreux contresens. Comprendre un phénomène, c’est bel et bien être capable de le référer à l’« outillage mental » idoine.
Dans mon ouvrage, j’entends l’anachronisme non pas en son sens savant, mais, le prenant au mot, à la lettre, en son sens littéral donc, au premier degré en quelque sorte : le contresens historique n’est plus alors une erreur condamnable ou une regrettable faute épistémologique, mais un contre-courant qui résiste à la course de l’histoire, un mot d’ordre pour tous ceux qui ne partagent pas l’enthousiasme des élites pour le progrès, ou plutôt l’innovation, car jamais le hiatus entre le progrès moral et le progrès technique, que Rousseau plaçait au cœur de son révolutionnaire Discours sur les sciences et les arts en 1750, n’a semblé si criant.
Plus encore, c’est la pensée d’Ernst Bloch, si proche de celle de Walter Benjamin, qui m’inspira le choix de ce titre. Pour le philosophe qui mena sa thèse sur Thomas Müntzer, l’anachronisme forme une résurgence du passé dans le présent qui, en raison de son caractère incompressible, irréductible, est susceptible d’inspirer une résistance à la cage de fer capitaliste. C’est ainsi que mes Anachronismes explorent huit formes de cette remémoration, de ce « temps du maintenant » (die Jetztzeit) selon l’expression de Benjamin, susceptibles de trouer le continuum spatiotemporel hégémonique.
Quelles sont selon vous les vertus d’une « philosophie de l’intempestivité » ? À quel type de philosophie s’oppose-t-elle ?
La référence à la philosophie de Nietzsche, et plus particulièrement à ses Considérations, est ici évidente. Justement, dès la préface de la Seconde considération intitulée « De l’utilité et des inconvénients de l’histoire pour la vie », le philosophe affirme être « le disciple d’époques plus anciennes, notamment de l’Antiquité grecque, et que c’est seulement dans cette mesure qu’[il a] pu faire sur [lui]-même, comme fils du temps présent, des découvertes aussi inactuelles ». Et, dès la phrase suivante, il écrit encore que le sens de la philologie classique n’est autre que « d’exercer une influence inactuelle, c’est-à-dire d’agir contre le temps, donc sur le temps, au bénéfice d’un temps à venir ».
Sur quel temps, ou contre quel temps, alors, essaie d’agir Nietzsche en faisant montre d’intempestivité ? Sa cible : les pensées du « processus universel », c’est-à-dire les philosophies de l’Histoire, dont beaucoup, aujourd’hui, ont disparu, sauf une qui régit de fond en comble l’imaginaire des sociétés contemporaines : il s’agit du récit cyber-techno-solutionniste, fiction néoprogressiste qui légitime le déploiement planétaire du système capitaliste et managérial ainsi que le projet d’une gouvernance mondiale sous tutelle américaine.
Votre livre parcourt un grand nombre de thèmes (la biologie, l’histoire, la technique, le langage…) et une galerie impressionnante d’auteurs. Qu’est-ce qui fait l’unité de votre démarche ?
Huit stations structurent en effet Anachronismes : la biologie, l’histoire, la technique, l’anthropologie, le langage, la théologie politique, l’ontologie et l’éthique. La question de l’unité est donc justifiée. Une première réponse émerge des propos précédents : ces chapitres sont autant de variations sur le thème de l’anachronisme et mettent ainsi en exergue une forme d’intempestivité. Je ne déplie pas mon objet de pensée de façon linéaire, mode d’exposition qui ne ferait que reproduire la logique chronologique que je prends précisément pour cible ; c’est pourquoi je m’attelle plutôt à tourner autour, en multipliant les perspectives, dans le langage de Nietzsche, ou les esquisses, dans celui de Husserl.
J’ai fait en revanche le choix de structurer tous les anachronismes selon une même logique de renversement, un peu comme s’il s’agissait dans un premier temps de plonger le lecteur dans la totalité de l’arraisonnement avant d’explorer avec lui des brèches et des passages, des mémoires et des possibles ; et autant ces derniers sont propres à chaque station, autant se font tout de même écho quelques rengaines qui reviennent tout au long de l’ouvrage : l’institution, l’analogie, le frein, la tenue, etc.
Par certains aspects, votre propos fait écho aux livres récents de Jean Vioulac (Anarchéologie, Métaphysique de l’Anthropocène) qui ont pour thème l’essence catastrophique de l’histoire. En quoi le rejoignez-vous et en quoi vous distinguez-vous de lui ?
Anarchéologie et Métaphysique de l’Anthropocène sont des livres remarquables, comme l’est l’ensemble de l’œuvre de Jean Vioulac de façon plus générale. Il fait partie des rares philosophes contemporains à proposer une pensée d’ensemble qui se confronte directement au nihilisme de la Machine et du Capital. Ses travaux me donnent le vertige : non pas tant par la maîtrise impeccable de l’histoire de la philosophie, ni par l’imparable logique en forme de rouleau compresseur de son argumentation, auxquelles je me suis peu à peu accoutumé ; mais, pour moi qui suis son travail en dévorant chaque nouvelle livraison dès sa parution, par l’élargissement des cercles concentriques qu’il recherche à chaque reprise : en d’autres termes, par l’empan de l’objet – la catastrophe – que sa réflexion s’efforce de saisir en repoussant toujours encore les limites de ladite catastrophe. Rapidement : dans un premier temps, Vioulac met en cause la société industrielle et capitaliste dont il extrait les racines métaphysiques ; dans un deuxième temps, il développe un propos qui prend pour origine la révolution anthropologique et technique du Néolithique ; dernièrement, il passe au stade géologique avec l’Anthropocène et en vient même à s’interroger sur la légitimité de l’existence de l’Homme, cet animal de la négativité – qui sème donc la mort partout où il passe. Je crains qu’une telle spirale nous mène à un désespoir sans retour. Au suicide, au fond.
De mon côté, et bien modestement, j’essaie de montrer que la tradition européenne, grecque et catholique, en dépit de son tropisme bien réel vers l’arraisonnement de la planète, offre un certain nombre de ressources, hélas recouvertes par l’irrésistible mouvement du Gestell et ses multiples manifestations, que je tente d’exhumer pour en montrer l’intérêt à la fois théorique et stratégique dans le cadre de ce qu’il faut bien appeler, avec George Steiner, « une contre-révolution industrielle ». Si bien qu’après m’être attardé à examiner le management sur toutes ses coutures – ou presque –, j’en suis venu à proposer ces Anachronismes comme une forme d’antidote au fatalisme que pourrait générer le constat de l’extension infinie du domaine de la logique automate.
« Que les choses continuent à « aller ainsi », voilà la catastrophe », écrivait Walter Benjamin. Votre livre constitue-t-il, en quelque sorte, une longue et riche variation sur cette célèbre citation ? Vous opposez par ailleurs au phénomène de l’accélération techno-capitaliste le « frein de la Révolution ». En quoi cette conception de la révolution est-elle éloignée de celle de Marx et quelle forme a-t-elle prise historiquement ?
Walter Benjamin, Martin Heidegger et quelques autres penseurs hors-norme se trouvent en effet au cœur de mes Anachronismes. La pensée de Benjamin est particulièrement puissante puisqu’elle donne à voir, de manière très nette, le changement d’orientation de la révolution : traditionnellement conçue comme une course vers le Grand Soir et la prise de pouvoir par cet acteur historique qu’est le prolétariat, direction futuriste qui justifie l’utilisation de la métaphore de la locomotive par Marx, elle devient sous la plume de l’auteur des Thèses sur le concept d’histoire la résistance à la marche de l’Histoire, qui appelle cette fois-ci l’analogie des freins d’urgence. D’où provient ce renversement complet de perspective ?
Vous donnez la réponse dans votre question : Benjamin établit l’équivalence du progrès et de la catastrophe. Il saisit à quel point que le cours des choses ne nous conduit qu’à la catastrophe, et c’est bien ce que d’aucuns tentent présentement de comprendre à travers la notion – encore contestée – d’Anthropocène. C’est la raison pour laquelle le révolutionnaire ne peut désormais plus jouer la carte de l’accélération, mais doit devenir, selon l’expression de Günther Anders, un « conservateur ontologique », soucieux de la sauvegarde du monde et des civilisations.
Toutes les manifestations historiques du freinage peuvent illustrer cette conception de la révolution : ce sont, de tous temps, les bris de machine, les barricades (qui sont les ennemies de la Boutique comme l’écrit Marx), les blocages de raffineries et de dépôts, les opérations « escargots », la prise de ronds-points, le piratage des réseaux… Il s’agit, dans tous les cas, selon l’expression si juste de Benjamin, de « saboter le trafic ».
Vous attachez une grande importance à la notion de katéchon. D’où vient-elle et sous quelle forme politique s’est-elle principalement manifestée ?
En dépit du mouvement général de l’histoire vers la sécularisation des sociétés, malgré les thèses sur le christianisme comme religion de la sortie de la religion, j’ai nourri l’intime conviction, au fur et à mesure de mes recherches, que le fond de l’affaire demeure, en dernier ressort, de facture théologique. Dans le cas de la tradition occidentale, le modèle de l’État s’élabore, comme l’ont montré les historiens du droit, dans l’Église de la réforme grégorienne : c’est dans ce moule, en effet, que s’élabore l’idée inédite de toute-puissance qui structure la pratique souveraine du pouvoir moderne. Un tel absolu, que Hobbes illustre à juste titre par la figure biblique du « Léviathan », monstre marin qui symbolise le chaos primordial, porte en lui-même la démesure de la catastrophe.
Mais le christianisme peut opposer à la toute-puissance, qui est pourtant en partie son rejeton, deux catégories dont je me saisis dans mes Anachronismes : d’une part, la kénose, qui n’est autre que l’évidement de Dieu renonçant à sa toute-puissance pour se faire homme ; d’autre part, le katéchon, littéralement « la force qui retient » et qui désigne le retardement de l’advenue de l’Antichrist. La kénose me permet de penser une forme d’autorité qui s’exerce non pas dans le pouvoir mais dans le retrait, tandis que le katéchon me semble pointer vers l’invariant institutionnel des sociétés humaines.
En vous appuyant notamment sur les thèses de Guy Debord, vous constatez que « l’être humain vit une nouvelle forme de captivité : sa cellule n’est plus close par des barreaux et des serrures […] mais ouverte sur l’infinité des spectacles […] dont il ne peut que difficilement s’extirper afin de se cramponner à la racine du réel ». Les intuitions formulées dans La Société du spectacle (1967) se sont-elles réalisées à un degré inattendu ?
Qu’on le dise avec Heidegger en soutenant que la tradition métaphysique établit le règne de la présence constante, ou avec Baudrillard qui observe le règne de la transparence généralisée et de l’écran total adossé à l’avènement de l’hyperréel, cela revient dans les deux cas à observer une hyper-sollicitation voire une saturation de la vue prise dans le flot de l’étant mis à disposition. Guy Debord avait eu l’intuition géniale, dès 1967 et la parution de La société du spectacle, que la concentration du capital allait lui donner une nouvelle forme : le spectacle, cette totalité sociotechnique qui reconfigure l’espace-temps selon l’ordre tautologique et circulaire des images. Et le spectacle, en outre, d’être la seule forme d’unification dans la société divisée et séparée, de telle sorte qu’il détient le monopole de la parole : il exclut par définition toute négativité, laissant craindre la possibilité que tout, absolument tout, finisse par être avalé et recyclé dans son système autoréférentiel qui efface d’un trait à la fois le concept et le réel, pour ne plus laisser subsister que les seuls signifiants sous forme d’images chantant les louanges du pouvoir et flattant les bas instincts.
De ce point de vue, la pensée de Debord, malgré le demi-siècle qui nous sépare des thèses de La société du spectacle, semble bel et bien des plus pertinentes pour penser l’omniprésence du spectacle à l’époque des smartphones et des réseaux sociaux qui absorbent l’attention de l’utilisateur par le défilement constant de la page : le « scroll » représente en ce sens l’antépénultième de la fusion de l’individu et du spectacle, juste avant le port de lunettes de réalité augmentée puis de la greffe d’une puce cérébrale. La pleine positivité du spectacle sera alors réalisée ; et d’anachronisme, ou d’intempestivité, on ne parlera plus guère.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.