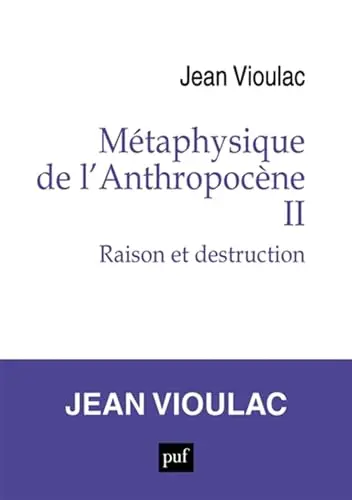Le philosophe Jean Vioulac publie le deuxième volume de sa Métaphysique de l’Anthropocène (PUF). Il prolonge ici sa réflexion sur la destinée catastrophique de l’histoire humaine et continue d’élaborer son anthropologie négative. Dans ce nouvel opus, Leibniz occupe une place très importante. Le philosophe allemand est considéré comme le penseur de l’avènement du « machinisme » et de « l’âge cybernétique ». Il représente aussi l’actualisation du potentiel d’abstraction que contient, depuis son origine platonicienne, la métaphysique occidentale.
PHILITT : Vous semblez vouloir lever un malentendu sur votre démarche philosophique en récusant les accusations de nihilisme, de pessimisme ou de misanthropie. Penser la catastrophe, ce ne serait donc pas l’espérer mais tenter de la conjurer ?
Jean Vioulac : Penser la catastrophe, ce n’est en aucun cas l’espérer, c’est évidemment tenter de la conjurer. Mais la première tâche est celle de la lucidité, et celle-ci est très difficile à conquérir, parce que toujours dominent les puissances du déni. D’où l’accusation de pessimisme, qui permet de ne pas tenir compte d’un message inquiétant en l’attribuant à un trait de caractère du messager. L’exigence de lucidité impose pourtant de refuser autant le pessimisme que l’optimisme au profit du réalisme. Le point de départ, pour tenter de cerner ce qu’il en est de la réalité, consiste à prendre acte des données procurées par les sciences contemporaines : ce sont ces sciences, dans les rapports de synthèses les plus officiels qu’on puisse imaginer, qui montrent que l’humanité se dirige vers une catastrophe globale. Il s’agit alors de comprendre le processus en cours, pour découvrir que la logique du gigantesque dispositif de production qui s’est mis en place avec la révolution industrielle est une logique d’annihilation : une pensée de l’annihilation peut alors sembler nihiliste, elle ne l’est pas, au contraire, puisqu’elle ne peut conquérir sa lucidité que par son hérésie, en s’arrachant à toutes les normes imposées par ce dispositif.
Vous affirmez que le concept d’Anthropocène oblige l’homme à assumer sa négativité. Prendre acte de cette négativité revient-il nécessairement à renoncer à toute forme d’humanisme ?
Non, et c’est pourquoi la pensée de l’Anthropocène n’est pas davantage misanthropie. Dire que l’homme se définit par la négativité, ce n’est certainement pas porter un jugement négatif sur l’être humain : c’est cerner son statut ontologique, et c’est même y reconnaître sa grandeur, puisque cette négativité lui ouvre l’espace de jeu de sa liberté et de sa pensée. La reconnaissance de la négativité au cœur de l’humanité s’impose à partir du moment où l’on assume que l’homme est résultat d’un processus évolutif issu de l’animalité, ce que Nietzsche a conclu de Darwin : l’homme est « l’animal désanimalisé », l’animal qui refuse de l’être, celui qui nie et renie la nature en lui ; qui refoule sa vie pulsionnelle, dira Freud. Sans la négation de l’animalité en l’homme, il n’y aurait pas d’humanité. Mais le concept d’Anthropocène est insuffisant, parce que ce n’est pas « l’homme » qui est en cause dans la crise écologique, c’est le mode de production industriel, et celui-ci est entièrement fondé sur l’aliénation des hommes, dépossédés de leur puissance, laquelle est transférée à un dispositif qui peut en déployer la masse cumulée. La révolution industrielle se caractérise par le passage de l’outil à la machine, qui n’est autre que cette délégation des compétences des hommes dans des dispositifs automatisés. Or la technique n’est rien d’accessoire, elle est un des principes fondamentaux de l’hominisation de l’animal-homme : la révolution technologique a des conséquences anthropologiques, elle redéfinit peu à peu et insidieusement l’être même de l’homme. Avec l’informatique, le processus de transfert de compétence inclut les capacités cognitives des hommes, leur langage, leur mémoire, leurs capacités d’analyse, d’anticipation et de décision, d’écriture… Aristote définissait l’homme comme le zôon lógon ékhon, le vivant doté du lógos ; l’informatique délègue le lógos aux machines, elle en dépossède les hommes, qui l’ont ainsi externalisé et deviennent des vivants dépendants de logiciels : ainsi se confirme le pressentiment de Tocqueville d’un nouveau despotisme qui « à la longue ravirait à chacun plusieurs des principaux attributs de l’humanité ». Le risque est tout à la fois celui de la ré-animalisation et de la technicisation de l’homme, il est celui de la déshumanisation de l’humanité, réduite au rang de troupeau grégarisé par le spectacle, gouverné par le biopouvoir et la régulation algorithmique. La critique de cette époque relève donc bien d’une forme d’humanisme.
En vous appuyant sur Deleuze et Marx, vous évoquez le potentiel révolutionnaire de la honte de soi. Le problème des dirigeants qui défendent le système actuel est-il qu’ils sont incapables d’avoir honte d’eux-mêmes ?
La honte est en effet un phénomène important, parce qu’elle est une forme de conscience de soi, où le sujet prend conscience de ce qu’il est, de son être, et condamne cet être au nom de ce qu’il devrait être ; elle implique ainsi la négativité. Les dirigeants, qui ne sont plus aujourd’hui que les fonctionnaires du dispositif de destruction, qui par ailleurs manipulent éhontément les masses par le spectacle et jouissent éhontément de leurs privilèges de caste, devraient en effet avoir honte d’une irresponsabilité qui confine aujourd’hui à la complicité de crime contre l’humanité. Mais il faut aussi envisager une honte essentielle, celle de l’homme qui se découvre en deçà de ce qu’exige son humanité, qui prend conscience de sa grégarisation et de sa technicisation. La honte d’avoir été réduit à un troupeau de consommateurs, de touristes, de téléspectateurs ou de supporters aurait un potentiel révolutionnaire.
Vous consacrez des pages passionnantes à Leibniz que vous intronisez penseur de « l’avènement du machinisme » et de « l’âge cybernétique ». Qu’est-ce qui caractérise ce régime ontologique ?
L’œuvre de Leibniz est absolument cruciale : mais il s’agit de tout autre chose que d’histoire de la philosophie. Notre époque est caractérisée par l’avènement de l’informatique, de l’internet, de la numérisation universelle, de la régulation algorithmique, de l’intelligence artificielle… Il y a là la mise en place d’un nouveau pouvoir, qui domine les hommes, ne serait-ce que par la masse de ses données, sa capacité de stockage et sa puissance de calcul, et qui, de fait, a profondément transformé le monde du travail, les sociétés, les vies individuelles, le rapport au temps et à l’espace, à la réalité et à la vérité… Norbert Wiener dès 1949 a compris que l’informatique était un pouvoir, il l’a renommée « cybernétique », du grec kubérnèsis, « pilotage », « gouvernement ». La question, c’est donc de comprendre ce pouvoir, un peu comme Hobbes au XVIIe siècle avait conçu le nouveau type de pouvoir advenu avec l’appareil d’État, et c’est à cela que nous sommes confrontés : l’émergence d’un cyber-Léviathan, un Léviathan non plus étatique mais numérique. Son originalité, c’est d’être le pouvoir d’une abstraction, c’est ce qui le rend si difficilement concevable et qui empêche d’y reconnaître un pouvoir réel. La cybernétique est le pouvoir du logiciel, c’est-à-dire d’une certaine configuration de la logique, elle-même résultat de toute une histoire. Wiener, mais aussi les principaux fondateurs de l’informatique comme Gödel ou Turing, se sont tous réclamés de Leibniz : et en effet, Leibniz à la fin du XVIIe siècle mène à son terme le projet de mathématisation de la rationalité qui définit la modernité européenne, il identifie la pensée au calcul et la réalité au calculable, élabore une logique binaire faite de 0 et de 1 permettant la numérisation universelle, automatise toutes les procédures déductives, élabore une ontologie du réseau et de l’espace non-local du virtuel, conçoit l’univers comme une « machine de machines » et Dieu comme Mens ordinatrix, « intellect ordinateur », qui en a établi le programme… L’œuvre de Leibniz atteste que la mise en place du dispositif cybernétique mondial n’est pas le simple effet d’inventions empiriques, elle est l’accomplissement d’une potentialité de la rationalité occidentale, c’est-à-dire de son régime de vérité ou régime ontologique spécifique. L’avènement du dispositif cybernétique est une lame de fond qui achève une histoire millénaire, ce qui ramène à de justes proportions les prétentions de ceux qui affirment que tout cela est sous contrôle et qu’ils savent exactement ce qu’ils sont en train de faire.
Vous écrivez que Leibniz réduit la pensée à la « computation et l’automatisation de toutes les procédures de calcul, la définition de la substance par la forme ». Creuse-t-il la tombe de la subjectivité ?
Parfaitement, et c’était son but explicite. Le XVIIe siècle est celui de la révolution scientifique moderne, à laquelle Descartes donne sa première formulation en concevant le projet d’une science totale fondée sur une logique de la certitude destinée à produire indéfiniment des vérités. Leibniz reproche à Descartes d’être incapable de mener à bien son projet, parce qu’il se fonde sur l’intuition et l’attention d’un sujet : or la subjectivité, c’est justement le maillon faible de tout raisonnement. Le projet leibnizien consiste à court-circuiter la subjectivité et l’intuition au profit d’inférences formelles qui se déduisent les unes des autres sans quitter le champ de l’objectivité. Le modèle est celui du syllogisme, en lequel Leibniz voyait un « art d’infaillibilité », puisqu’une fois posées les prémisses, la conclusion s’en déduit objectivement et automatiquement. En d’autres termes, le projet de Leibniz consiste à éliminer l’erreur humaine pour automatiser toutes les procédures de calcul. La numérisation de la pensée consiste à la fonder, non plus sur un ego, mais sur un numéro, et cette numérisation est ce qui permet l’automatisation, qui procure le statut de « soi » (en grec autós), c’est-à-dire l’ipséité, au numéro et non à l’ego, et permet ainsi l’élimination de la subjectivité. C’est la logique poursuivie depuis lors : l’éjection de l’homme, sa disqualification, sa relégation au profit de systèmes objectifs devenus autonomes. S’il y a un grand remplacement, il est ici : dès que l’homme est remplaçable par une machine, il est remplacé.
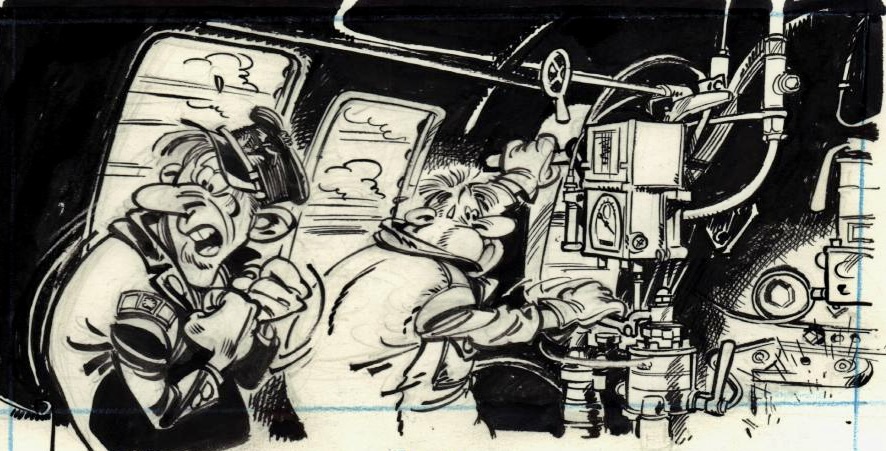
Dans ce livre, vous radicalisez et systématisez votre critique de Platon. Est-il vraiment, comme l’écrivait Nietzsche dans une lettre à Overbeck, « coupable de tout » ?
La tentative pour penser la cybernétique impose une généalogie de la raison numérique : cette généalogie découvre dans l’œuvre de Leibniz le moment crucial de son élaboration. Mais Leibniz s’oppose aussi à Descartes parce qu’il récuse sa prétention à faire table rase du passé, et s’approprie l’héritage de la pensée grecque, notamment la logique du syllogisme. L’origine de cette rationalité est en effet la Grèce ancienne : le premier penseur de la raison numérique et de la numérisation intégrale du réel, c’est Pythagore, et celui qui a donné à cette rationalité la forme d’une œuvre, c’est Platon. Toute la pensée de Platon est arc-boutée contre la thèse de Protagoras selon laquelle « l’homme est la mesure de toute chose », pour affirmer que c’est la raison pure, l’idée, et finalement le nombre, l’unité numérique, qui est la mesure de toute chose ; tout son propos consiste à récuser l’homme réel en chair et en os, à disqualifier son point de vue sur le monde, au profit de pures formes intellectuelles et de leur rapport les unes avec les autres. C’est l’origine de cette rationalité formelle et abstraite, de cette dialectique objective qui court-circuite les sujets : Platon parlait même de noûs kubérnètikos pour désigner l’esprit divin qui a mis en ordre l’univers, littéralement traduit, « l’intelligence cybernétique ». Mais Platon n’est coupable de rien, il n’a fait qu’expliciter et exprimer la configuration de la rationalité dont l’avènement caractérise le moment grec, avènement qui s’explique sur de tout autre bases : en l’occurrence des bases sociales et techniques, avec l’avènement de la monnaie titrée, qui tout à la fois numérise et objective l’abstraction réelle opérée dans les échanges. L’hégémonie contemporaine de la raison numérique ne doit rien à l’influence de Platon, et tout au dispositif capitaliste de production.
« La philosophie a commencé avec Platon, elle s’achève avec Hegel », écrivez-vous. Quel est le sens d’un tel « achèvement » puisque vous êtes vous-même tributaire de philosophes qui leur sont postérieurs (Marx, Husserl, Heidegger notamment) ?
Platon a donné à la rationalité sa structure déterminante en posant au fondement « l’idée de Bien », que les monothéismes ont identifié à Dieu, et sur laquelle il projetait de fonder un État rationnel : cette configuration de la pensée s’achève dans l’idéalisme absolu de Hegel, qui au début du XIXe siècle comprend notre époque comme avènement du Bien réalisé dans l’État de droit, en lequel il voyait « un Dieu réel ». Cette thèse fut tragiquement récusée depuis : les totalitarismes ont révélé le potentiel d’annihilation de l’État, Auschwitz a acté la mort de Dieu, et Hiroshima a montré que la numérisation de la rationalité s’accomplissait dans l’atomisation de la réalité. Notre époque révèle que le principe de raison était principe de mort : et en effet Platon définit expressément la philosophie par le désir de mort, il précise que le philosophe n’atteindra vraiment ce qu’il recherche qu’en mourant, et fait d’Hadès, le dieux des morts, son dieu tutélaire ; Hegel ne donne d’autre fonction à l’existant fini que d’être anéanti pour qu’advienne l’Absolu. Platon et Hegel sont sans conteste les plus grands philosophes de l’Histoire, mais ils sont les penseurs d’une Histoire mue par la pulsion de mort. C’est pourquoi je ne me réclame pas de philosophes, mais de ceux que Paul Valéry appelait misosophes, des anti-philosophes : Marx est celui qui renverse Hegel, Nietzsche celui qui renverse Platon, parce qu’ils ont saisi la puissance de mort qui dominait dans la rationalité, et ont tenté de la refonder sur la vie, ce que Husserl et la phénoménologie ont tenté aussi.
Le monde, pour éviter la catastrophe, a besoin d’une révolution des mentalités et des usages. Pourquoi l’option de Benjamin (tirer le frein d’urgence) vous semble-t-elle plus adaptée que celle de Marx (la révolution comme locomotive de l’histoire) ?
Il faut tout d’abord insister sur le statut essentiel de la question de la révolution. La révolution est un état de fait : la révolution industrielle est la plus grande révolution qu’ait connu l’humanité depuis la révolution néolithique, en deux siècles elle a changé la face de la terre, bouleversé de fond en comble les sociétés et la condition même de l’homme. Il faut alors comprendre ce qui se passe, déterminer qui prend le pouvoir, quel est le nouveau régime qui s’instaure : or la logique de ce processus est celle de l’aliénation et de l’automatisation, qui dépossède méthodiquement les sujets de leurs capacités pour les déléguer à des objets. Le nouveau pouvoir qui advient, c’est le pouvoir de l’objectivité, de la rationalité formelle et abstraite ; le nouveau régime, c’est celui du numérique, de la cybernétique. C’est le cœur de l’analyse du capitalisme par Marx : l’avènement du capitalisme est une révolution définie par « l’inversion du sujet et de l’objet », qui institue l’entité numérique immatérielle de la valeur en « sujet dominant » et « sujet automate », et qui lui procure ainsi le statut de « soi » ; le Capital, dit Marx, c’est l’« ipséité de la valeur ». Marx constate donc l’avènement d’une nouvelle locomotive de l’Histoire : le Capital. Le principe moteur de sa turbine est « l’autovalorisation de la valeur », c’est-à-dire l’accroissement continu d’une quantité numérique formelle et abstraite. Le dispositif capitaliste consomme, donc consume, toute réalité pour produire l’irréalité de la valeur, qui est la vapeur injectée dans ses pistons pour aller toujours plus vite ; il engloutit dans sa chaudière la totalité des ressources disponibles, y compris les ressources humaines, pour accroître toujours davantage la bulle spéculative d’une richesse abstraite, virtuelle et finalement fictive. Le capitalisme est un exterminisme — je reprends le concept forgé par Edward Thompson —, et c’est bien ce que l’on constate aujourd’hui, où l’écosystème terrestre est pris dans un processus de destruction tel qu’il n’y en avait pas eu depuis 65 millions d’années. L’urgence est donc une révolution anti-capitaliste, qui renverse ce système. Mais nul ne peut prétendre prendre en main une machinerie planétaire définie par l’automatisation, il s’agit d’identifier une contradiction interne qui la condamne à se renverser elle-même : c’est ce que fait Marx, qui voit dans la logique de prolétarisation la création d’une classe anti-capitaliste toujours plus nombreuse, laquelle doit provoquer un basculement des pôles permettant de rendre à la communauté des sujets tout ce qui s’était aliéné dans le systèmes des objets. Quand Marx parle de sa confiance dans le processus révolutionnaire, c’est parce qu’il espère que le prolétariat va devenir la nouvelle locomotive de l’Histoire, et que par lui l’humanité pourra s’instituer en sujet historique et destituer le sujet qu’est le Capital. Mais 1914 fut une « catastrophe historique mondiale », comme l’a vu Rosa Luxemburg, parce que l’Internationale a échoué à empêcher la guerre, le prolétariat ne s’est pas constitué en sujet de l’Histoire, il s’est laissé réduire au rang de matière première par la machine de guerre et s’est laissé consumer par elle. C’est le contexte de la pensée de Benjamin, qui voit que la seule locomotive, c’est le Capital, qui menace l’humanité, comme il le craignait, de « s’accomplir dans une autodestruction catastrophique ». L’urgence, c’est de l’arrêter, ou, selon une autre formule de Benjamin, de « couper la mèche avant que l’étincelle n’atteigne la dynamite. »
Vous avez choisi de mettre en conclusion de votre ouvrage une citation du Bilan de l’intelligence de Paul Valéry qui fait l’hypothèse que la pensée humaine serait une anomalie dont le destin serait de disparaître, soudainement, comme elle avait surgi. On va encore vous accuser de vouloir dévaloriser l’être humain !
Encore une fois, il s’agit de lucidité et de réalisme, à partir du savoir que nous procurent les sciences contemporaines. L’Anthropocène nous impose de concevoir le phénomène anthropologique à l’échelle des temps géologiques, et de nous demander quel est le sens de l’irruption au sein de la nature de l’être dénaturé. L’homme émerge à partir de l’animalité, son devenir est le processus de son hominisation et de son humanisation, il porte en lui la promesse de l’humanité. Le mot « humanité », en français, est d’ailleurs ambigüe : il désigne à la fois un état de fait (l’ensemble des êtres humains) et une exigence éthique (la bienveillance, la bonté). C’est parce que l’homme est porteur de cette promesse que, à la suite de Benjamin, je reprends le concept de messianisme. Nous savons que l’espèce humaine est en évolution dans le temps, nous savons d’où elle vient, nous savons ce dont elle est capable, nous savons à quel degré de sublime elle s’est élevée, dans ses œuvres, mais aussi dans ses pratiques, puisque elle est effectivement capable d’amour et de bonté : on a tendance à l’oublier, mais le fait est avéré. La question est de savoir où elle va. Notre époque nous dirige-telle vers un accomplissement de l’humanité de l’homme, qui établirait le règne de la liberté, de l’égalité, de la fraternité ? C’était l’espoir de Marx, celui de l’accomplissement de la promesse messianique, et cette hypothèse n’est pas niaiserie : elle était l’idéal de la Révolution française, elle est toujours celui de la République. Mais notre époque impose aussi l’hypothèse que le processus d’humanisation de l’animalité soit remplacé par un processus de mécanisation de l’humanité, qui établirait le règne de la machine : certains y travaillent, ce sont les transhumanistes et les prophètes de la « singularité technologique ». À moins que ne l’emporte ce que Freud appelait la « pulsion humaine d’autodestruction », dans le processus de liquidation totale qui définit le capitalisme, où « tout doit disparaître », comme l’indiquent à intervalles réguliers les vitrines des magasins. En ce cas, Valéry a raison, l’homme n’aura été rien d’autre qu’un phénomène tératologique, un accident de l’évolution, un déraillement. C’est précisément ce qu’il faut conjurer, c’est pourquoi j’ai tant été frappé par les paroles de Sartre, qui en 1975 concluait ainsi son Autoportrait à 70 ans : « Ou bien l’homme est foutu — et, dans ce cas, non seulement il est foutu, mais il n’a jamais existé : les hommes n’auront été qu’une espèce, comme les fourmis — ou bien l’homme se fera en réalisant le socialisme libertaire. Quand j’envisage les faits sociaux particuliers, j’ai tendance à penser que l’homme est foutu. Mais si je considère l’ensemble, je me dis que la seule chose à faire, c’est de souligner, de mettre en valeur et de toutes ses forces ce qui peut amener une société d’hommes libres. Si on ne le fait pas, on accepte que l’homme soit de la merde. » Telle est notre tâche : faire en sorte que l’Anthropocène soit autre chose que Coprocène.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.