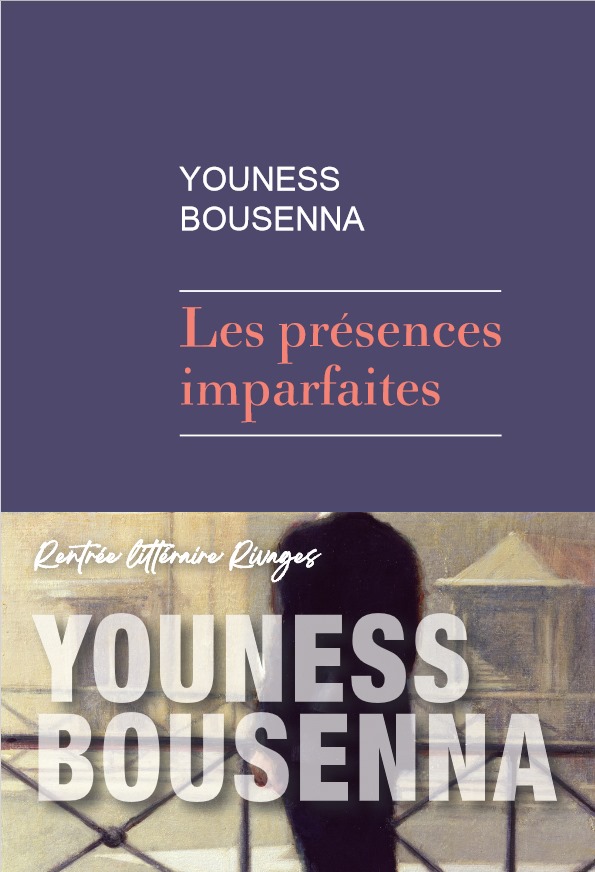Journaliste et collaborateur de notre revue, Youness Bousenna publie son premier roman Les Présences imparfaites aux éditions Rivages. Déjà auteur de Albert Camus, L’éternité est ici (Première Partie, 2019) et co-directeur de l’anthologie Résister à la modernité (éditions du Rocher, 2020), il dresse ici le portrait d’un homme, Marc, qui a raté sa vie à force de vouloir la réussir. Au crépuscule de sa cinquantaine, ce dernier déroule dans une confession le fil d’une existence marquée par une quête d’intensité qui s’est heurtée sur une vacuité résidant, entre autres, dans son incapacité à aimer.
PHILITT : Le héros de votre roman, Marc, a été marqué au fer rouge par une adolescence ennuyeuse dans la banlieue parisienne, à Thiais. En quoi cet ennui constitue-t-il pour lui la source d’une révolte ?
Youness Bousenna : L’ennui adolescent, qui va façonner l’égoïsme existentiel de ce personnage, repose sur une dialectique cherchant à articuler deux approches romanesques, l’une définissant l’individu par ses déterminations sociales et l’autre, aux antipodes, le considérant à travers des essences. Un premier terme tient donc à une part intemporelle, qui est la question de l’attente : Marc est construit sur le postulat qu’une vie n’est vivable que si l’on peuple le temps à venir de quelque chose qui lui donne un sens – une augmentation de salaire, le paradis après la mort, une vie d’influenceur à Dubaï –, à l’image de Vladimir et Estragon attendant Godot ou Drogo les Tartares aux confins du désert.
Marc est de ce fait confronté à une question qui n’a ni époque ni frontière, mais depuis sa condition particulière qu’est une jeunesse passée dans une banlieue parisienne morne, où tout conspire à éteindre le sens. C’est pour cela que, dès le début du roman, j’ai voulu poser cet enjeu à travers une situation sociale, évoquant une « lutte des classes secrète, qui divise le monde entre ceux qui s’amusent et ceux qui s’ennuient » : l’ennui adolescent naît dans une haine envers les nantis que Marc s’imagine, faute de les connaître vraiment. Cette haine féconde une révolte, qui n’est pas politique mais ontologique. Il se promet alors de vivre pour lui, de rattraper le temps gaspillé de la jeunesse.
Assez tôt dans le livre, une phrase vient synthétiser la destinée de Marc : « J’ai réussi ma vie à ce prix [en cédant à la colère], et je l’ai perdue aussi. » De quelle nature est cette « réussite » qui est aussi, et surtout, un échec ?
Cet enfant de la classe moyenne est né en 1961. Il fait donc partie de la première génération à pouvoir choisir son avenir, grâce notamment à l’accès aux études supérieures, en étant guidé par un horizon quasi-théologique : « trouver sa voie ». En cherchant à réussir sa vie, Marc fait finalement sienne une aspiration qui est avant tout une injonction contemporaine – il est, en cela, le produit de son temps. Cependant, Marc ne donne jamais réellement forme à ce désir. J’ai précisément voulu que la mécanique du roman ouvre sans arrêt des fenêtres nouvelles sur son existence : l’ambition professionnelle en devenant grand reporter au Figaro, l’exaltation du voyage et du journalisme de guerre, l’amour avec Claire, le goût des autres à l’occasion d’une grève au sein de la rédaction, et enfin un horizon ouvert par la transcendance spirituelle.
Marc a donc réussi sa vie au sens social, ayant accumulé des gratifications qui devraient suffire à étancher sa vanité, mais il sait que la misère qui déclenche cette confession alors qu’il a 58 ans se situe sur un autre plan : l’accumulation de petits succès n’a éternellement pu masquer la défaite, qui est d’ordre éthique, et qui, à ce moment clef de sa vie, provoque son effondrement intérieur. L’énergie sur laquelle repose le roman achève alors de produire ses effets. La colère, qui a tracté sa vie et son obsession de s’échapper de lui-même, produit simultanément son impasse – car cet égoïsme cache, au fond, une haine de soi. Marc se retrouve alors comme Clamence, l’avocat au centre de La Chute d’Albert Camus, dont hérite la forme romanesque des Présences imparfaites, pourvu de sa lucidité comme dernière arme pour examiner cet échec. L’ultime combat s’engage alors contre lui-même pour cerner son mal et peut-être, grâce à la confession, sauver quelque chose par le verbe.
À plusieurs reprises, par la voix du narrateur, vous semblez réfléchir sur la vanité qui accompagne toute entreprise littéraire. Quelles sont selon vous les motivations profondes de celui qui veut entrer en littérature ?
La vie de ce personnage est traversée par deux actes d’écriture. En marge de sa profession de journaliste, Marc sera l’auteur de quatre romans. L’écriture du premier, Le Petit chef (1984), inspiré par la détestation pour son supérieur au Figaro, est motivée par l’envie de séduire Claire, qui deviendra sa compagne. En 1998, le troisième, Nos Défêtes, qui se présente comme un texte restituant l’atmosphère des années 1990, parvient à être sélectionné sur la deuxième liste du prix Renaudot. Une petite aura littéraire se pose sur lui, mais elle se dissipera avec son dernier titre, Les Mains pleines (2009), dont l’échec le conduit à mettre un terme à sa carrière de romancier. Cette énumération sous-entend la nature de l’auteur qu’il est : un écrivain de circonstance, intermittent, pour qui le geste d’écriture est indissociable d’une envie de plaire.
Mais un événement, qui se dévoile à la fin du roman, produira la nécessité d’un autre acte d’écriture, cette fois-ci mû par une recherche de vérité. Cette confession, qui forme donc mon roman, est immédiatement présentée comme le « livre ultime » et non destiné à la publication. Écrire pour ne pas être lu : le paradoxe que constitue le statut de ce texte interroge la tension au cœur de la création littéraire. Marc l’explicite lui-même en disant que « l’écriture, c’est l’orgueil de s’offrir à la lecture du monde entier emballé dans l’humilité d’en douter ». Il y a donc un mélange inextricable de modestie extrême – oser présenter son imperfection créative – et de prétention extrême, puisque publier équivaut à postuler que l’humanité entière pourrait lire son œuvre. Malgré son refus de la publication, cette tension n’épargne pas totalement Marc. Tout en postulant d’emblée que tout est perdu, l’acte de l’écriture porte en lui-même une attente en forme d’aveu : la littérature peut quand même sauver quelque chose, parce qu’il reste toujours la possibilité de réussir son échec.
Afin de conjurer l’ennui qu’il redoute plus que tout, votre héros cherche à intensifier son existence, notamment en embrassant une carrière de journaliste au service international du Figaro. Que dit de notre époque cette perpétuelle quête d’intensité ?
La « mort de Dieu » qui caractérise la modernité bouleverse le rapport à l’existence : sans perspective d’au-delà, l’horizon se rétrécit à l’échelle de la vie et l’éternité se transforme en perpétuité. L’existence se retrouve sommée de combler, en quelques décennies, les aspirations stérilisantes à la réussite évoquées plus haut, dont la caractérisation principale tient en effet à la quête d’intensité. Dans La Vie intense. Une obsession moderne (Autrement, 2016), Tristan Garcia donne une architecture philosophique à cette intuition, faisant de cette intensité le corollaire ontologique de l’énergie électrique, dont la domestication a rendu possible le mode de vie moderne. Cette électrisation intérieure, qui se substitue à ses yeux au salut, devient le moteur de son propre sentiment de puissance et le fétiche de sa singularité.
Cet arrière-plan nourrit la perpétuelle recherche d’intensité de Marc. Mais la superposition des expériences produit le même effet que des électrocutions : des secousses puissantes, mais éphémères. L’intensité contient ainsi sa déception. Au fond de ce personnage, il se livre ainsi un combat souterrain entre la « quantité » et la « qualité », entre un vécu dopé par l’addition de stimulations grisantes mais sans cesse guetté par l’essoufflement – puisqu’elles contraignent à courir après leur renouvellement – et une existence qui aurait conjuré cette mécanique par le cheminement vers un plan ontologique plus profond. Or, en faisant le constat que « pour aimer sa vie, il faut aimer autre chose », Marc réalise qu’un tel état, qu’il envie sans trouver la force de s’y hisser, ne s’atteint que par une voie d’intériorité qui lui échappe constamment.
Vous êtes également journaliste. Comme lui, éprouvez-vous des sentiments ambivalents vis-à-vis de la profession que vous exercez ?
Mon roman dépeint le monde du journalisme sans illusion, parfois même crûment. Comme tout milieu de pouvoir, et peut-être tout milieu tout court, il y a des intérêts, des connivences et des compromissions. Le regard prosaïque posé sur le journalisme de guerre, la proximité de la direction du Figaro avec le pouvoir politique ou l’emprise des logiques du capitalisme avec le rachat par Dassault en 2002 sont autant d’épisodes qui vont à rebours de l’idéalisation de cette profession. Pour autant, j’ai voulu me démarquer de la tradition marquée par Illusions perdues, qui oppose la pureté de la création littéraire à la prostitution représentée par le journalisme, où l’écriture n’est qu’une pratique utilitariste au service d’ambitions obscènes.
Cette démarcation tient à trois raisons. D’abord, contre cette tradition du mépris, mon livre fait aussi place à mon goût pour ce métier, qui a sa beauté et sa nécessité. Par ailleurs, la haine balzacienne du journalisme me semble doublement datée : sur le plan littéraire, car elle est devenue un lieu commun, et sociologique – le métier n’est plus, pour la grande majorité, synonyme d’accès à la grande bourgeoisie, comme à l’époque de Rubempré. Plus profondément, le refus d’appréhender cette profession sur le mode de la corruption répond à un désir d’échapper au cadre axiologique de Balzac, c’est-à-dire le romantisme. Cela se traduit par l’envie de délaisser les manichéismes de la pureté cantonnant la lecture du réel à deux pôles, la perfection et la corruption : le journalisme n’est ni intrinsèquement idéal ni intrinsèquement vicié. C’est pour cela que je le traite aussi en lieu de travail comme les autres, avec sa machine à café, ses petites habitudes et ses combats sur la température de la clim.
Léon Bloy disait du bourgeois qu’il était « incapable d’aimer ». Est-ce cette malédiction qui frappe votre héros dans sa relation avec Claire ?
Il est vrai que, issu de la classe moyenne, sa profession lui permet d’acquérir un capital économique et symbolique le rapprochant de la bourgeoisie. Mais cette ascension n’est pas évoquée en termes sociologiques, et le roman s’attache assez peu à explorer ce que ce statut lui offre en tant que dominant car ce n’est pas la dimension qui m’intéresse. Je situe d’abord mon texte sur le plan ontologique, et c’est à travers ce prisme que j’ai tenté de construire son incapacité à aimer. Claire, avec qui il restera en couple une quinzaine d’années, est une personne naturellement lumineuse, étrangère aux méchancetés, qui tient sa liberté radicale de se suffire à elle-même. Dans sa présence comme dans son absence, elle sera jusqu’à l’issue du roman sa moitié à la fois nécessaire et impossible.
Ce mal qui le ronge et qui le rend incapable d’aimer tient à la structure même de son égoïsme, qui relève d’une haine de soi. Si « pour aimer sa vie, il faut aimer autre chose », la relation avec Claire exhibe l’autre part de cette circularité : pour aimer il faut s’aimer. Ainsi, les marques d’attention et d’affection ne provoquent qu’un dégoût et une perfidie croissants chez Marc, comme une pulsion d’abaissement face à ce qui pourrait l’élever. Dans ce passage, j’ai voulu rendre une zone qui me semblait peu explorée dans l’écriture des relations, c’est-à-dire les cruautés banales que l’amour comporte souvent. Pour Marc et Claire, cette logique mènera leur relation vers une expérience-limite, un abîme que le lecteur découvrira, et qui parachève la mécanique. Le roman est ici marqué par une théologie négative empruntée à Baudelaire, une postulation vers le Mal qui tient dans l’œuvre de ce dernier au compagnonnage avec Satan. Pour le formuler dans les termes de l’exorcisme, registre capital chez Baudelaire, cette théologie voudrait que le contact avec le Bien d’un être souffrant de cette infestation le conduise, non pas à la rédemption, mais à une chute encore plus profonde dans le Mal. C’est contre cette morsure au cœur de son être que Marc doit donc se débattre, écartelé entre sa méchanceté pulsionnelle et la souffrance qu’elle lui inflige.
Le personnage de Mireille incarne jusqu’à la caricature une forme d’antimodernisme de type guénonien. Ce rejet univoque de la modernité vous agace-t-il ?
Au contraire, j’ai beaucoup de tendresse pour le personnage de Mireille, pour son errance au milieu du monde. Cette vieille journaliste du service religions, qui a préféré rejoindre le service économie pour éviter de partir à la retraite, vit dans une obsession eschatologique : pour elle, tout fait signe. De ce fait, elle développe une existence désincarnée, où sa seule passion consiste à s’immerger dans des extrémités mentales, qu’elles soient mystiques, mathématiques ou philosophiques. À travers elle, je glisse plusieurs clins d’œil à l’ésotérisme – les initiés identifieront une phrase de René Guénon glissée dans mon texte – ainsi qu’à la littérature du Paris occulte, en particulier lorsque Mireille entraîne Marc avec elle dans une séance de sa petite société secrète du Quartier latin. Je n’aborde donc pas son anti-modernité avec une sévérité qui la réduirait à une sclérose de l’esprit. Je crois au contraire que cette façon d’aborder le réel la rend touchante, parce qu’elle répond à un besoin de sens, à la nécessité que « tout ça » ne veuille pas rien dire.
Cette solitude n’est d’ailleurs pas un isolement, car son psychisme particulier n’est qu’une réponse à une condition qui concerne les personnages principaux du roman, et qui fait écho à une dimension de l’expérience évoquée par le philosophe Clément Rosset. Celle-ci pourrait se résumer ainsi : il faut un double pour affronter le réel qui, dans sa nudité crue, est intenable. Cette échappatoire, qui est l’autre nom de l’attente, oriente le rapport au monde de chacun. Claire, dotée d’une lumière qui augmente sa présence ici et maintenant ; Mireille, qui s’évade dans le monde de l’esprit pour fuir le non-sens de la matière ; Marc, qui remplit sa vie de propulsions pour ne jamais se retrouver lui-même, maintenant ; son père, qui sature sa vie d’habitudes, comme si la répétition allait freiner le passage du temps. Chacun a besoin de quelque chose – une fiction, une obsession, un aveuglement – pour apprivoiser le réel, et son épreuve du sens qui nous étreint à chaque instant.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.