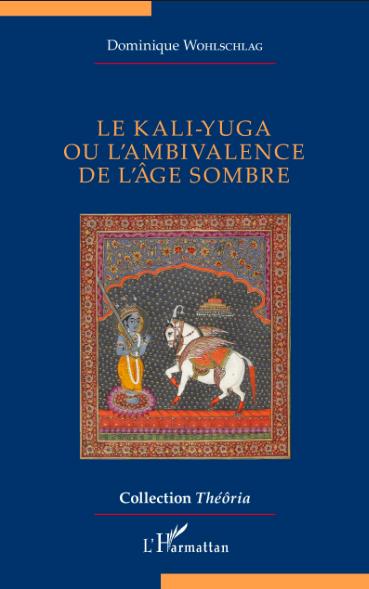L’indianiste et sanscritiste Dominique Wohlschlag, collaborateur émérite au Musée d’ethnographie de Genève, publie, après les Clés pour le Mahâbhârata (Infolio, Gollion, 2015), Le Théâtre de l’extase (2018) et Aux Sources de l’hindouisme (2020), un livre intitulé Kali-Yuga ou l’ambivalence de l’âge sombre (L’Harmattan, Théôria). Par un examen rigoureux des textes fondateurs de l’hindouisme et de leur comparaison avec les autres traditions, l’auteur délivre une vision paradoxale de la modernité, dont la dégénérescence anthropologique et cosmique sans précédent s’accompagne de possibilités de salut nouvelles qui mettent l’héroïsme spirituel à la portée des dernières âmes attentives aux signes des temps.
L’hétérogénéité de la famille de pensée antimoderne que soulignait Antoine Compagnon ne fait que refléter la diversité des conjectures des écrivains Occidentaux sur les origines de la modernité. Face aux hésitations des antimodernes, pour qui la modernité remonte tantôt à la Révolution Française, tantôt à Descartes ou tantôt à l’année 1881, les sciences traditionnelles de l’Inde antique font preuve au contraire d’une remarquable rigueur dans l’identification de « l’âge sombre » de l’humanité. En effet, l’écriture de la grande épopée du Mahâbhârata au IIIe siècle av. J.-C., marque un changement d’orientation mythologique majeur dans l’Inde antique. Tandis que les récits sacrificiels des Veda étaient tournés vers les commencements du monde, l’ensemble formé par le Mahâbhârata et les Lois de Manou (Mânavadharmashâstra) inaugure une perspective eschatologique où la conscience spirituelle de l’Inde se tourne vers la compréhension de la fin du monde. Par des observations astronomiques et leurs inférences symboliques, soutenues par une puissante « intuition métaphysique », l’Inde antique en vient ainsi à constituer une science très précise des cycles universels dont chacun, les mahayuga, se déroulent selon un devenir involutif de quatre âges allant du plus excellent au plus terrible, selon un raccourcissement progressif du temps : le krita-yuga, le tretâ-yuga, le dvâpara-yuga puis le kali-yuga, respectivement caractérisés par 4800, 3000, 2400 et 1200 années divines, soit, rapportées en termes humains ou géocentriques par les Lois de Manou qui les multiplient par 360, un total de 4 320 000 ans, dont 432 000 en tout pour le seul kali-yuga. Or, il ne fait aucun doute que ce que l’Inde désigne par « l’âge sombre » ou « âge de Kali » se rapporte bel et bien au monde moderne auquel nous assistons : « Le dérèglement climatique, les flux migratoires, le bouleversement des mœurs, l’érosion des religions et la dissolution des familles sont en effet les signes les plus communément cités dans les descriptions anciennes de la fin du kali-yuga ». Ainsi « le devenir du monde s’est avéré de plus en plus conforme aux prédictions “apocalyptiques” du Mahâbhârata », et, à sa suite, des textes puraniques (Bhâgavata-puranya) qui constituent la « forme la plus aboutie » de la doctrine des quatre âges dans l’Inde du VIe siècle.

La doctrine universelle des quatre âges
La prédiction initiale de 432 000 ans pour le dernier âge (ou 4 320 000 ans pour l’ensemble du cycle) n’est pourtant pas l’apanage de l’Inde ancienne. Dans une démarche de « mythologie comparée » qui confirme à bien des égards l’idée de René Guénon selon laquelle existe, derrière l’apparente diversité des mythes et des doctrines spirituelles, une tradition perpétuelle et unanime qui transmet une sagesse fondamentalement commune, Dominique Wohlschlag cite les analyses de Robert Bolton qui, entre autres exemples, « retrouve par exemple le chiffre de 432 000 ans dans les Eddas d’Islande » et remarque que « le calendrier maya débute en 3113 av. J.-C., soit onze ans seulement avant la date indienne retenue pour le début du kali-yuga », sans parler, « d’un point de vue symbolique », de l’incontestable « universalité de certains mythes cosmologiques tels le déluge, la dégradation progressive des conditions de vie ou les références au zodiaque ». Cette universalité doit d’autant moins surprendre qu’on retrouve la doctrine cyclique des quatre âges cosmiques en Grèce avant l’Inde, ainsi que dans la Bible. D’une part, au moins quatre siècles avant la rédaction du Mahâbhârata, « Hésiode dans Les Travaux et les jours puis Homère dans L’Iliade et L’Odyssée » énoncent une involution quaternaire du temps à laquelle ils assignent le symbolisme des métaux : « un âge d’or », « période idéale [qui] fut suivie d’un âge d’argent, puis d’un âge de bronze et finalement d’un âge de fer dans lequel nous nous trouvons actuellement ».
Mais surtout, Dominique Wohlschlag s’oppose à l’opinion très courante, notamment énoncée par Jacques-Albert Cuttat selon laquelle le temps judéo-chrétien serait un temps linéaire qui s’opposerait au temps cyclique des autres traditions, et inaugurerait ainsi la notion d’histoire. Or, comme le fait remarquer l’auteur, « la notion d’ “histoire”, au sens habituel du terme, apparaît en Grèce avec Hérodote, au Ve siècle avant J.-C., indépendamment de la tradition hébraïque » ! D’ailleurs, et n’en déplaise au littéralisme des créationnistes niais, il faut rappeler que si « la Bible compte 5784 ans depuis la Chute », son exégèse interne rappelle que « mille ans sont, à tes yeux (Dieu), comme le jour d’hier » (Psaume XC, 4) ; « qu’un jour devant le Seigneur est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour » (2 Pierre III, 8). Il ne s’en faudrait pas de beaucoup pour établir la multiplication, et de constater, dans ces conditions, que les presque 6000 ans « divins » qui nous séparent de la Chute selon la Bible correspondent en fait à plus de 2 milliards d’années humaines ! Seulement, « l’incidence de cette herméneutique sur l’imaginaire chrétien, pourtant commune aux deux Testaments, a certainement été moindre que le calcul puranique indien ».
C’est pourquoi l’auteur attire plutôt l’attention sur les correspondances mythiques. D’une part, il relève que la théorie de la répétition des cycles a été formulée par le père de l’Église Origène dans son Traité des Principes (III, 5, §3), lequel se fondait sur deux livres de l’Ancien Testament : « Isaïe (LV, 17) enseigne qu’après ce monde il y en aura un autre : “Il y aura un monde nouveau et une terre nouvelle, que je ferai subsister toujours devant ma face”, dit le Seigneur. Et l’Ecclésiaste (I, 9) montre qu’avant ce monde il y en eut d’autres : “Qu’est-ce qui a été fait ? La même chose qui sera. Et qu’est-ce qui a été créé ? La même chose que ce qui sera créé.” […] Les témoignages prouvent les deux points, que des siècles ont existé avant nous et que les siècles existeront après nous. » D’autre part, Dominique Wohlschlag attire l’attention sur la vision du « colosse aux pieds d’argiles » par Nabuchodonosor (Daniel II, 32-35), qui, dans le songe, finit par être détruit et remplacé par une vaste montagne. Or, « cette figure anthropomorphe renvoie d’un côté aux métaux attribués par la tradition grecque aux quatre âges » (tête d’or, poitrine et bras d’argent, ventre et cuisses d’airain, et pieds de fer mêlé à de l’argile), « et de l’autre aux quatre castes de l’Inde telles que les décrit l’Hymne de l’homme (purusha sûkta) du Rig-Veda (X, 90) où les brahmanes correspondent à la tête, les kshatryas (guerriers) aux bras, les vaishyas (commerçants) aux cuisses et les shûdras (serfs) aux pieds. » La doctrine des cycles n’est donc pas propre à l’Inde, bien que cette culture en ait établi une analyse mathématique d’une précision inégalée. Au contraire, « il y a donc, dans le monde biblique, comme en Grèce, et surtout en Inde, exactement à la même période, l’émergence parallèle d’une eschatologie laissant prévoir un avenir à la fois sombre, très sombre même, puis lumineux en fin de compte ».
L’âge sombre
Dans les textes traditionnels de l’Inde, le nom d’ « âge sombre » qualifie par métonymie les temps modernes : l’enténèbrement sensé caractériser en propre la modernité se rapporte en effet, plus exactement, à la première des deux phases de la dégénérescence propre au dernier âge, que René Guénon appelle, dans Le Règne de la Quantité et les Signes des temps (1945), la « solidification du monde ». À ce titre, le livre de Dominique Wohlschlag est une actualisation et un prolongement de ce maître-ouvrage de Guénon, car « nul n’a si bien montré, ni avant lui, ni après lui, à quel point la doctrine des quatre âges qui est à la base de son analyse du “règne de la quantité” offre des clés de compréhension claires et précises pour interpréter les dérives particulières du monde moderne, forcément décrites en termes imagés et symboliques dans la littérature ancienne. » Or, « enténèbrement » et « solidification » ne représentent « en fin de compte que deux faces d’un seul et même phénomène : la solidification engendre une opacité et cette opacité est précisément ce qui empêche l’homme moderne de voir ou de sentir la réalité derrière des apparences désormais dépourvues de toute transparence ». Cette solidification conceptualisée par Guénon « résulte d’une sorte d’amalgame entre les notions de matérialisation, de quantification et d’inertie » qui, dans l’ordre théorique, désigne le matérialisme philosophique et scientifique de la première modernité (Lumières et siècle industriel), et qui, dans l’ordre pratique, se vérifie visuellement par « la dégradation écologique de la planète », le « mitage des territoires », le « bétonnage des villes », « la prolifération des autoroutes », « la pollution lumineuse, sonore ou chimique », mais aussi « l’envahissement de la sédentarisation » et le raidissement « intégriste » de l’islam contemporain.
Quant à la seconde et dernière phase de la modernité, elle fait référence à la « dissolution » (pralaya) finale du monde et de ce monde-ci, où « le monde est alors “renversé” (viparite loke), ce qui constitue une “catastrophe” (de kata-strephô, retourner) », au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, en effet, la dissolution du monde est notamment décrite par la Bhâgavata-purânya par la succession de « catastrophes cosmiques ». En particulier, « une sécheresse de cent ans » où « les hommes, à la recherche de nourriture, se battront entre eux et se livreront au cannibalisme, jusqu’à ce que le feu du Serpent cosmique (adichesha) réduise tout en cendres », selon une étonnante proximité, de nouveau, avec les « scénarios stoïciens prévoyant une future destruction du monde par le feu », ou, selon la liturgie grégorienne, « le monde sera réduit en cendres (in favilla), au témoignage de David et de la Sibylle ». On ne peut ici que songer aux menaces contemporaines du « réchauffement climatique » et de la « diminution de la biodiversité ». Quant au sens figuré, il s’agit plutôt des « bouleversements sociaux » sur lesquels le poète visionnaire Mârkandeya insiste surtout pour la fin de ce cycle. Il prévoyait toutes les « fissures [des] frontières », aussi bien « géographiques, sociales ou idéologiques » auxquelles nous assistons effectivement : les « problèmes migratoires » (le déménagement du monde), la « dissolution des traditions ou des religions » – dont l’auteur décrit de nombreux symptômes –, la désagrégation légale de l’institution du mariage, et tous les autres symptômes relevant de ce que le sociologue Zygmunt Bauman appelait à sa manière la « société liquide ». Pire : le dernier âge, si l’on tient compte de la « précession des équinoxes » fidèlement aux calculs puraniques, serait beaucoup plus court que les 432 000 ans prévus sans cette variable : il ne resterait à parcourir que 1353 ans à compter de 2025 avant que notre monde ne passe.
L’ « âge béni » des humbles
Ce gros millénaire paraît certes court absolument parlant, mais autrement plus long que les prophéties catastrophistes. D’ailleurs, les débats décrits par le Mahâbhârata entre les protagonistes « englués dans la guerre du Kurukshetra tentant interminablement de définir un dharma » montrent en fait que ce genre de spéculations est « devenu plus conjectural que jamais ». De plus, si la solidification du monde à sa dissolution est bien « l’âge sombre » (kali-yuga), Dominique Wohlschlag fait remarquer combien la couleur noire véhicule elle-même un symbolisme mélioratif, celui de « la Divinité indifférenciée » attribuée au dieu Krishna. Ainsi l’âge sombre serait à d’autres égards « un âge “béni” ». En effet, « jamais, disent les textes, la réalisation spirituelle n’a été aussi facile et accessible pour le grand nombre ». Dans le Vishnu-purânya (VI, 2), Vyâsa s’exclame ainsi, après avoir plongé dans le fleuve sacré du Gange, « que l’âge de Kali [est] véritablement excellent », en particulier « bénéfique pour les hommes de la quatrième caste, les shûdras », « de même pour les femmes ». En effet, l’involution du cycle consiste à chaque fois en une domination de la caste inférieure et de son moyen spirituel de réalisation, sur la caste supérieure et son rite propre. Au deuxième âge correspondait ainsi la domination des guerriers (kshatriya) sur les contemplatifs (brahmanes), de sorte que « le moyen spirituel caractéristique de cette époque [était] le sacrifice », selon le Bhâgavata-puranya (XII, 3, 52). Dans le troisième âge (dvâpara-yuga) où dominait « la mentalité du peuple des paysans, des marchands et des artisans (vaishya) » correspondait « l’adoration » ou « circumambulation, prise comme une synecdoque de l’ensemble des gestes, des inclinations, prosternations, salutations, offrandes diverses, etc. ». Or, « ce qui change avec le quatrième âge […] est que la bhakti (la dévotion) peut se résumer à l’invocation de l’un ou l’autre des Noms divins ».
L’invocation s’avère, dès lors, la voie de réalisation spirituelle la plus adaptée au monde moderne, « perçue comme une grâce particulière offerte par Dieu à l’homme “amoindri” de la fin des temps » : « d’âge en âge, la réalisation spirituelle exige de moins en moins d’efforts des hommes ». Pour le grand nombre, le dernier âge est ainsi l’âge de la bonne nouvelle. En effet, « l’homme du kali-yuga a largement perdu les qualités constitutives des premières castes, respectivement la concentration, le courage et la persévérance, autrefois nécessaires pour parvenir au but de la vie sur terre ». Il ne reste donc à l’homme moderne qu’une dernière vertu : « la fidélité ». Or, le dépositaire privilégié de cette vertu est l’homme de basse caste : dans le Mahâbharata, la fidélité est la vertu évidemment attribuée au « chien, [qui est] l’animal emblématique des shûdras ». Chose remarquable, d’ailleurs, « dans la tradition chrétienne, on a fait de saint Dominique », qui est justement le représentant chrétien de la voie de l’invocation par « la dévotion du rosaire », « le Domini canis, le chien du Seigneur, dans l’intention de souligner sa fidélité au Christ ». Or « l’humilité (vinaya, amânitva) », qui est la sœur de la fidélité, est justement « cette vertu reconnue comme indispensable pour pratiquer la voie invocatoire », y compris dans le soufisme qui enseigne qu’« il n’y a pas de dhikr (invocation) sans faqr (pauvreté spirituelle) ».
Finalement, si la modernité est l’âge sombre où s’accumulent les démissions et les dissolutions, tant physiques que morales, elle est aussi l’âge béni. Les individualités exclues des anciens systèmes hiérarchiques s’y trouvent être en état de réaliser leurs meilleures dispositions spirituelles, à l’image du premier âge où, selon les textes hindous, « il n’y avait pas de castes », car n’existait que la « caste unique » de Hamsa. Ainsi les quelques âmes de sagesse restantes, issues de tous les milieux sociaux, peuvent-elles se réjouir de leur privilège de pouvoir restaurer la lumière au milieu des ruines, en disant, avec la « Vierge Rouge » : « Tu ne pouvais pas être née à une meilleure époque que celle-ci où on a tout perdu. »[1]
[1] Simone Weil, La Pesanteur et la grâce, « L’harmonie sociale », Plon, 1991, p. 270.
©Crédits photo : Sage sikh dans une foule urbaine / Thomas le Helloco
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.