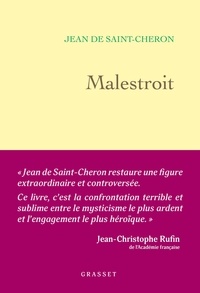Dans Malestroit (Grasset, 2025), l’écrivain Jean de Saint-Cheron nous permet de découvrir la figure stupéfiante d’Yvonne-Aimée de Malestroit née Yvonne Beauvais (1901-1951). Cette femme hors du commun a mené une existence radicale tant sur le plan temporel que spirituel. Dans sa jeunesse, elle aidait les pauvres au quotidien dans la banlieue parisienne, plus tard, elle fonda un hôpital dans le couvent de Malestroit avant de s’engager dans la Résistance. Mais à ses accomplissements concrets répondent aussi son combat contre le malin, ses profonds élans mystiques et les nombreux miracles qu’elle aurait accomplis. Loin de déceler une tension entre ces deux aspects de son existence, Jean de Saint-Cheron y voit la parfaite cohérence d’une héroïne de l’amour et de la charité.
PHILITT : Au début de votre livre, vous rappelez que le procès en béatification d’Yvonne Beauvais avait été clos par le cardinal Ottaviani, pourtant conservateur, mais « soucieux de ne pas effrayer le monde moderne et son scientisme ». Pourquoi la figure d’Yvonne Beauvais a-t-elle embarrassé à ce point le Vatican, malgré son CV irréprochable ?
Jean de Saint-Cheron : Elle n’est pas canonisée par l’Église, mais quasi-canonisée par la République. C’est important de le souligner. Son cas rappelle celui de Jeanne d’Arc, notamment quand, à la fin du XIXe siècle, la IIIe République a exalté sa figure dans le roman national. C’est le moment qu’a choisi l’Église pour se réveiller et la béatifier, puis la canoniser au début du XXe siècle. Mais, pour le moment, l’Église a laissé Yvonne Beauvais au monde profane qui a vu en elle une grande héroïne. Pourquoi l’Église a eu peur ? Je ne fais qu’émettre des hypothèses. Dans les années 60, le paradigme intellectuel dominant, que nous pouvons qualifier de scientiste, ne rendait pas facile de présenter au monde, en l’assumant jusqu’au bout, un personnage tout droit sorti des légendes du Moyen Âge : stigmatisation, don de prescience, apparition inexplicable autour d’elle de fleurs ou d’une odeur d’encens… Il était plus simple pour l’Église d’élever sur les autels des saints à l’allure plus rationnelle, même s’il y a des exceptions, comme le prêtre italien Padre Pio (1887-1968), dont la vie fut également, dit-on, nimbée de phénomènes extraordinaires, et qui sera finalement béatifié et canonisé en 2002 grâce à la ferveur populaire.
En 1960, Ottaviani referme violemment le dossier d’Yvonne Beauvais car l’Église n’a pas envie de se ridiculiser face au monde. Pour comprendre une telle position, il faut rappeler cela dit que toute l’histoire de l’Église déborde d’imposteurs mystiques et de faussaires du divin, s’attirant admirateurs et gloire plus ou moins éphémère. Cela explique que le Vatican soit toujours très prudent face à ce genre de cas. La canonisation d’un homme ou d’une femme dont il serait démontré après coup qu’il était un simulateur ou un pur halluciné discréditerait totalement le discours de l’Église sur le surnaturel. Une fois que l’institution religieuse a frappé une vie de son sceau, elle ne peut plus revenir en arrière. À cela s’ajoute le fait que, de son vivant, Yvonne Beauvais avait déjà eu des démêlés avec la hiérarchie de l’Église et que beaucoup de prêtres exorcistes avaient douté de la véracité des faits qui lui étaient attribués. Il y avait donc des éléments à charge dans le dossier, ce qui permet de comprendre qu’elle était pu être considérée comme une mystificatrice par le cardinal Ottaviani, même si le dossier a été extrêmement mal traité. Car il contient surtout des centaines de preuves qu’elle n’était ni menteuse ni mégalomaniaque. L’Église rappelle régulièrement que la sainteté, ce n’est pas les miracles. La sainteté, c’est l’exercice de l’amour. Ce n’est pas léviter ou faire jaillir des fleurs de son flanc ! Mais précisément, Yvonne a passé sa vie à secourir les autres, à se donner et à prendre pour eux ses risques inouïs, bref, à être héroïque dans l’amour…
Quelle est la position officielle de l’Église sur le surnaturel ?
L’Église a seulement reconnu deux cas de stigmatisés authentiques dans l’histoire, au XIIIe et au XIVe siècle, respectivement saint François d’Assise (1182-1226) et sainte Catherine de Sienne (1347-1380). Depuis, zéro. L’Église admet que cela peut exister, car Dieu est capable de tout. Mais notamment depuis les nouvelles normes édictées par le Vatican en 2024, l’Église ne se prononce plus sur le caractère surnaturel d’un phénomène, quel qu’il soit. Elle peut encore reconnaître certains miracles de guérison, comme à Lourdes. (Cela dit, sur les milliers de dossiers déposés à Lourdes depuis un siècle, seuls 71 d’entre eux ont été reconnus.) Mais concernant les phénomènes extraordinaires de la vie mystique (stigmates, bilocation, prescience…), l’Église peut dire qu’elle ne s’y oppose pas, mais n’affirme plus que tel phénomène inexplicable est incontestablement vrai. En revanche, elle peut affirmer dans certains cas qu’un phénomène, une vision par exemple, est faux.
À titre personnel, savoir si tel ou tel phénomène extraordinaire est matériellement exact ne m’intéresse pas tellement. Ce n’est en tout cas pas l’objet de mon livre. Ce qui me fascine, c’est l’existence de cette femme dont la vie intime était saturée d’événements mystiques – et il faut admettre que les nombreux témoignages sont à ce titre stupéfiants – et qui en même temps fut capable d’un pragmatisme impressionnant dans des circonstances très diverses : porter à bout de bras des familles misérables dans les bidonvilles de la banlieue parisienne des années 1920, puis entrer en religion et fonder un hôpital moderne, avec un sens étonnant des affaires pratiques, enfin s’engager de facto dans la Résistance… Je me suis demandé : y a-t-il finalement opposition ou cohérence entre cette vie mystique presque délirante et ce pragmatisme et cette énergie hors norme au service des autres ? On est loin de l’image de la stigmatisée maigre comme un clou qui passe sa vie dans son lit.
Vous semblez suggérer dans votre livre que le combat contre le démon et celui contre Hitler était pour Yvonne Beauvais un seul et même combat. Est-ce pour cette raison que sa vocation religieuse devait également s’exprimer dans la Résistance ?
Il y a une immense cohérence entre le combat spirituel qui est propre à la vie chrétienne et le combat temporel pour le bien dans notre histoire humaine. Pour beaucoup de chrétiens, la foi a été un moteur pour entrer en Résistance pendant la guerre. Par ailleurs, c’est intéressant de voir quelqu’un qui dit se battre contre le diable depuis quinze ans, et qui porte les marques physiques de ses affrontements sans qu’aucun médecin ni exorciste ait pu établir qu’elles étaient feintes, qualifier Hitler de « démon » dans les années 30 (avant la guerre). Je crois que ce n’était pas dans sa bouche une métaphore. En tout cas pas tout à fait, car Hitler n’est pas strictement pour elle un ange déchu, mais un possédé c’est certain. Un démoniaque au sens strict. Elle précisera même un peu plus tard qu’Hitler est « un démon d’orgueil ». C’est-à-dire le pire de tous. C’est le péché de Satan lui-même, celui qui veut remplacer Dieu.
En étudiant les archives et les témoignages, vous vous étiez vous-même dit que « c’était trop » et que « personne n’y croirait ». Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné dans son parcours ?
Ce qui m’impressionne le plus chez elle, c’est sa charité héroïque, poussée jusqu’aux limites de ce dont l’être humain est capable. Ce don-là entraîne une souffrance. L’exercice de l’amour est inséparable de la douleur en ce bas monde. Outre les tortures que lui infligea la Gestapo, Yvonne Aimée a passé sa vie à souffrir : d’épuisement du fait de son abnégation au service des autres, de maladies aggravées par son activité de servante des malades, ainsi que par son combat spirituel ahurissant. Et pourtant, elle est restée ce personnage bon-vivant, joyeux, simple, capable de gouverner sa communauté avec autorité et douceur. Son équilibre psychologique m’étonne. Et encore une fois son pragmatisme et son discernement. En temps de crise, on est loin de la morale kantienne : elle ment aux nazis les yeux dans les yeux (cela semble une évidence mais…), fait réaliser des faux-papiers, déguise des parachutistes en religieuses et les fait passer dans la clôture, ce qui est rigoureusement défendu par les règles de l’Église…
Contrairement au cardinal Ottaviani, pourquoi avez-vous eu envie de croire que tout cela est vrai, justement ?
Je suis arrivé à la très ferme conviction qu’Yvonne-Aimée n’était ni une faussaire ni une menteuse ni une manipulatrice ni une folle. Cela irait à l’encontre du pragmatisme avec lequel elle a mené sa vie temporelle. Cela contredirait de façon téméraire les centaines de témoignages très divers qui permettent de faire son portrait. Mes recherches m’ont permis de faire la rencontre d’une femme extraordinaire. Incroyablement attachante aussi, jusque dans ses histoires de cœur à 20 ans. Je pense aussi qu’elle avait une vie mystique extrêmement intense à laquelle je n’ai pas accès et que nul ne peut réellement comprendre.
Son existence est liée de manière très intime à la souffrance. Y a-t-il un dolorisme chez Yvonne Beauvais ? Est-ce que c’était une manière pour elle de se rapprocher de son grand amour, à savoir Jésus ?
Si le dolorisme, c’est l’exaltation de la souffrance pour la souffrance, il n’y a pas de dolorisme chez Yvonne Beauvais. En revanche, il y a un dolorisme chez elle dans la mesure où elle a compris qu’il n’y avait pas d’amour sans souffrance et qu’elle fait le choix d’aimer en dépit de la souffrance. Je dirais même qu’elle déteste tellement la douleur, qu’elle préfère souffrir elle-même par amour des autres plutôt que de laisser souffrir les autres. Son dolorisme n’est pas un délire mystique désincarné qui vise à se rapprocher de Jésus sur la Croix. Elle cherche bien plutôt à imiter la souffrance du Christ sur sa Croix, lui qui a accepté de souffrir pour que les hommes n’aient plus à souffrir. Yvonne-Aimée cherche donc à prendre sur ses épaules une part de la douleur du monde. Elle choisit de souffrir pour que les autres soient épargnés.
Yvonne Beauvais aurait toute sa vie affronté le démon dans des combats nocturnes desquels elle ressortait avec notamment de profondes lacérations dans le dos. Ces affrontements ont-ils été attestés par les autorités religieuses ?
Les autorités religieuses n’ont jamais affirmé que c’était faux. Tous les médecins qui se sont penchés sur son cas n’ont pas réussi à établir qu’il y avait une fraude. Mais il y a eu beaucoup de témoignages directs de ses supérieures lorsqu’elle était au couvent : des bruits de combat, un prêtre a vu les lacérations de sang apparaître sous ses yeux… On peut choisir d’y voir des hallucinations, mais aussi être intrigué par le nombre très important de témoignages concordants. Rien de mégalomaniaque chez elle non plus, car elle écrivait dans ses carnets intimes qu’elle aurait voulu une existence normale, « une vie comme tout le monde ».
Des témoins auraient assisté à un épisode de bilocation d’Yvonne Beauvais. Elle se serait rendue dans le bunker d’Hitler pour l’avertir : « Démon ! Ton règne ne sera pas de longue durée. Tu t’arrêteras. Et vite. » Un tel récit, par sa dimension excessivement spectaculaire, ne contribue-t-il pas à entretenir le soupçon ?
Le récit existe (mais les témoins étaient en France, et non en Allemagne…). On a le droit de le rapporter. Personnellement, je ne suis pas sûr d’y croire. Mais ce n’est pas ça qui est important. L’histoire d’Yvonne Beauvais se situe dans un ensemble d’une radicalité extrême. D’une certaine manière, elle a passé sa vie à être à mille endroits à la fois pour aider les pauvres et les souffrants. Cet épisode ne doit pas être compris comme un tour de magie qui surviendrait tout d’un coup, il faut l’inscrire dans le grand récit de son existence. Qui est incroyablement cohérent.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.