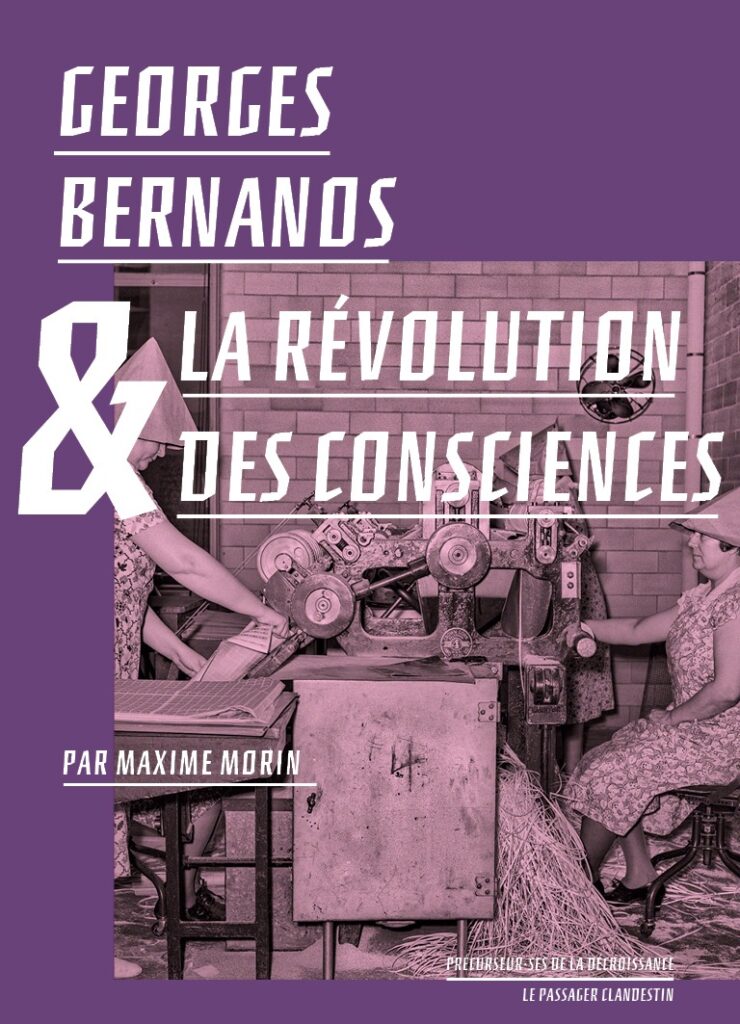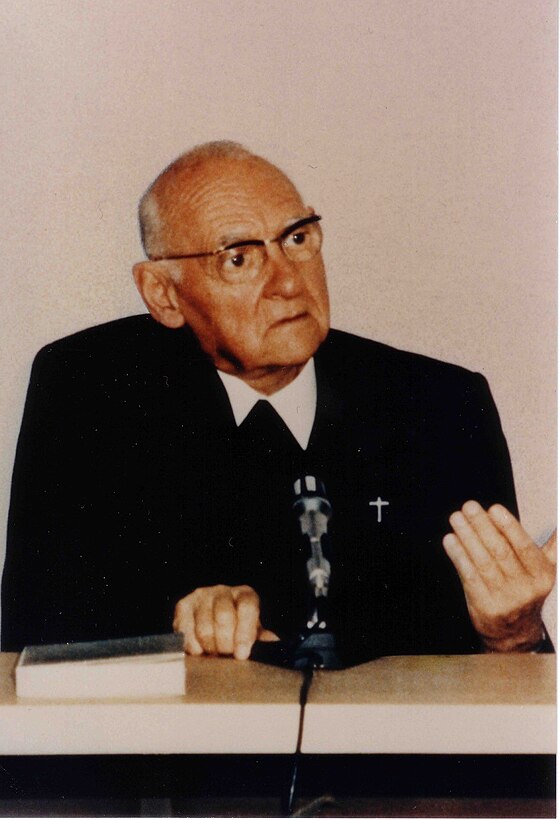Ancien élève de l’ENS de Lyon, Maxime Morin est actuellement doctorant à l’université de Lille et à l’université de Gand. Sa thèse porte sur la critique de la technique dans l’œuvre polémique de Georges Bernanos. Déjà auteur notamment d’un Dictionnaire de la vie postmoderne (Équateurs, 2023, avec Marguerite Hennebelle), il publie Georges Bernanos et la révolution des consciences (Le Passager clandestin, 2025), livre dans lequel il fait l’hypothèse d’un Georges Bernanos décroissant.
PHILITT : Dans votre essai, vous faites l’hypothèse d’un Georges Bernanos décroissant, mais, précisez-vous d’emblée, l’écrivain catholique ne défend pas pour autant de « projet politico-économique ». De quel genre de décroissance s’agit-il dans ce cas ?
Maxime Morin : Il est important de commencer par rappeler que ce livre repose effectivement sur une hypothèse, mais sur une hypothèse d’un type bien précis. Il ne s’agit pas de partir de la définition de la décroissance aujourd’hui en vigueur, c’est-à-dire celle qui s’est constituée à partir du fameux « Rapport Meadows » publié en 1972 par le club de Rome, et d’apporter cette définition de l’extérieur et rétrospectivement à l’œuvre de Bernanos afin de comparer celle-ci à celle-là pour déterminer leurs similitudes et leurs différences. Mon approche n’est pas hypothético-comparative. Il s’agit, bien plutôt, de prendre comme point de départ l’œuvre de Bernanos elle-même pour y faire apparaître, de l’intérieur et endogènement, une définition de la décroissance. Tout l’enjeu est donc de reconstituer, à partir du corpus, un élément lexico-conceptuel qui lui fait défaut en le déduisant des lois qui organisent la structure d’ensemble de ce corpus. Par exemple, il m’a semblé qu’en élucidant et en clarifiant la critique de la croissance qui est bien présente dans l’œuvre de Bernanos, on pouvait en déduire quelques éléments pour une théorie bernanosienne « positive » de la décroissance. Mon approche est donc hypothético-déductive : j’ai voulu, en quelque sorte, fournir à un signifié dont je fais l’hypothèse qu’il occupe une véritable place dans le corpus bernanosien le signifiant qui lui manque.
Et alors, on en revient à votre question : quel genre de concept de la décroissance, en effet, l’œuvre de Bernanos peut-elle bien secréter endogènement ? Si la décroissance, pour Bernanos, n’est pas seulement ni d’abord un « projet politico-économique », c’est parce que la croissance n’est pas seulement ni d’abord un problème politico-économique, comme l’écrit Bernanos en toutes lettres dans un article intitulé « Compromis ou compromission » et publié dans La Bataille le 31 juillet 1946 : « Le problème qui se pose n’est pas plus politique que social ; il est cela sans doute, mais il est beaucoup plus que cela. C’est un problème de civilisation. Car la prétendue civilisation [moderne] n’est pas un des aspects d’une civilisation générale dont la civilisation antique et la civilisation chrétienne seraient deux autres aspects. La civilisation [moderne] est une contre-civilisation. Ou l’arrêter dans son évolution foudroyante, ou périr. » Le vocabulaire employé semble se référer à l’imaginaire antagonique et réactionnaire du choc ou de la guerre des civilisations (imaginaire au prisme duquel Bernanos est bien souvent interprété, et d’abord par lui-même). Or, une telle lecture ne nous donne qu’un aperçu partiel de la technocritique bernanosienne, et ne nous permet absolument pas d’accéder à l’originalité de celle-ci. Que la croissance (« l’évolution foudroyante ») soit d’abord un problème de « civilisation » avant même d’être (et à vrai dire, pour pouvoir être) un problème « politique » et « social », cela ne signifie pas qu’elle est pour Bernanos le lieu d’observation privilégié d’un affrontement entre deux civilisations axiologiquement asymétriques (la civilisation chrétienne, connotée positivement, et la civilisation technique, connotée négativement). Cela signifie plutôt qu’elle est pour lui l’évènement par quoi la « civilisation [moderne] » devient à partir d’elle-même autre qu’elle-même (« une contre-civilisation ») en s’imposant à son insu d’obéir à des lois contraires à sa nature propre. Les lois, par exemple, de l’économie, qui soumettent l’inchiffrable à la législation du chiffrable, comme l’écrit Bernanos à Albert Guérin dans une lettre ouverte datée de 1939 : « Nous avons réappris l’arithmétique, et notamment cette fameuse règle de trois qui préside, dans la vie moderne, à tous les rapports sociaux. » Imposition et obéissance qui dérivent toutes deux d’une mécompréhension de l’humanité par elle-même : « Une civilisation inhumaine, c’est évidemment une civilisation basée sur une fausse ou incomplète définition de l’homme », peut-on lire dans « La liberté, pour quoi faire ? », conférence donnée en Suisse en 1947. Pour le dire d’un mot, l’humanité est sacrifiée à une mauvaise définition d’elle-même, c’est-à-dire sur un malentendu : « Le monde a cru s’enrichir, alors qu’il s’appauvrissait de tout ce qui le faisait riche, de toutes les richesses vraiment communes aux hommes, et la hideuse logique du profit devait le conduire à l’état ridicule où nous le voyons maintenant » (« Redevenir humain », publié le 5 février 1941 dans le quotidien brésilien O Jornal).
On peut formuler ce malentendu de la façon suivante : l’être humain s’illusionne lui-même en s’imaginant manquer fondamentalement de quelque chose, et cherche à tout prix à combler ce manque. Se « surestimant », d’une certaine manière, il oublie la pauvreté et l’impuissance qui sont au fondement de sa condition ontologique et qui constituent paradoxalement sa plénitude propre : « Le pauvre n’est pas un homme qui manque, par état, du nécessaire, c’est un homme qui vit pauvrement, selon la tradition immémoriale de la pauvreté, qui vit au jour le jour, du travail de ses mains, qui mange dans la main de Dieu, selon la vieille expression populaire », lit-on dans l’ébauche d’une Vie Jésus commencée en septembre 1943 (je souligne le début de la phrase). La décroissance en son versant positif consisterait alors (si une telle chose est seulement possible) à abandonner l’illusion métaphysique d’une puissance humaine autonome et conquérante pour « s’en remettre » totalement et sans partage à l’impuissance constitutive de notre nature.
Vous distinguez deux temps dans l’œuvre de Bernanos, un premier antimoderne et un second technocritique. Qu’est-ce qui caractérise chacun d’entre eux ?
La bipartion de l’œuvre de Bernanos est courante dans la recherche bernanosienne. On la trouve exposée dès 1954, dans l’ouvrage du théologien Hans-Urs Von Balthasar Le chrétien Bernanos : « Il a fallu les incessantes humiliations de sa propre existence pour que Bernanos humanisât l’image idéale de ses héros, en même temps qu’il devait renoncer lui-même à une certaine forme de son premier idéal. » Si j’ai distingué deux temps dans la vie de l’auteur, c’est-à-dire si j’ai séparé celle-ci en deux parties dont le point de séparation se situerait aux alentours des années 1932 et 1934 (années, entre autres, de la rupture avec l’Action française, des deux accidents de moto, de l’approfondissement de la précarité matérielle des Bernanos, du départ pour l’Espagne, et des premières maturations du Journal d’un curé de campagne), c’est donc par commodité didactique et pour faciliter l’exposé biographique. Maintenant, si l’on veut être un peu plus précis, ce qu’il faudrait plutôt dire – et cela n’invalide en rien la distinction effectuée dans le livre ni la bipartition canonique de l’œuvre – c’est que la vie de Bernanos toute entière est partagée entre deux temporalités, ou mieux : deux attitudes, lesquelles se superposent en chaque point de son œuvre. Moyennant une très légère reformulation de votre question, on obtient donc la proposition suivante : la première partie de son œuvre et de sa vie est donc dominée par une attitude antimoderne, et la seconde par une attitude technocritique.
L’attitude antimoderne se caractérise par l’illusion romantique en vertu de laquelle l’individu-sujet, s’imaginant libre et autonome en désir comme en acte, met au compte de son vouloir souverain l’actualisation ou bien authentique ou bien inauthentique de son existence – étant entendu qu’une telle actualisation s’opère dans le cadre phénoménologique exclusif de l’extériorisation et de l’intentionnalité que Michel Henry nomme « monisme ontologique » : l’Être se réalise, à travers le sujet humain, à l’extérieur de lui-même et donc en devenant autre que lui-même dans l’étant, à charge pour celui-ci de veiller à la « bonne » (authentique) réalisation de celui-là. C’est la rengaine bien connue du versant romantique ou antimoderne de l’œuvre bernanosienne (et à quoi celle-ci se trouve généralement réduite) : il y aurait d’un côté « les imbéciles », confiné à l’inauthenticité existentielle, et de l’autre « les héros et les saints », se hissant courageusement jusqu’aux sphères de l’authenticité existentielle. Ce sont de telles coordonnées conceptuelles qui dominent largement des textes comme par exemple Sous le soleil de Satan (1926) ou La Grande peur des bien-pensants (1931). Du point de vue qui m’occupe dans le livre, c’est-à-dire du point de vue de la critique de la croissance et du progrès technico-économique, l’antimodernisme consiste à opposer une bonne civilisation (chrétienne) à une mauvaise civilisation (technique), et à postuler que leur extériorité réciproque ou leur rivalité ontologique est originaire. C’est pourquoi il est tout à fait possible d’interpréter la pensée bernanosienne sous le rapport de la guerre des civilisations, comme semble le faire Bernanos lui-même en certains points de son corpus : « Je crois à la guerre sainte, je la crois inévitable, je crois inévitable, dans un monde saturé de mensonge, la révolte des derniers hommes libres. […]. Je crois à la guerre des hommes libres, à la guerre des hommes de bonne volonté » (Les Grands cimetières sous la lune).
L’attitude technocritique, consiste à postuler que cet antagonisme, loin d’être originaire et fondateur, est au contraire dérivé. Qu’est-ce à dire ? C’est dire qu’il n’y a pas ni choc des civilisations ni guerre des religions, puisqu’il n’y a qu’une seule véritable force en présence et que celle-ci se bat contre elle-même sans s’en apercevoir – conformément à la situation ontologique qui caractérise le monde moderne, et que Bernanos nomme à plusieurs reprises un « tragique malentendu ». En ce sens, la civilisation technicienne n’est rien d’autre que l’autoextériorisation de la civilisation chrétienne (on pense à la topique bien connue, et reprise à Chesterton par Bernanos, des « idées chrétiennes devenues folles »), c’est-à-dire son automutaltion, c’est-à-dire encore, et en quelque sorte, sa maladie congénitale. Bernanos ne dit pas autre chose, lorsqu’il écrit dans une conférence rédigée en 1946 et intitulée « La France devant le monde de demain » : « [U]ne telle civilisation ne mérite même pas le nom de contre-civilisation, [elle] est une maladie de la civilisation générale. Lui refuser le nom de civilisation serait absurde. Un médecin ne refuse pas le nom de foie à un foie diabétique. Le foie du diabétique est toujours un foie, mais le diabétique peut très bien mourir de son foie. » La civilisation technicienne n’est pas une force antagonique à la civilisation chrétienne, elle est la propre force de cette civilisation retournée contre elle-même. C’est la fièvre de la maladie, précisément, qui fait voir double, c’est-à-dire qui fait croire au christianisme que les coups qu’il se porte à lui-même sont portés par une autre civilisation contraire et belliqueuse.
Il est intéressant de noter, sans avoir ici l’espace de tirer les conclusions abyssales qu’une telle affirmation laisse deviner, que ces deux attitudes sont chez Bernanos aussi contradictoires et mutuellement exclusives – bien qu’étroitement corrélées – que le sont, pour René Girard, le christianisme historique et la révélation évangélique (pour autant cependant que celle-ci est comprise dans toute l’ampleur de sa portée révolutionnaire).
Vous assimilez par ailleurs l’antimodernisme de Bernanos à une forme de complotisme. Pour quelles raisons ? Un penseur explicitement antimoderne comme Charles Péguy, que Bernanos a beaucoup médité, n’est-il pas vacciné contre le complotisme, notamment grâce à son engagement en faveur de Dreyfus ?
Je ne suis pas un lecteur de Péguy suffisamment assidu pour pouvoir statuer sur cette question, mais il me semble que son œuvre est passible du même malentendu, c’est-à-dire de la même confusion entre deux attitudes à la fois profondément contradictoires et intimement liées. À vrai dire, un tel malentendu me semble constitutif d’un grand nombre de pensées. Faute de pouvoir développer cette idée plus avant dans le contexte du présent entretien, je me contenterai de dire qu’elle m’a été inspirée par les œuvres de Michel Henry et de René Girard, et notamment par leurs ouvrages Généalogie de la psychanalyse (1985) et Critique dans un souterrain (1976).
Pour en revenir à votre question, le complotisme dont je parle dans le livre se rapporte à l’attitude bernanosienne antimoderne. Il consiste à imputer l’entière responsabilité de la destruction de la vie par la technique à la volonté viciée de quelques-uns : les fameux « imbéciles », catégorie qui réunit, pour le Bernanos romantique et réactionnaire, les juifs, les savants, les ingénieurs, les polytechniciens et les chrétiens médiocres. Loin d’être comprise en sa qualité de processus ontologique, la destruction de la vie se trouve au contraire réduite à un simple fait, objectivement observable et quantifiable, soumis à l’appréciation axiologique du moraliste.
« On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » Cette phrase de Bernanos issue de La France contre les robots (1947) est célèbre mais elle fait selon vous l’objet d’une méprise. Comment faut-il l’interpréter ?
La méprise dont fait l’objet cette citation est structurellement identique à celle qui consiste à lire toute l’œuvre de Bernanos à l’aune de la seule attitude antimoderne et sans tenir compte de la conversion à l’attitude technocritique qui traverse son œuvre de part en part. Il suffit, en effet, de faire une brève excursion sur Twitter pour se rendre compte que cette phrase est invariablement mobilisée par des individus qui ne semblent pas disposer du concept d’« universalité » et qui s’exceptent systématiquement – et en un sens comme par magie – d’une « conspiration » dont ils n’accusent en général que certaines catégories de bouc-émissaires bien particuliers (par exemple, les personnes non-blanches ou les militants « d’ultragauche »).
On ne comprend donc absolument rien à cette citation de Bernanos si on la lit sans avoir préalablement résolu la triple amphibologie des concepts de « conspiration », d’« universalité » et de « vie intérieure ». La « conspiration » dont parle ici notre auteur n’est rien d’un fait empirique, et n’est donc justement pas – pour faire le lien avec la question précédente – un complot ourdi dans l’ombre par une certaine quantité déterminée d’individus malveillants. Il s’agit bien plutôt d’un processus ontologique, qui concerne par construction l’humanité en sa totalité et qui détermine donc sa relation interne à elle-même – « universellement ». En ce sens bien précis et en ce sens seulement, la « conspiration universelle » désigne alors le processus ontologique en vertu duquel l’humanité s’auto-aliène à une fausse définition d’elle-même, s’imaginant autonome et mu en toute transparence par une volonté rationnelle-calculatrice préoccupée en priorité au progrès ou au perfectionnement de sa propre nature – nature préalablement objectivée au dehors pour être stabilisée dans une représentation aisément manipulable. Qu’un tel processus configure les conditions d’impossibilité de « toute espèce de vie intérieure », cela ne veut absolument pas dire qu’elle nous prive tous de notre quant-à-soi spirituel, ni qu’elle nous empêcher de penser librement, c’est-à-dire en nous déterminant « intérieurement » et sans influence « extérieure ». Cela veut dire, bien plutôt, qu’en tant qu’auto-aliénation, ce processus menace le milieu ontologique d’intériorité ou d’immanence dans l’orbe duquel la vie ne peut pas ne pas advenir. Ou, pour le formuler autrement : la conspiration universelle est cette illusion transcendantale en vertu de laquelle la civilisation moderne rend la vie impossible par le geste même où elle s’imagine en réaliser les possibilités les plus hautes, c’est-à-dire en lui ménageant le milieu ontologique d’extériorité ou de transcendance dans les limites desquelles elle ne peut que mourir d’être condamnée à se « réaliser » à distance d’elle-même.
Ce que Bernanos nomme la « religion du progrès » est-elle pour lui une religion au sens stricte ?
Mon hypothèse est que non seulement la « religion du progrès » est bien pour Bernanos une religion au sens strict, mais que – et beaucoup plus scandaleusement – elle est la religion par excellence, en cela qu’elle est l’accomplissement du concept de religion bien compris. Pour le bien comprendre, il nous faut d’abord en élucider la duplicité, étant entendu que selon la perspective adoptée – celle de l’antimodernité ou celle de la technocritique – il nous apparaîtra différemment.
Sous la guise de l’antimodernité, qui en est une d’antagonique, il est absolument nécessaire que la religion du progrès soit effectivement considérée une religion, sans quoi elle ne pourrait pas entrer en rivalité avec la religion chrétienne. Et il est en effet très clair que ces deux religions sont bien considérées être en concurrence par le premier Bernanos : la religion de la mort ou du néant (celle du progrès, telle que la désigne Bernanos dans un article de 1909 intitulé « Vieilles rues et vieux souvenirs ») et la religion de la vie (celle des chrétiens, telle que la désigne Bernanos un peu partout dans son œuvre) concourent pour faire triompher leurs valeurs respectives – les valeurs du mal pour la première, les valeurs du bien pour la seconde – dans le monde. Or précisément,si le bien triomphe du mal sous ce rapport, c’est le mal qui aura gagné secrètement, puisque le mal repose précisément dans l’illusion que le « triomphe » ne peut avoir pour seul lieu de manifestation que le monde. L’attitude bernanosienne antimoderne considère donc la religion du progrès et la religion chrétienne comme deux doubles rigoureusement symétriques, sur le mode des frères ennemis. Dans un article publié le 14 décembre 1913 dans L’Avant-garde de Normandie, le jeune Bernanos pousse la comparaison jusqu’à soutenir que la religion du progrès dispose de son propre clergé : « Une autorité spirituelle soutient cette société qui semble se faire un jeu de vivre en dépit des lois mêmes de la vie : la religion du progrès. Cette religion a ses pontifes. Ministres ou non, ils sont nos maîtres. » Aussi la religion du progrès n’est-elle rien d’autre que l’actualisation, inconsciente d’elle-même, d’un instinct religieux qui définirait essentiellement l’être humain. Afin de pouvoir hiérarchiser deux manifestations ou deux occurrences de cet instinct, il faut bien que celles-ci partagent la même substance, autrement dit soient pris dans un rapport d’homogénéité structurelle – condition sine qua non à la bonne tenue de toute comparaison axiologique. La texture de cette substance, je propose de la nommer (avec Michel Henry) « transcendance », moyennant quoi, si la religion chrétienne se trouve alors définie comme celle qui vise la « bonne transcendance » (Dieu), la religion du progrès se trouve a contrario définie comme celle qui vise de « mauvaises transcendances » (l’Argent et la Technique, ou « l’Or et le Fer », pour reprendre le lexique mobilisé par Bernanos dans un article publié le 7 mai 1941 dans O Jornal et intitulé « Une tragédie finit, une autre commence »). En tant que visant une mauvaise transcendance et qu’ainsi se vouant à un mauvais objet de culte, la religion du progrès est considérée une idolâtrie en son sens le plus courant : l’adoration de faux dieux.
Sous la guise de la technocritique, il me semble que le christianisme n’est plus interprété par Bernanos relativement aux coordonnées ontologiques de la transcendance, et que celles-ci se trouvent dépassées ou à tout le moins dénoncées comme relevant fondamentalement d’une illusion transcendantale. Sont alors renvoyés dos à dos les adeptes du progrès et les adeptes du christianisme historique (c’est-à-dire, pour reprendre la terminologie girardienne, les adeptes d’une définition « sacrée » et « sacrificielle » du christianisme ; ou, pour reprendre la terminologie bernanosienne, les « chrétiens médiocres ») comme appartenant tous deux et indifféremment à la catégories des idolâtres. Dans une perspective toute kierkegaardienne, le second versant de l’œuvre bernanosienne peut nous mener à la conclusion que le christianisme bien compris n’est pas une religion, pour autant que la religion relève de la sphère ontologique de la transcendance, et que le christianisme relève bien plutôt de celle de l’immanence absolue. En ce qui concerne le problème qui nous intéresse, le « second » Bernanos n’oppose donc plus la religion du progrès à la religion chrétienne comme deux religions s’affrontant à armes égales et sur le même plan d’existence – de la même façon que s’affrontent, partant de présupposés métaphysiques rigoureusement identiques, technophiles et technophobes – mais pense au contraire, d’une part, le christianisme comme hétérogène à toute forme de religiosité transcendante, et d’autre part, la religion du progrès comme l’accomplissement d’une telle religiosité, c’est-à-dire comme une religion qui se donne les « moyens techniques » de mener jusqu’à son terme l’auto-envoutement en quoi repose la logique du « sacré ».
Dans une phrase percutante issue de Français, si vous saviez (posthume, 1961), Bernanos écrit : « Le monde moderne a deux ennemis, l’enfance et la pauvreté. » Pour quelles raisons ?
Il faut se garder de lire cette citation à la lumière du paradigme rivalitaire et antagonique qui est celui de l’antimodernité, et qui consiste à dire, encore une fois, que deux mondes s’affrontent dans l’ouverture d’un même horizon d’existence – et donc, que deux camps se font face. On voit mal comment une telle lecture pourrait ne pas mener ceux qui l’entreprennent à se ranger, avec toute l’assurance que confèrent les illusions de l’héroïsme romantique, dans le camp de l’enfance et de la pauvreté, réactivant ainsi toutes les croyances trompeuses du premier idéal bernanosien et sans s’apercevoir donc que tout ceci ne relève ni de la logique du choix, ni de celle de l’intérêt bien compris ou de la partisanerie.
Le plus important, dans cette phrase, est de bien comprendre que c’est « le monde moderne » qui en est le sujet. Cette citation ne dit donc pas que l’enfance et la pauvreté sont les ennemis du monde moderne : elle dit que le monde moderne considère l’enfance et la pauvreté comme ses ennemis. Et s’il l’imagine comme ses ennemis, c’est parce qu’il est incapable, par construction, de les comprendre – et il faudrait même aller jusqu’à dire que le monde moderne repose de jure sur une mécompréhension de l’enfance et de la pauvreté. C’est ce que dit en toutes lettres la suite du texte : « Dans une civilisation technique dont la seule règle est l’efficacité, qu’est-ce que l’enfance, sinon une période inefficace de la vie, et qu’il s’agit de raccourcir le plus possible, ou même de supprimer. Supprimer l’enfance, quelle énorme récupération de travail et d’énergie ! L’enfance ne sert pas à grand-chose et la pauvreté ne sert à rien. » Aussi l’enfance et la pauvreté sont-ils renommés, conformément aux lois utilitaires de l’efficacité à la législation desquelles obéit le monde moderne, la minorité et la précarité, et sont estimées devoir être combattues afin ne pas nuire à la croissance, dogme princeps de la religion du progrès.
Aussi, du point de vue technocritique qui n’en est pas un d’antagonique, la réciproque n’est-elle pas vraie : si l’enfance et la pauvreté sont les ennemis du monde moderne, le monde moderne n’est pas l’ennemi de l’enfance et de la pauvreté. Il faut dire bien plutôt que le monde moderne est la maladie de l’enfance et de la pauvreté, qu’il est leur automutilation secrète. C’est pourquoi Bernanos décrit à plusieurs reprises l’individu moderne comme un enfant « mutilé » ou « humilié », c’est-à-dire comme un enfant dont la ferveur toute naïve et idolâtre pour la religion du progrès n’est rien d’autre que l’effet d’une fièvre ou d’un « delirium tremens ».
Vous affirmez, contre un lieu commun répandu, que Bernanos ne cherche pas, sur un mode luddite, la destruction des machines, mais bien plutôt à sauver les machines elles-mêmes contre la civilisation des machines. Qu’est-ce que cela signifie exactement ?
Cela signifie plusieurs choses. Premièrement, que l’illusion d’une menace de l’être humain par les machines est un mythe fondamentalement technophobe, et que la technocritique doit être, là-contre et avant toute chose, une démythification radicale d’une telle technophobie, laquelle n’est absolument rien d’autre qu’une technophilie à rebours. Comme l’écrit Bernanos à deux reprises, une première fois dans un article publié le 20 janvier 1945 dans O Jornal et intitulé « Une guerre d’imposture » et une seconde fois l’appendice de La France contre les robots : « Non, le danger n’est pas dans les machines, car il n’y a d’autre danger pour l’homme que l’homme même. » Ce danger tient en ceci que l’humanité s’oppose à elle-même comme son ultime illusion – et d’autant plus illusoire, cette illusion ultime, qu’elle s’imagine dissipatrice des derniers mensonges du sacré – la transcendance technique. Or, cette transcendance repose sur le dogme de la croissance et du progrès technico-économique, dogme qui, comme nous l’avons vu, ne peut mener l’humanité qu’à se détruire elle-même à son insu dans le moment même où elle s’imagine se dépasser vers la « surhumanité ». Aussi le danger dont parle Bernanos dans la phrase que j’ai citée a-t-il pour nom l’autodestruction – on sait d’ailleurs Bernanos éminemment requis, et dans toute son œuvre, par le problème du suicide. En vertu d’une telle logique, la civilisation des machines est alors amenée à détruire aussi bien les machines que les êtres humains. Le problème de la civilisation des machines n’est donc pas les machines, mais le principe autodestructeur qui l’anime. Sous ce rapport, détruire les machines revient tout simplement à accompagner, voire éventuellement à accélérer la téléologie autodestructrice à laquelle les êtres humains se configurent eux-mêmes par la médiation de la transcendance technique.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.