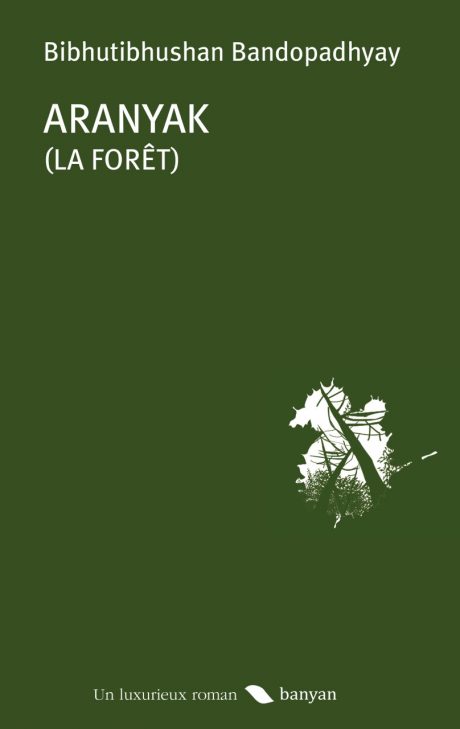De l’Inde, le public averti connaît surtout sa philosophie et sa mythologie, sur lesquelles les publications n’ont jamais tari depuis l’intérêt que les romantiques européens ont porté sur ces manières alternatives d’aborder la vérité et le surnaturel. Seulement, connaissons-nous la littérature écrite par le peuple de l’Indus ? Depuis dix ans, les éditions Banyan s’efforcent de faire connaître au lectorat français la mésestimée littérature de l’Inde, dont Bibhutibhushan Bandyopadhyay (1894-1950) est un des plus grands noms.
Écrivain bengali de la première moitié du XXe siècle, Bibhutibhushan Bandyopadhyay est l’auteur de La Complainte du Sentier et de L’Invaincu, deux romans ayant donné au cinéma mondial trois de ses plus grands chefs d’œuvres par les adaptations de Satyajit Ray. Son roman Aranyak, publié en 1939 et en partie autobiographique, est un hymne au Bihar, état le plus pauvre de l’Inde et synthèse des grandes contradictions d’un pays englué dans la modernité.
Aranyak, ou « La Forêt » en bengali, est le récit d’un jeune citadin, Satyacharan, quittant la ville de Calcutta après y avoir terminé ses études de droit pour occuper un poste de gestionnaire de terres dans le district de Purnia de l’état du Bihar. Sa monotone existence de citadin se métamorphose à son arrivée sur une terre onirique, recouverte de forêts luxuriantes et habitées par une myriade d’êtres qui porteront la conscience du jeune homme jusqu’à l’exaltation. Rapidement, Satyacharan découvre les secrets d’une existence solitaire, rythmée au gré des mouvements gracieux d’une Mère nature dont la vénusté ne cesse de le subjuguer. Les récurrentes descriptions saisiront le lecteur non-indien, et on ne peut que deviner que la prose de Jyoti Garin parvient à rendre une grande partie de la mélodie originelle de la langue de l’auteur. Les chapitres sont divisés en plusieurs temps, égrainant le récit à la manière d’un chapelet dont chaque perle rassemble un souvenir du séjour du jeune homme.
L’Inde du cœur
Comme le lecteur, Satyacharan sera sans doute ébahi par l’extrême pauvreté des habitants du Bihar, car par « extrême », il faut entendre qu’il ne s’agit pas du nôtre, mais du leur. En effet, l’État le plus pauvre de l’Inde est régulièrement le théâtre de famines « gargantuesques » à côté desquelles nos épidémies apparaîtraient comme roupie de sansonnet. Cette triste condition a pour pendant une richesse champêtre absolument inouïe : les paysages, la faune, la flore seront l’objet de si délicats portraits qu’un écho résonnera sans doute dans le cœur du lecteur esthète. Si ces derniers n’auront rien de commun avec ce que l’homme occidental expérimente dans ses campagnes, il saura peut-être reconnaître le sentiment de profond dépaysement que procure une terre préservée de l’action humaine.
Une telle terre est une terre de tous les possibles, c’est une terre à conquérir autant qu’à contempler, une terre à désirer autant qu’à redouter, car elle est un symbole du retour à l’origine, à la source, à la puissance. En ce lieu, l’homme juste possède un droit naturel, et c’est ce droit qu’exercera Satyacharan pendant ses années à l’Office. Si son cœur est noble, sa tâche est en partie destructrice : en allouant des parcelles de terres en friches pour leur culture, celui-ci contribue petit à petit à détruire le lieu sous sa garde, objet de ses incessantes contemplations. Le fantôme des citadins cupides plane derrière chacun de ses actes notariaux, et Satyacharan ne peut que retarder un processus qui devra aboutir, quels que soient ses efforts pour l’en empêcher. De même que Raja Dobru Panna, le Roi santal sans royaume avec lequel il se liera, Satyacharan est un Seigneur sans terres, et c’est une prouesse de la narration de Bandyopadhyay que d’illuminer cette injustice sans pour autant la fustiger grossièrement. En effet, ici, chacun se satisfait de sa condition sans états d’âmes, et ces injustices apparentes finissent pas se dissiper dans le cours d’existences paisiblement menées.
L’Inde éternelle
Dans ses Fondements de la culture indienne, Sri Aurobindo affirme ceci : « Si un Indien venu des temps anciens des Upanishad, du Bouddha ou de l’âge classique qui suivit, devait se retrouver dans l’Inde d’aujourd’hui […]. Il verrait son peuple agrippé à des formes, à des enveloppes, à des lambeaux du passé, aveugle aux neufs dixièmes de son sens le plus noble […]. Il serait confondu par l’étendue de la misère mentale, de l’immobilité, la répétition statique, l’abandon de la quête du savoir, la longue stérilité de l’art, la faiblesse de l’intuition créatrice comparée à celle de son époque… ». Aranyak n’est pas un roman philosophique, ni son héros un penseur, mais Satyacharan ne serait peut-être pas en désaccord avec l’un des plus grands esprits de l’Inde moderne. Le constat de la dégradation de l’esprit traditionnel est sans appel : plus de soupirants pour la sagesse des Brahmanes tandis que les castes inférieures concentrent tous les pouvoirs en manifestant un simulacre d’ordre spirituel.
Cependant, ce roman et son héros sont avant tout le récit de l’expérience intérieure d’un lieu. Satyacharan, comme à certains égards Alexeï Karamazov, ne sont que les témoins d’un désordre grandissant au sein d’un ordre dont ils perçoivent secrètement la plus grande perfection, de la manière la plus pure et la plus naturelle qui soit : « Quand le soir se glissait dans les vastes champs dégagés, ah, combien de fois dans cette brève accalmie entre les averses avais-je rêvé d’un dieu ? Ces nuages, ces soirs, cette forêt, le chœur des chacals, ces fleurs flottant sur l’eau de Sarasvatî-Kundi, Manchi, Raju Parey, Bhanumati, Mahalikharup, la pauvre famille Gond, le ciel … Jadis, cela avait dû germer dans Son imagination. […] Le dieu dont je rêvais n’était pas un juge antique, ni un législateur sage et lointain, ou bien enfermé dans un jargon philosophique abscons, omniscient et immortel. Non. Les crépuscules dans les champs étendus de Narha-Baihar ou d’Ajmabad, les masses de nuages rouge sang, les champs éclairés par le clair de lune me faisaient sentir qu’il est amour et charme, poésie et beauté, art et émotion. Il aime passionnément, crée avec la puissance de son art et s’épuise en dons constants pour l’amour de ses créatures. »
Cette intuition paraît totalement éluder les élans de désespoirs d’un être pourtant bien conscient des conséquences de son action destructrice. Mais en parvenant à ne pas leur prêter une excessive attention, à l’instar du petit colibri de Pierre Rabhi, il lui sera permis de remplir une mission authentiquement créatrice en un lieu où personne ne semble disposé à l’accomplir. Ceci mène sans doute à la principale leçon du roman, que nous pourrions rendre à travers les paroles d’un loup, frère lointain de Bandopadhyay : « Gémir, pleurer, prier, est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t’appeler. Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler ».
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.