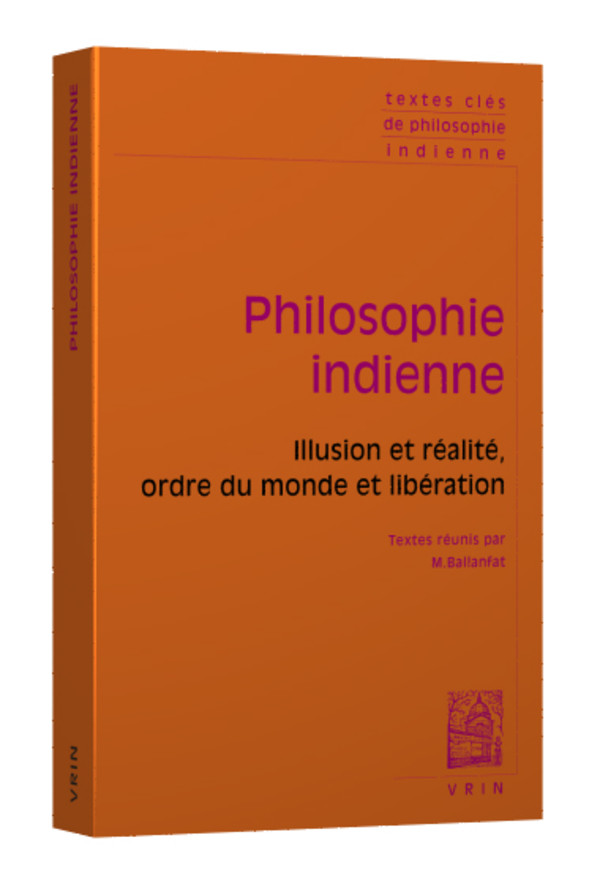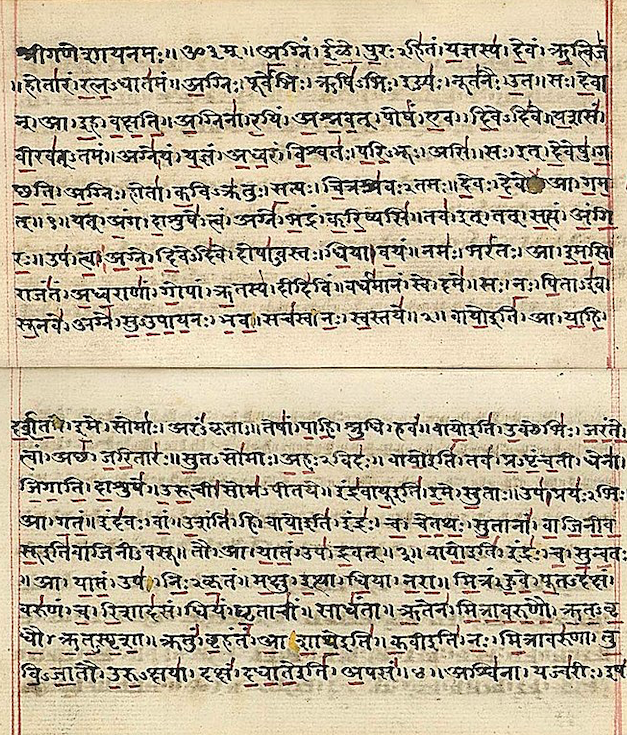Accompagné de plusieurs chercheurs, Marc Ballanfat, enseignant-invité au Centre Sèvres, ancien chargé de cours en philosophie comparée à la Sorbonne et ancien directeur de programme au Collège international de Philosophie, vient de publier Philosophie indienne : illusion et réalité, ordre du monde et libération (Vrin). Ce recueil est une introduction savante aux écoles philosophiques de l’Inde ancienne (IIe-XIIe siècles) : neuf textes essentiels y présentent les débats foisonnants de cette époque au sujet de la connaissance du langage, de la nature, de l’esprit, de l’humain et du divin, selon une approche fondamentalement sotériologique de la philosophie, destinée à délivrer les hommes de l’illusion existentielle qui les empêche d’atteindre la réalité absolue et le détachement.
PHILITT : En sachant qu’il existe une pluralité d’écoles philosophiques en Inde, telles que les différentes « perspectives » (darshanas) constituées autour de la référence traditionnelle aux textes sacrés du Véda, pourquoi avoir choisi d’intituler votre livre « philosophie indienne » au singulier ?
Marc Ballanfat : Une première raison de ce choix est éditoriale : de même qu’il existe, dans cette collection « Textes clés » de la librairie philosophique Vrin, un livre intitulé Philosophie japonaise, l’idée était d’harmoniser ces différentes synthèses sur les formes de pensée philosophiques non-européennes. Il y a cependant une seconde raison, autrement plus essentielle : par la rigueur formelle de ses traités, la vigueur de ses controverses logiques, l’aspiration à dépasser l’illusion pour accéder à la réalité vraie, la créativité rationnelle de ses arguments, la philosophie indienne est à égale dignité avec la philosophie européenne. En effet, par-delà la diversité des écoles philosophiques indiennes, par-delà l’étendue et la virulence des débats qui ont eu lieu durant la période historique que nous avons sélectionnée, celle de leur formation systématique d’une haute technicité théorique, plusieurs postulats communs les réunissent. Ces postulats permettent précisément de distinguer la manière indienne de philosopher de la manière européenne. En particulier, leur premier postulat commun est que l’humanité, dans son ensemble, quelle que soit sa situation sociale, souffre d’une misère métaphysique, c’est-à-dire d’une souffrance causée par une illusion presque naturelle tant elle constitue l’existence humaine. Cette illusion réside fondamentalement dans une double ignorance : celle de ne pas savoir accéder à la connaissance vraie des choses, mais une ignorance qui s’ignore elle-même et produit l’attachement des Hommes à ce qui n’a pas, en vérité, la consistance de la réalité. Nous prenons pour réel et digne d’attachement ce qui n’a essentiellement pas plus de nécessité et de permanence qu’une vague qui ourle le sable. Le but premier de la philosophie traditionnelle en Inde, c’est donc de libérer les êtres humains, quels qu’ils soient, de cette illusion métaphysique qui est la cause universelle de leur souffrance. La connaissance a donc un caractère libérateur.
Il existe cependant une exception…
Effectivement, il faut immédiatement nuancer en précisant que les philosophes indiens de la Mîmâmsâ, qui se consacrent à l’exégèse et au commentaire du Véda, ne poursuivent pas ce but, mais se bornent à accorder une valeur suffisante à l’accomplissement rigoureux des sacrifices, grâce auxquels l’ordre socio-cosmique (le dharma) est maintenu et conservé. Cette indépendance par rapport à la visée sotériologique commune à d’autres écoles explique que, par exemple, un philosophe de la Pûrvamîmâmsâ comme Kumârila Bhatta, fut davantage soucieux de la validité logique des interrogations théologiques sur l’existence d’un Dieu suprême auxquels il prenait part, que de la portée libératrice de la philosophie.
Le seul traité de philosophie politique d’envergure enregistré dans l’Inde ancienne est l’Arthaçâstra attribué à Kautilya, consacré à l’art de gouverner, selon une approche comparable à celle de Machiavel dans la modernité européenne. Comment expliquez-vous cette place aussi réduite de la philosophie politique en Inde, contrairement au rôle fondamental joué par Aristote en Occident ?
La quasi-absence d’une réflexion socio-politique en Inde, effectivement très visible, s’explique justement par ce dont nous parlons. Comme je l’explique dans l’introduction du recueil, le postulat est que la misère existentielle des êtres humains se fonde sur leur condition naturelle, de manière plus fondamentale que les difficultés liées aux conditions sociales et économiques : un homme de haute caste souffre au moins autant de l’illusion qu’un homme de basse caste. À l’inverse, le développement de la philosophie politique en Europe s’explique par un autre postulat, qui est l’explication de la misère humaine par des raisons sociales. Or, comme vous l’avez fait remarquer, Aristote joue ici un rôle autrement plus important que Platon. En effet, Aristote est le grand philosophe politique de l’Antiquité grecque, ne concevant pas la réflexion sur la vie bonne sans une réflexion sur la vie politique : l’homme étant d’après lui un « animal politique » (zoôn politikôn), c’est aussi dans la cité, c’est-à-dire dans le domaine politique, que doit se réaliser au mieux sa nature raisonnable. Mais Aristote est aussi, inséparablement, le grand philosophe de la logique telle qu’elle s’est historiquement constituée en Occident. Or, la logique aristotélicienne est une logique « bivalente », c’est-à-dire fondée sur le critère binaire du vrai et du faux, selon les principes de contradiction et du tiers-exclu : une chose ne peut pas être et n’être pas en même temps et sous le même rapport, d’où il s’ensuit qu’une chose est, ou bien n’est pas, il n’y a pas de milieu. Il est probable que cette conception de la logique s’explique par le contexte politique de la démocratie grecque, dont elle est une expression : juger, c’est prendre son parti, soit pour x, soit contre x. Cette logique binaire domine le débat politique démocratique jusqu’à aujourd’hui, puisqu’il se polarise systématiquement par rapport au clivage droite / gauche, sans qu’il soit possible au citoyen engagé de ne pas choisir son camp.
En quoi l’Inde ancienne a-t-elle contourné cette façon de penser binaire, mille ans avant la naissance des logiques plurivalentes dans l’Europe contemporaine ?
Dans des contextes très différents que sont le jaïnisme, le bouddhisme et le brahmanisme, l’Inde a développé un très grand intérêt pour l’inférence, de laquelle on peut déduire une doctrine du jugement, c’est-à-dire : pour qu’un prédicat soit associé à un sujet, il faut pouvoir être chaque fois capable d’en donner la raison (R). C’est, là, le modèle de l’inférence indienne : S est P, grâce à R. C’est pourquoi de nombreux philosophes indiens en ont tiré la conclusion qu’il existe toujours, non pas une seule, mais plusieurs raisons possibles susceptibles de justifier pourquoi tel sujet a tel prédicat. En ce sens, la logique indienne est nécessairement une logique plurivalente, qui ne confond pas la plurivocité avec l’équivocité : il ne peut pas toujours y avoir une seule raison pour laquelle S est P. Par exemple, on peut dire : « la table est blanche », et non pas certes noire, mais elle l’est pour plusieurs raisons possibles, selon qu’il s’agit de la substance de la table, de son mode d’existence, de la relation entre substance et qualité, de la relation à l’espace, au temps, à la personne présente, ainsi de suite. À l’inverse, Aristote a construit une logique univoque : il part du postulat que P se dit de l’entièreté de S, de sorte qu’il ne peut y avoir qu’une seule raison pour laquelle P se dit de S. Par comparaison, la chercheuse Marie-Hélène Gorisse présente, dans le recueil, un texte très éclairant de Prabhâcandra, un philosophe jaïn ayant vécu entre 980 et 1065. On y découvre comment le jaïnisme, en particulier, a contribué à la construction d’une logique plurivoque en Inde : P ne se dit pas de l’entièreté de S, mais seulement d’une partie de S, d’où il s’ensuit que l’on peut concevoir qu’un autre P puisse se dire d’une autre partie de S, et ainsi de suite. En procédant ainsi, la logique jaïne arrive à établir sept modes d’assertions possibles, c’est-à-dire sept façons de juger que S est P. Ainsi cette logique à sept énoncés dépasse la contradiction que la logique occidentale pourrait a priori voir entre la proposition qui dit vrai d’un sujet, et celles qui pourraient également dire vrai du même sujet, mais d’une autre façon (« il se peut que S soit P », « il se peut que S ne soit pas P », etc). Il y a ici un véritable perspectivisme non relativiste dans la mesure où la prise en compte des différentes modalités d’affirmer que S est P n’ôte rien à la vérité partielle de chacune. Contrairement à la logique de l’identité entière et définie une fois pour toutes (Aristote), la pluralité jaïne des perspectives engage une identité plurielle et temporaire.
Pourquoi la philosophie indienne dépend-elle du lien très étroit de la logique avec la grammaire sanskrite ?
En Inde, la grammaire précède la philosophie, car de nombreuses réflexions grammaticales se sont développées afin de justifier les pouvoirs de la langue dans l’accomplissement très méthodique et précis des rituels sacrificiels, selon les modalités révélées dans les textes sacrés du Véda. Sur cette base, la philosophie indienne a pu se développer comme une réflexion sur les pouvoirs de la pensée, sans opposer spiritualité et rationalité. La grammaire est donc le modèle de la rationalité indienne, par opposition à l’Occident où le modèle de la rationalité a souvent été mathématique. Ce modèle donne aux Indiens une grande assurance, car ils savent que ce dont ils parlent est grammaticalement fondé : le modèle grammatical de la philosophie indienne ne laisse quasiment aucune place aux équivoques et aux contresens, qui peuvent davantage avoir lieu dans une tradition philosophique – celle de l’Europe – qui a confié à un autre type de langage que le langage grammatical dont elle se sert, à savoir le langage mathématique, le soin de construire l’exactitude du raisonnement. Cette assurance indienne dans l’usage du langage explique que les philosophes y soient autant à l’aise dans l’aphorisme (les sûtras) que dans les grands commentaires.
L’opposition que l’on rencontre souvent dans les milieux occidentaux entre « les sciences » et « la littérature » ne s’explique-t-elle pas par cette tendance à identifier exclusivement l’exactitude rationnelle au langage réservé des mathématiques ?
Nous avons effectivement recours au langage grammatical dans la majeure partie de notre temps et de notre activité. Or, par ce privilège accordé aux mathématiques dans la construction d’une pensée rationnelle, nous excluons beaucoup de personnes. Les difficultés croissantes des Français à maîtriser les mathématiques, que nous indique notre dégringolade au 26ème rang du classement PISA, ne s’explique-t-elle pas dans une certaine mesure par la difficulté plus importante à percevoir le sens d’un langage qui n’est pas aussi pratiqué que celui de la grammaire, si souvent mobilisée de nos échanges quotidiens jusqu’à la littérature ? Peu de personnes sont réceptives aux mathématiques, dont la rationalité propre est de moins en moins intelligible à la majorité de nos élèves et des anciens élèves que nous sommes. Au contraire, grâce à la grammaire, l’Inde dépasse l’opposition dont vous parlez : il est probable que la grammaire, en jouissant d’un ancrage social aussi étendu, permette d’universaliser de manière beaucoup plus pratique l’exercice de la rationalité, puisque la forme dans laquelle celle-ci s’exerce appartient à la fois à l’usage courant de la langue et à la référence traditionnelle aux textes sacrés. Bien sûr, il ne faut pas mésestimer les difficultés rencontrées par les élèves dans la maîtrise de la grammaire aujourd’hui, mais il est assez probable que le défi pourrait être plus facilement relevé du côté de l’enseignement de la grammaire pour les raisons dont nous parlons. L’Homme est un être de langage, plutôt qu’un être de mathématiques : dans ces conditions, la rationalité grammaticale est peut-être plus adaptée aux êtres humains considérés dans leur ensemble, que la rationalité mathématique – aussi indispensable soit-elle pour l’Inde y compris, connue pour avoir notamment découvert le zéro mathématique.
On pourrait vous rétorquer que l’universalité de l’éducation de la raison est cependant compromise en Inde par le système des castes, qui n’est pas égalitaire : qu’en pensez-vous ?
Durant mes travaux en Inde, j’ai été moi-même reçu comme « étranger » (mleccha), dont l’impureté est équivalente à celle des indiens hors-castes réputés « intouchables » (dalits), c’est-à-dire infréquentables par les indiens qui appartiennent à des castes. Le brahmane vishnouite qui m’a généreusement dispensé ses enseignements, me recevait pour cette raison en-dehors de sa demeure où il ne m’était pas permis d’entrer. On peut penser que cela est paradoxal, car ce brahmane m’a transmis un savoir qu’il n’aurait pourtant pas communiqué à des indiens de castes inférieures mais moins « impures » que moi. De fait, certains indianistes marxistes expliquent l’existence de ce système de castes par l’absence de philosophie politique, dont le développement aurait pu mettre en question cette organisation sociale. Cependant, si l’on prend le problème du côté indien, il n’a tout simplement pas lieu d’être puisque, selon les écoles sotériologiques, le discours de la libération s’adresse universellement à tous quelle que ce soit leur caste : il ne suffit pas de jouir d’une fonction sociale confortable pour être délivré de la misère, puisque cette misère est au contraire expliquée, non par des raisons sociales, mais par des causes beaucoup moins visibles, d’ordre ontologique. C’est pourquoi les Brahmanes eux-mêmes prévoient un dépassement du système des castes (ativarna) par ceux qui font vœu de « renoncement » à tous les biens de ce monde, c’est-à-dire à tous les attachements illusoires de l’existence. J’ajoute enfin que, dans ce recueil, Philosophie indienne, j’ai pris soin de revaloriser l’importance d’une figure du Vedânta trop souvent négligée : celle du théiste Ramanuja, qui propose une interprétation de la misère existentielle et des moyens de s’en délivrer différents de ceux de son prédécesseur plus connu, Shankara. En effet, tandis que ce dernier estime que la misère est illusoire, et que la libération consiste précisément à en découvrir l’inexistence, Ramanuja au contraire estime que la libération ne peut être recherchée qu’à condition d’attribuer quelque réalité à la misère dont souffre l’être humain. Par suite, Ramanuja ne réserve pas son enseignement aux « deux fois nés » (Dvija), c’est-à-dire aux castes supérieures et aux lettrés, mais il offre plutôt au grand nombre la possibilité de se libérer progressivement de la misère au moyen de rites dévotionnels, praticables par n’importe quel indien de caste inférieure ou supérieure.
La différence fondamentale entre l’Inde et l’Europe en philosophie concerne donc bien l’explication de la misère humaine, en termes ontologiques pour la première et politiques pour la seconde. Vous avez néanmoins consacré un livre, en 2011, sur Simone Weil ou Le combat de l’Ange contre la Force (éd. Hermann). Précisément, Simone Weil ne serait-elle pas le grand « docteur universel » de la philosophie, dans la mesure où cette mystique vigoureusement engagée en politique était sensible à l’une et l’autre perspectives sur la misère humaine ?
Ce que vous suggérez est une idée fort intéressante, à laquelle on pourrait cependant objecter l’hypothèse d’une élaboration diachronique de la pensée de Simone Weil, qui aurait été très préoccupée dans un premier moment par la philosophie sociale et politique, avant de se vouer entièrement, dans un second moment, à la mystique et à la métaphysique. Mais je ne crois pas qu’elle ait renoncé à la philosophie politique pour aller vers la philosophie mystique. Je crois plutôt, comme vous, que Simone Weil, même dans sa période de maturité mystique, est restée très sensible à la question sociale, de même que son engagement passionné dans la Résistance est postérieur à son événement de conversion spirituelle en la chapelle romane de la basilique Sainte-Marie-des-Anges, près d’Assise en Italie. Entre son séjour en Allemagne en 1932 pour comprendre la montée en puissance du nazisme, et ses écrits de Londres sur la décréation en Dieu, Simone Weil manifeste à la fois une très grande intuition politique et une très grande intuition mystique, sans contradiction. Justement, le « moment indien » de Simone Weil, durant lequel elle entreprit d’étudier les doctrines de l’Inde, a joué un rôle non négligeable dans le dépassement et le contournement de cette contradiction. En particulier, sa découverte des textes philosophiques et sacrés de l’Inde lui a permis de mieux aborder les textes mystiques de la tradition européenne, et de comprendre que les choses de l’esprit peuvent et doivent être abordées avec la même méthode et la même rigueur que celles des mathématiques.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.