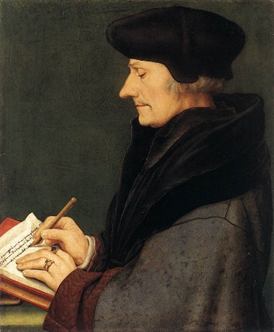Au XVIe siècle, « Rome n’est plus dans Rome » devient la nouvelle devise pour désigner une cité assaillie par le malheur et qui appelle tous les écrivains à son chevet. Parmi eux, Joachim du Bellay, poète de la Pléiade. Son séjour romain débouche sur une méditation poétique empreinte d’une admiration sincère, doublée d’une profonde mélancolie. En effet, sa Rome, qui exerce une attraction incontestable, est à l’intersection de l’Histoire et du Destin.
Des Antiquités de Rome aux Regrets (ces deux recueils romains), du Bellay tente de cerner l’héritage paradoxal d’une ville à la fois lumière du monde et incarnation physique de l’hubris. Un dialogue des siècles s’engage alors, où l’individu est comme englouti par une avalanche de monuments qui incarnent physiquement le péché spirituel de l’ambition. Aucune effusion architecturale et artistique ne semble suggérer avec autant d’éclat la coopération de tous les pur-sang de l’imagination humaine. Mais, à mesure qu’il chemine dans Rome, le poète ne peut s’empêcher d’inscrire le symbole de ces ruines dans le contexte contemporain du catholicisme romain. Le constat est sans appel : la cité est défigurée par l’ambition.
L’autre religion à Rome, après celle du Christ, est le pouvoir : ce dernier est une affaire de tous les jours et il ne perd pas de temps pour corrompre même les âmes les plus pures, les hommes aux intentions les plus droites. Signe des temps, le relâchement moral de la chrétienté se prolonge à mesure que l’excroissance de l’administration pontificale s’amplifie. Les palais foisonnent, mais la religion dépérit ; les fêtes s’accumulent, mais la piété recule ; on veut rebâtir la Basilique Saint-Pierre, mais l’on tarde à réformer l’Église.
Sous l’Antiquité, les grands poètes n’étaient pas de simples artistes destinés à distraire les sens par des figures de style ; ils étaient au contraire des intermédiaires entre les dieux et les hommes. Virgile et Ovide régnaient sur l’empire des mots, tandis que les empereurs régnaient sur celui des hommes. Conformément à sa fibre humaniste, du Bellay convoque ces glorieux ancêtres comme en leur temps ils invoquaient les Muses :
« Que n’ai-je encor la harpe thracienne,
Pour réveiller de l’enfer paresseux
Ces vieux Césars, et les ombres de ceux
Qui ont bâti cette ville ancienne ?
Ou que je n’ai celle amphionienne,
Pour animer d’un accord plus heureux
De ces vieux murs les ossements pierreux,
Et restaurer la gloire ausonienne ?
Pussé-je au moins d’un pinceau plus agile
Sur le patron de quelque grand Virgile
De ces palais les portraits façonner … »
La poésie sublime ici l’art pictural. Si l’éloquence est la peinture de la pensée, selon les mots de Pascal, alors la poésie est la fresque aboutie de l’âme humaine, prise dans le tourbillon de l’Histoire. La ville où du Bellay déambule – en partie pour conjurer l’ennui qui l’assaille dans le palais de son oncle (le cardinal Jean du Bellay) – se relève du choc de l’Apocalypse (le sac de Rome en 1527 a profondément traumatisé les esprits). Mais elle renâcle à produire des pontifes soucieux de tempérer les inclinations au luxe et de renoncer aux délices. Il y a la crainte, parmi les cardinaux, de voir émerger celui qui remettrait en question le train de vie privilégié dont ils abusent. La partie est pourtant bien mal engagée car le successeur de Pierre (à l’époque Jules III) s’avère davantage soucieux de jouir sans retenue des dernières années de sa vie. La papauté, impuissante face aux forces temporelles se complait dans la vie de cour : le pontife s’y réfugie régulièrement avec ses plaisirs pour seul horizon, laissant à ses conseillers le traitement des affaires courantes. L’Empire romain n’est plus. Qui donc lui a succédé ? L’Église visible voulue par saint Augustin ou l’Empire de Charles Quint, incarnation du christianisme étatisé ? La première est fortement décrédibilisée, le second coupable d’un crime impardonnable. Rome connaît donc un nouveau tournant existentiel :
« Nouveau venu, qui cherches Rome en Rome
Et rien de Rome en Rome n’aperçois,
Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois,
Et ces vieux murs, c’est ce que Rome on nomme.
Vois quel orgueil, quelle ruine : et comme
Celle qui mit le monde sous ses lois,
Pour dompter tout, se dompta quelquefois,
Et devint proie au temps, qui tout consomme.
Rome de Rome est le seul monument,
Et Rome Rome a vaincu seulement.
Le Tibre seul, qui vers la mer s’enfuit,
Reste de Rome. Ô mondaine inconstance !
Ce qui est ferme, est par le temps détruit,
Et ce qui fuit, au temps fait résistance ».
Dans cette poésie aux accents ovidiens (« Temps mangeur des choses et toi vieillesse envieuse, vous détruisez tout », Métamorphoses, 234-235), du Bellay expose la fatalité inhérente de la ville-monde qui, selon un cycle parfaitement éprouvé, rejoue indéfiniment le passage de la barbarie à la civilisation, de la civilisation à la décadence. Le temps des conquêtes côtoie celui des guerres civiles ; la gloire de la cité laisse place à la colère des dieux. Pourtant, ce bouillon de contradictions fascine et représente un héritage jalousement convoité par des forces politico-religieuses désireuses d’égaler, au moins symboliquement, une grandeur alors sans équivalent dans l’Histoire. Du Bellay demeure néanmoins lucide. Si Rome est ce modèle que tout le monde cherche à imiter, il doit également être dépassé, ou plutôt renouvelé. Face à une papauté décrédibilisée et à un Saint Empire aux relents tyranniques, le royaume de France s’impose comme une alternative crédible. La dédicace des Antiquités au roi Henri II ne doit donc rien au hasard : en tant que successeurs de Charlemagne, premier empereur chrétien d’Occident, les rois de France possèdent une légitimité incontestable. De cet héritage, ces derniers ont toujours tiré une forme de romanité impériale. Le rêve sans cesse avorté des ambitions italiennes – et qui le sera définitivement avec la paix de Cateau-Cambrésis (1559) – en est une manifestation politique. Celle-ci innerve d’ailleurs largement la littérature, où les écrivains rivalisent d’élégies à l’endroit du nouveau César : sous la plume du poète, le roi de France est appelé à faire de Paris une nouvelle Rome, transfigurée :
« Rome la grand’ et les doctes Athenes
[…]
Ornées d’abord par Ciceron et Demosthenes
Et ce Paris qui suit divinement
L’antique honneur de ce double ornement ».
La fin de l’âge d’or

Rome plus que jamais obsède. Les premières victimes consentantes de cette tumeur mentale sont les Italiens eux-mêmes (surtout les Romains). Prisonniers d’une gloire antique largement révolue, ils promeuvent la dévotion vis-à-vis de l’ancien Empire alors même que ses ruines devraient servir à actualiser les jugements de la Bible. Ne tirant jamais les leçons de son passé, Rome semble condamnée à rejouer la partition de la cité maudite, instrument sanglant de la Providence. Toute tentative de faire revivre la Rome des Romains est donc vaine et ce, en dépit du pillage organisé des forums romains pour construire les églises et les palais des papes :
« Regarde après, comme de jour en jour
Rome, fouillant son antique séjour,
Se rebâtit de tant d’œuvres divines :
Tu jugeras que le démon romain
S’efforce encor d’une fatale main
Ressusciter ces poudreuses ruines ».
Si les monuments peuvent encore faire rêver les hommes, ils doivent aussi dissuader leur quête incessante de grandeur. Une illusion n’en demeure pas moins féconde lorsqu’il s’agit de revigorer un message plus politique : en puisant son inspiration dans un imaginaire nourri de Dante et d’Aristote, la papauté acte malgré elle la mort de la conception augustinienne des deux Cités. Elle a beau sacraliser les guerres menées contre Venise ou la France, en recourant à des discours eschatologiques et au registre de la croisade, les enjeux restent de nature bassement temporelle.
« …Pareille à sa grandeur, grandeur sinon la sienne.
Rome seule pouvoit à Rome ressembler,
Rome seule pouvoit Rome faire trembler :
Aussi n’avoit permis l’ordonnance fatale
Qu’autre pouvoir humain, tant fust audacieux,
Se vantast d’égaler celle qui fit égale
Sa puissance à la terre et son courage aux cieux. »
On a volontiers comparé le siècle de Léon X (pape de 1513-1521) au siècle d’Auguste. Mais le règne du premier empereur romain ne fut pas seulement une effusion de monuments gigantesques et de fêtes grandioses ; il inaugura une période de profondes réformes politiques : en dépit d’un pouvoir absolu, et soucieux des apparences, Auguste avait restauré la dignité de certaines institutions malmenées durant la guerre civile. À côté, le pontificat du pape Médicis, enivré du « nectar de l’Antiquité » (Jules Barbey d’Aurevilly), se réduit du moins à une simple hypostase sinon à une pathétique bacchanale. Derrière les attraits de la pompe, se cache une décadence amplement consommée. Mais si la civilisation est vouée à disparaître, la culture peut lui survivre :
« Le corps de Rome en cendre est dévallé,
Et son esprit rejoindre s’est allé
Au grand esprit de ceste masse ronde.
Mais ses escripts, qui son loz le plus beau
Malgré le temps arrachent du tombeau,
Font son idole errer parmy le monde ».
Le tombeau de l’humanisme ?
L’atmosphère semble malgré tout acter la défaite de la République des Lettres : la paix universelle, rêvée par les humanistes, s’est heurtée aux chimères de la monarchie universelle. Dans cette perspective, Rome ne reflète plus la puissance ; elle est au contraire un sermon vivant contre l’hubris. C’est pourquoi du Bellay ne se limite pas à une simple poésie-peinture qui donnerait l’illusion d’une permanence de la grandeur romaine. Les raisons de la puissance contiennent aussi les ferments de la chute. Cette lucidité fait écho aux critiques prononcées par Erasme à l’encontre de l’humanisme paganisant dont la rhétorique a longtemps servi à dresser des parallèles douteux entre l’apothéose des Césars et le triomphe du Christ ressuscité. Les papes de la Renaissance continuent de jouer opportunément sur ces ambiguïtés afin de conquérir les esprits et les noyer dans un déballage de fêtes. Les artistes jouent ici les auxiliaires zélés : les Stanze de Raphaël incarnent magistralement cette apothéose où toutes les sciences agissent de concert pour réaliser le dessein de la providence divine. Cette domination du champ culturel fait oublier, pour un temps seulement, la perte de puissance politique.
En dépit d’une certaine mélancolie, les complaintes de Du Bellay ne sont pas encore un chant du cygne : la littérature demeure un système de normes indépassable. Si cette dernière demeure maltraitée par des ambitions qui ne pourront jamais la ramener au niveau de son passé lointain, il n’est pas trop tard pour conserver à Rome le siège de la culture, quitte à éclipser le centre de la chrétienté, embourbé dans la corruption. Cette culture est d’ailleurs autant le produit du vice que de la vertu. A nouveau, les ruines de Rome servent de tremplin idéologique : l’Antiquité est cette fois-ci convoquée pour jeter les bases d’une résurrection.
Mais il faudrait pour cela qu’on arrachât la ville à la tragédie de l’Histoire. Rome est toujours Rome ; bâti sur le marbre et les cadavres. Renouer avec la tradition des Anciens s’avère ainsi le seul remède pour surmonter cette malédiction. À sa modeste échelle, Du Bellay veut servir de passeur. Ancré dans son temps, il entretient un état de tension permanente où gravitent et s’affrontent registre providentiel et réalisme antique ; il tente de maintenir la superposition des deux concepts dans une perspective humaniste, sans tomber dans les travers de l’idolâtrie. Cependant, cette ambiguïté féconde aux premiers temps de la Renaissance s’avère désormais précaire face aux assauts des extrémistes de tous bords. Aussi le poète embrasse-t-il une perspective proprement biblique pour rappeler que les événements demeurent soumis à la loi divine : la seule certitude relative aux empires est celle de leur effondrement futur. Le destin de Romulus sera accompli à travers ses descendants qui, une fois leur civilisation assise sur l’autel de la force, périront sous les coups des Barbares.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.