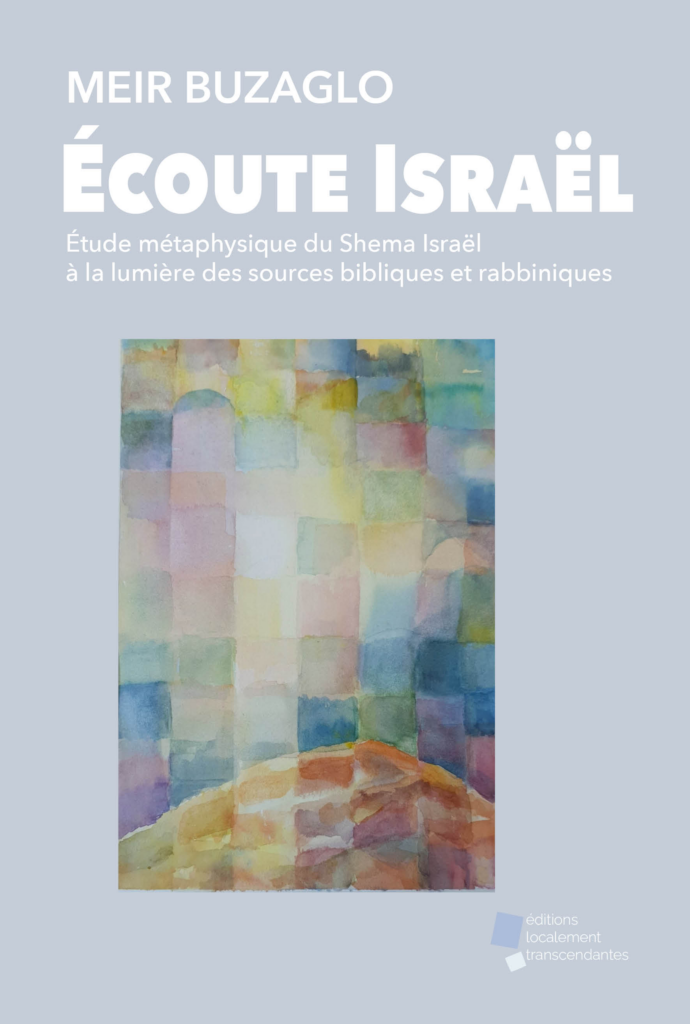Le judaïsme n’est pas réductible à une orthopraxie. Dans Écoute Israël (éditions Localement Transcendantes), le philosophe Meir Buzaglo, professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem, rouvre le grand chantier de la prière fondatrice du judaïsme, Shema Israël, pour en renouveler la compréhension. Dans le sillage de Saadia Gaon, Baḥya ibn Paquda et Maïmonide, ou encore du kabbaliste Azriel de Gérone, il interroge l’unité absolue de Dieu à la lumière de sa méthode d’« élucidation fidèle », qui allie fidélité aux sources traditionnelles et dialogue avec la philosophie, en particulier néoplatonicienne. Un essai ambitieux pour restaurer la doctrine métaphysique du judaïsme, par-delà ses réductions éthiques et ses instrumentalisations politiques.
PHILITT : Dans le contexte géopolitique hautement tragique d’aujourd’hui, l’identité juive est politisée de toutes parts. Contre le « discours nationaliste étroit » présent en Israël, vous soutenez dans votre livre que « c’est la réduction de la place de Dieu dans la vie des croyants qui laisse le champ libre à la prédication fanatique ». Comment croyez-vous que « la foi en l’unité divine, commune aux religions monothéistes, devrait enrichir la rencontre entre les traditions » ?
Meir Buzaglo : Dans le discours occidental contemporain, nationalisme et libéralisme se partagent le terrain : aux valeurs nationales revient la charge de l’identité, au camp libéral celle des valeurs universelles de justice et d’égalité. La religion y apparaît généralement comme une nuisance – perception que les phénomènes de fanatisme religieux ne font que renforcer. Au Moyen-Orient, une telle division du travail s’avère impraticable. Les croyances et les héritages religieux y déploient une intensité qui rend le discours libéral insuffisant. Un exemple l’illustrera : en Europe comme aux États-Unis, nul ne se dispute les lieux saints ; à Jérusalem, nous vivons à proximité du Mont du Temple, l’endroit le plus explosif de la planète. Dans ce cas précis, c’est la conjonction de trois modérations qui a permis jusqu’ici de cohabiter sur ce volcan : la modération du libéralisme, qui exigerait de permettre à chacun d’y prier ; la modération du nationalisme, qui a transféré la gestion du Mont du Temple au Waqf jordanien ; et la modération du zèle religieux par le Grand Rabbinat. Plus généralement, le libéralisme athée se révèle impuissant face au nationalisme lorsque celui-ci se renforce du zèle religieux. Le libéralisme recrute d’abord ceux que rebute cette alliance mais peine à résister lorsque cette force s’accroît démographiquement et institutionnellement.
La purification de la foi en Dieu fait obstacle au détournement de la religion par le nationalisme. La Torah connaît la tentation de ce détournement et l’anticipe dans l’injonction des Dix Commandements : « Tu n’invoqueras point le nom de l’Éternel ton Dieu en vain. » Il faut être aveugle pour ne pas voir que les sources des traditions religieuses dépeignent Dieu comme miséricordieux et compatissant, placent la justice et la dignité humaine au sommet de leur hiérarchie, et considèrent la protection des sans-défenses comme l’occasion privilégiée d’exprimer la position de l’homme face à Dieu. Le croyant le plus zélé sait au fond de son cœur que Dieu excède les désirs de vengeance. L’engagement envers les grandes valeurs occidentales, lorsqu’il s’oriente dans une direction anti-religieuse, perd son efficacité au Moyen-Orient. Comme Einstein a pu le dire à Heisenberg : on ne répète pas deux fois la même plaisanterie. En tant que croyants, nous prions Dieu d’éclairer nos yeux pour connaître Sa volonté et surmonter nos penchants. Si, au lieu de prier pour la victoire dans les guerres, nous priions Dieu de nous aider à promouvoir le bien, nous aurions déjà considérablement progressé – et le laïque israélien pourrait cesser de combattre indistinctement tous les héritages religieux.
La religion juive est souvent définie comme une « orthopraxie » par opposition aux religions qui seraient plus théoriques, centrées sur « l’orthodoxie ». D’où vient cette conception, selon vous ?
Le monde grec opère une distinction tranchée entre l’action et la contemplation, qui a le rang suprême. Le monde juif, lui, se place sous le régime du commandement, de la mitzvah. Parmi ces commandements, certains relèvent de la pratique, d’autres – centraux en réalité – de la contemplation. L’étude de la Torah constitue un commandement dont la centralité pour le judaïsme va de soi. Lorsque le commandement est le point de départ, nous saisissons le théorique – d’ordre métaphysique – autrement. Leibowitz et Levinas ont souligné à notre époque la primauté du commandement, mais en post-kantiens qu’ils sont, ils ont réduit la dimension ontologique présente dans les diverses formes du monothéisme. Si nous ne sommes ni des positivistes logiques comme Yeshayahu Leibowitz, ni des penseurs rejetant d’emblée l’ontologie comme Levinas, la voie s’ouvre alors pour inclure dans l’étude de la Torah la contemplation métaphysique de la relation vigilante que le Dieu Créateur entretient avec l’histoire humaine. De fait, la fidélité à la transmission intergénérationnelle par laquelle nous parviennent les commandements inclut également le devoir de connaissance :
« Et toi, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d’un cœur entier et d’une âme désireuse, car l’Éternel sonde tous les cœurs et comprend toute formation de pensée ; si tu Le cherches, Il Se laissera trouver par toi ; mais si tu L’abandonnes, Il te délaissera pour toujours. » (1 Chroniques XXVIII, 9)
Ou, plus simplement encore – si simplement qu’il est facile de l’ignorer :
« Écoute, Israël, YHWH est notre Seigneur, YHWH est Un. » (Deutéronome VI, 4)
Un second point mérite attention : le rapport entre pratique et contemplatif. La pratique sert d’atelier à la compréhension métaphysique et enrichit les sources de la connaissance. Dans le midrash comme dans la bénédiction après les repas, nous évoquons l’idée que le Shabbat constitue un avant-goût du monde à venir. Impossible de conceptualiser rigoureusement ce type de relation que le midrash qualifie d’ « avant-goût » : « un avant-goût du monde à venir, c’est le Shabbat ». C’est le même type d’analogie qui met en relation le sommeil et la mort. Nulle relation conceptuelle entre sommeil et mort, certes, mais nous ne pouvons pas abandonner ces analogies sans porter atteinte aux métaphores qui gouvernent la culture que nous avons développée. De même, l’accomplissement du commandement élargit l’espace de nos expériences et nous met en relation avec la métaphore qui saisit le monde à venir. J’espère pouvoir développer ce point à l’occasion.

À ce propos, vous critiquez Spinoza qui « exigeait l’élimination de toute dimension théorique de la foi ». Quel problème le Traité théologico-politique (1670) pose-t-il fondamentalement, selon vous ?
La menace que pose le Traité théologico-politique concerne, à mon sens, la compréhension traditionnelle de la Torah au sens riche du terme. Spinoza ne s’oppose pas seulement à la lecture maïmonidienne de la Torah – qui voit dans l’étude de la métaphysique un commandement – mais aussi à la lecture qu’en font les sages. En réduisant la Torah au seul texte biblique et en affirmant que des êtres humains l’ont écrite, il pensait abolir la praxis qui lui accorde une place centrale. Il me semble qu’en définitive, Spinoza a échoué dans cette entreprise. Cette praxis demeure vivante et vigoureuse à un point qui suscite l’étonnement, et le principe de charité nous oblige à tenter de comprendre cet affairement dans l’étude avant de prétendre l’épuiser par telle ou telle explication psychologique.
Un examen préliminaire révèle d’ailleurs la faiblesse des arguments spinozistes. Pour établir une contradiction entre la croyance que la Torah fut écrite par Dieu et l’affirmation qu’elle le fut par des hommes, il aurait fallu d’abord nous expliquer ce que signifie « la Torah a été écrite par Dieu ». Croit-on vraiment que d’après la Tradition, il s’agit d’un ensemble de pages descendues une à une du ciel ? On peut appréhender la Torah en termes phénoménologiques, du point de vue de celui qui s’y engage. En bref : une manière d’approcher la Torah que l’on peut qualifier de très « sérieuse », qui reçoit confirmation et se renouvelle par la réponse qu’elle suscite dans la Torah, et qui l’élève ainsi à un niveau supérieur. L’affirmation empirique selon laquelle la Torah a été écrite par des hommes n’ajoute ni ne retranche rien à cela. Lorsque Salomon Maïmon fut interrogé au tribunal sur ce qu’est le shofar, il répondit qu’il s’agit d’une corne de bélier – réponse analogue à la cause matérielle aristotélicienne. Mais si cette corne de bélier sert à sonner le shofar aux jours de repentance, si elle éveille à la repentance, si les enfants s’entraînent dehors à en sonner, si tous attendent la sonnerie pour pouvoir manger, si le rituel se relie aux midrashim sur le shofar et à la possibilité que le sacrifice remplace le zèle religieux d’Abraham prêt à sacrifier ce qu’il a de plus cher, alors la réponse de Salomon Maïmon est loin d’épuiser l’essence du shofar. La critique biblique, dont Spinoza est l’un des initiateurs, nous livre la cause matérielle du texte biblique et s’imagine avoir ainsi épuisé sa signification.
Quelle est la motivation de Spinoza ? Il tente de préserver la liberté de pensée en confiant la religion aux fonctionnaires de l’État. Il ne s’agit pas de séparer religion et État, mais d’annuler le pouvoir autonome des autorités religieuses. Son argument est aussi simple que juste : on ne peut confier l’État à l’establishment religieux. Malgré telle ou telle réserve, sur ce plan, Spinoza avait raison. Les résultats humanistes du recul de l’Église en Europe et les résultats amers du règne des autorités religieuses en Iran constituent une preuve décisive de ses propos. Cependant, dans un monde post-séculier, il devient difficile d’ignorer que la proposition spinoziste constitue une réaction excessive. Non seulement parce que libéralisme anti-religieux et fondamentalisme se nourrissent l’un de l’autre, mais parce que le retrait de l’autorité séculière face aux Écritures Saintes les a abandonnées à des interprétations fanatiques qui ne profitent ni à la religion ni au monde des valeurs humanistes.
L’unité de Dieu dans la Torah est souvent réduite par les profanes à ce que vous appelez sa signification « cosmologique » — celle du « seul vrai Dieu » parmi les dieux auxquels croient les humains. En quoi le sens « métaphysique » est-il encore plus important ?
Ma compréhension du métaphysique s’énonce en termes platoniciens : la suprématie du Bien. Le sens de la croyance en « YHWH notre Dieu, YHWH est Un » réside dans la croyance en la victoire du Bien. La question de savoir si Dieu est divisible ne m’intéresse guère, d’autant qu’aucune source ne soutient pareille idée. Si quelqu’un l’affirmait et le justifiait, je ne m’y opposerais pas, mais cela n’en ferait pas quelque chose de métaphysique au sens profond du terme. À cet égard, la critique de l’onto-théologie comporte une part de vérité. Mais il ne faut pas s’arrêter là. Le sens cosmologique, dans ses formulations familières, évacue la question de la distinction entre bien et mal et ne qualifie pas la nature du règne divin. Il risque également de rendre superflue la responsabilité humaine. La formulation métaphysique, qui renvoie au-delà de l’ordre physique naturel par un appel au Bien, ne rend pas la responsabilité humaine superflue. Elle en constitue au contraire la condition : si le monde n’est qu’une jungle, et l’histoire une chute dans l’abîme de la violence, que reste-t-il de la responsabilité humaine et de la vigilance politique auxquelles nombre d’entre nous demeurent attachés ? La victoire du Bien, l’appel de ceux qui furent envoyés dans les chambres à gaz en proclamant le Shema, constitue une condition de l’action humaine. Einstein pensait que pour partir en quête de la raison dans l’univers, il faut supposer qu’une divinité rationnelle se trouve à son fondement. Kant pensait que pour garantir que l’action humaine ne soit pas vaine, il faut croire qu’un grand bonheur attend les bons. Dans le même sens, sans croyance en la victoire du Bien, nulle place pour la responsabilité humaine. Levinas y fait allusion lorsqu’il soutient que le désespoir constitue un péché religieux. À mon humble avis, il aurait été juste de développer ce point dans l’affirmation même de la primauté de l’éthique.
Vous réévaluez « la perfection » et « l’infinité » comme deux véritables caractérisations de Dieu dans le verset fondamental du Shema Israël (Deutéronome 6:4). Comment la recherche sur les midrashim et la Kabbale vous a-t-elle conduit à ces découvertes ?
L’intégration des midrashim, des prières ou des poèmes liturgiques dans le corpus étudié fait émerger cette lecture comme une image possible. L’étude des significations hébraïques du mot « un » (ehad) qui apparaît dans le Shema fait apparaître l’idée de perfection. « Un », dans l’une de ses acceptions, signifie complet, entier — comme dans « et le Tabernacle fut un ». Il s’avère que les midrashim des Sages ont éclairé ce point. Nous concluons la prière par l’Aleinou Leshabéah, qui se termine par les mots du prophète Zacharie : « en ce jour, l’Éternel sera Un et Son nom sera Un ». Lorsqu’ils interprètent ce verset, les Sages comprennent « Un » comme « Bien ». D’importants kabbalistes comme Rabbi Azriel de Gérone ont compris l’Ein Sof (l’Infini) comme perfection.
En abordant la « signification universelle » de l’unité divine, vous contestez le préjugé selon lequel le judaïsme serait une foi tribale, au sens précis défini par Elinor Ostrom – c’est-à-dire une « religion réservée » aux seuls élus. Comment cette théorie juive de l’universalité vous permet-elle de concevoir une alternative au cosmopolitisme kantien ?
Le peuple d’Israël, selon la définition maïmonidienne, est la nation qui connaît YHWH. La dimension universelle de la foi juive n’en demeure pas moins évidente pour tous. Abraham est le père d’une multitude de nations, et il est dit de lui : « en toi seront bénies toutes les familles de la terre ». À Rosh Hashana, la prière ajoute : « qu’ils forment tous une seule union pour faire Ta volonté » – c’est l’ensemble du genre humain qui est visé. Ces données sont connues. Ce qui importe lorsque nous nous penchons sur la fin des temps, c’est avant tout la manière dont cette perspective influence notre perception du passé et du présent. Dans cette conception, l’islam et le christianisme participent de la promotion de la grande annonce. Maïmonide a défendu cette position à une époque où les Almohades tentaient d’islamiser les Juifs par la force et où la chrétienté menait de cruelles croisades. L’exemple maïmonidien est ici décisif : sans croire en Dieu, les Juifs n’auraient pu croire en l’homme.
L’enseignement de Kant est important. La prise de position contre l’utilisation de l’homme comme moyen et non comme fin – ce que nous nommons aujourd’hui « réification » – est un principe suprême. Mais il a également montré, en fin de compte, combien nous demeurons sujets à l’erreur lorsque nous ne suivons que notre raison. Non seulement parce qu’il découle de sa doctrine que, si un homme de la Gestapo frappe à votre porte pour savoir si vous cachez un Juif, vous devez lui dire la vérité — faute de quoi l’interdiction de mentir comporterait une exception, ce qui contredit l’impératif catégorique. Mais aussi parce que, lorsqu’il définit le mariage comme un contrat permettant à deux personnes d’utiliser le corps l’un de l’autre, il sombre dans le grotesque. Le contenu même du cosmopolitisme pose problème. L’idée d’abolir les nations est particulièrement problématique, comme l’ont fait remarquer Herder et d’autres. Lorsque je défends mon appartenance au monde juif, je ne m’oppose pas au cosmopolitisme au nom d’une autre idée générale — le nationalisme. Je m’y oppose au nom du Shabbat. Dans une situation marquée par la désintégration de la famille, de l’éducation, de l’État, par la domination des écrans et l’asservissement au travail, je ne vois pas d’espoir pour l’humanité sans le Shabbat.
Vous soutenez que pour philosopher, « le croyant doit [commencer par] suspendre ses croyances », « non pas parce qu’il ne peut pas répondre de son point de vue, mais parce qu’il commence avec une réponse ». Dans quelles conditions, alors, peut-on parler de « philosophie juive » ?
Nous touchons là une question méta-philosophique importante. Le philosophe commence-t-il de nulle part ? C’est probablement faux. Le philosophe appartient à un contexte : il est déterminé par les opinions qu’il rejette, par celles qu’il a rencontrées, par la langue, par les lecteurs auxquels il s’adresse – sans même évoquer la manière dont les revues, dont les comités de lecture définissent ce qu’est une bonne philosophie, le déterminent également ! Le départ à l’aventure du philosophe en quête possède un charme qui suscite l’étonnement et évoque l’éveil du sujet. Le philosophe juif doit se contenter de voyages moins séduisants. Il faut admettre que sa philosophie ne constitue pas un acte de liberté mais d’obéissance. Il demeure également limité dans les conclusions auxquelles il peut parvenir. Mais, par une grâce dont l’origine reste obscure, on ne peut s’arrêter à cette seule constatation. Des philosophes qui se sont lancés sans repères dans une telle quête ont grandement échoué. Platon, avec son idée folle sur la communauté des femmes et des enfants. Kant, avec ses délires moraux — et je ne parle pas ici de l’abolition même de la métaphysique, qui me semble erronée. Bertrand Russell, qui prônait les mariages ouverts jusqu’à ce que sa femme commence à l’irriter avec les enfants d’un amant qui gravitait autour d’eux etc.
D’autre part – cela s’est produit dans mon travail –, une énigme fascinante est apparue. Alors que j’étudiais Bahya Ibn Paquda (qui s’est largement inspiré du néo-platonisme de Plotin) pour rectifier sa doctrine à la lumière des sources traditionnelles, j’ai constaté que je comprenais mieux Plotin et que je « rectifiais » en fait Plotin lui-même. Cela se produit aussi dans des contextes plus évidents : lorsque vous parvenez à la conclusion que Dieu est l’Être nécessaire et développez cette idée vers celle de cause de soi, il apparaît que le nom de Dieu dans le judaïsme – YHWH – fait allusion de manière évidente à son être comme Être nécessaire. Le philosophe croyant ne peut se permettre la liberté du philosophe laïque. Mais le philosophe non engagé envers la Tradition devrait se trouver perplexe face à la profondeur de la philosophie religieuse. Et si sa liberté de pensée s’étend jusque-là, l’invitation lui est adressée d’envisager la possibilité d’avoir à modifier le sens et la définition du philosopher avec lesquels il s’était mis en route.
Comment votre méthode « d’élucidation fidèle », à la fois philosophique et traditionnelle, prétend-elle restaurer un dialogue pacifique face à la persistance des « anathèmes » et des « contre-anathèmes », dont le plus célèbre fut le Herem prononcé contre Spinoza par les autorités rabbiniques ?
L’idée d’élucidation fidèle ne vise pas seulement le philosophe, mais aussi les rabbins et les institutions qui ont voulu neutraliser la raison. Ils ont traduit le désaccord en combat, en excommunication – et, selon certaines sources, en brûlant des livres de Maïmonide. Je propose au contraire de transformer le désaccord en « controverse au nom du Ciel ». Dans l’élucidation fidèle, Aristote, Platon et Spinoza deviennent des partenaires de conversation dialogique, de havruta. Maïmonide pensait qu’on ne pouvait être un Juif complet sans Al-Farabi. Thomas d’Aquin a enrichi son christianisme avec Maïmonide. Et j’ai besoin de Spinoza comme partenaire de conversation pour être un homme complet et un Juif croyant.
Traduction par Yehiel Davenne
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.