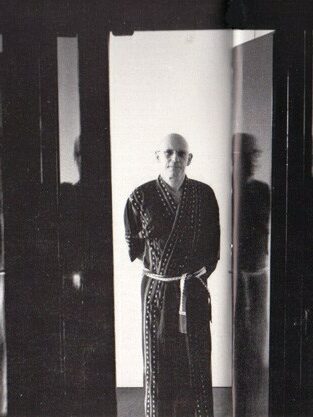Thomas Brisson est professeur au département de science politique de l’université Paris 8, chercheur au Cresppa et chercheur associé à la Maison franco-japonaise. Attentif à la diffusion des idées et des savoirs occidentaux à une échelle globale, son dernier ouvrage, La désoccidentalisation des savoirs (éd. La Découverte), tente de penser les contradictions. Est-il seulement possible d’appréhender le monde oriental dans des catégories profondément occidentales ? La recherche de Thomas Brisson permet un pas de côté, échappant à fois à la vision d’un universalisme occidental dominateur et à la critique décoloniale peinant à rendre compte de la complexité des échanges entre Orient et Occident.
PHILITT : Votre livre s’intitule La désoccidentalisation des savoirs. Pouvez-vous définir ce titre et la thèse principale de l’ouvrage ?
Thomas Brisson : Un titre en dit toujours trop ou pas assez. Cela fait des années que je fais des recherches sur la question de la diffusion, l’importation et de la reprise des savoirs des sciences humaines en dehors des mondes occidentaux. La « désoccidentalisation des savoirs » a d’abord à voir avec ce processus de diffusion du savoir, mais touche également à la reprise critique de ces savoirs issus du monde occidental par les mondes non-occidentaux. L’idée de l’ouvrage était de penser conjointement ces deux éléments : ce qui est de l’ordre de la diffusion et de l’ordre de la critique, ce qui pourrait être contre-intuitif au départ, car s’il y a critique on peut supposer une résistance et s’il y a diffusion on pourrait penser qu’il y a acceptation et reprise. Je pense que l’on peut trouver une forme d’articulation possible et penser les choses ensemble, la diffusion des savoirs s’accompagnant presque nécessairement d’une redéfinition locale.
Nous avons souvent le schéma de l’Occident hégémonique débordant sur le Sud. Relativisant la modernité occidentale, vous montrez que certains pays non-occidentaux ont entrepris des missions contre-hégémoniques par le contact avec l’Occident lui-même. À ce titre, en quoi le Japon vous a paru un exemple intéressant à traiter ?
La logique des sciences sociales et de l’hégémonie occidentale sont liées mais sont aussi à dissocier. J’essaye de voir comment fonctionne la logique d’attention aux savoirs de l’Occident, qui est souvent première, comment la logique de l’hégémonie arrive ensuite, et comment cela s’imbrique. Le Japon est à ce titre intéressant, les Japonais ont découvert les sciences sociales durant l’ère Meiji, même s’il y avait un précédent avec les études hollandaises. L’attention à ce qui se passait en Occident a été très tôt très forte, et il y a chez les Japonais une capacité à articuler efficacement un savoir contre-hégémonique, et ce quand bien même les Japonais ont connu leur propre impérialisme, leur propre hégémonie en Asie. Mais ils ont réussi à sortir de la dette envers l’Occident rapidement, et réussir là où la Chine ou l’Egypte allaient au départ échouer. Les Japonais ont été les premiers historiquement grâce à des canaux précoces de diffusion de la connaissance, mais avec la modernisation et l’assimilation de nouveaux dispositifs dans cette diffusion nous pouvons aujourd’hui relativiser cette exception : rien ne dit que la Turquie, la Chine ou d’autres ne puissent pas arriver au même point.
Ce processus d’assimilation passe en partie par la traduction et la capacité à traduire un terme occidental dans un contexte non-occidental. Selon vous, est-il possible de penser un terme en dehors de son milieu ?
Je n’ai pas de réponse fixe à cette question, cela reste ouvert. Pour reprendre le cas précédent, a-t-on par exemple un Japon totalement modernisé et occidental, ou avons-nous un Japon qui a réussi à se glisser dans les paradigmes occidentaux pour en faire autre chose ? Cette question renvoie à une interrogation que j’ai depuis longtemps : dans quelle mesure les savoirs occidentaux ont-ils radicalement redéfini les épistémès alternatives ? Le cas du bouddhisme japonais m’intéresse particulièrement à ce titre : est-ce que les savoirs occidentaux et leurs effets « désenchantants », pour le dire dans une perspective post-wéberienne, ont mis fin à une trajectoire du bouddhisme antérieure en l’intégrant irrémédiablement dans une modernité saturée et écrasante ? Ou bien la modernité occidentale ne serait-elle finalement qu’un des différents paradigmes qu’a traversés le bouddhisme au cours de son histoire, de la même manière qu’il a traversé les mondes indiens ou chinois, la modernité occidentale n’étant alors qu’un moment parmi d’autres, et pas forcément le plus déterminant, dans une longue trajectoire ? Je ne suis pas sûr que l’on ait la réponse, mais il est clair qu’elle prendrait place soit dans une lecture pessimiste d’une modernité définitive qui intègre recompose et finalement piège tout ce qui n’est pas elle, soit dans une lecture plus ouverte de la modernité qui montrerait des échappatoires multiples.
Que vous inspire l’idée d’une différence irréductible entre Occident et Orient ?
Il me semble que l’on voit actuellement l’Occident devenir un monde parmi d’autres. Il y a des reprises, des savoirs réinventés, mais je suis assez optimiste et confiant sur cette capacité des mondes à devenir pluriels. Les sciences sociales ne sont finalement pas un piège, ce n’est pas que de l’hégémonie, de la domination pure. Si utiliser les sciences humaines suppose évidemment un passage par une rationalité occidentale, je ne crois pas du tout à la thèse du captive mind, où l’esprit serait forcément prisonnier d’une rationalité définitive. Il y a des possibilités de considérer et de s’approprier un paradigme piégeux sans pour autant tomber dans le piège.
À côté de cela, les logiques sont complexes, et il faudrait qualifier proprement la modernité. De quoi parlons-nous ? De l’autonomisation des espaces sociaux ? Du capitalisme ? De la scientifisation et de la technicisation du monde ? De plus il y a des logiques sociales qui traversent de manière globale l’Inde, l’Égypte, le Japon et l’Occident. Il y a donc des continuités, et nous avons intérêt à les penser globalement, ce qui implique, qu’on le veuille ou non, de se situer par rapport aux sciences sociales. Le but du livre était aussi d’aller au-delà du discours d’une partie des études post-coloniales et surtout, aujourd’hui, décoloniales. Nos collègues japonais, chinois, indiens ont contribué autant que nous aux savoirs des sciences sociales, et le fait que cette grande aventure ait commencé avec Weber, Durkheim ou Marx n’est peut-être finalement pas si important.
Dans ce cadre et voyant les pôles de production de savoirs se déplacer dans des espaces non-occidentaux, les hégémonies se renversant, aurons-nous bientôt un discours similaire sur la « désorientalisation des savoirs » ?
J’ai plutôt tendance à le penser en effet, en tous cas si l’on donne à ce terme de « désorientalisation » un sens ici aussi dialectique. Mais les logiques globales sont difficiles à appréhender et les prévisions toujours hasardeuses. D’autant plus que ces questions sont aussi politiques, les sciences sociales peuvent être menacées par les montées autoritaires qui se multiplient ici aussi globalement, y compris en Europe et aux États-Unis où l’on assiste à des attaques importantes contre ces savoirs. C’est peut-être similaire à ce que nous voyons dans l’intelligence artificielle, où des savoirs techniques et appliqués dans le monde chinois concurrencent très nettement les Etats-Unis, à cette différence près que les savoirs techniques sont souvent vus comme un moyen de renforcer la puissance des États alors que les sciences sociales ont une dimension critique que ces mêmes États voient avec de plus en plus de méfiance. De ce point de vue, on peut penser que les sciences sociales ne vont pas mourir mais que, dans un monde où la centralité des États se réaffirme, la production des savoirs se recomposera. Quand bien même il y aurait un pôle asiatique puissant ou des tentations identitaires marquées, l’appareillage des sciences sociales reste valide pour penser les dynamiques à l’œuvre. Je vois donc plutôt des modèles hybrides, avec persistance et reconfiguration des sciences sociales critiques, aujourd’hui peu pensables.
Vous passez un long morceau de l’ouvrage sur le zen et sa pénétration en Occident par la psychologie. Lors de son voyage au Japon, Michel Foucault faisait remarquer que « le zen et le mysticisme chrétien sont deux choses qu’on ne peut pas comparer, tandis que la technique de la spiritualité chrétienne et celle du zen sont comparables ». Qu’en pensez-vous ?
C’est très intéressant, et je pense que Foucault voyait cela par rapport à ses propres questions, notamment dans les débats autour de Jung avec lequel il voulait se démarquer. Je suis d’accord avec Foucault dans le sens où il est difficile de rentrer dans quelque chose en en restant à des techniques ou des savoirs opératifs, mais une réponse du bouddhisme pourrait aussi être que l’on ne rentre dans un monde que par des catégories, jusqu’au moment où ces mêmes catégories lâchent. Nous approchons un discours par des catégories savantes, mais à la fin le discours s’articule sur ce qu’il y a au-delà du discours et au-delà d’un savoir classique. La psychanalyse, particulièrement dans sa version lacanienne, ou la critique du discours sont sûrement des endroits plus intuitifs pour des occidentaux voulant approcher la question du zen.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.