Dans la préface de son premier recueil de poèmes, Poète… vos papiers !, Léo Ferré livrait l’un de ses écrits les plus beaux et les plus violents. À la recherche de la poésie véritable, ce « manifeste du désespoir » renvoyait dos à dos les révolutionnaires et les bourgeois, leurs idéaux politiques et artistiques et leur conception identique de l’humanité, pour ne plus célébrer que la liberté de l’homme solitaire et insoumis – l’unique poète véritable.
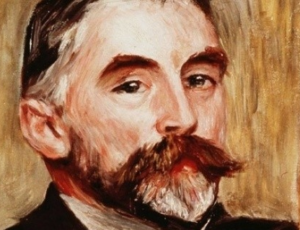
La radicalité de Léo Ferré pose problème jusque dans les cercles anarchistes dont il partageait quelques idées, et son héritage poétique demeure mal compris. Davantage estimé pour avoir su sculpter le verbe avec prodige que pour lui avoir insufflé violence et insoumission, il n’est plus désormais que d’hommage artistique pour commémorer le souvenir du « chanteur ». Trop souvent oubliée, c’est pourtant sa rébellion perpétuelle contre les hommes qui caractérise l’esprit le plus singulier de ses écrits. Il constatait amèrement que « la poésie contemporaine ne chante plus : elle rampe ». Contemporain d’une époque où l’insurrection était « de gauche », « comme on dit d’un fromage qu’il est de chèvre ou d’un vin qu’il est de Bordeaux », il avait en effet été témoin de cette soumission de la poésie aux grands idéaux prétendument libérateurs qui s’arrogeaient le monopole de la pensée révolutionnaire.
Or, loin de la lourdeur racoleuse des poèmes tardifs d’Aragon, bien plus éloignée encore des mots d’ordre pseudo-poétiques de mai 68, la poésie de Ferré célébrait le rejet radical de la révolte populaire, de la clameur de la foule et du cri du peuple. Comme Nietzsche ou Mallarmé, il voulait que sa plume soit éminemment aristocratique, donc solitaire, et il reniflait dans la poésie des salons bourgeois les mêmes effluves rances que dans la poésie faite combattante de la classe ouvrière. « Le poète d’aujourd’hui doit être d’une caste, d’un parti ou du Tout-Paris », ironisait-il. C’est précisément pour cela qu’il refusait les conventions poétiques classiques, affirmant que « les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s’ils ont leur compte de pieds ne sont pas des poètes : ce sont des dactylographes », tout autant qu’il exécrait l’affaissement de l’art démocratisé, raillant la vacuité consternante du dadaïsme qui entendait « poétiser le prolétaire ».
Léo Ferré ne fut jamais non plus partisan de l’avant-garde élitiste, ne confondant pas aristocratie et snobisme : « L’art abstrait est une ordure magique où viennent picorer les amateurs de salons louches qui ne reconnaîtront jamais Van Gogh dans la rue. » Son exigence se caractérisait en réalité par un isolement intransigeant, impropre au compromis moderne, et intolérable aux idéalistes, optimistes et humanistes, finalement naïfs. « Les sociétés littéraires, c’est encore la société : la pensée mise en commun est une pensée commune. »
La solitude est ce qui reste à l’homme de liberté

S’il tenait tant à ce que le poète embrasse pleinement sa condition solitaire et accepte la réclusion, c’est parce que Léo Ferré n’accepta jamais de transiger avec sa conviction éternelle ; il ne fut jamais partisan de l’anarchisme, mais bel et bien de l’anarchie. Méfiant à l’égard des courants politiques qui s’en réclamaient et qui n’aspiraient au fond qu’à renverser l’ordre moral sans toucher à l’ordre politique, il lui accordait un sens bien plus puissant et étendu, qui évoque encore les écrits de Nietzsche : c’était l’ordre du monde même qu’il rejetait. L’ordre de la nature, l’ordre qu’appose sur les chaotiques remous de la vérité la perception ordonnatrice de l’homme, l’autorité du réel sur le rêve. « Divine Anarchie, adorable Anarchie, tu n’es pas un système, un parti, une référence, mais un état d’âme. […] Tu es l’avoine du poète. » Seul, l’homme est libre, et devient poète. Enchaînés à nos semblables, nous ne sommes plus que médiocres et désarmés, contraints de suivre le flot implacable de la multitude, « avec nos âmes en rade au milieu des rues, nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions ». La solitude de l’homme noyé dans la masse menace plus pernicieusement et plus dangereusement son âme que la solitude de l’ermite éternellement libre qui s’écarte de ses frères pour mieux les aimer.
Il n’y a donc plus rien à espérer des hommes pris ensemble et la seule révolution qui puisse éclater, l’unique combat qui puisse se livrer, sont intérieurs. Plus rien à espérer de l’Histoire non plus : « Le progrès, c’est la culture en pilules. » Plus cynique encore, la société s’avère même prête à profiter de l’isolement de l’homme des masses qui n’aurait pas encore brisé ses chaînes pour retrouver la solitude et la liberté, à faire fructifier son malheur et à en tirer bénéfice. Elle a déjà prostitué l’art, elle se montrera bien capable d’en faire autant avec ce faux désespoir présenté comme inéluctable. « On vend la musique comme on vend le savon à barbe. […] Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu’à en trouver la formule. Tout est prêt : les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir ? » Le véritable désespoir, à l’inverse, est celui du poète, et c’est un cri d’espoir. C’est ce cri que pousse Léo Ferré dans ce manifeste du désespoir, qu’il achève en souhaitant qu’il constitue pour ses frères libres un manifeste de l’espoir, une fois la liberté retrouvée dans la poésie. Car elle est pour lui « ce no-man’s-land où les chiens n’ont plus de muselière, les chevaux de licol, ni les hommes de salaires ».
