Ouvrage majeur de l’ineffable Max Weber et référence en matière de sociologie, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme propose une lecture séduisante d’un phénomène propre au monde moderne – l’essor du capitalisme – en dévoilant ses racines théologiques. Le propos est passionnant et doit fixer notre attention, à la fois, sur la méthode d’analyse adoptée ainsi que sur la thèse défendue.
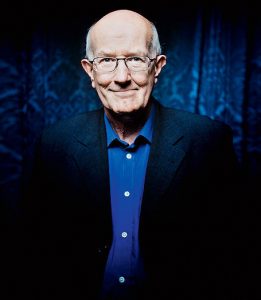
Il est toujours commode de situer historiquement la naissance d’un nouveau monde au moment précis où celui-ci s’accomplit pleinement, passe de la puissance à l’acte. La « table rase » opérée par la Révolution de 1789 est, en ce sens, un point d’ancrage privilégié puisque l’Ancien Régime y fut explicitement (visiblement) congédié par une refonte de l’armature juridique. Se dessine alors les contours d’une autonomie républicaine en devenir – non sans quelques hésitations : entre bonapartisme et monarchie libérale à l’anglaise – résolument tournée vers l’avenir, et sur laquelle rebondira la rationalité économique propre au capitalisme. Dire que de l’éthique protestante jaillit l’esprit capitaliste c’est dire qu’au sein d’une structuration à dominante religieuse du monde – mode de structuration que Marcel Gauchet ramasse en quatre caractéristiques : obéissance au passé (tradition), hétéronomie du pouvoir (domination), respect des inégalités naturelles (hiérarchie) et primauté accordée à la totalité sur les parties ou entités individuelles (incorporation) – il est déjà possible d’entrevoir, avant même les mutations institutionnelles profondes issues des mouvements révolutionnaires, les prémices d’une nouvelle ère. La rationalisation de la production, en tant qu’élément central de la modernité, ne se réfracte pas tant – pas décisivement – dans un état de sécularisation avancé qu’au cœur du débat théologique, au creuset de nouvelles sensibilités religieuses.
Selon l’épistémologie positiviste chevillée aux écrits wébériens, la valeur d’un travail intellectuel – de la sociologie, cette « science sociale » – se mesure à son degré de rigueur scientifique. L’homme de science, après avoir circonscrit son objet d’étude, vise l’obtention d’une connaissance labellisée « wertfrei », dépourvue de « jugements de valeur » (neutralité axiologique ou éthique). L’exigence de neutralité agit comme un filtre destiné à produire un savoir purifié : partir de l’être – du fait – pour dégager, non plus un devoir-être, mais une causalité mécanique, une relation de cause à effet. Il faut donc y voir une réprobation de la métaphysique et, par truchement, de l’éthique. Cependant, ostraciser les jugements de valeur ne signifie nullement supprimer le « rapport aux valeurs » et Weber ne renonce pas à l’exploration d’un fait en lien avec des principes, des croyances : identifier une valeur en lui conférant une fonction explicative ne dérogerait pas à la scientificité de l’étude. C’est sur ce point que Max Weber se démarque de Marx et de son matérialisme historique.
L’Histoire n’est pas uniquement déterminée par des rapports de pouvoir – de classe – moulés dans un certain type d’organisation économique mais, au moins tout autant, par des idées, des croyances qui, en eux-mêmes, possèdent une force contraignante. Weber refuse d’admettre que les idées religieuses et/ou morales (superstructure) résultent entièrement du mode de production (infrastructure). Ce rejet du matérialisme historique traduit, plus profondément, l’opposition à une lecture « historiciste » de la méthode scientifique. La neutralité éthique se justifie différemment ou, ce qui revient au même, la question éthique et politique fondamentale des Anciens – comment l’homme doit-il vivre ? – est évincée sur un autre mode : chez Marx la découverte d’un sens historique inéluctable suffit à motiver une telle éviction ; chez Weber c’est l’impossibilité d’affirmer objectivement la supériorité d’une valeur ou doctrine morale sur une autre qui l’autorise. D’un côté l’Histoire, de l’autre le relativisme ou subjectivisme moral. Il n’y a donc pour Weber aucun sens de l’histoire caché derrière les intentions des acteurs ; l’ombre du soupçon ne plane pas au dessus de son œuvre : l’éminent sociologue se tient à l’écart du moment nietzschéen – après lui foucaldien – dont la teneur consiste à croire qu’il faudrait « traiter les faits sociaux comme des choses dépouillées des significations (anthropomorphiques) que les gens y attachent en tant qu’acteurs […], séparer la réalité des choses (les rapports de pouvoir) des interprétations subjectives fournies par les intéressés (l’invocation des règles de justice) » (Vincent Descombes, «Le moment français de Nietzsche», in Coll., Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens).

Il y a pourtant une limite au principe de neutralité axiologique. Non pas que la méthode positive liquide jusqu’à la possibilité même du jugement moral puisque, si l’éloge et le blâme perdent l’estime véhiculée par un effort intellectuel sérieux, ils n’ont pas pour autant totalement disparu du discours : l’auteur positiviste devra alors changer de registre, opérer en qualité de moraliste ou de philosophe et non plus de scientifique. Ajoutons par ailleurs que le respect d’une attitude positiviste au sens large peut tout à fait conduire, selon une perspective davantage historiciste, au développement d’un propos prescriptif (politico-juridique) indexé sur la compréhension des lois du progrès – Comte ou Marx peuvent en témoigner. La normativité ne disparaît pas, elle est rationalisée.
La limite évoquée plus haut tient au caractère foncièrement illusoire d’une rupture avec l’émission de jugements de valeur : illusoire en ce sens que de tels jugements constituent l’horizon indépassable de tout travail intellectuel ; horizon infranchissable que Weber contourne par l’effet d’une dissimulation, d’une rétention. Le choix des valeurs relatives à un objet d’étude (à une sociologie de la morale ou de la religion) s’insèrent dans un phénomène institutionnel plus large dont il faut saisir, cerner, les caractéristiques, l’éthos. C’est bien le cas du phénomène religieux et Weber n’en disconvient pas. À ce stade le recours au jugement moral se révèle pourtant inévitable car indispensable : le sociologue ne peut faire l’économie d’une discrimination entre l’authentique et l’inauthentique, entre le supérieur et l’inférieur. Weber devait par exemple relever l’influence délétère du puritanisme sur la création artistique. Or ce fait – l’affaiblissement de la création artistique généré par l’esprit puritain – n’est digne d’intérêt « que parce qu’un élan authentiquement religieux et d’une haute envolée a été à l’origine du déclin de l’art, c’est-à-dire du « tarissement » de la source primitive d’un art authentique et vraiment grand » ; « car supposez au lieu de cela qu’une superstition languissante ait donné naissance à une quelconque camelote : il est évident qu’aucun homme sensé n’y accorderait la moindre attention » (Leo Strauss, Droit naturel et Histoire). L’auteur de Droit naturel et Histoire restitue l’analyse wébérienne en s’affranchissant des « non-dits » : le choix d’étudier la compénétration du champ religieux et artistique – tous deux traversés par un éventail de valeurs – donne à voir une valorisation sous-jacente de ces deux phénomènes, une justification de leur élection par un jugement sur leur authenticité, sur leur éminence.
Weber et les racines protestantes du capitalisme
La thèse est simple en surface : l’éthique protestante constitue un événement majeur – pas le seul néanmoins – dans le passage d’une économie précapitaliste à une économie capitaliste. Weber tente donc d’expliquer la modification du mode de production par l’émergence de nouvelles valeurs. Si le capitalisme repose uniquement sur le fait de posséder un capital et de vivre selon les revenus de celui-ci, alors l’éthique protestante ne peut sérieusement éclaircir ce phénomène ; l’activité économique d’avant la Réforme était déjà capitaliste selon cette définition. En effet, « l’entrepreneur exerçait une activité purement commerciale ; l’emploie de capitaux était indispensable ; enfin, l’aspect objectif du processus économique, la comptabilité, était rationnel » (Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme). Néanmoins, l’esprit qui animait l’entrepreneur conservait une fibre traditionnelle – catholique : il ne cherchait pas à s’enrichir mais à gagner suffisamment pour vivre selon son habitude.
La réussite économique n’étant pas ardemment désirée, la production, bien que raisonnablement organisée, ne connaissait pas encore une parfaite optimisation ; optimisation ou rationalisation des moyens de production en vue de réduire les coûts (augmentation de la productivité), mais aussi rationalisation des méthodes de vente (cibler une clientèle en proposant des produits spécialement adaptés). Cela n’a été possible que par l’accroissement de la part d’indépendance, d’anonymat, sur laquelle se fonde désormais les relations sociales et notamment les relations entre le détenteur du capital et ses ouvriers. L’interchangeabilité des travailleurs (et des acheteurs) fait le lit des sociétés capitalistes. Ce que Georg Simmel identifie clairement : « Le cercle relativement étroit dont dépendait l’être humain dans une société monétaire à peine ou pas développée, était bien plus personnalisé » ; « c’est avec des hommes bien précis, connus personnellement, quasiment non interchangeables, que le paysan germain primitif […] et même bien souvent encore l’homme médiéval, entretenaient des relations de dépendance économique » (Georg Simmel, Philosophie de l’argent).
L’éthique protestante aurait contribué, indirectement, à stimuler l’attention portée au travail (au métier) et à la réussite économique. Le protestantisme – surtout d’obédience calviniste – défend l’idée que seule une communauté d’élus désignés par Dieu obtiendront le salut : la grâce de Dieu ne se mérite pas, elle est donnée en dehors de toutes conditions propres à la créature. Les bonnes œuvres, la foi et les sacrements ne peuvent constituer des moyens pour obtenir un salut strictement inféodé au décret divin. C’est la croyance au libre arbitre – pourtant pas incompatible en soi avec un déterminisme providentialiste – que condamne définitivement l’esprit protestant. Personne ne peut préjuger de son élection mais tout le monde doit agir in majorem Dei gloriam.

Ainsi le travail est devenu, chez les calvinistes, un élément central dans l’amour du prochain, lui-même au service de la gloire de Dieu. Si personne ne peut connaître son statut – élu ou réprouvé – en raison d’une prédestination insondable, Calvin a pu valoriser une confiance en soi robuste, persévérante, signe de la vraie foi et de la grâce divine. Un signe intérieur et non encore la quête incontournable d’une certitude salvatrice. C’est la relation, le lien, entre l’exaltation de la gloire divine par le métier et la certitude du salut que vont proclamer les épigones de Calvin. Le travail sans relâche se transforme en un moyen d’acquérir cette confiance en soi inébranlable et donc la certitude de son salut. Il ne s’agit toujours pas d’acquérir son salut, mais de « se délivrer de l’angoisse du salut » : les bonnes œuvres permettent, dans ce contexte, de découvrir sa qualité d’élu ; elles doivent témoigner, dans leur intention, d’une conscience qui, à chaque instant, « se trouve placée devant l’alternative : élu ou damné ? »
Ce décalage entre la position de Calvin et celle de ses fidèles – décalage qu’effleure timidement Weber sans, bien sûr, émettre un quelconque jugement de valeur – confirme la critique straussienne de la neutralité axiologique. « Si l’on parle d’un enseignement de l’importance de celui de Calvin, la simple référence aux “épigones” ou au “commun des mortels” implique un jugement de valeur sur l’interprétation du dogme de la prédestination qu’ils ont adoptée : autrement dit, il y a de fortes chances pour que les uns comme les autres soient tombés dans l’erreur » (Leo Strauss). Ce que Weber ne dit pas, ce que sa méthode lui interdit de formuler, c’est la corruption qu’a subie la doctrine calviniste. On en revient ici à l’idée d’une interconnexion foncière entre rapport aux valeurs et jugements de valeur : choisir un phénomène, un objet d’étude, c’est encore préciser ce que cet objet a d’authentique. Weber aurait dû, soit insister sur le dévoiement de la doctrine initiale (celle de Calvin), soit affirmer que l’essence même du protestantisme se love de ses manifestations tardives. La réserve straussienne n’enlève cependant rien au lien établi entre une certaine interprétation de la prédestination et le développement du capitalisme. Cette critique, à elle seule, n’ébranle pas le fond de l’argumentation.
La réforme se situe donc à l’origine d’un processus de rationalisation mais aussi d’embourgeoisement. La rationalisation roule sur un « désenchantement du monde » que suggère, dans l’éthique protestante, l’élimination des moyens offerts par les sacrements dans la quête de salut, c’est-à-dire par la purge du surnaturel, de la magie, que faisait intervenir une certaine culture de la rédemption. L’embourgeoisement suppose l’enrichissement ainsi qu’un goût accru pour l’utilité dans le travail et l’acquisition des biens. Nous assistons à la naissance du pâle confort bourgeois enroulé dans sa bonne conscience. La sécularisation fera le reste : « L’ardeur de la quête du royaume de Dieu commençait à se diluer graduellement dans la froide vertu professionnelle ; la racine religieuse dépérissait, cédant la place à la sécularisation utilitaire. »
Laissons, pour conclure, Weber se résumer : « L’ascétisme protestant, agissant à l’intérieur du monde, s’opposa avec une grande efficacité à la jouissance spontanée des richesse et freina la consommation, notamment celle des objets de luxe. En revanche, il eut pour effet psychologique de débarrasser des inhibitions de l’éthique traditionaliste le désir d’acquérir. Il a rompu les chaînes [qui entravaient] pareille tendance à acquérir, non seulement en la légalisant, mais aussi, comme nous l’avons exposé, en la considérant comme directement voulue par Dieu. »
