Inconnu en France, Denis Davidov est pourtant pour les Russes un héros de la guerre de 1812. Il fut une figure militaire et littéraire majeure dans la Russie du début du XIXe et le modèle du personnage de Denissov dans Guerre et Paix. Surnommé « le capitaine noir » par les Français, héros byronien et ami de Pouchkine, il deviendra au-delà de ses exploits guerriers et de ses essais militaires comme La guerre de partisans (1821), le fondateur d’une poésie originale appelée « hussarade ». Une forme poétique triviale dans laquelle il célèbre la Russie, l’alcool, l’héroïsme ou bien encore les filles de joie.
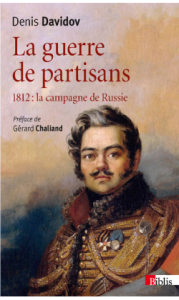
La petite troupe, composée d’une trentaine de cavaliers aux dolmans blanchis par la neige, avance péniblement. Le mois d’octobre touche à sa fin et, pourtant, l’hiver russe est déjà là. Le vent boréal tétanise les corps affaiblis par plusieurs mois de campagne et le ciel recouvre la plaine sarmatique d’une épaisse tunique blanche. Les sabots s’enfoncent difficilement dans ce manteau neigeux. En cet automne 1812, ces quelques cavaliers précédent la Grande Armée qui entame sa funeste retraite près de quatre mois après avoir, si brillamment et bruyamment, traversé le Niemen, frontière naturelle de la Russie et du Grand-duché de Pologne alors sous protectorat français. Napoléon en personne dirige cette petite troupe. Elle mène une reconnaissance près de Maloïaroslavets, petite ville au sud-ouest de Moscou. Soudain au détour d’un bois, les « hourras », fameux cris de guerre russe, se font entendre. Les cosaques attaquent et chargent l’empereur et sa garde. Le général Rapp, héros de la bataille d’Austerlitz, forme avec ses hommes un mur devant l’empereur, contraint lui aussi à sortir l’épée du fourreau. Heureusement, l’arrivée inespérée d’un corps de dragons de la garde sauve le petit détachement. Ces cosaques, menace pesante et constante autour de la Grande Armée, sont organisés et menés par le fantasque et flamboyant Denis Davidov, surnommé « le capitaine noir » par les Français.
La Grande armée a alors encore pourtant fière allure. Elle n’est pas ce sinistre amoncellement de débris humains, survivants hagards, aux corps décharnés, qui parviendra à échapper de justesse au piège russe quelques semaines plus tard après le passage de la Bérézina. Toutefois, cette campagne de 1812 a déjà dévoré un grand nombre d’hommes : désertions, blessés et morts lors des multiples escarmouches sur la route de Moscou et terrifiante hécatombe lors de la bataille de Borodonino. Ses rangs sont décimés. La prise de la capitale, ville brûlée par son fanatique gouverneur Rospotchine, sujet des pages éclatantes de Tolstoï dans Guerre et Paix, n’est qu’un bref et illusoire répit avant l’holocauste final. Car face à l’opiniâtreté russe et à la résolution de son tsar Alexandre Ier, décidé à résister jusqu’au bout, Napoléon ne peut que se décider à un repli stratégique vers l’Ouest. C’est lors de ce long calvaire du retour que les cosaques de Davidov vont participer à la mise à mort de la Grande Armée.
La plume et le sabre
Avant de se couvrir de gloire durant cette campagne, Denis Davidov a été un officier au début de carrière erratique. Il se passionne pour la rédaction d’épigrammes, de fables satiriques dont certaines à l’encontre du tsar. Ses écrits circulent sous le manteau au sein de l’armée et lui valent la méfiance de l’état major. Il commence à rédiger ses célèbres « hussarades » au ton souvent gouailleur : « Bourstov, mon bagarreur joyeux, / Ami de bouteille et de jeu ! / Au nom de Dieu… et du raki / Viens, rends visite à mon logis ! » Son caractère rebelle amène même certains à le soupçonner de participation dans l’assassinat du père du tsar, Paul Ier. Par représailles, le commandement l’assigne d’ailleurs pendant un temps à des postes sans intérêt dans des garnisons de province.

Le tournant de sa carrière survient en 1806 quand il devient aide de camp du général Bagration avec qui il entretiendra des relations parfois tendues et moquera même le physique dans certains écrits. « Voici celui qui se rit de mon nez », déclara même le général. Cependant, aux cotés de ce brillant tacticien, Davidov apprend le commandement et découvre la guerre de partisans qu’il théorisera quelques années plus tard. Grand cavalier, il est ensuite nommé lieutenant-colonel de hussards et s’illustre dans la campagne de 1808 contre les Finlandais et contre les Ottomans en 1809. Au cours de ces années, Davidov s’intéresse aux techniques de guérilla initiées par les espagnols dans la guerre (1808-1814) qui s’ouvre dans la péninsule quand Napoléon impose son frère Joseph sur le trône d’Espagne. Il écrit ainsi dans son journal de route : « Presque tous les chefs des partis espagnols qui s’illustrèrent comme guerriers ne s’étaient jusqu’alors occupés de que de choses fort étrangères à la guerre et sortaient des classes les plus inférieures de la société. […] Bientôt toute la nation se divisa en petits détachements. Il n’y eut pas une route, pas un sentier par lequel on put éviter les guérillas. […] Leur but constant était de détruire l’ennemi en enlevant tous les approvisionnement de guerre et de bouche. »
La guerre qui s’ouvre en 1812, entre la France et ses alliés et la Russie, va lui permettre de mettre en application ses théories novatrices. Pour faire face à la formidable armée de plus de 400 000 hommes réunis par Napoléon, le général de la principale armée russe, Barclay de Tolly pense nécessaire d’éviter une guerre frontale perdue d’avance. À cette fin, il veut mener une guerre d’esquive et de harcèlement dans laquelle, justement, Davidov excelle. Le destin lui tend ainsi la main. Ce n’est pas le nombre d’hommes mais la profondeur stratégique offerte par la Russie et son territoire immense qui vaincront les Français. Les Russes prendront alors pour cible les lignes de ravitaillement de l’ennemi, et frapperont par surprise ses arrières et ses troupes isolées comme l’écrira Davidov dans son traité sur la guerre des partisans : « La véritable guerre de partisans doit occuper tout l’espace qui sépare l’ennemi de sa base d’opération, couper ses lignes de communication, anéantir ses détachements et convois […]. Voilà la guerre de partisans dans toute l’acception du mot. » Clausewitz, alors officier du tsar, analysera aussi cette question dans son essai La campagne de 1812 en Russie.

Avec cette stratégie, les troupes russes peuvent ainsi prendre ponctuellement l’offensive dans une stratégie globale défensive. Mais cette retraite va pourtant à l’encontre de l’opinion d’une grande partie de l’état major qui juge contraire à l’esprit russe cette longue dérobade vers l’Est. Considérée comme infamante par beaucoup de soldats russes, elle deviendra pourtant leur salut. Dans l’espoir de sauver Moscou, le vieux Koutouzov est nommé général en chef de ses armées par le tsar. Davidov, quant à lui, se voit confier une petite troupe de cosaques avec laquelle il multiplie les succès comme l’écrira Tolstoï dans Guerre et Paix : « La guerre de partisans avait commencé dès l’entrée de l’ennemi dans Smolensk. Avant d’être reconnue comme telle par notre gouvernement, plusieurs milliers de soldats ennemis avaient été éliminés par des cosaques et des paysans. […]Denis Davidov fut, avec son flair aigu, le premier à comprendre l’efficacité de cette arme terrible qui, sans se soucier, des règles de l’art militaire, anéantissait les Français. C’est à lui que revient la gloire d’avoir fait le premier pas pour l’adoption de cette technique de guerre. »
Dans l’uniforme vieillissant
Après la prise de Moscou, l’armée française entame donc son long calvaire vers la France. Davidov, après ses nombreux succès, est maintenant à la tête d’une redoutable force de plus de 1 500 cosaques épaulés par des paysans armés. Ces hommes forment une menace permanente qui tourne autour des soldats de Napoléon comme une armée fantôme invisible et presque méphistophélique aux yeux des Français terrifiés par leurs apparitions. Mais ce poète, qui chante l’héroïsme russe à ses hommes autour du feu lors des veillées d’armes, admire aussi le courage inébranlable des soldats de la Grande Armée et particulièrement de la vielle garde impériale : « Nos cosaques ont l’habitude de galoper autour de l’ennemi lui arrachant des bagages et des canons, encerclant les compagnies éparpillées ou détachées, mais ces colonnes-là restent inébranlables. En vain, officiers, sous-officiers ou simples cosaques foncent-ils sur elles, les colonnes s’avancent l’une après l’autre, nous chassant à coups de feu, comme indifférents à nos raids inutiles… la garde de Napoléon passe parmi nos cosaques comme un navire armé de cent canons parmi des barques de pêcheurs. » Cet héroïsme n’a d’égal que celui du soldat russe qu’il célèbrera dans ses vers tout au long de sa vie : « Un cavalier ne peut dans un fauteuil se plaire, / Chanter la volupté, le repos, la douceur ; / Mais lorsque la Russie entonne un chant de guerre, / De ce chœur menaçant, je suis le premier chanteur. »

Une fois tu le chant de guerre, une fois les Français vaincus, le hussard noir poursuit encore sa carrière militaire avant de se retirer sur ses terres en vieux moujik des lettres. Il continue son œuvre littéraire, ses poésies et une correspondance amicale fort abondante avec les grands écrivains russes de son temps dont Pouchkine, Vasily Zhukovsky ou Mikhail Zagoskin… Il devient alors une source d’inspiration pour ces hommes de lettres.
En véritable précurseur de Byron, il a su mettre sa vie en cohérence avec sa poésie. Sa nature chevaleresque et héroïque connaît un grand écho quand le monde des lettres bascule dans le romantisme dont les âmes de ce début de siècle commencent à s’imprégner. Désireux de rallier à leur cause ce héros russe, les décembristes le contactent. Mais ce mouvement réformateur et libéral qui souhaite sortir la Russie de l’archaïsme du servage ne recevra cependant jamais son soutien. Il refuse toute participation à cette cause libératrice car selon lui « en tant que militaire je serai toujours un esclave ». Le vieux soldat meurt à 54 ans en 1839 et inspire à son jeune ami Pouchkine ces vers : « Je chevauche le doux Pégase / Dans l’uniforme vieillissant / De notre archaïque Parnasse / Mais, Ô mon cavalier ardent, / Même en cet art tu me dépasses, / Restant mon père et mon commandant. »
