Sylvain Tesson est écrivain et voyageur. de l’Himalaya aux steppes d’Asie centrale, de la Sibérie aux grands espaces mongols, il a parcouru le monde sous plusieurs angles, le plus souvent à bicyclette (On a roulé sur la terre, Éloge de l’énergie vagabonde) mais aussi en side-car (Berezina). Amoureux de l’autonomie et du repli, il envisage le voyage comme un moyen d’intensifier son existence.
[Entretien initialement paru dans la revue PHILITT #3 consacrée aux illuminations du voyage.]

PHILITT : Est-ce le voyage qui vous a fait écrivain ou est-ce l’écriture qui vous a fait voyageur ?
Sylvain Tesson : J’ai commencé par voyager sans vouloir écrire puis j’ai pris goût à l’écriture de voyage car j’ai compris l’extraordinaire jouvence de la tenue d’un journal, d’un journal intime, d’un journal quotidien, d’un journal de notes, d’un journal factuel, d’un journal même anecdotique. Je ne parle pas du journal que tiennent certains auteurs qui est un journal de la pensée, du sentiment, de l’introspection ou encore un laboratoire d’écriture. Je parle du journal comme un greffe des événements que vous vivez. La tenue de notes quotidiennes est un puissant supplétif à l’entreprise de désagrégation de la mémoire, au problème de l’oubli. C’est par la tenue de notes quotidiennes que j’en suis venu à écrire des récits de voyage. Le récit n’est en fait que la réorganisation du journal. Je le tiens depuis plus de 20 ans et cela implique une vulnérabilité profonde, une mise à nu, une dissection permanente de sa vie.
Par ailleurs, je ne suis pas un auteur d’imagination. Peut-être parce que j’ai trop observé le monde. J’admire les cerveaux capables de créer des univers (Lovecraft, K. Dick, Tolkien), mais je serai toujours plus émerveillé par l’observation entomologique que par la création de sciences-fictions ou de fantaisies. Je me contente du monde et c’est déjà un beau programme.
Quel fut votre premier voyage en tant qu’écrivain ? Occupe-t-il une place particulière ?
Le premier voyage qui donna lieu à un livre fut mon tour du monde à bicyclette. Au départ, je ne comptais pas du tout écrire un livre, mais Jean Raspail, que j’avais rencontré par des amis communs, me dit une phrase qui ne prit sens que plus tard : « Écrivez, toujours, que vous soyez épuisé, bouffé par les moustiques ou malade. » En vérité, on a réellement le sentiment d’avoir accompli sa journée de voyage qu’après l’avoir retranscrite sur le papier ; comme si la conclusion d’un voyage était le point final de son récit.
Ce n’est qu’ensuite que je suis parti avec l’idée d’écrire un livre. La traversée de l’Himalaya à pied en 1997 avec mon camarade Alexandre Poussin (La Marche dans le ciel, NDLR). Nous voulions écrire un livre donc nous prenions des notes, nous regardions le monde en sachant qu’un jour nous restituerions ce que nous avions vu. Ce qui évidemment fausse le regard, en tout cas le transforme, le change. Mais cela donne à la vie un surcroît d’intensité de savoir qu’on va la coucher sur le papier. Cela oblige à mieux regarder, à mieux écouter, à mieux penser, à mieux percevoir, à mieux éprouver.
Votre goût pour le voyage provient incontestablement de votre tempérament. Vous dites souvent être incapable de rester en place. Cependant, certains écrivains-voyageurs ont dû vous inspirer ? Pouvez-vous nous en parler ?
Il y a beaucoup de récits de voyage que j’ai aimés mais qui ne proviennent pas précisément de ce qu’on pourrait appeler des écrivains-voyageurs. Par exemple, le récit de la campagne de Russie de Stendhal – il se rendit à Moscou avec la Grande Armée – est extraordinaire car on est totalement à côté de l’Histoire. Ce que décrit Stendhal n’est pas du tout à verser au dossier de la compréhension historique des événements. Il évoque des femmes, des richesses, des souffrances, la sienne… La manière dont Delacroix nous rapporte ses expéditions au Maroc, le voyage Atlantique de Jünger… C’est cela qui m’intéresse. Les grands artistes usent du mouvement pour trouver de l’inspiration. Sont-ce des écrivains-voyageurs ? Je ne crois pas. Ce sont des écrivains qui voyagent.

En effet, ce ne sont pas des écrivains emblématiques de ce point de vue, contrairement à Joseph Conrad par exemple…
Le livre de Conrad que je préfère entre tous, Lord Jim, est certes tiré de ce qu’il a observé – on n’écrit pas aussi bien sur les mers d’huile quand on ne les a pas vues – mais ce n’est pas un livre d’écrivain-voyageur, c’est un livre de grand écrivain. Le propos de Lord Jim est celui de la trahison, de la faute portée, du fardeau et de la tentative de se débarrasser du péché. Ce n’est pas un thème d’écrivain-voyageur. Le type qui écrit bien mais qui raconte qu’il est en train de faire sa pipe avec sa machette ne m’intéresse pas.
Dans Berezina, vous reproduisez le parcours de la retraite de Russie par Napoléon. Vous semblez par ailleurs nourrir une affection toute particulière pour le peuple russe. Qu’ont-ils que les Français n’ont pas ? Sont-ils des compatriotes de substitution ?
Les Russes ont quelque chose que les Français n’ont plus : le sens du commun, le sens patriotique. Les Russes succombent moins aux sirènes de l’individualisme qui ont fait perdre chez nous ce sentiment d’appartenance à une société. C’est peut-être d’ailleurs parce que les Russes ont affronté la Grande Armée en 1812 qu’ils ont ressenti la nécessité de s’inventer un patriotisme. Ils ont une plus grande affection pour la scénographie de la vie : l’Histoire, la représentation politique, le faste… Ils ont moins ce sourire ironique que nous aimons tellement. Parfois, le sourire de Voltaire est l’incarnation absolue du rictus de l’intelligence. Parfois, c’est une grimace. Hélas… Ils ont beaucoup moins que nous l’impression d’avoir un destin universel et éternel. Nous souffrons d’un franco-centrisme incroyable. Il y aussi chez le Slave, sans verser dans les généralités de comptoir, un fatalisme, une acceptation des choses qui passent. Quelque chose qui vient peut-être de l’orthodoxie, quelque chose d’héraclitéen : nous vivons sur des pentes qui se désagrègent, il s’agit de se mouvoir dignement dans un monde incertain. C’est ce sentiment que les artistes aiment, que les Russes acceptent et que les politiciens français refusent.
Je me sens beaucoup plus proche d’un pêcheur du lac Baïkal – avec le rapport qu’il entretient à la nature, au temps, à une forme de rudesse – que d’un Français imbu de lui-même et citoyen du présent, indifférent à tout ce qui concerne son passé et préoccupé par tout ce qui à trait à son avenir. La différence est là : c’est une différence de positionnement par rapport au temps. Les Russes ne bazardent pas le passé. Les Français sont dans la détestation de tout ce qui les a précédés. L’Histoire n’est pas un petit séquençage dans lequel on ferait un droit d’inventaire.
Dans Éloge de l’énergie vagabonde, vous filez tout au long de l’ouvrage la métaphore de l’énergie. Le voyageur a besoin d’un carburant qui lui est propre. Dans quoi le voyageur tire-t-il sa force pour avancer quand le moral ou le physique le trahissent ?
Je vais le savoir bientôt car je pars à l’assaut du pic Karl Marx avec Cédric Gras (un autre écrivain voyageur, NDLR) à la frontière de Tadjikistan et de l’Afghanistan. C’est un sommet qui est à 6 700 mètres d’altitude. On sait d’expérience que cela va être dur pour nous. D’autant plus que j’ai eu des soucis de santé qui m’ont affaibli. Bizarrement, à chaque fois que l’on est là-bas on se dit qu’on ne nous y reprendra pas et, aussitôt rentrés, nous y retournons. Une sorte de force irrépressible nous amène à voyager.
Dans quoi puisons-nous ? Surtout pas dans un narcissisme – le besoin de se prouver quelque chose – ou un hédonisme, mais une sorte de jouissance. C’est moins agréable que de boire un mojito dans un transat. Ce n’est pas non plus christique et doloriste. Je n’ai de douleur à offrir à personne. Surtout pas à une abstraction venue de je ne sais quelle révélation. Je ne peux vous donner qu’une définition par la négative. Tout de même, il y a le sentiment indescriptible d’être arrivé au bout, de savoir que c’est fini. C’est parce que l’on sait que ça va s’arrêter que l’on est heureux de continuer. J’ajouterais également : la mémoire de ce qu’on a fait dans une vie. Il y a le tribunal des souvenirs qui juge ce qui a été intense et ce qui ne l’a pas été. Je ne mets rien au-dessus d’une course en montagne ou d’une journée à m’esquinter sur les pistes en l’attente d’une halte. Je ne mets rien au-dessus du répit.
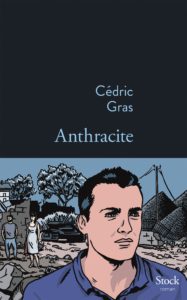
Vous affirmez que le goût du voyage est lié à une volonté d’intensification de l’existence. Mais l’intensification doit-elle nécessairement être physique ? N’y-a-t-il pas des intensifications spirituelles ?
Bien sûr, pour les êtres qui sont intellectuels ou spirituels ! Il y a des saisissements de l’âme. Mais tout le monde n’est pas saint Augustin ou Thérèse de Lisieux. Pour cela, il faut avoir un bouillonnement, une chaudronnerie intérieure. Je ne l’ai pas.
Même devant la contemplation de la beauté naturelle ?
C’est vrai. Mais cela doit être associé à l’effort physique. Pour contempler véritablement, il faut avoir eu des difficultés pour accéder à un lieu. L’âme ne sera pas émue s’il on vous y dépose en hélicoptère. Il y a un lien entre l’intensité de ce que l’on ressent et l’état d’épuisement dans lequel on est arrivé. Cela s’appelle la conquête des hauts lieux, la conquête de postes et des loges. J’ai besoin d’aller m’esquinter pour ressentir un petit quelque chose en plus.
Vous entretenez une certaine défiance vis-à-vis du monde moderne (matérialiste, technocratique, bourgeois). Avec l’uniformisation du monde, il est de plus en plus difficile de fuir la modernité. Y a-t-il encore des lieux qui lui échappent ? Si oui, quels sont-ils ?
Il n’y en a qu’un. Ce sont les livres. L’uniformisation ne me fait vraiment de mal que dans un champ, celui qui est le plus atteint : le langage. La langue est une merveille. Peut-être ce que les hommes ont fait de mieux. Inventer des langages dans toutes les couches sociales, dans toutes les interstices d’une société, dans tous les métiers, dans toutes les confréries, dans toutes les bandes, dans tous les clans… La modernisation, avant même de transformer les paysages, les villes, les tenues vestimentaires et bientôt les visages, c’est d’abord à la langue qu’elle s’en prend. Car c’est la langue qui est la plus fragile. Je sens chaque jour la disparition des mots face à la novlangue des robots. Alors qu’il y a une telle richesse ! Récemment, j’ai découvert le mot « pleinairisme » qui renvoie aux peintres réalistes du XIXe comme Courbet et je m’aperçois que ce mot pourrait désigner ma vie. Il faut vénérer les citadelles du langage car il y a un « logocide » qui est à l’œuvre.
Dans Dans les forêts de Sibérie – qui vient d’être adapté au cinéma – vous racontez vos six mois passés dans une cabane près du lac Baïkal. Le retour à la nature, à une certaine primitivité, est-ce un idéal selon vous ? Où est-ce seulement un moyen transitoire pour l’homme de se rappeler qui il est vraiment ?
Le repli est une belle solution. Cela peut être le repli monastique, le repli du gardien de phare, le repli dans la grande ville aussi, le recours aux forêts intérieures, le cabinet d’artiste… Il y a plein de possibilité de prendre la tangente. J’aime l’idée de la contrescarpe, de l’issue de secours, de la sortie. Mais comme le repli est une solution individualiste elle ne doit pas finir par constituer le slogan d’une école. Auquel cas elle s’annulerait d’elle-même.
