La collection Théôria de l’Harmattan, dirigée par Pierre-Marie Sigaud, publie Le soufi et la poésie, traduction d’un ouvrage de Mahmut Erol Kiliç, islamologue à l’université d’Istanbul. Cette étude vise à mettre en avant ce que doit la poésie de langue turque au vocabulaire soufi, dans ses aspects formels mais également dans ses aspects les plus profonds.
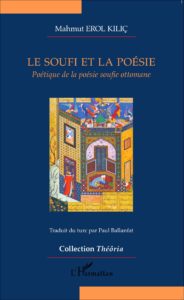
L’avertissement introductif du traducteur, qui parle d’une pensée « profondément influencée par l’orientalisme guénonien de l’entre-deux guerres et un platonisme rudimentaire », si elle peut surprendre dans le contexte universitaire occidental, est vite vérifié à lecture de l’ouvrage de Mahmut Erol Kiliç. En effet, le platonisme de l’auteur se ressent du point de départ de sa poétique : l’art y est mimesis, imitation par laquelle l’artiste se fait connaître comme artiste, comme Dieu fit la Création, disant : « J’étais un trésor caché et j’ai eu le désir d’être connu ; c’est pourquoi j’ai créé. »
Ishak b. Ibrahim (m.853), juriste et poéticien, présente le poète comme celui ayant accès à un sens derrière le monde menteur et faisant fonction de dévoileur. Cependant, il faut se garder d’approcher ce sens de manière unilatérale : la poésie est şiir, cousine du şuur (sentiment), et l’auteur rappelle à ce propos une plainte perçante de la voix populaire : « Nous avons plus besoin de ceux qui sentent (şuuriyûn) que de ceux qui versifient (şiiriyûn). » Cette pique illustre la vocation des poéticiens du monde musulman : distinguer le rimailleur, attiré par la gloire terrestre et les récompenses matérielles, de celui dont l’œuvre jaillit du for intérieur, épanche un savoir acquis par le biais du soufisme, voie d’accès à la plus haute spiritualité musulmane.
C’est l’une des autres bases de la poétique de l’auteur : point de poésie hors du soufisme, car c’est sous le coup des vérités spirituelles dévoilées au cours de la quête que constitue le soufisme, que se crée la conscience poétique. L’auteur rapporte le propos de Gelibolulu Mustafa Âlî, homme d’Etat du XVIe siècle, décrivant la précipitation avec laquelle celui qui sent venir l’inspiration poétique doit comme se réfugier auprès d’un maître spirituel qui donnera forme à cette inspiration. Il y a presque ici les éléments du politique de la poésie, ménageant la place de l’inspiration poétique en société. La dimension platonicienne transparaît de l’interdépendance de la poétique et de la politique : la préoccupation des théologiens et des juristes est de trouver pour le poète, dont les œuvres forment le langage de la spiritualité populaire et savante, une place dans la société. D’où l’importance de distinguer le poète vrai, spirituel élevé et orthodoxe, du faux poète qui manie un verbe illusoire. Platonisme encore, donc.
Cette poétique pose paradoxalement parfois la question de l’existence même de la poésie ou du moins interroge sa forme. L’élévation spirituelle, condition du poème, entraînera parfois jusqu’à la désagrégation de l’aspect exotérique de la poésie – la rime, la métrique, ce qui est littérature –, le vers se désagrégeant sous la puissance du sens intérieur. Les vers cités par l’auteur, où l’initié se débat entre cette nécessité d’observer la rime et le désir d’obéir aux accès de la plus haute contemplation, constituent sans conteste les plus beaux de l’ouvrage et justifient à eux seul le travail de traduction :
« Les lettres, les sons, les mots je les pulvériserai en les entrechoquant
Ah ! Si je pouvais parler avec toi sans ces trois-là »
(Djalâl ad-Din Mewlânâ Rûmî)
Rappelons que Rûmî est le poète le plus vendu aux États-Unis où il est perçu comme une sorte de figure new-age, mystique sans religion, et que cet ouvrage fait partie de ceux qui permettent de comprendre l’erreur profonde commise par ceux qui ne peuvent concilier la hauteur spirituelle de leur nouveau poète favori avec l’enracinement profond dans une religion – si barbare et légaliste qu’ils la perçoivent – qui fut la condition de sa naissance et de son élévation.

On touche peut-être là à l’utilité profonde de ce genre d’ouvrage, quant à une compréhension de notre propre poésie, à la compréhension de ce sacré qui y réside. Pour Pierre Boutang, auteur d’un Art poétique quasiment jamais lu et théorisant toute création poétique comme opération de traduction, « le poème existe, à la limite, détaché du poète et du traducteur ; ce dernier n’est nullement sujet de l’acte entrepris ; il est le lieu où cette existence indépendante de la langue où il est s’est produit, va prendre une autre chair ». Ce que finalement semble impliquer la poétique soufie, qu’elle soit ottomane ou non, ce qui travaille l’esprit des poéticiens musulmans, c’est peut-être l’idée que le poème constitue le reliquat du passage en ce lieu – en islam, « théophilie extrême » du croyant « amant du Dieu aimant, craignant Dieu et aimanté par Dieu » [1], ce lieu est réductible à la plus grande proximité avec Dieu – d’un homme, le poète. Dieu, les anges et le prophète ne sont point poètes, seul l’homme l’est, affirme Ismail Hakki Bursevi (m.1725), poète aujourd’hui révéré comme une figure sainte en Anatolie.
Ainsi, encore une fois, la poétique semble en islam se résoudre à une interrogation sur ce que signifie ce passage pour l’homme et sur la manière dont il s’insère dans la temporalité vécue, notamment la temporalité sociale et civique. Comment, finalement, ceux qui « habitent poétiquement le monde » y cohabitent-ils avec les hommes de l’apparence ? Il y aurait d’ailleurs tout lieu, pour les universitaires du monde musulman, de contempler ce que fut véritablement la tragédie de Hölderlin, à qui nous empruntons ce mot célèbre, tragédie d’un poète né au XIXe siècle – que G. Steiner qualifie justement de siècle de l’ennui, ennui spirituel où la dimension poétique est concassée, subjuguée par le monde technicien – qui ne trouve d’échappatoire que par la rébellion la plus totale et n’aboutit qu’à un rejet de principe hors de la cité. Après la Tour de Hölderlin, le poète sera le Voyant rimbaldien, le trouvère eschatologique du Grand Jeu, adolescent rêveur et « poète aux heures des autres » (à la différence, rappelait Léon Bloy, du bourgeois qui n’est poète qu’à ses heures à lui).
[1] J.-P. Charnay, Islam profond – Vision du monde, Paris, Éditions de Paris, 2009
