Dans Un démon de petite envergure (1905), Fiodor Sologoub propose une nouvelle déclinaison de la figure du nihiliste. À travers Peredonov, l’écrivain dépeint un homme à la laideur morale inégalée, préoccupé uniquement par son avancement social. Si les nihilistes ont toujours été traités avec sévérité par la littérature russe, les prédécesseurs de Peredonov déployaient une grande force de subversion et disposaient d’un caractère hors norme faisant d’eux des héros noirs. Rien de tout ça avec Peredonov : seulement l’expression d’une médiocrité suffisante et d’un mépris généralisé pour tout ce qui n’est pas lui-même.
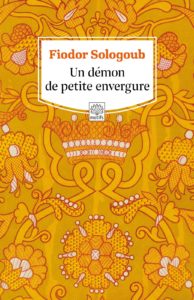
La figure du nihiliste est un des topoï de la littérature russe de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Tourguéniev avait été le premier à mettre en scène un nihiliste avec Bazarov dans Pères et fils (1862). Leskov lui avait emboîté le pas avec À couteaux tirés (1870) avant que Dostoïevski ne fasse définitivement entrer le personnage dans la grande histoire de la littérature avec Les Démons (publié de 1871 à 1872 dans Le Messager russe). Il est d’ailleurs frappant de voir à quel point chacun de ces trois écrivains abordaient la question du nihilisme sous un angle différent, différence qui traduisait en réalité une évolution dans la mentalité des nihilistes eux-mêmes. Ainsi, Bazarov était un nihiliste scientiste, matérialiste, imprégné des écrits de Pissarev (révolutionnaire russe, membre du Cercle de Tchernychevski et considéré comme un des initiateurs du nihilisme). Les protagonistes du roman de Leskov étaient quant à eux de véritables bandits dénués de tout scrupule. Enfin, Stavroguine et Kirilov, deux figures emblématiques des Démons, donnaient au nihilisme une dimension métaphysique jusque là abordée de manière trop superficielle par Tourguéniev. Dostoïevski montrait alors les ultimes implications de l’indifférence au bien et au mal et l’abîme qui attendait l’homme qui voulait défier Dieu.
Avec le roman de Fiodor Sologoub (1863-1927), Un démon de petite envergure, paru en 1905, c’est la queue de comète du nihilisme qui luit sous nos yeux. Son héros, Peredonov, un professeur d’une petite ville russe, carriériste, paranoïaque et absolument odieux, n’a plus rien à voir avec le nihilisme structuré et idéologique d’un Bazarov, ni avec la radicalité d’un Kirilov ou la suprême indifférence d’un Stavroguine : « Ses sentiments étaient grossiers, obtus, et sa conscience n’était qu’un appareil corrosif et délétère. Tout ce qui parvenait à sa conscience se transmuait aussitôt en boue et en ordure. Il ne voyait dans les objets et les êtres que leurs défauts, et ces défauts le réjouissaient. » Au mieux, Peredonov pourrait être rapproché du « néguilisme » de Gordanov, personnage principal d’À couteaux tirés. Mais la comparaison a ses limites. L’« anti-nihilisme » de Gordanov s’était construit contre l’ancienne génération de nihilistes incarnée par Bazarov. Sa « scélératesse », s’inscrivait encore dans une certaine tradition de pensée, dans la mesure où elle en était la réfutation : la réfutation de la réfutation. Le cas de Peredonov est en réalité à part et semble déconnecté de la tradition qui le précède. Si le titre, Un démon de petite envergure, fait évidemment écho à Dostoïevski, Peredonov n’est pas un petit Stavroguine ou un petit Kirilov (un personne du roman s’appelle d’ailleurs Kirilov, autre clin d’œil aux Démons). C’est un personnage profondément antipathique ayant poussé son individualisme à la limite du supportable, mais sans jamais s’impliquer dans des dangers proprement métaphysiques.
Peredonov tient à être vu à l’église de peur d’être montré du doigt
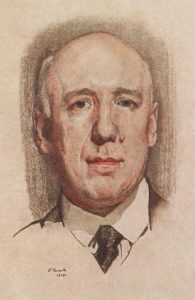
On apprend dans le livre que Peredonov possède les œuvres de Pissarev, mais cela ne signifie pas qu’il y a chez lui une adhésion doctrinale. Bien au contraire : « Auparavant, Peredonov avait tenu à exposer ses livres comme pour témoigner de ses idées libérales. En fait, il n’avait ni idées ni même envie de réfléchir. Il gardait ses livres pour la façade, mais ne les lisait jamais. » S’il ne semble posséder aucune véritable conviction, qu’elle soit conservatrice, libérale ou même nihiliste (au sens de Bazarov ou de Pissarev), il reproduit des attitudes qui étaient celles des nihilistes, en s’attaquant à certains symboles de la culture russe, en l’occurrence Pouchkine. « Je dois avouer, à votre avantage, que vous avez eu Mickiewicz. Il est au-dessus de notre Pouchkine. Son portrait est sur mon mur. Auparavant, c’était Pouchkine qui y figurait ; je l’ai remisé dans les cabinets ; en fait, ce n’était qu’un larbin. » Une provocation qui fait ici référence à Bazarov qui soutenait dans Pères et fils : « Un honnête chimiste est vingt fois plus utile que n’importe quel poète. » Ou encore : « D’après moi, Raphaël ne vaut pas un centime, et eux pas davantage. » La dévalorisation de l’art est un lieu commun du nihilisme russe que Dostoïevski synthétisera dans une formule célèbre pointant du doigt l’écueil contenu dans le relativisme : « Toute la question est de savoir si Shakespeare est supérieur à une paire de bottes, Raphaël, à un bidon de pétrole ! » Mais encore une fois, Peredonov fait un pas de côté : il ne se moque de Pouchkine que pour célébrer le poète polonais Mickiewicz. Sa défense de l’art ne se fait qu’avec des accents antipatriotiques, autre lieu commun du nihilisme.
Peredonov est insaisissable. Il semblerait qu’il ait adopté autrefois des idées libérales, mais son arrivisme l’oblige à les présenter, devant des personnes susceptibles de participer à son avancement social, comme des erreurs de jeunesse. Confronté à un fonctionnaire qui lui rappelle son passé, Peredenov s’empresse de préciser qu’il était un libéral atypique : « Je voulais une Constitution, mais sans Parlement. » Il aurait été libéral, mais tout en restant un peu conservateur quand même. Une manière de montrer à son interlocuteur qu’il demeure éloigné de toute velléité révolutionnaire et qu’il peut faire office de citoyen modèle. Les incohérences sont légion dans le discours de ce méchant individu. « – Suis-je vraiment nihiliste ? demanda Peredonov. C’est ridicule. Je possède une casquette à cocarde ; je ne la mets pas souvent, c’est vrai. » Et d’attribuer plus loin la paternité de la revue La Cloche à Mickiewicz plutôt qu’à Herzen, témoignage de son inculture crasse et du caractère totalement superficiel de son « nihilisme ». En effet, La Cloche de Herzen était un organe de presse très célèbre, une des sources intellectuelles du libéralisme et du socialisme (en Russie, les deux traditions sont difficiles à distinguer) que les conservateurs nommeront indifféremment « nihilisme ».
Préoccupé par sa carrière et par sa réputation, le paranoïaque Peredonov tient à être vu à l’église de peur d’être montré du doigt par ses compatriotes, car un honnête citoyen se doit de respecter la double autorité du tsar et du métropolite : « […] Peredonov, au lieu de rentrer chez lui, se fit conduire à l’église à l’heure où commençait l’office. Il estimait depuis quelque temps qu’il était dangereux de ne pas fréquenter assidument l’église ; on pouvait le dénoncer. » Alors que les anciens nihilistes réémettaient en question les valeurs de l’ancienne Russie, Peredonov prétend les défendre dans une optique exclusivement individualiste. En réalité, la question des valeurs ne l’intéresse pas. Peredonov peut adhérer (superficiellement) à n’importe quelle idéologie du moment qu’elle sert ses intérêts (matériels). Peut-être est-ce cela la queue de comète du nihilisme que Sologoub veut nous décrire ? L’émergence d’hommes déstructurés – des coquilles vides – prêts à être remplis par n’importe quelle idée dès lors qu’elle ne contredit pas leur individualisme et permet d’occuper une place avantageuse dans la société.
