Juan Asensio est essayiste et critique littéraire. Depuis 2004, il tient le site Stalker qui se conçoit comme une « dissection du cadavre de la littérature ». Il vient de publier Le temps des livres est passé (Ovadia, 2019), ouvrage qui regroupe le meilleur de ses études littéraires, de Max Picard à Robert Penn Warenn en passant par Ernesto Sabato, Joseph Conrad ou encore László Krasznahorkai.

PHILITT : Le temps des livres est passé, le titre de votre ouvrage, est une expression employée par Bloy dans sa correspondance avec Hello. Le premier voyait dans le journalisme un « lupanar universel des intelligences ». Le second écrivait : « Si la critique littéraire existait aujourd’hui à Paris, la face du monde serait changée en huit jours. » Quelle influence ces deux écrivains ont-ils eu sur votre travail ?
Juan Asensio : J’ai commencé à lire Léon Bloy en 1991. Aussi étonnant voire miraculeux que cela puisse paraître, c’est dans un magasin Fnac de la place Bellecour, à Lyon que je découvris, tout en haut du présentoir comme s’il s’agissait de dissuader les badauds et de toiser les nains, la collection presque complète des volumes du Mendiant ingrat parus au Mercure de France ! Je ne savais alors rien de lui, n’ayant pas une seule fois lu son nom, ne l’ayant pas une seule fois entendu prononcer alors que j’effectuais ma scolarité dans un établissement catholique, l’externat Sainte-Marie. Pour les acheter, je me décidai fort vite à vendre à un prix dérisoire mes innombrables volumes (que pour la plupart j’avais volés) de la collection dédiée à la science-fiction chez Presses Pocket, à l’époque ornés des couvertures passablement laides quoique frappantes du peintre ridiculement symboliste Siudmak. Ce n’est que quelques années plus tard, en 1997 si je ne m’abuse, et même pas par le biais de Bloy qui admirait Ernest Hello, que je découvris l’auteur pour le moins étonnant de Physionomie des saints.
Je ne puis réellement analyser, ni même quantifier l’influence que Bloy et Hello eurent sur mes recherches et lectures (souvent celles que leurs livres provoquèrent, du reste) mais il est évident que je sentis s’ouvrir un gouffre sous mes pieds : chez ces deux écrivains, l’un doux comme un agneau et l’autre écumant comme un Minotaure entravé qui serait conduit à l’abattoir par un placide garçon boucher, je découvris, plus que réjouis je l’avoue, une violence réelle, profonde, inaltérable, entée sur une colère dont l’horizon était apocalyptique, donc intraitable : rien ne contenterait ces deux-là et il y a fort à parier que leur dernier souffle, contrairement aux témoignages iréniques de dernière heure, n’a pas ressemblé à un chromo pieux. Apocalyptique donc intraitable ai-je écrit. Il ne s’agit pas là d’une image commode mais d’une évidence : les textes de Bloy et de celui dont il n’hésita pas à clamer le génie bizarre (tout en le moquant plus d’une fois d’être si incroyablement soumis à son épouse : imagine-t-on, s’amuse et se désole tout à la fois l’auteur du Désespéré, un visionnaire et même un prophète tenu en laisse par une virago ?) se détachent sur un immense rideau de flammes d’une hauteur prodigieuse, allumées par le livre de saint Jean nous narrant la Révélation finale, dont ils appellent de leurs vœux le déchaînement, dont l’incendie du Bazar de la Charité ne sera, pour l’un, pas grand-chose de plus qu’une flammèche farceuse.
Comme lors de toute réelle découverte littéraire, je fis une chose et j’en ressentis une autre : d’abord, banalité sans doute mais réel baume appliqué sur le cuir faussement épais de l’adolescent inquiet et solitaire que j’étais alors, d’abord, immédiatement à vrai dire, je me sentis beaucoup moins seul. Ensuite (mais il ne s’agit là que d’une chronologie imagée vous vous en doutez), ensuite je lus tout ce qu’il m’était possible de lire de et sur Hello et Bloy, comme je l’avais fait, quelques années avant encore, pour Georges Bernanos, l’année de la Palme d’or décernée à Pialat levant le poing contre tous les salopards qui le sifflaient. Je tenais ma sainte trinité, car même Barbey, que l’on rapproche souvent de ces trois-là ce qui est bien normal, ne provoqua pas un tel ébranlement en moi : une langue étincelante évidemment, qui d’ailleurs frappa celui qui devint son secrétaire enthousiaste, Léon Bloy lui-même, mais bien trop d’afféteries femelles et de poses pour épater le bourgeois, aux rangs détestés desquels il appartenait par bien de ses travers. Cette triade, alors que j’approche doucement (très vite, en fait !) de la cinquantaine, n’a pas pris une ride, et je m’amuse toujours lorsque tel décombre pontifiant, petit caniche de Michel Houellebecq dont il serait toutefois difficile de deviner la queue frétillante d’aise sous les replis de graisse sure, voue aux gémonies le haïssable et haineux Léon Bloy pour lui préférer le bouilleur précieux de camomille Joris-Karl Huysmans, pour la seule raison que Michel, croit-il stupidement, en serait son plus authentique héritier ! Comme je l’ai écrit sur mon blog en évoquant Soumission, Houellebecq n’est que le clone malingre, velléitaire, impuissant de Durtal plus que de Huysmans et, comme je l’ai aussi montré sur Stalker, la plus anodine des lignes que Léon Bloy écrivit contre les textes de celui qui avait pourtant été son ami est plus que valable pour l’auteur délabré de l’Extension du domaine de la lutte : si ce qu’a écrit Bloy sur Huysmans avait pour but évident de blesser ce dernier, ce qu’il a écrit, sans bien sûr le savoir (encore que !) contre son impuissant et ridicule continuateur ne peut que détruire ses plus altières prétentions, si tant est qu’il soit possible de rapprocher le concept de verticalité de cet écrivain si peu vertébré qu’est Michel Houellebecq.
Comment peut-on être mauvais lecteur au point de transférer à l’un, rusé comme un singe pelé et bien capable, après tout, de se faire passer pour un écrivain véritable, espèce approximative d’augure des temps modernes lâchant, au cours d’entretiens pénibles quelques mots poussifs plus que rares censés être énigmatiques, que les pythies journalistiques se dépêcheront d’interpréter comme s’ils étaient tombés de la bouche hiératique du Sphinx lui-même, comment diable peut-on donc transférer les qualités de l’un à l’autre et même, sans rire, inscrire Houellebecq ou ses personnages (c’est tout un chez lui) dans la sincérité du cheminement spirituel de Huysmans, que nul ne peut contester, en dépit du sourcil broussailleux qui vient de se relever sur la face outrée de l’auteur de L’âme de Napoléon ? Certes, comme Pierre Glaudes l’a écrit, il m’a toujours semblé que l’écrivain Huysmans était inférieur à l’écrivain Bloy, mais il faut avoir des Himalaya de sottise devant les yeux pour ne pas voir que l’auteur de Là-bas était à tout le moins un écrivain, autrement dit un orfèvre des mots, ce que Houellebecq n’est qu’ici ou là, entre deux scènes pornographiques au langage coruscant (bite, chatte, cul, salope, pute, etc.), au détour d’une phrase à peu près réussie qui a l’air de l’étonner le premier et qui fait l’admiration des andouilles. Telle imbécile journalistique à cervelle de dinde catholique n’a-t-elle pas déclaré sur un réseau social bien connu que la dernière page de Sérotonine lui avait arraché des larmes, ce qui ne lui était pas arrivé depuis la lecture de Dostoïevski ?
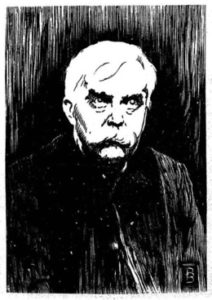
Vos vitupérations à l’encontre de vos contemporains vous valent un perpétuel procès en ressentiment. Vous vous en prendriez aux gloires établies par jalousie ou parce que vous souffririez d’un manque de reconnaissance. Votre cœur recèle-t-il, comme celui de Léon Bloy, un désir de gloire contrarié ?
Oui, j’ai lu cela des dizaines de fois, mon blog faisant figure de relique antique puisque je l’ai créé en 2004. Je suis un nain qui se juche commodément sur les épaules de géants, je suce méthodiquement, goutte à goutte sans en perdre une seule, leur génie et me gonfle de leur souffle, prenez l’image qu’il vous plaira pourvu qu’elle soit censée confondre l’imposteur que tout le monde sait bien que je suis, et d’abord celles et ceux qui sont venus à moi en s’essuyant les semelles sur un paillasson et en poussant la chansonnette bien connue : votre travail est admirable mais point dénué de travers… Non, sans blague ! Ce sont de consternantes stupidités emmaillotées comme il se doit dans l’assurance, pour le coup prétentieuse, de celles et ceux qui ne savent rien et qui, croyant vous blesser de dards et de flèches aussi émoussés que des vacheries de cour de récréation, vous affublent des tares qu’ils exsudent si visiblement. Ces vertueux contempteurs sont des impuissants et, pour le coup, des envieux car enfin, ai-je jamais écrit, ai-je une seule fois écrit, depuis que mes textes sont publics, ai-je eu une seule fois l’audace de prétendre que j’étais un écrivain ? Non, rien d’autre que critique littéraire mais cela, personne ne me l’enlèvera, bien que je doute que nous soyons nombreux à désirer être caractérisés de la sorte.
Me suis-je servi des grands que je sers (du verbe servir, dont la forme pronominale, se servir, est bien connue mais doit être rappelée, ces Diafoirus ayant tendance à confondre ces deux emplois fort différents) pour gagner ma vie, en faisant le beau (je reste poli) comme tant d’autres qui n’ont rien lu ou presque ou bien au contraire ont beaucoup lu, y compris de grands romanciers comme Paul Gadenne mais semblent avoir tout oublié en faisant le clown sur le plateau de Cyril Hanouna, ou nous parlent encore de Péguy comme s’ils lui avaient baisé le front juste avant que s’y loge une balle allemande ? Aurais-je même tiré à moi la couverture universitaire pour jouer le mandarin, intervenir à tous les colloques possibles et imaginables, être de toutes les éditions critiques, vendre mes Mimologiques 1, 2, 3, 4 et 56 comme des petits pains extradiégétiques et avoir le plaisir, que l’on devine inavouablement exquis, de voir mon nom imprimé sur le papier Bible d’un volume de La Pléiade ? Qu’on me les montre, enfin, ces preuves irrécusables de ma jalousie, de mon envie, de mon ressentiment, de ma haine, de mon ratage, alors même que j’étrille les textes de nains et salue, comme je le puis mais sans jamais ménager mes efforts, ceux des grands ! Faut-il être stupide, mauvais lecteur ou alors d’une mauvaise foi endémique pour ne pas comprendre que le véritable ressentiment, celui dont on ne trouvera pas une seule ligne chez moi, salit les grands auteurs et, à l’inverse, place sur un piédestal les petits, à seule fin d’être remarqué, et même : récompensé, par ces derniers ? Bon sang, mais si j’étais ce critique assoiffé de reconnaissance que quelques âmes salopes planquées derrière des écrans aux langues boursoufflées de bubons prétendent que je suis, sans jamais me mettre sous les yeux une unique ligne de ma consternante et constante envie selon eux, n’aurais-je donc pas fait, n’étant, concédez-le moi, pas moins doué qu’un autre et disposant aussi de cet organe qui, avant de servir à parler, est utilisé par ces bouffons pour lécher, n’aurais-je donc pas fait tout ce qu’il faut faire, y compris appuyer sur le bouton si visible de l’ascenseur et proclamer urbi et orbi le génie flagrant de mes protecteurs pour être publié dans la collection de Philippe Sollers, L’Infini, écrire des piges pour le journaliste le plus idoinement transparent de la place parisienne, le perpétuel ravi de la crèche Étienne de Montety, patron du Figaro (dit) littéraire ?
Soyons donc sérieux quelques secondes et affirmons cette évidence toute simple : mes contempteurs, du plus intelligent ou pensant l’être au plus stupide et l’étant vraiment, ne peuvent tout simplement pas admettre que je sers, encore une fois, les auteurs que je pense, que je sais, que je montre être grands, tout bonnement parce qu’eux, pour le coup, sont incapables de se dévouer de la sorte ce qui, je le conçois, peut être inimaginable pour ces cervelles remplies de bourre et de haine, ce qui fait somme toute peu de matière ! Rendez-vous compte, admirer des morts, Bernanos, Conrad, Melville, Faulkner, Gadenne et tant d’autres mais aussi des vivants, Marien Defalvard, Christian Guillet, Guy Dupré qui s’en est hélas allé chercher dans quelque royaume oublié ses fiancées de glace et, au contraire, trouver nuls des vivants, des bons vivants, des trop vivants, des puants la vie fausse, rhétorique (nous la retrouverons plus loin) comme par exemple les animalcules se nourrissant des miettes que laisse tomber de sa table prestigieuse le Messie germanopratin Sollers, qui lui-même ne serait rien sans sa lamentable clique d’eunuques suiveurs et de Marie Madeleine de foire médiatique comme la sinistre Josyane Savigneau, ou bien estimer navrants et médiocres un Renaud Camus ou un Richard Millet, ces peureux devenus, en quelques années, les souffleurs de tout ce que la France compte de racistes droituriers, totalement incapables de comprendre qu’il y a plus de force et de colère réelles, d’amour viscéral de notre pays dans une seule ligne de La Belle France de Georges Darien que dans les mille volumes du Maître du Petit Château de Plieux et dans les libelles suintant la satisfaction et puant le ressentiment, pour le coup, de notre guerrier très chrétien d’opérette, qui n’aura jamais tenu entre ses mains qu’une Kalachnikov en plastique, pour jouer les Charles Martel de carton-pâte.
La thèse du ressentiment dissimule deux éléments décisifs : d’abord la nullité objective de la plupart des écrivains que vous attaquez, ensuite le travail très important de découverte et de mise en valeur des écrivains que vous chérissez. Craignez-vous que votre violence verbale éclipse le caractère positif de votre « dissection » ou pensez-vous, au contraire que ces deux aspects de votre travail participent d’une même exigence ?
Vous avez écrit de manière concise et impeccable (à croire que vous avez dû, vous aussi, faire les frais des véritables envieux que sont ces vertueux accusateurs !) ce que je viens d’exposer un peu trop longuement sans doute, et en faisant qui plus est un petit détour par les égouts des prosateurs souchiens mais enfin, cela fait tant d’années que je lis ces stupidités que l’on me pardonnera, je l’espère, de m’être (légèrement) énervé ! Je serai plus bref concernant votre dernière question : non, je ne le crains absolument pas car, pour l’heure, cette heureuse aptitude m’a permis, avec une précision digne d’une horloge atomique genevoise, d’éloigner les fâcheux et de ne conserver autour de moi que les meilleurs lecteurs, celles et ceux qui savent, ou en tout cas qui comprennent intuitivement que, comme il en va pour Bloy auquel je ne me suis jamais comparé de près ou de loin, ma colère, ma honte devant des auteurs que l’on encense ignoblement, sont la face sombre, non point ténébreuse ou vile mais sombre je l’admets bien volontiers, de ma joie consistant à découvrir et surtout faire découvrir de grands textes, saluer les œuvres d’auteurs injustement oubliés ou dramatiquement sous-estimés. Si j’ai pu faire lire à un seul lecteur (je dis bien : un seul) les romans de Paul Gadenne, les superbes études de Max Picard, les références spéculaires enchâssées dans l’écrin d’une culture virtuose d’un Pierre Boutang ou d’un Thomas De Quincey, les flamboiements d’ironie et de méchanceté de Karl Kraus, les dissections implacables de la novlangue française pratiquées par Armand Robin ou Jaime Semprun, les errances mélancoliques et érudites de W. G. Sebald hanté par le massacre de plusieurs millions de Juifs, les romans métaphysiques et noirs de László Krasznahorkai, les labyrinthes baroques dans lesquels Malcom Lowry ou Ernesto Sabato plongent leurs personnages tourmentés, si j’ai réussi à faire cela, si j’ai réussi à transmettre une minuscule parcelle de la beauté et de l’inquiétude que j’ai moi-même reçues par ces écrivains et penseurs, j’affirme haut et fort que je puis mourir demain ; que je parte en paix ou bourrelé de remords et de regrets, rongé par tout le mal que j’aurai fait à mes ennemis et mes proches, que je retrouve aux Enfers, l’âme aussi noire que celle de Gilles de Rais, des gens sur les tombes desquels je me serai retenu d’aller cracher et même me soulager, ne regarde après tout je crois, que mon Créateur.

Krasznahorkai, à qui vous consacrez deux articles dans votre livre, devrait tempérer votre pessimisme. L’écrivain hongrois est bien vivant et il mérite déjà de figurer auprès des très grands. Le temps des livres est-il vraiment passé s’il y a Krasznahorkai ?
Il l’alimente au contraire, mon pessimisme, car ses plus grandes œuvres nous peignent une époque livrée au chaos. Une scène des Harmonies Werckmeister ne cesse de me hanter et se confond désormais avec toutes les images que j’ai vues durant la longue agonie de mon père réduit à l’état de cadavre vivant ; je songe à cette vision hallucinée d’une troupe de simples badauds échauffés jusqu’au délire meurtrier par la voix du Prince maléfique, qui déferlent dans les rues d’un petit village hongrois et pénètrent dans un hôpital. Arpentant les couloirs à un pas qui n’augure rien de bon et saccageant tout sur leur passage, ils tombent ainsi sur un vieillard nu, décharné et impuissant, qui essaie de se protéger des coups. Cela, cette scène noire, éprouvante, qui a dû bien des fois se produire dans la réalité, témoigne pour tous les humiliés et les offensés. J’ai découvert Krasznahorkai, en premier lieu, comme scénariste des films de Béla Tarr. Il a non seulement adapté certains de ses romans pour le grand écran mais a aussi proposé au cinéaste hongrois la magnifique parabole apocalyptique qu’est Le Cheval de Turin, le dernier film de Tarr selon ses dires que, pour l’heure, nous n’avons aucune raison de remettre en cause. J’ai évoqué sur mon blog tous ses ouvrages traduits en français, à l’exception du dernier, Seiobo est descendue sur Terre qui, je crois, vous a frappé. Deux titres doivent encore paraître d’ici quelques mois en France, l’auteur ayant d’ailleurs lui aussi annoncé qu’il avait décidé d’arrêter d’écrire : imaginez qu’un seul de nos lamentables écrivants ait la lucidité et le courage d’arrêter de produire, par hectolitres, leur bouillie publicitaire ! Impossible, tout bonnement impossible car, alors, ils arrêteraient d’exister et seraient instantanément dissous comme des moucherons de pissotières par un minuscule rai de lumière ! Vous aurez remarqué que j’établis une nette différence entre cet écrivain pour le moins puissant dans sa façon d’embrasser différentes thématiques et de leur donner une profondeur pouvant s’étendre, comme c’est le cas dans Guerre & Guerre, sur des siècles et la petite littérature à la française, le sous-pongisme d’Éric Chevillard pour mémère hypokhâgneuse et son chihuahua professoral, le fourre-tout a-verbal d’un Mathias Énard, probable futur prix Nobel de littérature, à moins qu’il ne se fasse damner le pion par l’ignoble créature de Philippe Sollers qu’est Yannick Haenel, qui mérite le nom d’écrivain comme moi celui de maître en élevage de grenouilles !
Il semblerait que les motifs d’espérance se trouvent plutôt à l’étranger. La France est-elle touchée plus que les autres pays par cette crise de la littérature ? Sa chute est-elle proportionnelle à sa grandeur passée ?
Je pense comme vous, mais restons prudents, comme m’incite à le craindre l’exemple de la littérature espagnole contemporaine, qui me paraît faussement puissante ainsi que l’illustre l’œuvre bavarde d’un Jaume Cabré ou même celle d’un Javier Cercas. Je ne vois pas grand-chose, dans cette langue, depuis que le grand Roberto Bolaño a cessé de descendre dans les souterrains boueux où, comme Ernesto Sabato, il sait bien que vivent tout un tas de créatures repoussantes, point toutes aveugles il s’en faut. Je disais penser comme vous, mais j’ajoute immédiatement que je ne sais strictement rien de la littérature actuelle de langue française, qui m’a toujours semblé n’être qu’un ersatz ; voilà qui, si je pratiquais cette dernière, me permettrait, peut-être, d’atténuer quelque peu mon pessimisme ! J’espère seulement, mais j’en doute fort, qu’elle n’a pas les yeux rivés sur la verroterie infâme que Paris veut faire passer pour des pierres précieuses car, sans cela, nous pouvons, sur celle-ci et en dépit de son exotisme passablement éventé comme sur l’hexagonale, faire une croix ou même, pour ce qui me concerne, aller cracher sur son cadavre puant ne méritant aucune tombe, aucun retour à la terre, mais une évacuation rapide dans quelque immense latrine. De toute façon, si l’on admet que la force d’une littérature doit quand même bien dire quelque chose, pour ne pas dire : pratiquement tout, de la puissance d’une nation, il est parfaitement normal que la française, autrefois imposante, majestueuse, donnant le la à la planète entière, recule à mesure de la dégringolade irrésistible, de la perte monumentale (mais tout à fait logique) de prestige international de la France.

Je réponds ainsi à votre question : oui, en effet, la littérature française, jusqu’au début du XXe siècle inclus et même, jusqu’à la mémorable défaite sur laquelle des Céline, Rebatet, Drieu la Rochelle et Brasillach ont puissamment écrit, a été l’une des plus grandes, la plus grande peut-être au monde, avec l’allemande, l’anglaise, la russe et l’américaine, nord et sud compris bien sûr. Le constat a été porté mille et mille fois, du moins par les plus lucides : la littérature française, dans son ensemble et pas dans telle ou telle individualité qui se bat pour ne pas être entraînée par la marée montante de merde commerciale et publicitaire, ne vaut pratiquement plus rien : pauvreté de sa langue, misère de son ambition, gélification de sa capacité de nommer ce qui se trame sous nos yeux, nullité de sa portée métaphysique, poétique, symbolique ou, si l’on ajoute à cette navrante théorie d’ombres bavardes un Michel Houellebecq qui, dans tel ou tel petit cénacle new-yorkais, passe peut-être pour un nouveau Victor Hugo, kilométrique, et je n’oublie pas sa fâcheuse tendance à se confondre avec la parole putanisée des journalistes. La littérature française ou plutôt ce qu’il en reste n’intéresse plus guère que quelques maquereaux journalistiques, pour filer ma plaisante métaphore, et les industriels du recyclage, qui n’ont jamais autant et utilement, je m’empresse de l’ajouter, fait fonctionner, et à plein régime, leurs salutaires pilons. Soyons augure si vous me le permettez : si la France devait se relever de sa déroute prodigieuse, nul doute qu’il faudrait en chercher les signes dans sa littérature. Or, j’ai beau chercher, je ne vois guère, hormis quelques noms déjà cités et/ou évoqués sur mon blog, de femmes et d’hommes capables d’envisager de gravir ou plutôt : de remonter la pente, car il faut croire qu’en France, plus personne n’a de goût pour jouer au Sisyphe, à moins qu’il ne soit dûment récompensé par des invitations sur les plateaux de télévision et quelque juteux à-valoir. Il me semble que le dernier romancier de langue française de quelque puissance incontestable, certes gâchée par d’incroyables et constantes facilités et gamineries, a été et reste Maurice G. Dantec, que tout le monde ou presque, y compris son lamentable premier biographe Hubert Artus, semble avoir oublié, comme si nous étions enfin soulagés de ne plus devoir lire un farfelu nous rappelant que la quête de Dieu et celle d’une langage rimbaldienne, magique donc, était l’unique mission de celles et ceux prétendant écrire, tenir une plume pour faire autre chose que la tournée des séances de dédicaces.
Votre préférence va pour les écrivains qui sont capables, comme vous dites, de développer « une métaphysique noire » ou de « descendre dans les souterrains boueux ». Se poser la question du mal est-il une des conditions nécessaires pour produire une littérature digne de ce nom ?
Bien sûr ! Trouvez-moi un seul grand écrivain, de quelque époque que ce soit, qui ne se soit pas préoccupé de la question que Georges Bataille jugeait être intimement liée à la littérature ! Un seul ! Je n’en vois aucun, et les géants, eux, la toute petite poignée d’écrivains qui ont vraiment tout dit (Dante, Shakespeare, Cervantès, Dostoïevski, Conrad, Melville, Stevenson, Goethe, Kafka et Faulkner, Céline, Jünger et Bernanos peut-être, Sebald et Krasznahorkai nous verrons !) ont embrassé ce que les doctes et les prudents appellent la question du Mal (que je majuscule volontairement). D’ailleurs, Le temps des livres est passé pourrait être lu comme la tentative, forcément parcellaire, consistant à proposer l’étude de plusieurs figurations romanesques du Mal ou du démoniaque, par le biais de textes sur 2666, Diadorim de Guimaraes Rosa ou encore Sous le volcan de Malcolm Lowry. Ceci étant affirmé, qui n’est qu’une évidence à mes yeux, il ne s’agit pas seulement de poser cette redoutable question mais d’explorer les innombrables figurations littéraires qui en découlent, celles données par Bernanos étant du reste fascinantes, puisqu’il commence avec son premier roman par la figuration d’un personnage satanique après tout assez traditionnelle, héritée du romantisme (même si j’ai pu montrer, ailleurs, que tout n’était pas aussi lisse ni simple), jusqu’à parvenir, avec Monsieur Ouine, aux limites mêmes de la littérature, pour le dire avec Claude-Edmonde Magny. J’ai développé dans l’un de mes ouvrages ayant valeur de petite parabole, Maudit soit Andreas Werckmeister !, à propos de ce roman difficile qui me fait songer à La connaissance de la douleur de Carlo Emilio Gadda, la métaphore, à mon sens opérante, d’une littérature pouvant être considérée comme un trou noir, au sens astrophysique du terme qui désignait ce que l’on appelait, naguère, un astre occlus dévorant absolument tout ce qui se trouve à sa proximité, y compris la lumière, incapable de s’échapper de son gouffre dévorateur. Comme la matière tombée dans le disque d’accrétion de l’ogre interstellaire, le langage tourne autour du puits dévorateur qu’est le personnage de l’ancien professeur de langues. La question du Mal pose donc, à mon sens, celle des limites mêmes de nos capacités d’énonciation, raison pour laquelle, proposant un raccourci du jugement que Bataille a développé dans un ouvrage fameux et, plus largement, dans toute son œuvre, nous pourrions dire que la littérature est le Mal ou n’est rien d’autre qu’un petit amusement solipsiste.
Symétriquement, peut-on affirmer que la littérature du « tout va bien » incarnée par Jean d’Ormesson, l’écrivain institutionnel le plus important de notre époque, est une littérature qui se détruit elle-même ?
Je vous suggère de poser la question à Romaric Sangars. Je crois savoir qu’il a lu plus de deux lignes de Jean d’O sans mourir d’ennui, distillant même, de ses méditations on le devine très profondes, une camomille passablement insipide, et n’étant je le crains pas franchement parvenu à gifler ce petit bout de vieillard gommeux perpétuellement bronzé et souriant, ce qui est un comble de maladresse tout de même lorsque l’on prend la pose minaudière du guerrier archéo-futuriste du très saint Verbe. Nous avions, jadis, une époque où un pamphlet pouvait prétendre corroder les métaux les plus durs ; nous avons, désormais, des béjaunes prétendument incorrects non seulement incapables de distribuer une insolente paire de baffes à qui les mérite amplement, mais étant bien incapables, se trouvant même à des années-lumière, par leur propre liniment lacrymalo-martial, de redresser la gueule de la littérature sur laquelle ils pleurent à grosses larmes.
Ces amabilités dites, que la mauvaise littérature s’autodétruise ne me gêne nullement mais vous vous trompez : la « littérature » (dés)incarnée par l’auteur de Je vais bien et j’espère que toi aussi, pauvre con qui n’est pas riche et bronzé comme je le suis est en plein essor, à tel point qu’il nous sera bientôt impossible de séparer la vraie littérature, l’exigeante, l’exploratrice, l’époumonante, ou ce qu’il en restera, de son double hâlé, heureux d’être stupide, progressiste comme un oiseau vole (depuis la naissance), con et prétentieux comme un petit robot marcheur d’Emmanuel Macron (depuis la naissance également). Il y a d’ailleurs, pour ce genre de soupe revigorante, des spécialistes qui sont eux-mêmes toujours contents d’être des commis et qui vous communiquent une irrésistible banane dès que leur voix rigolarde, heureuse d’être fausse et criarde, se met à vendre à la criée quelques courges tavelées : je songe à Augustin Trapenard que j’ai plus d’une fois croisé, un sourire idiot sur une face commune, le sourire idiot de l’homme content de lui-même, près de la Maison de la Radio ; comment ne serait-il pas heureux de tout et de rien, d’être heureux d’être heureux de rendre heureux si je puis dire, ce spécialiste en andouillerie promotionnelle et en boudin livresque, professionnel de l’Ouverture des esprits à l’Ailleurs, à l’Autre, au Tout-Autre même, à la Littérature, à la Poésie, lui qui n’a pas honte (il en est même très fier) d’estimer que Cécile Coulon pourrait bien être un croisement réussi de Marceline Desbordes-Valmore, Cristina Campo et même Sylvia Plath (bien sûr, je n’ai sans doute pas besoin de préciser qu’il n’a pas dû lire une seule ligne de ces écrivains magnifiques).
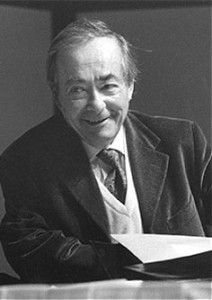
Le premier chapitre de votre ouvrage regroupe des articles consacrés au thème de la parole. Vous y traitez des méconnus Max Picard, Armand Robin ou encore de Karl Kraus. Cette façon d’aborder la littérature par le prisme du Verbe vous vient-elle de George Steiner à qui vous avez consacré un essai ?
De George Steiner, oui, en effet, et de celui qui fut son grand ami, certes tardivement, Pierre Boutang, dont l’œuvre fascinante, parfois superbement hermétique, est d’une portée à l’évidence supérieure à celle de l’auteur de Réelles présences, et chaque ligne nouvellement lue de cet extraordinaire esprit encyclopédique me renforce dans cette conviction, qui du reste doit être celle de Steiner lui-même si je ne m’abuse. Nous pourrions encore citer le génial Walter Benjamin mais aussi, là encore, celui qui fut son grand ami, le spécialiste de la kabbale juive Gershom Scholem. Steiner parle, à propos de l’auteur du difficile et lyrique Purgatoire, de logocratie, un terme assez facile à comprendre (que Boutang corrige toutefois en éléocratie, évoquant plus directement le royaume de la grâce que celui du logos), mentionnant d’autres logocrates comme le furent à ses yeux Joseph de Maistre et, plus près de nous, le remarquable quoique souvent loufoque inventeur verbal que fut Martin Heidegger (laissons à un Gérard Guest le soin de nous démontrer qu’il est, toutefois après lui et peut-être aussi Maxence Caron, le plus grand philosophe de tous les temps).
Je me suis toujours étonné du fait que George Steiner n’avait pas jugé utile d’étudier, dans le cas qui nous occupe, le coruscant Léon Bloy, dont pas une seule ligne je crois ne peut être véritablement coupée de sa racine logocratique, le Verbe, pour le dire autrement et sans passer par de complexes détours platonico-cratyliens. Pas davantage il ne mentionne Georges Bernanos, dans cet ouvrage comme, à ma connaissance, dans quelque autre de ses autres écrits, et il y a dans ce silence, probablement volontaire (car je ne puis imaginer un George Steiner qui ne saurait rien de Bloy ou de Bernanos !) un point qu’il faudrait sans doute creuser, un non-dit signifiant, pour le dire pompeusement. Il ne parle pas plus, et là c’est pour le moins franchement étonnant, de Carlo Michelstaedter longuement évoqué dans mon livre et dont le maître ouvrage, après lequel il se tira une balle, La persuasion et la rhétorique, a été une de mes plus grandes découvertes de lecteur. Pour tous ces auteurs, le langage (plus que la parole, avec laquelle il ne faut pas le confondre), s’il ne vise pas la réelle présence, une notion directement piquée par Steiner au culte catholique, est un amusement de bateleur qui s’adonne à la rhétorique. Je cite ce gamin absolument remarquable écrivant à l’un de ses amis, Nino Paternolli, pour vous donner quelque idée de ce qu’il vise, autrement dit un langage qui épouserait intimement les plus secrets linéaments d’une vie, y compris dans sa plus humble banalité : « Vivre les choses pour soi-même et non présumer les avoir vécues du fait que l’on en parle, cela est le sérieux ». La persuasion, par opposition à la rhétorique qui, nous assure Michelstaedter, « entourbillonne » serait ainsi, à son terme, à sa fine pointe, le langage secret que l’âme se tient à elle-même, la vox cordis dont parle Boutang et qu’il oppose, là encore avec Platon, à la pesanteur marmoréenne de l’écrit. Or, choisir de s’engager dans une telle quête, c’est de facto parier sur le fait que le langage humain n’a que peu de rapports avec l’outil purement technique (et ne pouvant pas même être qualifié de proto- ou de pré-langage) qu’un singe un peu plus doué que les autres, moyennement un apprentissage tout de même considérable, est parfaitement capable de développer. Pour le dire d’une autre façon, qui est un vers détourné de Paul Cela que j’ai utilisé comme sous-titre de mon essai sur George Steiner : la Parole souffle sur notre poussière.
Vous avez fait le choix de sélectionner pour votre livre uniquement des articles qui sont des analyses philosophiques et littéraires des œuvres de grands écrivains. Toute la dimension pamphlétaire de votre travail est absente (même si certaines études vous permettent parfois d’attaquer nos contemporains). Est-ce un choix éditorial ? Estimez-vous ce pan comme secondaire ?
Ce pan atrabilaire de mon travail, cette écume si vous le voulez : aucun éditeur n’en veut, sans doute parce qu’il estime que la critique littéraire véritable, à cran d’arrêt comme l’appelait (la réclamait, plutôt) Julien Gracq dans sa Littérature à l’estomac n’intéresse plus personne, surtout pas les journalistes, et, en conséquence, ne peut se vendre qu’à une poignée de réactionnaires envieux et aigris dont nous avons tracé plus haut le si peu flatteur portrait ! Le temps des livres s’ornera peut-être un jour, à la faveur d’une improbable réédition, d’un petit texte évoquant l’histoire éditoriale comico-héroïque de ce manuscrit monstrueux. Au diable, donc, la tradition remarquablement riche et illustrée de milles teintes différentes de verdeur de la critique littéraire polémique à la française (c’est un pléonasme, notons-le, l’art de la polémique étant incontestablement français), illustrée par tant de plumes acérées, parfois trempées dans l’acide voire le curare (mes préférées), de Sainte-Beuve à Matthieu Galey, Philippe Muray, Angelo Rinaldi ou même, plus récemment, Jean-Philippe Domecq et Pierre Jourde (laissons Naulleau faire le beau sur les plateaux car, désormais, le pauvre homme, visiblement désorienté par une gloire tardive, confond Paul Gadenne et Cyril Hanouna), en passant par Barbey d’Aurevilly, Léon Bloy ou Léon Daudet ! Si le temps des livres est passé, que dire de celui des livres ouvertement méchants qui, pourtant, non seulement n’exigent pas moins de travail d’écriture que les radieux (ce serait même plutôt l’inverse : la louange est facile, la critique, elle…), mais nous donnent une image parfaitement vive, inversée en somme, de ce que la littérature devrait être ?
