Camille Dalmas est journaliste et co-fondateur de la revue d’écologie intégrale Limite. Il vient de publier Le paradoxe Chesterton (L’escargot, collection Vraiment Alternatifs), essai roboratif qui expose les différentes facettes de l’auteur d’Orthodoxie : de son rire sérieux à son distributisme en passant par ses conceptions de l’art littéraire et du patriotisme.
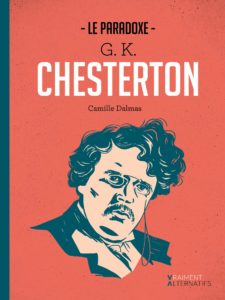 PHILITT : Vous démontrez dans votre livre que tout chez Chesterton fut paradoxal : son art, ses opinions politiques, son apparence physique… Est-ce pour cela que Chesterton s’est reconnu dans la figure du Christ, le grand maître des paradoxes, celui qui, à chaque parole formulée, défie le sens commun ?
PHILITT : Vous démontrez dans votre livre que tout chez Chesterton fut paradoxal : son art, ses opinions politiques, son apparence physique… Est-ce pour cela que Chesterton s’est reconnu dans la figure du Christ, le grand maître des paradoxes, celui qui, à chaque parole formulée, défie le sens commun ?
Camille Dalmas : Le paradoxe est la « clé d’or » qui unifie toute l’œuvre de Chesterton et qui trouve sa conclusion dans la métaphysique chrétienne. Après sa conversion au catholicisme en 1922, il n’a d’ailleurs cessé de souligner cette spécificité du message du Christ, figure paradoxale par excellence, puisque « vrai Dieu et vrai homme » selon les mots du catéchisme romain. La fin de son œuvre, sorte de merveilleuse apologie du christianisme si l’on rassemble la dizaine de volumes d’essais remarquables écrits à la fin de sa vie (L’homme éternel, Le Puits et les Bas-fonds, La Chose, Pourquoi je suis catholique etc.) ne vise d’ailleurs que cela : découvrir dans chaque paradoxe des Évangiles une raison supplémentaire de se convertir.
Vous insistez sur l’ethos comique de Chesterton, sur son grand rire gargantuesque. Doit-on en conclure que Chesterton ne prenait rien au sérieux ?
Vous avez parfaitement raison de comparer Chesterton à Gargantua, il y a quelque chose de l’ogre débonnaire chez lui qui le rend généralement sympathique à tous les lecteurs. Mais comme cela a été fait parfois avec Rabelais, on aurait grand tort de réduire l’œuvre de Chesterton à une joyeuse paillardise. Tout d’abord parce que chez Chesterton, le rire est un sujet extraordinairement sérieux. Il a d’ailleurs tendance à expliquer systématiquement que si les sujets prétenduement sérieux intéressent si peu de monde, c’est souvent parce qu’ils sont moins sérieux que les sujets jugés mineurs. Le rire est chez lui un outil salvateur et révolutionnaire. Il fait vaciller les grands comme les bouffons jadis les princes, il relève les petits, il tombe comme la foudre sur les affameurs et les escrocs. C’est un rire honnête, sans méchanceté, sans bassesses, pareil à celui du petit garçon d’Andersen qui aperçoit lors d’un défilé solennel que son empereur est en tenue d’Adam. Chesterton développe d’ailleurs une théologie du rire très originale, celle du mystère de l’humour divin. Le paradoxe est bien évidemment un levier sans pareil pour susciter le rire, et Chesterton en abusa bien entendu dans ce but précis aussi.
Il y a une cependant une chose que Chesterton prenait très au sérieux et pour laquelle, il me semble, il ne laissait aucune place à l’humour. Il ne voyait en effet pas comment on aurait pu rire de ce petit nourrisson de porcelaine déposé là, dans une mangeoire de paille, par un jour de grand froid, au creux d’une petite église, entre ses deux parents et quelques joyeux ruminants. Pas plus qu’il n’aurait envisagé un bon mot devant cette époustouflante petite fille qu’il dit avoir croisé dans le Monde comme il ne va pas et qui porte avec elle toutes les révolutions du monde : « Avec les cheveux roux d’une gamine des rues, je mettrai le feu à toute la civilisation moderne. » Pour Chesterton, l’enfance est un territoire sacré ; qui la souille n’est qu’un démon.

Il existe d’ailleurs un enregistrement de Chesterton riant pendant une conférence aux États-Unis lors de laquelle il se moque très gentiment de son confrère Rudyard Kipling. Ce rire est étonnamment aigu, vif, rond… Presque un rire d’enfant.
Face au snobisme en vogue à son époque qui se voulait volontiers « hérétique », Chesterton se présentait comme un « orthodoxe ». En quoi consistait l’orthodoxie de Chesterton ?
Chesterton fit un livre pour répondre à cette question (Orthodoxie) après en avoir écrit un autre qui s’intitulait Hérétiques. Ce besoin d’une orthodoxie se trouve merveilleusement résumée dans Petites choses formidables : « Les actes et les arrangements de peu d’importance d’un homme devraient être libres, souples, inventifs ; ce qui devrait être immuable, ce sont ses principes, ses idéaux. Mais dans notre cas, c’est tout le contraire ; nos opinions ne cessent de changer, mais pas notre déjeuner. » Le problème est que Chesterton écrivait droit – en orthodoxe – avec des lignes courbes – en paradoxes – pour reprendre la merveilleuse formule de Loyola. Cette orthodoxie est bien évidemment celle du christianisme pour Chesterton. Elle consiste aussi en une défense d’aspect divers de l’existence, tel le patriotisme, le merveilleux, et tout ce qui fait une vie simple – il est là très proche de la common decency d’Orwell. Bref, l’orthodoxie de Chesterton comportait toutes ces choses que les grands esprits cyniques regardaient en ricanant. À ceux-là une nouvelle fois, il opposa son rire franc.
Un des postulats esthétiques de Chesterton consiste à affirmer que la beauté et la grandeur sont à chercher dans « les petites choses formidables ». Pouvez-nous nous expliquer ce point de vue déroutant ?
C’est d’abord un simple constat. Comme le remarquait Chesterton, en raillant l’alpinisme, une montagne est belle quand on la regarde d’en bas, elle est insignifiante à son sommet. La volonté de vouloir dominer tous les sujets pour les théoriser est une pathologie moderne. Les plus belles théories – comprendre theoria, contemplation – sont celles où l’on se fait le plus petit pour voir le monde en grand. Sur ce point Chesterton s’oppose radicalement à Spinoza qui voulait voir le monde « sous l’angle de l’éternité ». C’est sous l’angle de la finitude que le monde est beau. « Si un homme veut élargir son univers, il doit sans cesse se rapetisser. » Prenez l’observation spatiale : qui ne préfère pas les photos merveilleuses des galaxies prises depuis notre toute petite planète aux modélisations en donuts de l’univers que présentent actuellement des mini-Hawkins dans quelques universités américaines souffre d’une grave pathologie. C’est ce désenchantement du monde que combat Chesterton. Nous souffrons d’une hypermétropie des yeux, de l’esprit et du coeur, pour reprendre les trois ordres pascaliens. Pour nous en sauver, il nous faut devenir des « athlètes oculaires », et apprendre à voir la formidable grandeur des petites choses.

Parmi les paradoxes propres à Chesterton, celui de son patriotisme est particulièrement troublant. Il se pensait comme un patriote anglais mais a rejeté les deux mamelles de la nation : l’anglicanisme et le capitalisme. Quel genre de patriote était-il finalement ?
C’est une question difficile et vraiment nécessaire, parce qu’elle demande de mettre à bas de possibles simplifications nationalistes du message de Chesterton tout en ne vidant pas de son sens son patriotisme. Par patriotisme, Chesterton entend d’abord le respect et une affection toute particulière pour le pays de ses pères. Et il se trouve que les pères des pères de Chesterton furent un jour heureux : la Tamise coulait dans un des plus beaux royaumes de la Chrétienté où les cathédrales poussaient autant que l’orge et le houblon et où les hommes, principalement des petits propriétaires, vivaient de très riches heures sous le soleil de Dieu. C’est ce paysage idyllique, légendaire, mais pas utopique de l’Angleterre d’antan, de la « Merry England » chantée par Shakespeare et Chaucer que Chesterton défend quand il défend sa patrie. Il se trouve que le peuple d’alors était fidèle à Rome, avant que l’orgueil d’un Roi fasse vaciller l’universel dans le grotesque – et l’Église anglicane actuelle en est une démonstration splendide. Le patriotisme de Chesterton n’est pas celui d’une religion majoritaire ou d’un modèle économique dominant, mais de quelque chose qui unissait plus intimement l’Angleterre en une seule nation malgré les fractures terribles provoquées par les guerres de religion ou la déshérence sociale héritée des révolutions industrielles. Aimer son pays, c’était d’abord et surtout aimer les siens et les traditions qui unissaient concrètement ce peuple ainsi constitué.
C’est pourquoi Chesterton était patriote contre le colonialisme, patriote contre la City et contre les conservateurs à la Chambre des Communes, contre tous les faux patriotismes gangrénés par l’hubris d’une supériorité supposée d’Albion sur les autres nations. Son patriotisme au contraire était celui qui animait Dickens, Disraeli ou Orwell, celui d’un homme qui aime simplement son petit peuple sur sa petite île. Jamais Chesterton ne tomba dans le piège d’un « patriotisme de mains et des pieds » – autrement dit d’un nationalisme expansionniste et belliqueux – lequel est par ailleurs bien souvent pratiqué par ceux qui le dénonce chez les autres.
Malgré sa légèreté apparente, Chesterton s’est beaucoup impliqué politiquement en popularisant le mouvement distributiste. Pouvez-nous expliquer sa spécificité, le distributisme étant assez méconnu en France ?
Philippe Maxence, grand spécialiste de Chesterton, donne cette définition que je trouve parfaite : « Refusant à la fois les conséquences dramatiques du libéralisme économique et les fausses solutions apportées par le socialisme étatique, le “distributisme” postule la renaissance d’une société agraire et artisanale, reposant sur une large distribution de la propriété privée, afin qu’elle ne soit pas confisquée par quelques-uns et qu’elle permette à chaque foyer d’être propriétaire ou co-propriétaire des moyens de production. » Historiquement, le distributisme nait au début du XXe siècle dans une Angleterre exsangue, déchirée entre la déréliction sociale dramatique provoquée par la deuxième révolution industrielle et les espoirs totalitaires portés par certains courants socialistes, et vient s’inscrire à la fois dans une tradition conservatrice agrarienne, dans une mouvance socialiste non-marxiste telle que développée par William Morris et bien entendu tente de trouver une application de la doctrine sociale de l’Église. Chesterton n’en est pas l’inventeur, mais le défenseur le plus éminent. Mouvement radicalement anti-utopiste, antimoderne et anti-progressiste, le distributisme considère qu’un retour d’une forme de mesure et de prudence aristotélicienne en politique est indispensable pour faire émerger une véritable société juste, démocratique et libre.
Peu connu, il est donc peu représenté et expérimenté, si ce n’est quelques foyers très actifs en Argentine, en Italie et surtout aux États-Unis. Mais je crois que notre époque est un terreau très fertile pour le distributisme et sais qu’elle a encouragé quelques « lunatics » à passer à l’action dans une poignée de petits villages en France.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
