Tadao Takemoto, professeur émérite de l’université de Tsukuba, ancien professeur invité du Collège de France, est le descendant d’une longue lignée de samouraïs. Il a pratiqué le bouddhisme zen en suivant l’enseignement de deux maîtres zen : Shin’ichi Hisamatsu et Daisetz Teitaro Suzuki. Traducteur et collaborateur d’André Malraux ainsi que de Jean Grenier, il a également assuré la traduction des poèmes (waka) de l’impératrice Michiko en français et n’a cessé de promouvoir le dialogue entre les traditions japonaise et française. Dans son dernier ouvrage, Miyamoto Musashi, guerrier de la transcendance (éditions Signatura, 2019), Tadao Takemoto voit dans le samouraï philosophe Musashi (1573-1645) un cas exemplaire des hautes valeurs communes au bushidô japonais et à la chevalerie française, qui lui a inspiré une forme de dialogue.
PHILITT : L’idée de votre livre est de comparer le bushidô japonais à la chevalerie française et leur évolution et d’illustrer cela avec l’exemple du samouraï Miyamoto Musashi. Qu’implique le bushidô ? Peut-on parler de code de la chevalerie et comment s’est-il structuré ?

Tadao Takemoto : Le bushidô implique à l’origine deux aspects qui sont liés sous l’égide de valeurs et de règles communes : le courage guerrier et la piété (ou esprit transcendantal). Ces aspects sont d’ailleurs communs à la chevalerie occidentale.
La religion bouddhique a joué un rôle essentiel dans l’élaboration du bushidô, qui remonte au XIIIe siècle. Ainsi, le célèbre moine bouddhique Myôë, qui avait été fait prisonnier par les troupes de Hôjô Yasutoki, shikken[1] du shogunat de Kamakura, a enseigné à ce dernier la vérité bouddhique au temple Kôzanji (en banlieue de Kyoto), ce qui a permis l’extension du bouddhisme zen, et a fortiori le bushidô. Il faut dire que Myôë était un bonze très important et un exégète de l’ésotérisme Kegon (qui est le sutra[2] dit de la Roche verte fleurie). Le hasard a voulu que Hôjo Yasutoki fût également très pieux, ce qui a facilité la pénétration du bushidô par l’enseignement bouddhique.
Myôë lui a enseigné la compassion (qui se traduit par quatre idéogrammes 大慈大悲), qui est une des qualités morales du bouddhisme. Sur le fondement de cet enseignement, Hôjo Yasutoki a ensuite rédigé le Joei Shikimoku[3], le code légal du shogunat de Kamakura. Quelques décennies plus tard, Hôjô Tokimune, huitième shikken de Kamakura, a élaboré le premier code du bushidô.
Ceci est une des interprétations de l’origine du bushidô. En ce qui concerne votre chevalerie, nous pouvons remonter sa codification à la règle des Templiers, sensiblement à la même époque.
Vous distinguez justement trois périodes chronologiques, qui mettent en évidence un certain parallélisme entre l’évolution du bushidô et celle de la chevalerie (les origines du XIIe au XIVe siècles dont on vient de parler, la renaissance de la royauté et de la fidélité du XIVe au XVIe siècles et la Double Voie des Arts et du Sabre du XVIIe au XVIIIe siècles).
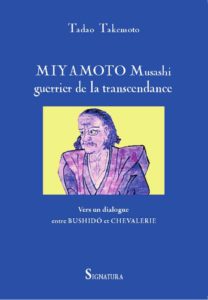
À mon sens, le personnage historique qui incarne le renouveau, éphémère, de la chevalerie française, équivalant donc à la deuxième époque que j’identifie, est Jeanne d’Arc. Si elle n’avait pas connu cette fin tragique, elle aurait peut-être pu, à elle seule, restaurer cet idéal à plus long terme. Au Japon, la situation n’est pas si éloignée que cela de la vôtre. Quelque cent ans auparavant, le plus célèbre samouraï de notre histoire, Kusunoki Masashige, a également fait figure d’idéal chevaleresque. En effet, ce dernier a servi loyalement l’empereur en exil Go-Daigo contre le gouvernement Kamakura et est parvenu à restaurer le souverain sur son trône (ce qu’on a appelé la restauration Kenmu entre 1333 et 1336) mais a finalement trouvé une mort tragique au combat contre une armée supérieure en nombre. Ce sens du sacrifice et de la fidélité absolue au souverain légitime rejoint celui de Jeanne d’Arc et illustre bien les valeurs communes de la chevalerie et du bushidô.
Le samouraï se distingue pourtant du chevalier en plusieurs points, qu’il s’agisse par exemple de la classe sociale (les samouraïs représentaient une véritable classe moyenne, soit environ 7% de la population, contrairement à l’aristocratie occidentale, qui en constituait 1%) ou du rituel (le seppuku).
Effectivement, les chevaliers appartenaient à la noblesse, alors que les samouraïs s’attachaient davantage à la terre qu’à la fortune. Ils étaient des propriétaires terriens, souvent méprisés par l’aristocratie, et étaient liés par des clans, tous soumis aux daimyos (les gouverneurs de province sous les ordres du shogun).
Quant au seppuku, on peut apporter deux explications à ce geste propre aux samouraïs : l’une matérielle et l’autre transcendantale. Cet acte marque un certain attachement à la stylisation, à l’aspect formel. Les Japonais n’ont pas inventé le geste de s’ouvrir le ventre (les Romains le faisaient déjà, comme nous l’a rapporté Plutarque) mais ils l’ont accompagné d’un cérémonial. Ainsi, j’ai souhaité, dans mon ouvrage, mettre en évidence l’importance du parallèle entre le seppuku et le jisei, le chant d’adieu, qui était un poème (ou waka) que le samouraï composait avant de mourir. Ce sont donc ces deux expressions – le geste physique et le geste artistique et transcendantal – qui constituent l’idéal formel du guerrier samouraï. Pourtant, dans l’imaginaire occidental, le jisei est toujours sous-estimé, voire oublié, et l’on ne retient que l’acte spectaculaire de l’éventration.
À titre d’exemple, le premier fils de Kusunoki Masashige, qui s’appelait Kusunoki Masatsura, a laissé, avant de mourir au combat, un jisei qu’il a gravé sur la cloison de la pagode Nyoirindo et qui peut se traduire ainsi :

« Je ne reviendrai plus jamais
j’avais pris cette décision il y a bien longtemps
si bien que je laisse ici mon nom
parmi les noms de ceux qui sont déjà morts[4]. »
C’est le jisei que je préfère. Il en existe des centaines de milliers, dont les premiers remontent aux temps les plus anciens, comme le raconte le Kojiki (la Chronique des faits anciens), qui est un livre relatant le mythe des origines au Japon.
Un des premiers jisei, selon cet ouvrage, est celui de la princesse légendaire Oto-Tachibana, qui accompagnait son époux le prince Yamato Takeru parti en campagne militaire dans les territoires de l’est et dont le navire a été pris dans une tempête. Pour apaiser l’ire du dieu de la mer, la princesse s’est jetée dans l’océan. Ce geste n’était pas désespéré mais au contraire, empli de bonheur. L’impératrice Michiko a d’ailleurs évoqué cet épisode dans une conférence qu’elle a donnée en 1998, au cours de laquelle elle a déclaré : « La mort volontaire d’Oto-Tachibana révèle l’inséparabilité de l’amour et du sacrifice. »
Cette tradition du jisei s’est perpétuée au fil des siècles (tout le monde par exemple connaît l’histoire des 47 rōnin), y compris jusqu’à nos jours. Ainsi, pendant la Seconde Guerre, de nombreux étudiants, qui avaient été mobilisés dans l’armée, ont laissé des poèmes d’adieu à la vie. Ces poèmes ont d’ailleurs été compilés dans des livres, qui ont, d’après moi, le tort de vouloir nous émouvoir à l’excès.
Tout cela reste ignoré des Occidentaux, qui ne comprennent peut-être pas cette tradition. Mais l’histoire comparative du bushidô et de la chevalerie doit, à mon sens, pouvoir permettre de remettre en lumière cet aspect mal connu de la tradition japonaise.
Malraux disait que la spiritualité japonaise est un domaine si vaste et évident que l’Occident ne parvenait jamais à la saisir, alors que la spiritualité occidentale est un dialogue (on pense notamment au dialogue entre Jeanne d’Arc et ses voix). Mais il peut y avoir des correspondances ou des passerelles. Ainsi, le théologien Olivier Clément, dans une conférence donnée au Japon, avait dit que le shinto est la meilleure perspective qui mène au christianisme. Dans le christianisme, en effet, la personnification même de l’absolu est omniprésente alors que ce n’est pas le cas au Japon.
Si les deux premières périodes sont marquées par un lien étroit et inaltérable entre vertu guerrière et transcendance, la troisième période se distingue par la distanciation progressive avec la règle de Jôei et par la codification à l’extrême du samouraï. Comment cela va-t-il conduire au déclin du samouraï et sa disparition au XIXe siècle ?
Le déclin s’explique surtout par la longue période de paix qui caractérise le shogunat Tokugawa, entre 1603 et 1867. Le bushidô était très respecté à cette époque et a été codifié de manière stricte, notamment par le philosophe Yamaga Soko qui a érigé le samouraï en homme supérieur confucéen et en exemple vivant pour les classes sociales inférieures.
Le bushidô était tellement respecté que l’opinion publique a largement soutenu les 47 rōnin, ce qui gênait considérablement le gouvernement Tokugawa pour lequel les actes de vengeance étaient interdits. En effet, la constitution d’alors interdisait cette pratique, ce qui a causé un grand dilemme. Ces samouraïs avaient été très fidèles à leur seigneur et à la cause du bushidô ; il n’y avait donc pas de raison de les condamner à mort. Le shogun Tsuyanoshi a demandé l’avis du grand maître de Nikko. Celui-ci lui aurait dit : « Laisser mourir, c’est là le bushidô. » Cela permettait également de respecter la loi, ce qui a constitué un merveilleux compromis.
Malheureusement, le bushidô de Tokugawa avait trop l’esprit de détail, à tel point que son âme originelle s’en est trouvée dénaturée. Les premiers shoguns ont promulgué plusieurs codes du samouraï (Buke-Gohattoshû) qui étaient chaque fois plus précis, plus restrictifs, sur la taille du chignon, des ongles, sur l’interdiction de la barbe ou des poils du nez ! On voit bien que ces codes sont loin de la spiritualité de la règle de Jôei. Mais pour l’essentiel, le bushidô a été conservé.
Comment interprétez-vous le seppuku de Mishima, le dernier samouraï de la Double Voie des Arts et du Sabre ? Peut-on dire de lui qu’il est une synthèse des génies classique européen et japonais ?
Tout en restant purement japonais, Mishima a toujours gardé le plus profond respect pour la culture française. Il n’a jamais cessé son entretien intérieur avec tel ou tel écrivain français. Finalement, c’est à travers le cas Mishima que les Français pourraient mieux saisir la signification de ce que peut être un samouraï.
Je voudrais l’illustrer avec un exemple. Si l’on se remémore La Condition humaine de Malraux qui, on le rappelle, traite de l’échec de la révolution communiste en Chine en 1927, on remarque que le sujet de la torture y est abordé, dans la sixième partie (je renvoie ici notamment à la mort du personnage Katow). Malraux était très fier de dire qu’il était le premier écrivain à avoir traité ce thème dans la littérature. En parallèle de la torture, qui est un supplice infligé par un tiers, Malraux évoque le seppuku (un supplice que l’on choisit de s’infliger) avec beaucoup d’admiration. Je cite : « Kyo, aidé par son éducation japonaise, avait toujours pensé qu’il est beau de mourir d’une mort qui ressemble à sa vie ». Comme il se le demande après, « que vaudrait une vie pour laquelle il n’eût pas accepté de mourir » ?
Cela n’a évidemment pas plu au gouvernement de Pékin, si bien qu’Eisenstein n’a jamais pu obtenir le droit de tourner l’adaptation de La Condition humaine (la vedette devait être un Chinois communiste, pas un samouraï).
C’est la raison pour laquelle Mishima a trouvé son meilleur interlocuteur en France, en la personne de Malraux, car ils se comprenaient.
Peut-on dire des kamikazes qu’ils étaient animés, par leur sacrifice, de l’esprit du bushidô ?
À l’origine non, car l’attaque kamikaze a été « conçue » par le vice-amiral Takijirô Onishi en 1944, au moment où le Japon subissait, depuis la bataille de Midway, de multiples revers. C’était finalement une tactique désespérée, de dernier recours, qui a subsisté jusqu’à la bataille d’Okinawa et qui a causé la mort d’environ 4 000 soldats. Cependant, il ne s’agit pas d’une simple tactique militaire. Il y a quelque chose d’intrinsèquement japonais dans ce sacrifice, avec une notion de l’honneur assumée : les kamikazes ne s’attaquaient qu’aux cibles militaires, jamais aux civils, contrairement aux actes perpétrés par les terroristes.
Ce qui est intéressant, c’est qu’Onishi lui-même s’est fait seppuku, en refusant d’ailleurs toute aide de ses hommes, qui se proposaient d’abréger ses souffrances en le décapitant, comme c’est l’usage[5]. Il a agonisé pendant des heures, afin de souffrir comme avaient souffert ses soldats. Là se trouve le bushidô. Maurice Pinguet en parle d’ailleurs très bien dans son ouvrage, La Mort volontaire au Japon[6].

Miyamoto Musashi a théorisé une voie qu’il a appelée le Bunbu-ryodô, la Double Voie des Arts et du Sabre, qui conjugue la vertu du sabre (l’art martial ou Hyoho) et les aptitudes artistiques. Quelle est sa conception de l’art martial ?
Pour lui, l’art martial peut se comprendre par ce qu’il nomme la Vertu du Sabre. À son époque, les fusils existaient déjà, mais les armes traditionnelles n’étaient pas abandonnées pour autant et le sabre restait l’arme de prédilection du samouraï. Le Japon venait de clore une longue période de guerre civile. Musashi, dans son testament, le Dokkôdo, a écrit : « La voie de l’art martial, je ne la quitte jamais. » Il écrit également que le bushidô « passé, n’est pas tari ». Pour lui, considérer l’art martial uniquement comme voie du sabre n’implique rien d’autre que « l’art martial en lui-même » (Ichibun-no-Hyôhô)[7]. En partant de là, il faut réaliser « l’art martial pour tous » (Daibun-no-Hyôhô), c’est-à-dire l’administration du pays.
En effet, pour devenir un guerrier puissant, il faut maîtriser toutes sortes de techniques mais cela ne suffit bien sûr pas. Si l’art martial se résume à tuer des ennemis, cela reste vain. Il faut, par le sabre, sauver des vies. C’est aussi en cela que consiste la chevalerie. Dans les nombreux duels auxquels il a participé dans sa jeunesse, Musashi utilisait un vrai sabre. Je pense par exemple à son fameux combat contre l’école d’escrime Yoshioka, qu’il a anéantie à lui seul (ses adversaires étant au nombre d’environ soixante ; parmi eux se trouvait un jeune garçon, qu’il a dû tuer pour une question d’honneur. Il l’a regretté par la suite et on l’a critiqué pour cela). Son état d’esprit a ensuite évolué et il a eu recours à un sabre en bois, afin de ne pas tuer ses adversaires.
Musashi est un homme de guerre valeureux, duelliste hors pair, mais il est également connu pour ses talents de peintre, de calligraphe, de sculpteur, de poète… Quel a été son apport dans l’art japonais ?

Son apport a été sans précédent et est resté unique. Aucun artiste zen, et il y en a eu beaucoup, n’a pu l’égaler. Je prends pour exemple sa peinture d’une Pie grièche sur une branche desséchée. Si le dessin en tant que tel est déjà exceptionnel (l’arbre, dressé tout en verticalité, est dessiné d’un seul trait et légèrement courbé, comme un sabre ou un arc, au bout duquel se tient non une flèche mais un oiseau), ce qui compte le plus est l’espace laissé au vide. Dans cette peinture, c’est en effet le Vide qui prévaut et auquel Musashi a su donner une forme.
De nombreux artistes occidentaux ont toujours reproché à la culture japonaise qu’il lui manquait un aspect transcendantal. Ainsi, Paul Claudel disait qu’il n’y avait pas de verticalité dans l’art japonais, simplement des courbes, ce qui est faux. Le japonisme dans la peinture occidentale remonte à Van Gogh, qui s’est inspiré de l’art japonais mais qui s’est limité à l’horizontalité. La verticalité japonaise n’a été découverte que bien plus tard avec Malraux et ce n’est pas un hasard si Musashi a tant compté pour lui.
Votre ouvrage présente un important appareil iconographique. Pouvez-vous nous parler de l’autoportrait inédit de Musashi reproduit en couverture et expliquer en quoi il est exceptionnel ?
Il s’agit du seul autoportrait (inachevé, en raison de l’absence du sceau et de la signature) de Musashi, qui était jusqu’à la publication de mon ouvrage totalement inédit, y compris au Japon. Il a été conservé au sein de la famille Miyamoto pendant très longtemps ; la famille n’y accordait pas beaucoup d’importance en raison de son inachèvement. Peint sur un rouleau kakejiku, il avait été secrètement accroché dans le tokonoma[8] ou sur une porte coulissante (fusuma) dans l’ombre, tout au fond d’une pièce pour échapper au regard des visiteurs curieux. Il a ensuite été donné en cadeau à maître Taniguchi Motome[9], que j’avais rencontré en 2003 alors qu’il était déjà très âgé. Au regret que j’exprimai devant lui de ne pas pouvoir exposer à Paris le sabre de Musashi (que ce dernier avait forgé lui-même), maître Taniguchi me répondit qu’il m’enverrait quelque chose d’inconnu. C’était cet autoportrait, dont je propose une analyse dans mon livre.
Justement, vous avez tenté de monter une exposition en France consacrée à Musashi, avant d’abandonner faute de moyens matériels et de mécènes. Avez-vous toujours l’espoir de faire connaître davantage au public français celui que vous appelez le personnage exemplaire du Bunbu Ryodo, le génie idéal japonais ?
C’était une exposition sur Musashi artiste et guerrier. Mon rêve était de la monter au Louvre, ce qui a failli se réaliser. J’avais fait des démarches auprès des mécènes japonais mais aucun n’était d’accord. En général, les musées français nous mettent généreusement des salles à disposition mais ils ne nous accordent pas de financement, donc c’est compliqué. Je ne perds pas espoir pour autant.
Musashi, en dehors de ses talents guerriers, est surtout connu pour son Traité des Cinq Roues (le Gorin no sho), qu’on peut assimiler à une sorte d’initiation aux arcanes de la vie. Pouvez-vous nous parler de l’importance de cet ouvrage capital pour les Japonais ?

C’est la première fois dans l’histoire du Japon qu’un samouraï aussi important que lui aborde dans un ouvrage d’autres disciplines que l’art martial, auquel il ne se limite pas. Comme on le sait, il a rédigé son Traité dans la grotte du Reigandô, sur des feuillets qui ont ensuite été copiés sur cinq rouleaux qui correspondent à la quintessence (Gorin) des cinq éléments : terre, eau, feu, vent, vide.
Il y explique notamment, en partant de son expérience de combattant, que la conservation de l’honneur ne concerne pas que les samouraïs mais tous les belligérants, quelle que soit leur condition. En effet, les armées recrutaient également des paysans, des bonzes, des femmes… C’est en combattant avec ces malheureux innocents qu’il a pu tirer les conclusions qu’il expose dans son Traité. C’était quelque chose d’inouï à cette époque, il a été le seul à en parler. Si l’on me permet cet anachronisme, on pourrait parler de « démocratisation » de l’art du combat.
La figure de Musashi, devenue une icône quasi légendaire et héros de romans populaires, ne correspond pas à la réalité des faits. Ce Musashi romanesque contredit même les règles du bushidô. Pouvez-vous nous dire comment s’est traduite cette contradiction et quelles ont été les incidences sur l’appréhension que nous avons des samouraïs et du bushidô ?
Cela est dû en grande partie à la « méthode chinoise » qui consiste en la « fictionnalisation » de l’Histoire et dont de nombreux historiens japonais ont été victimes, au premier chef Toyota Kagehide qui a écrit en 1776 une biographie de Musashi (appelée Nitenki) qui confond des éléments authentiques et fictifs. Au XXe siècle, c’est Yoshikawa Eiji qui rédige une biographie romancée en deux parties (La Pierre et le Sabre et La Parfaite Lumière) où il décrit un Musashi nonchalant, qui aime prendre son temps, faire la grasse matinée et qui arrive en retard à ses duels. Cela, bien sûr, est invraisemblable et paradoxal. Musashi a vraiment été traité à la légère, alors que les règles des duels étaient très strictes, et son image en a beaucoup souffert. Il est devenu un héros de mangas et de dessins animés.
J’ai voulu, dans mon ouvrage, partir à la recherche de la vérité.
Vous avez été le collaborateur et traducteur d’André Malraux pendant quelques années. Pouvez-vous nous parler de son intérêt pour la culture japonaise et ce rôle de passeur qu’il a joué entre les deux cultures ?

Certains Occidentaux avaient senti qu’il existe des liens secrets entre l’Homme et l’Univers ou l’Au-delà. Parmi eux se trouvait Malraux. Tout génie qu’il était, il n’a pas pu appréhender complètement la culture japonaise sans se rendre directement sur place. On sait que, arrivant en 1931 au port de Kobe depuis la Chine, Malraux a été très impressionné par les chantiers navals et l’activité des ouvriers qui s’y déployait. Il s’est d’ailleurs servi de cette expérience dans La Condition humaine, quand il décrit l’arrivée du professeur Gisors à Kobe. Il écrit notamment : « Il faudrait que les hommes pussent savoir qu’il n’y a pas de réel, qu’il est des mondes de contemplation ». C’est sur son bateau qu’il a écouté de la musique traditionnelle jouée au biwa[10] et il a alors saisi la différence fondamentale entre les civilisations chinoise et japonaise. Le Japon se situe au-delà de la tragédie, il y a quelque chose d’intrinsèquement transcendantal et Malraux l’a senti grâce à cette musique, d’après ce qu’il m’a dit. Il est en cela complètement différent de la Chine ; vous ne pouvez apporter une définition correcte du Japon (et c’est peut-être là que réside sa faiblesse) que si vous savez le différencier de la Chine.
Comment faut-il comprendre cette phrase de Malraux : « Laissez la France être le mandataire de l’âme japonaise » ?
C’est le sommet de sa pensée sur le Japon. Quand il est venu en 1958, les Japonais avaient perdu leur identité culturelle et se sentaient malheureux. Il a alors prononcé un discours dans lequel il affirmait que, contrairement aux deux grandes puissances, les États-Unis et l’URSS, qui étaient entrées dans l’Histoire récemment, la France et le Japon ont des racines très anciennes. Ce point commun devait leur permettre de se rapprocher et de mettre en œuvre ce que les deux grands blocs américain et soviétique ne pourraient pas faire. C’est à cette occasion qu’il a prononcé cette phrase. Contrairement à l’UNESCO, qui ne procède qu’à un échange de connaissances, Malraux plaidait pour l’interpénétration des âmes. C’est ainsi qu’il concevait l’échange culturel et cela m’avait beaucoup ému à l’époque. C’est ce qui a décidé de ma carrière universitaire en France.
Vous dites, dans votre ouvrage, que le Japon attend son réveil spirituel. Quelles seraient, à votre avis, les conditions requises pour cela ? Comment se matérialiserait ce réveil spirituel ?
Malraux, pour en revenir à lui, m’a dit un jour à Verrières-le-Buisson, en 1975, que le Japon restait bloqué dans une situation irrationnelle et qu’il fallait que le peuple se rassemblât autour d’un axe commun, qui était la famille impériale. Or, celle-ci venait d’être condamnée et l’empereur avait échappé de peu à l’exécution. Quand j’ai rapporté ces propos au Japon, le doute était palpable. Mais petit à petit, le Japon a commencé à se réveiller et à prendre conscience de l’importance de l’empereur. La décision d’Akihito et son épouse Michiko de mettre un terme à la culture de l’excuse que les gouvernements successifs leur imposaient et de se rendre en pèlerinage sur les lieux de la guerre pour rechercher l’apaisement (de l’intérieur du pays jusqu’aux îles du Pacifique, d’Okinawa à Iwo-Jima et Saipan où un millier d’habitants, qui fuyaient l’avancée des alliés en 1944, se sont précipités du haut de la falaise de Banzai, ce qui a constitué l’un des épisodes les plus tragiques de la guerre) a beaucoup aidé. Rappelons que, depuis la fin de la guerre du Pacifique, l’empereur ne peut plus se rendre au sanctuaire Yasukuni, qui célèbre tous les soldats morts pour la patrie depuis l’époque de Meiji. Cela a beaucoup attristé l’empereur Hirohito, qui a laissé une série de waka pour témoigner de ses regrets. L’impératrice Michiko a également composé de nombreux waka, sur Hiroshima, Iwo-Jima et le sacrifice des combattants morts pour leur pays. Je me permets de citer celui-ci :
« Parties sur quelle mer, quelle terre
je l’ignore.
Elles demeurent invisibles,
les nobles âmes
gardiennes du pays. »
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
[1] Régent officiel et dirigeant de facto du Japon.
[2] Ecrit philosophique rédigé sous forme d’aphorismes.
[3]Shikimoku signifiant « répertoire ». L’ère Joei couvrait la période allant d’avril 1232 à avril 1233.
[4]帰へらじと
兼ねて思へば
梓弓
亡き数に入る
名をぞとどむる
[5] Il s’agit du kaishaku et la personne désignée pour procéder à la décapitation est le kaishakunin.
[6] Editions Gallimard, 1984.
[7] Dans ses Trente-cinq règles de l’art martial.
[8] Petite alcôve au plancher surélevé en tatami, où l’on expose des calligraphies, des estampes…
[9] Maître de l’École de sabre Enmei Ryū, fondée par Musahi
[10] Luth à manche court.
