La première rationalisation hygiéniste, de facture utilitaire puis romantique, roule sur le développement généralisé de l’esprit technicien. Mais faut-il réduire le sport à la matérialisation de cet esprit dans le champ du loisir ? Cette réduction semble pleinement justifiée pour Friedrich Georg Jünger, contestable pour Christopher Lasch.
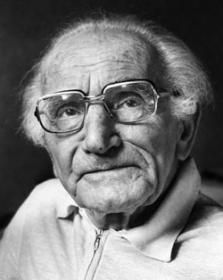
L’esprit technicien transite par l’organisation, c’est-à-dire, pour reprendre les mots de Jacques Ellul dans La technique ou l’enjeu du siècle, par « la technique appliquée à la vie sociale, économique ou administrative ». La technique, au sens large, désigne l’esprit technicien et ses conséquences, autrement dit la recherche systématique de l’efficacité (et de la seule efficacité) en toutes choses – l’organisation n’étant qu’un moyen pour atteindre cette efficacité. Mais, en ce qui concerne le sport, le fait marquant ne se situe pas dans la compromission avec une organisation qui, par définition, doit être centralisée par l’État ou une entité économique/administrative. En effet, la pratique sportive se déroule trop souvent sans affiliation à une quelconque organisation bureaucratique, et même si la bureaucratisation du sport existe indéniablement via sa professionnalisation, on ne saurait y voir un aspect déterminant. Cependant, l’esprit technicien peut exister sans organisation clairement identifiée.
Peut-être faudrait-il alors expliquer cette ascèse du sportif par la honte prométhéenne sur laquelle insiste Günther Anders dans les premières pages de L’Obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle ; cette « honte qui s’empare de l’homme devant l’humiliante qualité des choses qu’il a lui-même fabriquée ». Elle ne saurait se comprendre sans son pendant, la fierté prométhéenne, qui « consiste à ne rien devoir qu’à soi-même, y compris soi-même » : toute Bildung fait face à sa propre limite reflétée par l’image ou l’idée d’efficience propre à la machine qui, puisque issue d’un procédé de fabrication, n’est ni véritablement périssable, ni handicapée par cette faiblesse (morale et physique) originelle dont souffre l’homme – ce dernier aurait par conséquent « honte de ne pas être une chose ». La recherche de performance inhérente au sport, et l’optimisation des techniques qui en résulte, ne suggère-t-elle pas cette volonté de combler l’écart entre l’humain et la machine ? N’est-elle pas devenue, pour une part, un tremplin vers le transhumanisme ? Le sportif moderne ne serait-il pas cet « human engineer » que dépeint Anders – cet homme qui ne veut pas savoir « ce qu’est sa nature physique, mais jusqu’à quel point elle peut subsister (sans atteindre le point de rupture) », « à quelles conditions extrêmes elle peut se “conformer” » ? C’est ce que pense Friedrich Georg Jünger. Ce dernier conteste l’existence même d’un sport prémoderne : les Jeux olympiques grecs constituaient une fête religieuse et non un sport. Autrement dit, le sport n’a pas épousé l’esprit technicien mais, au contraire, l’esprit technicien a enfanté le sport.

La naissance de la discipline sportive s’explique d’abord, d’après Jünger, par une réaction face à la « grande ville techniquement organisée » et industrialisée. Cette réaction ne s’origine pas dans la honte prométhéenne mais, plus trivialement, dans la purge de l’effort physique provoquée par l’intrusion des machines : « le corps du conducteur d’un tracteur ou d’une faucheuse diffère de celui du cueilleur et du faucheur ». Si « le “sauvage” ne pratique aucun sport » c’est tout simplement parce que son travail exerce déjà ses facultés corporelles. L’activité sportive se caractérise, en premier lieu, par le perfectionnement technique – qui n’est, au fond, que l’application de la logique technicienne à l’exercice physique – et par la spécialisation intensive qui en découle inévitablement. L’équipement du sportif, de plus en plus perfectionné, tend à fragmenter (à « mécaniser ») l’effort physique en une série de micro-mouvements (répétition d’un segment) délimités temporellement et dont témoigne l’utilisation massive du chronomètre. L’organisation, qui a d’abord façonné le monde du travail par la division des tâches, imprègne l’activité physique à présent décorrélée du travail économique : « L’homme lui-même se transforme en une sorte de machine, son mouvement, contrôlé par des appareils, devient machinique. » La seconde caractéristique est jumelée à la première : la performance supprime la plaisir qui, jadis, provenait de la relation entre l’homme et son milieu naturel. Ainsi, à l’inverse de la natation – activité physique pleinement rationalisée par le mesure d’une performance – , « le plaisir procuré par la nage et la plongée trouve son origine dans le contact avec l’élément liquide, sa fraîcheur cristalline, sa froideur, sa pureté, sa transparence et sa souplesse ». Jünger admet toutefois que la « tension de la volonté à laquelle le corps doit se plier mécaniquement […] peut tout à fait s’avérer profitable et féconde » à condition de ne pas y voir une fin en soi au risque de gommer toute sensibilité esthétique ; une sensibilité emportée par la laideur du mécanisme – cette force de la volonté sur les corps que donne à voir la pratique sportive – et désormais incapable d’apprécier la grâce, cette légèreté du mouvement corporel comme soulevé par l’esprit.
Sport moderne et mécanisation du corps
Là ou Jünger voit une inesthétique foncière des corps sculptés, on peut déceler une esthétique romantique du don : don de soi dans l’effort, parfois jusqu’au sacrifice partiel du corps. Une esthétique du désintéressement appliquée à l’activité physique. Il ne s’agit donc pas simplement d’innerver la volonté. Ajoutons que la technique sportive se distingue assez nettement de la mécanisation industrielle dans la mesure où, comme le souligne Anders, le sportif, à l’image du musicien, fait sien l’instrument utilisé – qu’il s’agisse d’une perche pour le perchiste ou d’un archet pour le violoniste –, l’incorpore à « son organisme comme un nouvel organe », au contraire de l’ouvrier qui devient « l’organe de son instrument » et « se charge activement de se transformer en un être passif ». Il serait ainsi fâcheux d’interpréter le sport moderne à la lumière d’une simple mécanisation du corps ; cela reviendrait à considérer tout perfectionnement, tout désir d’excellence, comme une aliénation. Or, la performance sportive, une fois immortalisée (rendue publique), constitue une œuvre et donc une création qui, comme toute création, panse l’angoisse de la mort. Il est cependant indéniable que l’esprit technicien s’est emparé du sport, et il suffit de constater le recours à la planification des entraînements pour s’en convaincre. Mais c’est là tout simplement le ferment de l’époque, la transmutation de l’espérance en progrès. Il ne faut probablement pas aller plus loin.

Christopher Lasch relève d’ailleurs, en s’appuyant sur les travaux de Johan Huizinga, que le jeu sportif a toujours été sérieux, « qu’il est de son essence de prendre au sérieux des activités sans but utilitaire qui ne se réfèrent à rien d’autre qu’à elles-mêmes », comme le confirme l’intensité meurtrière des compétitions antiques. La rationalisation du sport est un élément – certes typiquement moderne – de ce sérieux et vient se substituer au mépris de la vie. La technique et la professionnalisation, contrairement à ce que semble soutenir Huizinga dans Homo ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, ne supprime donc pas en elle-même la tonalité ludique du sport qui s’épuise dans son caractère désintéressé. Ce sérieux se retrouve chez les spectateurs garants d’une culture (populaire) de l’excellence : un public de connaisseurs exigeants, une « élite démocratique », se maintient dans le sport. Plus significatif, souligne Lasch, « est le fait que tout le monde est d’accord sur les normes qui servent à mesurer l’excellence » en raison d’un lien plus fort entre sportif et supporteurs : « Le public sportif est encore constitué en grande partie d’hommes qui ont “pratiqués” dans leur jeunesse, qui ont acquis un sens du jeu et son capables d’en distinguer les différents degrés de qualité. » Cet accord permet d’assurer une réelle stabilité des normes seule capable de résister à une confusion des critères de jugement véhiculée par la mode – comme dans l’art pictural où la nouveauté devient un critère promu pour sa « valeur de choc ». Le sport est, en ce sens, conservateur ; il évite ainsi l’écueil de la banalisation et de son surgeon, le sensationnalisme, qui confère une valeur esthétique à l’excitation passagère de la nouveauté.
Mais le sport moderne n’échappe pourtant pas totalement au phénomène de banalisation. Le signe de ce mal réside dans la désintégration des conventions qui encadrent les rivalités – ce qu’on pourrait appeler le « fair-play » (en ce qui concerne les joueurs) et, surtout, la civilité des spectateurs. La banalisation surgit lorsque le sport perd son caractère de « fête public » pour entrer dans la société anonyme du spectacle. Lasch insiste particulièrement sur la relation fondamentale entre le jeu, le rituel et le drame. En effet, les sportifs « ne font pas que se mesurer ; ils exécutent une cérémonie familière qui réaffirme des valeurs communes » et « une cérémonie a besoin de témoins ; des spectateurs enthousiastes, au courant des règles de des significations sous-jacentes. » « Lorsqu’ils se soumettent sans réserve aux règles et aux conventions, les joueurs – et les spectateurs aussi – coopèrent pour créer une illusion de la réalité », et alors « le jeu devient une représentation de la vie dans laquelle chaque participant endosse un rôle comme au théâtre ». La vigueur du théâtre sportif, régulé par des conventions tacites, s’émousse à mesure que progressent les mouvements de foule. C’est alors le divertissement qui prend le pas sur le sérieux du jeu : « La télévision a créé une nouvelle catégorie de spectateur et transformé ceux qui assistent à la rencontre en participants, qui cherchent à se mettre dans le champ de la caméra et à attirer l’attention en gesticulant ou en agitant les drapeaux. » La réserve formulée par Lasch s’applique avant tout aux sports médiatisés et vise particulièrement les spectateurs.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
