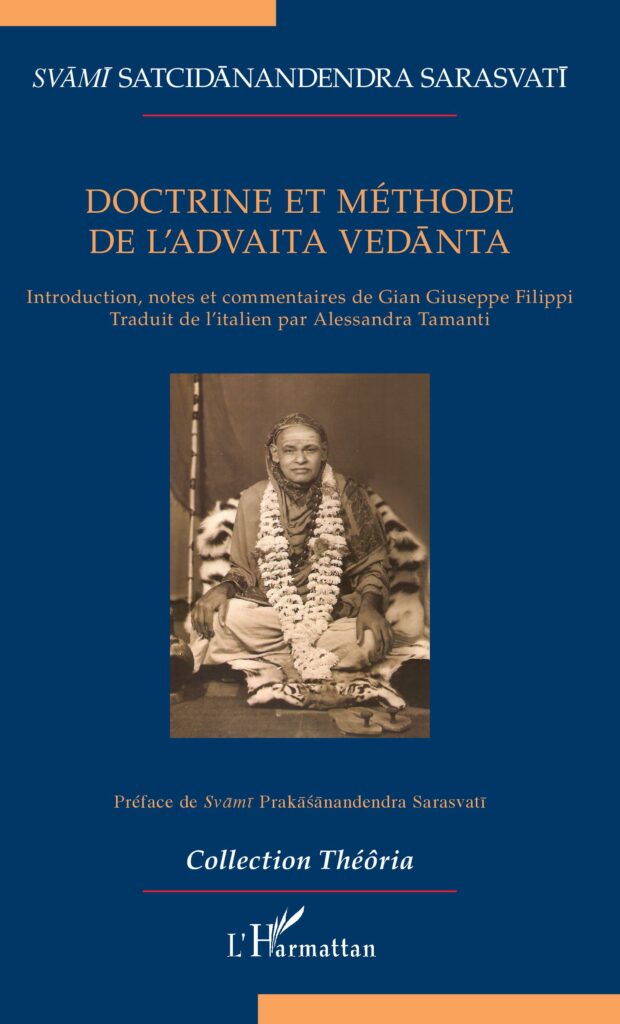Gian Giuseppe Filippi est professeur émérite de littérature hindi et d’indologie au Département d’Etudes Asiatiques et Méditerranéennes de l’Université Ca’Foscari de Venise. Grâce à la traduction française d’Alessandra Tamanti, il vient de publier, à la collection Théôria de L’Harmattan, Doctrine et méthode de l’Advaïta Vedānta du Swami Satcidanandendra Sarasvati. Dans ce livre, qui réunit deux œuvres du maître hindou initialement parues en langue anglaise, est réaffirmée, face à un certain nombre de mécompréhensions, la doctrine la plus purement métaphysique de l’Inde traditionnelle, celle de l’Advaïta Vedānta de Shankara.
Loin de toute réduction moraliste, la tradition hindoue identifie quatre buts à l’existence humaine qui, loin de s’exclure les uns les autres, constituent chez le brahmane les quatre stades normaux de sa vie : le kama, ou jouissance esthétique de la vie, satisfaction des désirs affectifs ; l’artha, ou prospérité matérielle, consistant en la fondation d’une famille et la conduite des affaires ; le dharma, ou l’accomplissement du devoir et des prescriptions de la loi ; et enfin le moksha, ou Libération de l’ignorance. Ce moksha est le but ultime du Védanta, c’est-à-dire de l’école philosophique et initiatique fondée par le grand maître Adi Shankara, au VIIIe siècle av. J.-C.
C’est de cette Libération dont il est question dans le livre du maître Satcidanandendra Sarasvati, né du nom « profane » de Subbaraya le 5 janvier 1880 dans une famille de brahmana au sein d’un village de la somptueuse contrée de Chikkamangalur, dans le Karnataka, au sud de l’Inde, et mort dans les environs de Holenarasipur le 6 août 1975, ville où il avait fondé en 1920 le Centre de la Lumière intérieure (Adhyâtma Prakasha Karyâlaya). Face à ce livre, le lecteur français est confronté a priori à une double difficulté : la métaphysique pure qui y est présentée ne manque pas de le dépayser de ses catégories philosophiques ordinaires, tandis que les concepts employés le promènent loin de sa langue. Le premier livre de l’ouvrage, originairement publié en 1969, a pour fonction de dissiper la première difficulté, en proposant de succinctes « Clarifications shankariennes de quelques concepts védantiques ». Alors le lecteur peut aborder avec plus de familiarité le second livre sur « La vision de l’Atman », publié en 1970. Enfin, un riche index de termes et de concepts sanskrits résout la seconde difficulté en guidant la lecture et la compréhension de la philosophie shankarienne dont cet ouvrage constitue une formidable introduction.
La philosophie de la non-dualité
Depuis sa fondation platonicienne, la philosophie occidentale est marquée par une tendance à substituer le logos (ou rationalité) au mûthos (système mythique et symbolique sacré de référence). Cette tension, relativement évacuée par la philosophie chrétienne du Moyen Âge, a cependant ressurgi violemment dans le monde moderne où le divorce n’en finit plus d’être consommé entre les deux. En revanche, la philosophie indienne n’a jamais souffert d’un tel conflit : la rationalité spéculative, tout en se distinguant du discours du mythe, n’a cessé d’y trouver ses plus hauts principes et d’en recevoir une inépuisable ressource de compréhension du réel. De sorte que les écoles philosophiques astika de l’Inde prennent toutes la forme de commentaires et sous-commentaires de l’unique tradition du Veda, à l’exclusion des philosophies nastika qui, telles que les écoles bouddhiques, se sont séparées du Veda et se réfèrent à d’autres mythes de référence.
Le svami Satcidanandendra Sarasvati, que nous nommerons ici Subbaraya pour plus de commodité, prend son parti des débats qui concernent l’interprétation des commentaires védiques constituant la doctrine de Shankara, maître de la doctrine de la « non-dualité » (kevaladvaïta) aux VIIIe et IXe siècle après J.-C. En fidélité avec la première version de cette doctrine, et antérieurement à ses évolutions postérieures, Subbaraya réaffirme, à l’appui de très nombreuses citations, son caractère « non-dualiste » (advaïta), l’unité fondamentale du réel derrière le voile d’illusion du monde (Mayâ). La métaphysique non-dualiste s’oppose à la dualiste en ceci qu’elle ne cherche pas à seulement connaître le Principe (ou Dieu) par rapport à sa manifestation (ou sa création), mais à le connaître en lui-même, comme l’unique réalité. Si Dieu est en effet la source de tous les êtres, la source de toute réalité quelle qu’elle soit, alors il est lui-même le seul vraiment réel, puisque rien de ce qui est n’existe sans l’acte par lequel Dieu conserve ses créatures dans l’être. Il faut donc prendre conscience que rien n’existe que Dieu (Brahman) : « les phénomènes empiriques en eux-mêmes n’ont pas d’existence indépendante, étant donné que, métaphysiquement parlant, l’être est unique, et Atman lui-même n’est que cet Être pur. »
C’est en ce sens que la doctrine shankarienne de la non-dualité (Advaïta Védanta) repense la subjectivité. En effet, tous les êtres ont en commun d’être : ils s’identifient donc à un principe ontologique commun qui justifie que nous puissions et devions parler de réalité ou d’Être comme substrat unique et englobant de tout ce qui existe virtuellement ou effectivement. Or s’il n’y a qu’une Réalité, et que l’âme individuelle (c’est-à-dire chacun de nous) est réelle, alors, notre propre essence ne nous appartient pas, mais elle n’est rien d’autre qu’un reflet de cette unique Réalité transcendante. De sorte que « de toute évidence, le terme Atman se réfère ici à la Réalité, fondement de l’ensemble du monde des phénomènes, à laquelle toute âme individuelle est identique » : je ne suis rien d’autre que l’Être et je n’ajoute rien de plus à cette unique Réalité qui produit et contient toute chose. Chaque être qui existe étant un « soi-même », tous les soi individuels ne sont que des instanciations de cet unique Soi (Atman) unique, universel et indestructible. L’Être est plus réel en moi que moi-même, qui en dépends et qui suis contingent : avant que d’être je, je suis, et cet Être est mon véritable Soi.
La méthode de la Discrimination
Si donc toute chose existante, en tant qu’elle est réelle, ne sort pas de cette unique Réalité, qui seule est, alors « on pourra se demander pour quelle raison on voit cet univers différencié, où existent tant d’êtres individuels », et a fortiori pourquoi « nous croyons fermement que nous sommes tous des êtres limités, remplis de désirs, et non pas cet Atman éminent. » Les Upanishads répondent : « c’est à cause de l’ignorance ou advidya ». Seule est réelle la Réalité unique qui précède tous les êtres, que l’ignorance (advidya) superpose tandis qu’au regard de la Réalité absolue, ils ne sont que des illusions, et non des réalités subsistant par soi. L’ignorance est en effet une tendance innée qui consiste à « superposer » sur l’unique Réalité d’autres réalités que l’on s’imagine subsister par elles-mêmes, à commencer par notre propre ego ainsi que les objets de nos passions auxquelles nous accordons une importance démesurée, qui tantôt nous rend euphorique, tantôt nous abat. Or la sortie de l’ignorance doit consister pour l’être humain à s’identifier au point de vue absolu, en mourant à son point de vue particulier et conditionné.
La religion en général, par l’institution de ses rites, permet à l’homme de « parcourir la distance qui sépare l’être manifesté de l’Être universel ». Par les moyens théoriques et pratiques qu’elle met en œuvre pour le salut de l’homme, elle lui permet de prendre conscience de sa dépendance à l’égard de son Seigneur (Ishvara), de sorte qu’elle lui permet à la fois de se libérer de la tyrannie de ses passions et de son égoïsme ainsi que de relativiser les souffrances dont il apprend à apprécier le caractère passager, presque illusoire. Pour aussi bonne qu’elle soit, cette voie rituelle et ascétique n’est cependant pas la méthode que propose Shankara, car comme le montre Subbaraya, la dévotion au Seigneur (Ishvara) reste dualiste : elle envisage l’unique Brahman sous le point de vue conditionné de l’âme individuelle, qui prend encore le monde manifesté pour une réalité. Or « aucune distinction ou différence n’est autorisée au niveau de Brahman Lui-même ».
La méthode préconisée par Shankara est donc radicale : elle consiste en la nette « discrimination » entre, d’un côté, le point de vue conditionné de l’individu, qui voit les choses dans leur multiplicité et leur relativité ainsi que tous les maux qui les accompagnent, et de l’autre, le point de vue, seul réel, de l’Absolu producteur de l’ensemble des êtres, au niveau duquel les déséquilibres partiels se résolvent l’ordre total. Cette Discrimination oppose ainsi le point de vue pragmatique ou empirique (vyavaharika), « qui correspond au point de vue de l’ignorance qui maintient la distinction entre connaissant et connu », au point de vue métaphysique ou scripturaire (paramarthika), où s’abolit la dualité du connaissant et du connu dans la conscience de l’unique Soi qui est l’objet connaissable en même temps que le sujet à partir duquel toute connaissance est possible.

Le métadogmatisme de la métaphysique pure
Selon l’enseignement de Shankara, si la religion est nécessaire à la plupart des êtres qui ne sont effectivement pas prêts à renoncer à leur vie ordinaire pour demeurer dans la pure contemplation, elle reste néanmoins « non-suprême » en tant que dualiste : en effet elle distingue « le Seigneur et sa Seigneurie », elle oppose Dieu et le monde pour mieux rapprocher les habitants de celui-ci vers Celui-là. Ce n’est donc point par la religion que, pour Shankara, la connaissance du « Brahman suprême » et non-duel peut se réaliser, mais par les trois moyens de l’écoute (sravana), de la réflexion (manana) et de la compréhension profonde (nididhyasana) de la doctrine védantique par le biais d’un maître qualifié, c’est-à-dire ayant réalisé l’identité avec le Soi. Ainsi Subbaraya insiste sur le fait que nulle obligation, nulle prescription, n’est censée intervenir en matière de connaissance pure : l’obligation ne concerne que le domaine « non-suprême » de la religion. La connaissance métaphysique ne connaît pas de prescription, mais seulement des indications nécessaires à l’atteinte du but fixé.
Cette connaissance, on le voit, se passe des moyens rituels qui sont ceux de la religion qui emmène par étapes, et pour ainsi dire analytiquement, l’individu à s’unir à l’Universel. En revanche, la connaissance du Suprême ne peut se faire que d’un seul coup, par une opération de synthèse ou d’intégration, comparable au calcul d’une intégrale en mathématiques. Il s’agit donc d’une prise de conscience surgissant sur la base d’une « illumination » intellectuelle. Cette illumination est en quelque sorte une grâce : l’enseignement métaphysique du guru réalisé est certes une condition nécessaire à la prise de conscience du Soi, mais elle n’en constitue pas la condition suffisante, qui échappe aux moyens humains et ne peut venir que du Soi transcendant.
Dans cette perspective, il est finalement bon de remarquer que l’institution indienne des castes prévoit son propre dépassement, pour une infime minorité cependant. Au terme du cheminement spirituel du brahmane, en effet, s’ouvre pour lui la possibilité de renoncer (samnyasin) au monde – à sa famille, sa caste et ses possessions – et de partir en contemplation dans la solitude. Au point de réalisation spirituelle où il se trouve, « il ne voit partout qu’une seule réalité », enseigne la Bhagavad Gita, de sorte qu’il discerne le Divin en tous les êtres sans distinction de nature ou de rang : « celui qui agit semblablement avec un bienfaiteur, un ami, un ennemi, une personne indifférente, l’ami d’un ami, une personne détestable, un familier, un saint, un pécheur, celui-là est réellement le meilleur d’entre les yogin. »
L’Inde pense ainsi positivement deux manières d’être « en-dehors » de la religion, c’est-à-dire du système des castes. Une première façon est de la quitter par le bas, en se situant en-deçà, par « antidogmatisme » athée : c’est l’avarna qui, soustrait aux obligations religieuses, l’est aussi du moindre statut social. Une seconde façon est de la quitter par le haut, en se situant au-delà, de façon « métadogmatique » : ayant pénétré la signification profonde des dogmes et des rites, le sage a pris conscience de l’identité de son être avec le Soi divin et immuable : il est alors en état de renoncer au monde, de devenir un « samnyasin ativarnasrami » qui se consacre exclusivement à la connaissance suprême et à son enseignement, en vivant dans la pauvreté. Un état d’abandon à Dieu que, huit cent ans après Shankara, le christianisme, qui recompose verticalement le sens de la religion en levant le voile sur ses plus saints mystères, érigea en principe universel de toute vie religieuse : alors naquit la grande voie de la charité.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.