Enfant de la Bourgogne, Henri Vincenot (1912-1985) narre dans ses récits la vie de « son pays et de sa race ». Rédigés dans une langue truculente et joyeuse, ses romans semi-autobiographiques La Billebaude et Le Pape des escargots sont imprégnés des rivières, des forêts, des accents et us et coutumes de sa Bourgogne.

Jean Madiran disait de lui qu’il faisait partie de ces « rares hommes qui ont su unir les trois forces vitales : intellectuelle, manuelle et spirituelle ». Comme Gustave Thibon, il appartient à cette race des écrivains-paysans qui ont su mener leur existence la plume dans une main et le bâton de berger dans l’autre. Né à Dijon, il mena une vie de Parisien contre son gré, la maladie de son fils l’obligeant à y vivre. Ce n’est qu’une fois l’âge de la retraite arrivé qu’il retourna dans sa Bourgogne natale, à Commarin, village de cent âmes, où il écrivit la majeure partie de son œuvre. Encore aujourd’hui cantonnée aux rayons régionalistes, sa littérature souffre d’un cruel manque de reconnaissance en dépit de sa portée universelle. La critique de la modernité y est constamment présente. Contre « les technocrates, les sociologues, les politiques, les mercantis et la foule des idoles urbanisés » qui mènent l’assaut contre la vie bourguignonne, Henri Vincenot exprime sa constante volonté de « défendre l’héritage » par la voix de narrateurs incarnant, selon Madiran, « l’antique sagesse paysanne ».
Chez Vincenot, l’attachement à la Bourgogne est tellurique. Il développe dans ses romans une théorie originale selon laquelle le sol bourguignon aurait des vertus particulières et les hommes engendrés par ce sol descendraient des Celtes. Ainsi la langue bourguignonne qui foisonne dans ses romans est imprégnée de mots d’origine gauloise ; même l’abondante moustache de Vincenot se veut celte. La beauté de sa Bourgogne vient de cette union singulière entre les anciennes pratiques païennes celtiques et la culture catholique. Or, c’est contre ce pays aux racines singulières que Paris mène la charge dans ses romans, le jacobinisme uniformisateur imposant aux institueurs le parler de Paris, le parler où l’on ne roule plus les « r » et que l’on bourre d’anglicismes. Ainsi, comme les élèves bretons auxquels il était « défendu de parler breton et de cracher par terre », l’élève bourguignon se voit « rabroué pour avoir écrit : “Le vin du Midi ne vaut pas tripette“, alors qu’il eût fallu dire : “Le vin du Midi est de mauvaise qualité.“ » Et bien souvent, le « rêve de l’instituteur » est atteint puisque les élèves arrivent finalement « à prendre le style administratif », c’est-à-dire la langue de Paris, sans relief et sans accent.
Amitié avec des tailleurs de pierre

Vincenot fait pourtant partie de ces élèves dont la IIIème République décèle l’intelligence et qu’elle souhaite préparer à l’examen des bourses. Mais contrairement à Péguy qui vantait ces « hussards noirs » qui lui avaient tant transmis, lui s’insurge contre cet « écrémage du monde rural de l’artisanat et de l’agriculture qui lui enlevait ses meilleurs éléments dès leur certificat d’études primaires pour les verser à jamais dans le monde de la théorie, pour en faire des administratifs, des bureaucrates ou des hauts théoriciens de tout poil […]. » C’est donc malgré lui que Vincenot va faire partie de cette foule de bons élèves contraints de quitter leur terre natale pour monter à Paris dans le but d’étudier. Cet exode des meilleurs esprits vers la capitale est d’ailleurs devenu un topos dans la littérature de la IIIe République. Dans Les Déracinés, Barrès regrettait également cette émigration de la jeunesse lorraine : « Pauvre Lorraine ! […] Mérite-t-elle qu’ils la quittent ainsi en bloc ? Comme elle sera vidée par leur départ ! […] Quel effort démesuré on lui demande, s’il faut que, dans ses villages et petites villes, elle produise à nouveau des êtres intéressants, après que ses enfants qu’elle avait réussis s’en vont fortifier, comme tous, toujours l’heureux Paris ! »
Henri Vincenot, poussé par ses instituteurs et sa famille, s’engagea pourtant dans cette voie. Il va à Paris faire ses études et travailler. Les narrateurs-auteurs suivent alors un parcours initiatique éminemment barrésien : partis de leur terroir, ils montent à la capitale pour y faire leur éducation et rejoindre les rangs les plus élevés de la société. De là, ils observent ce nouveau monde et forgent une critique acerbe de Paris. Déracinés, ses habitants ne connaissent pas l’authentique beauté, assimilée à du simple folklore : « Une Parigote ne peut pas voir une baraque en ruine sans vouloir en faire une image de catalogue ! » clame Gilbert, le héros du Pape des escargots. Progressistes, ces mêmes Parisiens critiquent la figure du bourgeois sans voir qu’ils en sont précisément à l’avant-garde par leur volonté de tout subvertir : après avoir détruit une exposition d’art contemporain, Gilbert, fils de paysan, est accusé d’avoir usé de tous les « poncifs bourgeois contre l’Art de Progrès » ! Le renversement est total. Ce n’est généralement qu’après une période d’adaptation ratée, pendant laquelle ils ont ressenti le complexe d’infériorité des hommes de la campagne débarqués à la capitale, que la réalité de la supercherie parisienne finit par leur sauter aux yeux. Les forêts et les monts bourguignons finissent par manquer au héros, et le seul endroit de Paris où il se sente bien et en bonne compagnie est finalement le chantier de Notre-Dame, où il se lie d’amitié avec des tailleurs de pierre directement issus des confréries médiévales. C’est ici que la prise de conscience s’opère. Il finit par comprendre, tardivement, que malgré son « exceptionnelle intelligence », jamais il ne pourra s’élever « plus haut que ces maîtres selliers, ces maîtres menuisiers, ces maîtres ferronniers, ces agriculteurs, ces éleveurs, ces piocheurs de vigne, ces torche-bœufs, ces bûcherons qui [l]’entouraient ».
La beauté de la vie rurale

Certes, cette vie dans la compagne bourguignonne est dure. Mais contrairement aux habitants des villes et des usines qui ne vivent « qu’un jour sur sept, le jour de la promenade des bons petits citadins châtrés », les Bourguignons sont libres. En Bourgogne, l’école « a le ciel pour plafond ». Vincenot sait que l’on méprise la vie rurale, tenue pour rustre et sévère, sous-développée, où l’antique paysan est représenté penché sur la terre pendant toute une vie de malheur sans la moindre récompense, sans la moindre considération. « Eh bien, camarades, nous répond Vincenot, vous en serez frustrés […]. Aucun de mes ancêtres, et Dieu sait si j’en avais autour de moi vous le savez, ne m’a jamais parlé de cela. » Quand l’auteur lit pour la première fois Germinal et La Terre d’Émile Zola, classés dans la liste des ouvrages interdits par son grand-père et la censure ecclésiastique, il tombe des nues. Il y découvre un monde qu’il ne connait pas. C’est « de la littérature sale. […] Ce que Zola nous dépeignait était faux. C’était des menteries sales. » Et malheureusement, déplore-t-il, c’est précisément cette littérature qui sert de référence aux jeunes gens qui souhaitent s’informer sur la vie à la campagne et s’en faire une idée juste.
« Certes, déclare-t-il dans une longue tirade, tous ces gens [de la campagne] grattaient la terre, le bois, le fer avec des outils qui semblent bien lourds et bien rudes aux mains des informaticiens et des psychosociologues d’aujourd’hui. Ils mangeaient du lard salé, veillaient à la lueur d’un misérable feu de bûches, chaussaient de vulgaires sabots de bois bourrés de paille, le plus souvent sans chaussettes, mais puis-je gentiment vous affirmer que manier l’outil est une joie, que le sabot est la meilleure, la plus saine et la plus pratique des chaussures, que le pied nu y est plus à l’aise que dans une chaussure fermée, que la sieste du médio [le milieu de la journée, en patois bourguignon] dans la paille de la grange vaut largement la sirène de la reprise du service de l’usine modèle et que la veillée au fond de la cheminée fut un des grands moments de ma vie […]. »
Les vertus bourguignonnes face à la modernité technicienne
Mais les Parisiens ne se contentent pas de rester dans leur ville : Paris s’exporte et apporte en Bourgogne tout le lot des nouvelles idées et des nouvelles techniques qu’exècre Vincenot. L’écrivain-paysan se rend compte qu’en plus de créer des citoyens identiques de Perpignan à Lille, les assauts menés par la République contre les particularismes régionaux ont produit un déracinement dont la fin n’était autre que de « fabriquer des individus de série, capables de s’insérer dans la grande époque de progrès technique, industriel et social ». « À notre insu, continue-t-il, on nous arrachait au singularisme païen, pour nous préparer aux fructueux échanges universels, c’est-à-dire pour pouvoir un jour, tous unis et confondus, nous servir des mêmes barèmes, des mêmes machines et devenir de bons consommateurs inconditionnels se servant des mêmes H.L.M. ! »

Vincenot a grandi dans la première moitié du XXe siècle : il fut un témoin avisé de la fin du monde rural, le monde tel que la Bourgogne l’a connu pendant des siècles et qui se voit perturber par la montée de l’individualisme libéral et l’arrivée des progrès techniques. Teintés de nostalgie, ses romans contiennent de nombreuses descriptions élogieuses des anciennes pratiques de la vie rurale qui semblent aujourd’hui d’un autre temps. L’eau par exemple est régulièrement dépeinte comme une denrée rare, à la limite du sacrée et dont il convient de mesurer toute l’importance.
Lorsque des citadins s’installent à la campagne et se font construire des cabinets de toilettes en porcelaine, des « watère-closettes » selon leurs anglicismes habituels, les habitants de la vallée sont scandalisés. C’était, « à l’époque, gaspillage effroyable ». Gaspillage des excréments d’une part, « qui sont de l’or et qu’il est criminel de laisser perdre » : chacun a en effet son fumier au fond du jardin qu’il convient d’arroser afin que la nature poursuive son cycle. Mais surtout gaspillage de l’eau elle-même, qui se voit souillée par litres à chaque passage aux « watère-closettes ». Ces dernières sont de véritables « usines à eau » où « tout est perdu et tout s’en va on ne sait pas trop où ». Quant à la vaisselle, celle-ci est vite fait quand les hommes sont entre eux, à la chasse, aux champs ou à l’atelier. Après le repas, ils essuient simplement leur assiette avec le quignon de pain et la retournent sur la table en attendant le prochain repas. « Salive vaut lessive », dit le proverbe bourguignon. Ces anecdotes n’ont pas pour Vincenot une simple valeur sentimentale : elles témoignent de la grande transformation qu’ont subie les campagnes françaises au XXe siècle, transformation vécue comme un déracinement.
La technique n’est pas neutre
Mais la plus spectaculaire percée de la modernité se manifeste par l’arrivée brutale du nouvel impératif de croissance, avec l’avènement conjoint des progrès techniques et de son corollaire, la nouvelle organisation du travail. Lorsque les paysans de la vallée, les uns après les autres, achètent une moissonneuse-batteuse, le vieux colporteur de nouvelles, qui a vu l’arrivée des premières usines dans la région, comprend toutes les implications économiques d’un tel changement :
– Tu n’as pas compris, Beuzenot, que chaque fois qu’un croquant achète une machine Cormick ça tue dix faucheurs ?
– Ça supprime leur peine, Gazette, mais ça ne les tue pas ; c’est eux qui conduiront la Cormick. […]
– Un seul conduira la Cormick ! mais les neuf autres ? hein ? Qu’est-ce qu’ils feront les neuf autres ? Tu veux que je te le dise ? Ils iront à Dijon, à Paris, esclaves dans les usines ! Et les villages deviendront vides comme des coquilles d’escargots gelés.
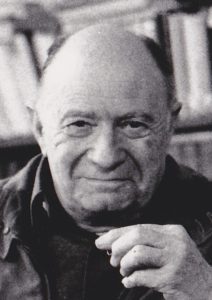
Comme le philosophe Jacques Ellul, Vincenot estime que la technique n’est pas neutre et se paie toujours d’un renoncement. « Il n’y a pas de progrès technique absolu, écrivait l’universitaire bordelais dans Le Bluff technologique. À chaque avancée de la technique, nous pouvons en même temps mesurer un certain nombre de reculs. » Tout progrès technique se paie donc à un prix qui demeure difficilement estimable et quantifiable. Henri Vincenot n’est pas candide, il ne considère pas tout « progrès matériel comme un don du ciel », selon le mot de Simone Weil, et en voit même toutes les potentialités destructrices. En son temps déjà, après avoir lu la nouvelle d’Alphonse Daudet Le Secret de maître Cornille dans laquelle est justement décrit le bouleversement causé par l’arrivée des minoteries industrielles en Provence, le poète Mistral s’écria : « Quel est l’artiste, le poète ou l’honnête homme qui, dans ce joli siècle de démocratie progressiste, n’est pas un peu démoli par les minoteries à vapeur ! » Vincenot éprouve le même sentiment avec la moissonneuse-batteuse, qui constitue pour lui ce que fut la minoterie à vapeur pour Alphonse Daudet.
La dégradation des liens communautaires
Toutes ces transformations entraînent donc des conséquences, notamment anthropologiques. Les relations entre les générations se détériorent, tout comme les liens communautaires. Auparavant, « la famille assumait alors toutes ses responsabilités. » Désormais, les nouvelles générations ne sont plus solidaires ni des antiques traditions, ni des aînés qui toujours pouvaient compter sur leur dévotion une fois l’âge de la vieillesse arrivé. Lors de la fête de la Saint Jean, les jeunes générations font preuve d’une désinvolture déconcertante. Ils ne se préoccupent plus « de ces histoires périmées. On allait bientôt tous avoir une faucheuse mécanique : trois soitures en un quart d’heure ! Au diable toutes ces vieilles superstitions de lune et de soleil ! Le progrès allait vous balayer cela de la belle façon ! C’était la fin des ténèbres ! Une ère lumineuse s’annonçait, où tout, oui “tout“, allait se faire mécaniquement ! »
La modernité n’épargne donc personne. La Bourgogne se voit envahie de prospecteurs parisiens qui souhaitent construire des centres thermaux ou des hôtels. Les traditions bourguignonnes se voient rabaissées au simple rang de folklore, uniquement bonnes à faire la une des magazines d’histoire ou de décoration. Les citadins affluent en masse afin de fuir les grandes villes, en apportant avec eux les nouvelles mœurs urbaines et dénigrant malgré eux la culture locale. Les romans de Vincenot sont un cri lancé contre l’avènement de ce nouveau monde. Dès 1978, le héros de La Billebaude clame : « Halte à la technique ! Halte à la croissance ! »
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
