Chacun connaît le philosophe néo-thomiste Jacques Maritain. Mais peu ont entendu parler de son épouse, Raïssa Maritain. Son ouvrage autobiographique Les Grandes amitiés (1941) raconte leur vie parisienne au cœur d’un cénacle d’intellectuels dans les années précédant la Grande guerre. Mais plus qu’un simple tableau dépeignant ses amitiés, cette autobiographie narre sa longue quête de la vérité.
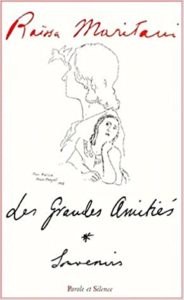
En 1893, la famille Oumansoff se voit contrainte de fuir la Russie tsariste et de s’installer en France à cause de la persécution antisémite qu’elle subit. La jeune Raïssa a alors dix ans. C’est à Paris que la jeune fille va développer son goût pour la beauté et la vérité. Excellente élève, la découverte de la poésie classique française la plonge dans un univers de beauté qu’elle avoue n’avoir pas connu en Russie. La lecture de Racine est pour elle une illumination. Elle réalise que les vers du dramaturge classique ne tirent pas leur beauté uniquement de « l’harmonie et [de] la musique des mots soumis aux règles mystérieuses de la rime et du rythme », mais surtout de « la valeur des mots en eux-même, non plus en tant que signes de la réalité, mais en tant qu’objets ayant leur forme propre, leur musique et leur magie ». Mais plus que la littérature française, c’est la lente découverte de la philosophie qui constitue pour Raïssa une révélation.
Elle fait tout d’abord le choix de s’inscrire en licence de sciences naturelles à la Sorbonne ; Raïssa a dix-sept ans, le XXe siècle commence tout juste. La jeune fille n’est alors pas encore mue par un appétit débordant de connaissances : tout juste veut-elle pouvoir « justifier l’existence », ce qui lui paraît le minimum nécessaire afin que « la vie humaine ne soit pas une chose cruelle et absurde. » Or, confie-t-elle, « philosophie et religion, conduite de la vie privée, structure des sociétés, je croyais que tout dépendait des découvertes des sciences naturelles et physiques ». C’est à la faculté des sciences que Raïssa fait la rencontre la plus décisive de sa vie en la personne d’un jeune homme déjà licencié en philosophie : Jacques Maritain. Celui qu’elle appela très vite « le plus grand de mes amis » l’introduisit auprès de son cercle d’amis dont les noms sont aujourd’hui restés dans les mémoires : Ernest Psichari, qui est comme un frère pour Jacques Maritain, et surtout Charles Péguy à qui ils vont régulièrement rendre visite dans sa boutique des Cahiers de la Quinzaine située juste en face de la Sorbonne, dans le Quartier latin. Retiré dans sa boutique, Péguy mène alors la guerre contre la Sorbonne qu’il considère comme la « citadelle des erreurs du monde moderne ». Raïssa Maritain considère même ce conflit entre Péguy et la Sorbonne comme « l’un des plus importants évènements spirituels de la France avant la Première Guerre mondiale. » Pour tout ce groupe de jeunes gens, Péguy, leur aîné, fait figure de maître.
La vacuité de la philosophie matérialiste de la Sorbonne
Brillants élèves, Raïssa et Jacques sont tous deux appelés par leur professeur, Félix le Dantec, à un grand avenir scientifique. Mais de plus en plus cet avenir leur paraît illusoire. À quoi bon connaître toute la réalité de la matière vivante si la substance même de l’être et de l’univers restent insondables et inaccessibles ? Les sciences naturelles ne leur donnent pas pleine satisfaction. Ils suivent alors régulièrement les cours de philosophie de la Sorbonne, mais ceux-ci également leur laissent une amère impression. Emplis de questions essentielles, les deux étudiants se retrouvent face à des professeurs qui ne croient pas à la vérité et professent le scientisme le plus borné. Or, comme le relève Maritain, « le scientisme impose à l’intelligence la loi même du matérialisme : cela seul est intelligible qui est vérifiable matériellement ». À toutes leurs questions métaphysiques, leurs professeurs se dérobent et arguent de l’inaccessibilité de l’esprit humain à de telles choses. « Philosophes, nos maîtres à vrai dire désespéraient de la philosophie », déplore Raïssa Maritain.
Les cours de philosophie se réduisent finalement à des cours d’histoire de la pensée. Le mot même de « vérité » déplaît aux professeurs, qui ne le prononcent, plein d’ironie, « qu’avec les guillemets d’un sourire désabusé. » Pour Raïssa Maritain, la conclusion est sans appel : « La seule leçon pratique qu’on pouvait recevoir en définitive de leur enseignement consciencieux et désintéressé était une leçon de relativisme intégral, de scepticisme intellectuel ; et si l’on était logique, de nihilisme moral. » Si l’on ne peut définitivement pas atteindre la vérité, alors ne peut que subsister l’atroce conscience de l’absurde. Raïssa Maritain a des mots terribles face à ce sentiment d’angoisse que lui procure la non-compréhension de l’être. Pour elle, « en aucun cas l’état des choses n’est acceptable sans une lumière vraie sur l’existence. Si une telle lumière est impossible, l’existence aussi est impossible […] ». Raïssa et Jacques se donnent alors un sursis tragique : s’il n’est pas possible d’en savoir plus, la seule solution reste le suicide. « Nous voulions mourir par un libre refus s’il était impossible de vivre selon la vérité. » Ils décident de faire « crédit à l’existence » pendant quelques temps ; s’ils ne trouvent pas de réponse, ils se donneront la mort.
Une première « idée de la vérité » dans la philosophie bergsonienne
C’est finalement dans le bâtiment en face de la Sorbonne qu’ils réussiront à trouver un début de délivrance. Henri Berson, alors professeur au Collège de France, attire les foules. C’est lui qui parviendra à leur transmettre une première « idée de la vérité ». Et c’est leur ami Charles Péguy qui les fit traverser la rue pour suivre ses cours ; dans son combat acharné contre la Sorbonne, il sut reconnaître la portée subversive qu’apportait l’enseignement de Bersgon qui rompait avec les canons du relativisme et du scientisme. Le philosophe est alors au sommet de sa renommée, puisque ses deux œuvres principales, l’Essai sur les données immédiates de la conscience (1889) et Matière et mémoire (1896) sont publiées. Raïssa assiste à ses cours avec son trio habituel : Jacques Maritain, Ernest Psichari et Charles Péguy. Les jeunes gens retrouvent également dans la salle le penseur du syndicalisme révolutionnaire George Sorel ou encore la poétesse Anna de Noailles.

Le professeur au Collège de France leur enseigne alors la chose essentielle qui tiraillait tant Jacques et Raïssa : la faculté spirituelle de l’homme à connaître. Bergson appelle cela l’intuition. Certes, il dénie à l’intelligence « tout pouvoir authentique d’appréhender le réel », selon le mot Raïssa Maritain. Mais il permet au moins à la jeune fille en quête de vérité de dissiper les théories positivistes de ses professeurs de la Sorbonne et de lui rendre « la possibilité même du travail métaphysique ». Quelques années plus tard, dans sa pleine maturité philosophique, le futur époux de Raïssa Oumansoff élaborera une critique acerbe de la philosophie bergsonienne. Mais en attendant, c’est pour eux une illumination qui met fin à toute idée de mort et provoque même chez Raïssa une extase à la seule entente du mot « vérité » qu’elle a tant recherché : « Au seul énoncé du mot vérité mon cœur tressaillait d’enthousiasme. La beauté de ce mot brillait à mes yeux comme un soleil spirituel opposé à toutes les ténèbres — celles de l’ignorance, celles de l’erreur, celles du mensonge, celles même de l’iniquité qui est une erreur de mesure et un mensonge. Connaître la vérité. Pléonasme. »
Mais très vite, cette soif de vérité franchit un nouveau stade dans l’esprit de Raïssa Maritain. Si elle apprend avec Bergson à appréhender la vérité, elle n’a pas encore la possibilité de déterminer la portée d’une telle assertion ; le philosophe lui a simplement donné une « idée de la vérité ». La rencontre la plus décisive en la matière se fera en la personne d’un vieil écrivain criblé par les dettes vivant reclus avec sa femme à Montmartre : Léon Bloy. Jacques et Raïssa, qui sont tout justes fiancés, font personnellement sa connaissance en 1904 après lui avoir écrit pour le féliciter pour son roman La Femme pauvre. Raïssa Maritain a des mots très touchants pour parler de lui, des mots contrastants fort avec la violence de ses écrits. Plutôt que le portrait d’un féroce pamphlétaire, elle livre la description d’un homme doux et bon qui leur fait humblement le don de son amitié : « Il n’y a pas d’outrecuidance dans le fait d’espérer mon amitié, lui écrit-il. Si vous êtes des âmes vivantes, comme je le suppose, le vieil homme douloureux que je suis vous aime déjà et sera content de vous voir. »
L’aboutissement dans la conversion au catholicisme
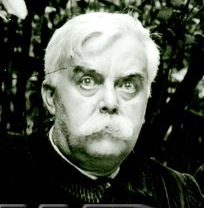
Léon Bloy est revenu à la foi catholique depuis quasiment trente ans et fait preuve d’une foi exaltée et intransigeante. Il ne se prive pas de parler de Dieu à la jeune fille, de la présenter à des amis catholiques, dont le peintre Georges Rouault, et de la confier à ses prières et à la Vierge Marie lors de ses pèlerinages. Raïssa Maritain ne croit alors pas en Dieu et a perdu depuis longtemps la foi de son enfance ; pour autant, la philosophie, l’art et la littérature ont éveillé chez elle le sens du surnaturel. Elle est touchée par la dimension éminemment spirituelle des dialogues de Platon et confie avoir eu une première intuition de Dieu, « violente et fugitive », à la lecture de Plotin. Mais c’est l’épreuve de la maladie qui la décidera à s’abandonner aux mains de Dieu.
Huit mois après sa rencontre avec Léon Bloy, en 1906, la jeune femme tombe gravement malade. Le pamphlétaire lui écrit alors : « ce matin, à la messe de l’aube, j’ai pleuré pour vous, mon amie. […] Vous êtes grandement aimée, surnaturellement chérie. Écoutez-moi. Vous serez guérie et vous connaîtrez des joies immenses. » Quelques jours plus tard, Raïssa guérissait. Cette dure épreuve dans laquelle furent plongés Raïssa et son fiancé est l’évènement qui déclenche chez eux un abandon total à la volonté divine. Ils se font baptiser le 11 juin 1906 et prennent tous deux Léon Bloy comme parrain. Le vieil écrivain exulte. C’est à la même période que Charles Péguy retrouve la foi de son enfance. Lorsque Jacques Maritain lui raconte sa conversion, le directeur des Cahiers de la quinzaine s’écrie alors « Moi aussi j’en suis là ! » — on connaît toutefois la complexité de sa conversion et sa difficulté à accepter les sacrements, ce qui provoquera des débats houleux entre les deux hommes. Pour Raïssa Maritain cette conversion est l’aboutissement de sa recherche de la vérité et le lent commencement de l’appropriation de sa foi nouvelle. Pour son mari, elle signe le début de l’élaboration de son œuvre philosophique néo-thomiste.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
