Joseph-Arthur de Gobineau (1816-1882) est l’écrivain maudit de la littérature française. Ignoré de son vivant, quand il n’était pas moqué, il a rencontré un succès posthume considérable en Allemagne au début du XXe siècle, ce qui lui a valu plus tard la triste réputation d’inspirateur du racisme et du nazisme. Or, comme le disait Hubert Juin, peu suspect de sympathies droitistes, « Gobineau n’est pas “raciste”. C’est un nostalgique, pour qui l’Âge d’Or est dans le passé, et la catastrophe dans l’avenir ». Jacques Bressler, historien et romancier, diplômé de philosophie et déjà auteur d’une biographie de Gobineau (Pardès, 2018) nous livre des clefs de réponse dans son étude intitulée Lire Gobineau aujourd’hui (PGDR, 2019).
P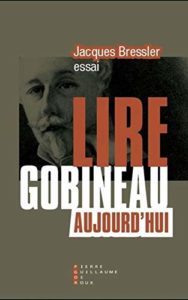 HILITT : Pourquoi lire Gobineau aujourd’hui ? Quel écho sa pensée trouve-t-elle de nos jours ?
HILITT : Pourquoi lire Gobineau aujourd’hui ? Quel écho sa pensée trouve-t-elle de nos jours ?
Jacques Bressler : J’ai souhaité présenter aux lecteurs le visionnaire qu’était Gobineau, c’est la raison pour laquelle il est intéressant de le relire aujourd’hui. Les événements actuels[1] qui portent sur des revendications identitaires fondées sur une appartenance ethnique sont d’ailleurs une illustration éclairante de la pensée de Gobineau, nous pouvons même dire qu’il les a anticipés. Ce caractère visionnaire a été remarqué assez tôt car dès 1905, Robert Dreyfus parlait des « prophéties de Gobineau » dans la publication des conférences qu’il lui a consacrées dans la sixième série des Cahiers de la Quinzaine.
Gobineau a vécu à une époque où l’Europe atteignait son point culminant dans le rôle civilisateur qu’elle souhaitait jouer et faisait des progrès considérables aux niveaux techniques et scientifiques. Elle exerçait sa domination et son influence sur le monde, y compris sur les jeunes États-Unis. Le destin de la civilisation européenne se présentait alors sous les meilleurs auspices. Dans ce contexte favorable pour l’Occident, Gobineau a pourtant, le premier, pensé et théorisé le déclin de cette civilisation, bien avant Oswald Spengler, et c’est une réflexion qui rencontre de nos jours beaucoup d’écho chez les Européens.
Il avait des mots très durs pour l’Occident qui, selon lui, était déjà en proie à la « dégénérescence », pour reprendre sa propre expression. Mais son originalité consiste surtout en ce qu’il raisonne en termes d’hérédité. Il explique, dans son œuvre, ce processus dégénératif par le métissage des populations, depuis l’Antiquité la plus reculée, et notamment par le mélange entre les peuples germano-nordiques, qu’il nomme les Arians (et qui deviendront les Aryens au XXe siècle) et les peuples méditerranéens. Pour lui, ce mélange est le moteur de l’histoire mais aussi le début de la fin : l’influence nordique, à l’origine d’une civilisation brillante, aurait été contrebalancée par l’influence délétère des civilisations méditerranéennes et gréco-latines, qu’il admirait mais qu’il ne mettait pas sur le même plan. Et il savait, au moment où il écrivait l’Essai sur l’inégalité des races humaines, de 1853 à 1855, que l’Europe, qui se lançait dans l’aventure coloniale, serait confrontée à des mélanges avec d’autres civilisations et à des phénomènes migratoires. C’est ce qu’il appelle « l’amalgame ethnique ».

Il faut préciser à ce stade que Gobineau était un homme profondément pessimiste ; ce sentiment habitait sa pensée, il était fondamental. Pour le citer, il prédisait que, dans un futur proche, « les nations, non les troupeaux humains, accablés sous une morne somnolence, vivront alors engourdis dans leur nullité, comme les buffles ruminants dans les flaques stagnantes des marais Pontins ». Aujourd’hui, il est légitime de se demander si nous ne sommes pas devenus des pessimistes gobiniens, sans le savoir.
Ce pessimisme est justement ce que met bien en valeur votre ouvrage : Gobineau ne voit aucune échappatoire à cette décadence, il se résout à voir disparaître cette « race ariane » et ses valeurs. En cela, il n’est pas réactionnaire car rien ne peut, dans sa pensée, s’opposer à la marche de l’Histoire : les Arians sont dès le départ condamnés à décliner du fait de ces mélanges inéluctables.
En effet et c’est ce qui est regrettable, dans un certain sens, car son pessimisme a choqué nombre de ses lecteurs. Si ces derniers se retrouvaient dans son analyse des causes de la décadence progressive de l’Europe, ils n’étaient pas d’accord sur les moyens d’agir. Un tel degré de pessimisme semble exagéré pour maints lecteurs français, qui ne voient pas la vie de la collectivité comme un héritage purement biologique. Les Français se conçoivent souvent comme de purs esprits et refusent le déterminisme de l’hérédité. Pour Gobineau, au contraire, tous les mouvements sociaux et politiques, les révolutions, les législations diverses ne changeront rien au destin de la civilisation. C’est une des raisons pour lesquelles il est si difficile aujourd’hui de le lire et cela explique le peu d’intérêt qu’il a suscité en France, contrairement à l’Allemagne ou à l’Amérique.
C’est ce qui a provoqué sa rupture, du moins intellectuelle, avec son ami le libéral Tocqueville, qui avait des idéaux plus progressistes et qui croyait en la « perfectibilité indéfinie de l’homme ».
Tout à fait. Quand on lit leur correspondance, on se rend compte que ces deux esprits s’opposent diamétralement. Tocqueville est un idéaliste, un universaliste, qui pense, en homme du XIXe siècle, que, certes, les races ne sont pas égales mais qu’elles pourront à terme se rejoindre ; il croit au progrès par l’éducation des peuples moins favorisés. Tout le contraire donc de Gobineau.
Gobineau est d’un caractère foncièrement aristocrate, même s’il ne l’était pas réellement dans les faits[2]. Il porte ainsi un regard méprisant sur la société bourgeoise et louis-philipparde de son temps qu’il n’aime pas, celle du « Enrichissez-vous ». Est-ce un antimoderne ?
C’est un antimoderne qui croit en la science ; il voudrait que l’Histoire entre dans la famille des sciences naturelles. Il déteste l’égalitarisme moderne, qui est une évolution de l’esprit des Lumières. Il est également opposé au cosmopolitisme des villes et au mélange de populations qui s’y produit. C’est à ce titre qu’il finit par déserter Paris pour Rome où il tiendra un atelier de sculpture vers la fin de sa vie.
C’est l’ennemi de la puissance de l’argent, il vitupère « une société qui n’est plus rien que par l’esprit et qui n’a plus de cœur ». Pour lui, l’homme qui vit pour la satisfaction des besoins est incomplet. Il privilégie donc les hommes d’élite, qu’il appelle « fils de rois ». Peut-on dresser dans ce sens une certaine parenté avec des auteurs comme Péguy ou Bloy ?
En effet, Péguy s’est intéressé à lui[3] et Gobineau a entretenu une correspondance avec Bloy, qu’il a d’ailleurs soutenu financièrement. Ce mépris de l’argent, de l’essor des puissances commerciales et industrielles est un aspect de Gobineau qu’on connaît encore assez mal. Il ne croit plus dans le mérite ni la prééminence de l’ancienne aristocratie. Il croit davantage aux « fils de rois » : dans son esprit, ce sont des êtres supérieurs, qui ont hérité de leurs lointains ancêtres arians un atavisme favorable (ce qui n’est d’ailleurs pas impossible ; Gobineau ne connaissait pas les lois de Mendel mais le caractère récessif de l’hérédité a été depuis démontré). Ils se singularisent donc par leur indépendance d’esprit et par le fait que les obsessions de l’époque, pour l’argent par exemple, les laissent totalement indifférents. Cela montre que Gobineau pouvait faire preuve parfois d’optimisme. S’il a prédit, dans l’Essai, l’effondrement des civilisations, il revient, dans son roman Les Pléiades (où il développe ce concept de « fils de rois ») sur ce qu’il appelle la persistance ethnique, à savoir le fait que des caractères magnifiques et royaux peuvent réémerger au bout d’un certain temps. Les fils de rois se reconnaissent entre eux car ils sont d’une même étoffe, ils constituent donc une nouvelle élite, qui remplace l’ancienne aristocratie. C’est finalement un aspect encourageant dans sa philosophie.
Il porte également un regard sévère sur sa patrie et dénonce, dans Ce qui est arrivé à la France en 1870, le centralisme extrême, la médiocrité de l’éducation, la bureaucratie, la toute-puissance du capital. Ce sont des problématiques, là encore, très actuelles.
Il est impitoyable pour son pays, ce qui lui a été difficilement pardonné. Mais il dit néanmoins des choses justes et le langage gobinien sur la France est toujours actuel. Il s’inscrit en cela dans une certaine tradition : les Français sont à la fois assez arrogants et extrêmement critiques à l’égard de leur pays et Gobineau ne fait pas exception à la règle.
Il a aimé le Second Empire, a soutenu Napoléon III mais a été profondément choqué par la défaite de 1870. Il a dénoncé la centralisation extrême, lui qui ne jurait que par l’indépendance des provinces, ce qui était assez courageux à l’époque. La nullité, comme il l’appelle, de l’administration, la mauvaise gestion des fonctionnaires de son temps sont vigoureusement condamnés sous sa plume. Peut-on dire qu’il aimait trop son pays, raison pour laquelle il se révoltait contre ses défauts les plus criants ? Il faut dire qu’il a vécu les révolutions de 1830 et 1848, la défaite de 1870 et la Commune de 1871 ; il avait l’impression que la situation ne s’arrangerait jamais et que la France serait toujours la victime des révolutions et des mouvements de violence radicale.
Gobineau est aussi un diplomate : il a été en poste en Suisse, en Iran, en Suède, au Brésil…, il a écrit des récits de voyage comme Trois ans en Asie. Son amour de l’Asie, qu’il considère comme la terre antique, la mère des sciences et des religions, est là encore méconnu. Cet attrait passionné pour l’Orient fait-il de lui un romantique tardif ?
Son esprit romantique ne fait aucun doute. Dans sa jeunesse, il a été initié aux langues orientales, alors qu’il vivait encore en Suisse avec sa mère. Il a lu très tôt les Mille et une Nuits, ce qui l’a initié à cette passion pour l’Orient. Il a commencé sa carrière de diplomate en 1849 en devenant premier secrétaire de la légation de France à Berne, puis s’est très rapidement rendu en Perse, dès 1854. Il a relaté son long voyage, sur mer puis en caravane, dans Trois ans en Asie, qui est sans doute son ouvrage le plus beau. Il est indéniable que sa période orientale a été le meilleur moment de sa vie.

S’il ne s’est pas vraiment expliqué sur les origines de cet intérêt, ce dernier ne s’est jamais démenti. Gobineau, qui était un travailleur acharné, a appris le persan, a entrepris des lectures de la philosophie orientale très poussées, a lu tous les indianistes et tous les orientalistes, et portait une admiration sans bornes à l’Orient antique, celui de l’invention de l’écriture (la fameuse écriture cunéiforme des Sumériens, au sujet de laquelle il a composé deux ouvrages qui ont été moqués en son temps[4]), celui des Phéniciens et des Grecs.
Il était à contre-courant des jugements de son époque et pensait que moderniser l’Orient ne pourrait que provoquer des conflits, la culture et la richesse orientales ne justifiant pas l’aventure coloniale de l’Occident. Était-il un anticolonialiste précoce ?
Oui. Gobineau avait d’ailleurs prévenu ses contemporains : la colonisation provoquerait tôt ou tard une réaction négative et c’est ce qui est arrivé. C’est ainsi que les Anglais se firent détester en Iran, qui s’est révolté contre l’Occident. Il a annoncé la révolution islamique dans un livre remarquable intitulé Les Religions et philosophies dans l’Asie centrale et a condamné la façon dont les Occidentaux ont voulu moderniser l’Iran, même si les Iraniens n’étaient pas fondamentalement contre l’adoption de ces nouvelles techniques qui ont quand même fait progresser l’humanité. Dans la droite ligne de sa philosophie, il estimait que les interventions des Occidentaux, en Iran ou en Égypte par exemple, ne pouvaient que déstabiliser ces populations.
Ses autres positions, notamment sur l’esclavage, le génocide des Indiens d’Amérique ou encore l’antisémitisme, prenaient là aussi le contrepied de ce qui était alors communément admis.
Le comportement des Américains à l’égard des autochtones lui a paru à la fois inévitable et monstrueux. Il a reconnu qu’un génocide des Indiens d’Amérique du Nord s’est perpétré et a, à ce titre, repris de manière virulente tous ceux qui, en Amérique, pensaient que les thèses exposées dans l’Essai sur l’inégalité des races humaines « justifiaient » en un sens de massacrer les Indiens et de maltraiter les esclaves noirs. S’il jugeait que les mélanges entre les civilisations différentes ne sont pas bénéfiques, il ne disait pas pour autant que les civilisations dites supérieures dussent opprimer les inférieures.
L’œuvre maîtresse de Gobineau, celle qui a scellé sa réputation, est l’Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855). Quelle en est sa genèse et dans quelle mesure cet ouvrage a-t-il influencé la suite de son œuvre littéraire, philosophique et historique ?
Il a médité cet ouvrage pendant un laps de temps assez long. Dans les années 1845-47, il a réfléchi sur ce thème et compulsé un nombre incalculable d’ouvrages à la bibliothèque Mazarine. Sa réflexion dépassait cependant la simple « inégalité des races » qui était une opinion très partagée à son époque, que l’on pense par exemple à Jules Ferry, à l’aspect civilisateur de la colonisation et à sa tirade sur le droit des races supérieures sur les inférieures. Le titre peut donc être dans un certain sens trompeur ou du moins incomplet car en effet, le grand thème de l’Essai est que les civilisations sont mortelles ; il l’a dit bien avant Paul Valéry. Elles naissent quand une certaine homogénéité ethnique préside à l’établissement d’une population ou d’une certaine partie d’une population, comme on peut le remarquer par exemple chez les Incas dont quelques familles seulement sont à l’origine d’une grande civilisation. Il pensait qu’il y a une spécificité ethnique, on dirait aujourd’hui génétique, dans l’émergence d’une civilisation, qui ne tombe jamais du ciel.
Gobineau ne croyait pas en la théorie des climats comme facteur de cette apparition, ni même en l’action providentielle et positive d’hommes de valeur qui serait capables de poser les bases de toute une culture. La civilisation n’est donc pas due à un homme, une institution ou à un climat favorable mais plutôt à la présence d’un groupe humain ethniquement homogène à même de produire une fulgurance, un développement prodigieux qui entraîne une floraison philosophique, littéraire, militaire… On le voit chez les Grecs par exemple. Bien qu’ils ne surgissent pas ex nihilo, ils sont doués d’une certaine aptitude originelle.
Les civilisations naissent, atteignent ensuite leur apogée, puis déclinent. Comme dit plus haut, ce déclin survient lorsqu’une civilisation supérieure arrive, par son expansion intellectuelle et physique, au contact d’autres civilisations moins douées. Elle se mélange à elles et finit par s’épuiser dans son effort consistant à dominer ses voisins.
L’Essai montre notamment l’émergence des civilisations méditerranéennes (les empires égyptien, assyrien, phénicien…) puis celle des tribus arianes du Caucase, dans les steppes d’Asie centrale. Il en décrit l’histoire, leurs invasions, leurs mouvements vers l’est (en Inde) et l’ouest (de la Scandinavie jusqu’en Grèce). Pour lui, les Grecs sont les héritiers des Hellènes, c’est-à-dire des peuples nordiques achéens, donc Arians, de langue indo-européenne et qui sont descendus des Balkans. La Grèce est le résultat quasi miraculeux de la rencontre entre l’esprit méditerranéen des îles grecques et des Arians nordiques.

En mettant l’accent sur les causes biologiques du déclin des civilisations, il s’inscrit en faux par rapport aux préceptes de la religion chrétienne sur le péché et la corruption des mœurs. Quel est son rapport à la religion ?
Les relations entre Gobineau et la religion sont complexes. Il était peut-être croyant mais ne pratiquait pas sa religion et était assez distant vis-à-vis des préceptes chrétiens.
Tocqueville lui a reproché son manque de foi et de charité et a critiqué son matérialisme. Cependant, Gobineau était prudent et s’attachait à ne pas froisser l’Église, qui était encore à l’époque toute-puissante. Il pensait que l’être humain est apparu depuis plus longtemps que ce qu’estime la Bible et s’il parle d’une arrivée de l’Homme sur Terre il y a 7 000 ans, c’est simplement pour respecter les croyances de l’Église et ne pas la choquer. La raison en est simple : il souhaitait que son livre sortît et craignait d’être mis à l’index. Il a donc fait cette concession à l’Église. Cela ne l’empêchait pas malgré tout de se tromper sur la date de l’apparition de l’homme préhistorique, mais il faut rappeler qu’à cette époque, la paléoanthropologie était une science nouvelle[5] et les premiers fossiles étaient à peine découverts. S’il avait pu anticiper sur ces découvertes, Gobineau aurait triomphé, car la paléoanthropologie montre qu’il a existé plusieurs espèces humaines. Il aurait eu beau jeu de dire ensuite que l’homme n’est pas unique mais constitué de familles différentes, ce qui est un thème gobinien important. Lire Gobineau aujourd’hui, c’est aussi regarder les thèmes gobiniens à la lumière de la paléoanthropologie moderne.
Comment définir son concept de race ariane ? Qui sont les Arians ? On y dénote quelques paradoxes : les Arians sont une civilisation supérieure selon lui, mais elle reste fruste et utilitaire, car étrangère aux préoccupations artistiques, à la spiritualité, contrairement aux civilisations sémites ou chamites. Il formule aussi beaucoup de critères esthétiques, donc forcément subjectifs.
Il est très précis sur ce peuple ; pour lui, l’Arian est l’homme honorable. Dès le départ, il lui donne une supériorité morale. Les Arians le montreront en Inde quand ils fonderont le brahmanisme, philosophie de caste (les prêtres étant au-dessus des guerriers), qui préserve du métissage. En Europe du nord et dans le Caucase, ce sont des hommes qui ont le culte de l’honneur, ce qui est fondamental chez eux. C’est ce qui les distingue des Sémites du sud, qui sont leur opposé (il dit ainsi, dans un passage d’une ironie assez drôle de l’Essai, que les Romains seraient prêts à vendre leurs femmes, leurs filles, leurs voisins, ce qui serait inconcevable pour un Arian) et dont le caractère « blanc » a été très dilué du fait de mélanges avec les populations noires. Pour Gobineau, l’élément blanc constitue une « race mâle », alors que l’élément noir constitue une « race femelle ». Pour illustrer cette opposition, il prend en exemple l’Iliade et met face à face l’honneur du béotien et énergique Achille, le guerrier arian, à la ruse d’Ulysse, le Sémite artiste. Il reconnaît tout à fait que les Arians ne sont pas des artistes, qui est une qualité dévolue aux Sémites, et que faire du seul honneur une règle de vie en société peut être nuisible. Mais l’Arian n’est pas pour autant rudimentaire, d’autant plus qu’il se distingue par la beauté de son corps, sa blondeur et ses yeux bleus, ce qui est une mutation génétique relativement récente.

Ce qu’il admire chez eux, c’est leur vitalité, qui les pousse à une supériorité technique et militaire alors que les Sémites du bassin méditerranéen se contentaient de commercer. Pour nourrir son argumentation, il s’appuie sur la partition de l’Europe à son époque, entre une Europe du sud, plus pauvre et moins industrialisée, et une Europe du nord riche, entreprenante, qui s’est modernisée très tôt et qui est l’héritière des peuples germaniques, donc des Arians. C’est d’ailleurs toujours peu ou prou le cas. Il reconnaît que cette vitalité est à la fois peu et beaucoup : les hommes du Nord ne sont pas agréables à fréquenter, ils sont froids, austères et égoïstes. Leurs œuvres d’art ne sont guère remarquables. Il les a même qualifiés de « polichinelles ». Mais ils sont faits pour dominer le monde. Pour lui, l’Amérique du Nord et l’Angleterre étaient les refuges des Arians : les Anglo-Saxons ont mieux résisté à l’influence méditerranéenne que les Gallo-Romains par exemple.
Finalement, la politique, les institutions, les victoires ou défaites militaires etc. n’ont pas d’importance car ce sont des accidents de parcours. Seule la vitalité demeure.
Si le métissage provoque un appauvrissement génétique mais aussi linguistique, le fait de rester dans un groupe homogène génétiquement n’est pas forcément facteur de force et de progrès, et Gobineau donne l’exemple des Aborigènes d’Australie. En va-t-il de même des Arians ?
Gobineau ne dit pas que l’homogénéité ethnique est productrice de civilisations. Il dit qu’il faut un ferment génétique, une spécificité qui va faire jaillir une civilisation, chose qui a manqué aux Aborigènes. L’homogénéité n’est pas la condition première mais seconde. La civilisation égyptienne, par exemple, s’est développée dans la vallée du Nil, il s’agissait d’une seule ethnie, dans une vallée où vivaient des individus semblables qui parlaient le même langage.

On pourrait objecter que la civilisation française a émergé alors qu’elle était déjà mélangée. Mais pour lui, il existe une préséance d’un groupe ethnique : c’est l’influence ariane, germanique, issue des Francs, et qui sera évidente au Moyen-Âge. La féodalité en est l’héritage ; le mot est d’ailleurs issu du gotique faihu (qui appartenait à la branche germanique des langues indo-européennes). Mais la culture française est un agrégat d’apport germanique et romain et sa spécificité ethnique a beaucoup évolué, contrairement au Japon par exemple dont la population est restée au fil du temps très homogène.
Autre paradoxe apparent : les Arians n’acquerront de sensibilité spirituelle et artistique qu’au contact des civilisations sémites, par métissage. Ne peut-on pas affirmer que le métissage est donc souhaitable, malgré ce qu’en dit Gobineau ?
On peine à trouver des exemples dans son œuvre. Gobineau cite le Japon, dont le peuple, qui est nationaliste, ne s’est pas métissé. Quel peuple souhaiterait se transformer complétement pour s’améliorer ? C’est en effet une contradiction de Gobineau. Il nous annonce des catastrophes dues au métissage mais il constate qu’au fond, les groupes humains n’osent pas tellement se mélanger. Il n’évoque que les civilisations en expansion, ce sont elles qui se métissent. Un autre exemple : la civilisation égyptienne a été peu expansionniste, elle a conquis peu de territoire et sa chute est surtout venue de l’invasion des peuples de la mer, Romains compris. L’idéal d’une civilisation, pour Gobineau, est de faire le vide autour d’elle.
On pourrait pourtant en identifier un exemple : les Germains ont régénéré l’empire romain (déjà métissé de base selon les critères de Gobineau) et les deux peuples y ont trouvé leur avantage.
On pourrait penser que les Germains, qui ont été taxés à tort de barbares, ont gagné quelque chose au contact de l’esprit latin, mais ce n’est pas la conception de Gobineau. Le mélange qui se produisit sur le territoire de l’ancienne Gaule est pour lui désastreux. Il faut dire qu’il y a eu, en Allemagne, une certaine réticence à se romaniser, à accepter ou subir l’influence latine, et cela s’est manifesté notamment par la Réforme de Luther, qui a constitué un retour aux sources purement allemandes. L’Allemand « proteste », il ne se soumet pas.
Gobineau a terminé sa vie en Italie, où il est devenu sculpteur. Il s’est donc plutôt bien accommodé de la civilisation « métissée ».
C’est une de ses contradictions. Il ne s’est jamais senti mieux qu’en Italie. A titre d’anecdote, au moment de visiter la cathédrale de Pise avec son ami le comte de San Vitale, ce dernier lui demande s’il ne trouve pas l’édifice magnifique, ce à quoi Gobineau répond par l’affirmative, tout en regrettant qu’elle se trouve en Italie et non dans un pays nordique. Il était tout à fait conscient de l’inaptitude des Arians à produire une quelconque œuvre artistique majeure. Il a ainsi détesté son séjour à Stockholm quand il était ambassadeur de France et n’avait qu’une envie : retourner à Rome.
Les thèses de l’Essai ont assez vite été occultées par les nouvelles théories scientifiques de l’évolution, à l’instar de celle de Darwin. L’avant-propos de la seconde édition (parue après sa mort, en 1884), laisse paraître son amertume, voire sa mauvaise foi quand il affirme que Darwin lui doit tout. Or, la théorie de l’évolution contredit celle de Gobineau : Darwin estime que les plus forts (du moins les plus aptes au changement) se substituent aux plus faibles, alors que Gobineau pense l’inverse.
Il est en effet faux d’affirmer que Darwin a copié Gobineau. Le premier ne connaissait pas le second, alors qu’ils étaient tout à fait contemporains. Ils sont d’ailleurs morts la même année, en 1882. Sa mauvaise foi est évidente. Cependant, la théorie de l’évolution darwinienne et de la lutte pour la vie est différente de la pensée gobinienne, elles ne doivent pas être mises sur le même plan. Gobineau réfléchit sur un temps très long, bien qu’il soit enfermé dans les 7 000 ans bibliques, et surtout, il considère l’évolution des civilisations. Darwin, lui, théorise dans un premier temps celle du règne animal, des espèces et considérera ensuite l’évolution de l’Homme, qui est le résultat d’une lutte pour la vie et d’une sélection naturelle. Pour Gobineau, le plus fort s’affaiblit parce qu’il n’a plus le même sang. Il écrira même à Cosima Wagner : « Le sang vaut mieux pour moi que la civilisation. » Finalement, il accorde sa préférence aux Arians, bien qu’ils ne soient pas aussi civilisés que les Latins.
L’Essai n’a eu aucun succès en France et Gobineau n’a jamais vraiment été pris au sérieux, qu’il s’agisse de cet ouvrage ou bien de ses travaux sur l’écriture cunéiforme. Comment expliquer ce désintérêt de ses contemporains, qui l’a fait tomber dans l’oubli dans son pays natal ?
C’est un autodidacte. Il n’a pas eu de succès en France, car il a été absent de son pays, pendant presque trente ans. Il lui était alors difficile de promouvoir ses écrits et ses éditeurs ne l’ont pas fait à sa place. Ses Trois ans en Asie ont rencontré une certaine audience malgré tout, ainsi que les Religions et les philosophies dans l’Asie centrale, et les Nouvelles asiatiques. Mais il a échoué complètement avec les Pléiades et la Renaissance, qui ne se sont vendues qu’à quelques centaines d’exemplaires. On s’est moins intéressé au doctrinaire ou au prophète de la décadence qu’à l’explorateur de contrées exotiques.
Il a pourtant eu du succès en Allemagne. Il doit cette popularité à sa rencontre avec Wagner ainsi qu’au dévouement de son disciple Ludwig Schemann, qui a beaucoup agi pour y diffuser sa pensée.

Il rencontre une première fois Wagner en 1874 brièvement, au cours d’une fête à Rome. Puis, quatre ans plus tard, il le retrouve à Venise. Ils sont âgés tous les deux et Wagner est un homme fatigué qui n’a plus envie de parler français et qui est, à cette époque, très renfermé sur lui-même. Malgré cela, Gobineau l’éblouit : il a des conversations brillantes et sait également charmer Cosima. Il fera ensuite des séjours assez longs à Bayreuth, dans la maison de Wahnfried, et l’entente sera telle que Wagner dira : « Faut-il que j’aie rencontré si tard le seul écrivain original que je connaisse. » L’admiration était réciproque.
Cette popularité en Allemagne n’a pas empêché sa récupération, dans un premier temps par les théoriciens du racisme et de l’eugénisme comme Georges Vacher de Lapouge ou Houston Stewart Chamberlain, et dans un second temps par les nazis, bien que ces derniers aient dévoyé sa pensée.
En effet, les deux pensées sont contradictoires dans le sens où Gobineau s’attache au passé, à une sorte de paradis perdu où les Arians dominaient, alors que Hitler a l’ambition d’établir une société utopique pour mille ans ; le premier est pessimiste, le second optimiste. De plus, pour Gobineau, les Allemands sont déjà métissés, ce qui ne peut que heurter la conception nazie de l’aryanisme germanique.
Les Allemands étaient, au début du XXème siècle, du moins une partie d’entre eux, très soucieux de leur origine ethnique et c’est cet aspect qui les a intéressés dans l’œuvre de Gobineau. On comptait un certain nombre de cercles de réflexion sur la race nordique et des hommes comme Hans F.K. Günther ont beaucoup écrit sur ce thème et sur les liens de sang entre les peuples nordiques et l’Allemagne ; Ludwig Schemann, quant à lui, a été l’initiateur d’un mouvement appelé la Société Gobineau (Gobineau Vereinigung, qui était basée à Strasbourg).
Les groupes de pensée allemands völkisch ou racistes, qui considéraient leur héritage ethnique comme la chose la plus importante, ont donc trouvé chez Gobineau un écho à leur préoccupation. Ils ont pris chez lui ce qui servait leur cause ; comme le disait la princesse de Sayn-Wittgenstein : on vous prendra beaucoup de choses et on conclura autrement. C’est ce qu’ont fait également les nazis. Les Allemands ont été de grands lecteurs de l’Essai (12 000 à 15 000 exemplaires vendus en Allemagne contre 400 en France). Gobineau les a tellement flattés en affirmant que l’héritage germanique est ce qu’il y a de plus noble et de plus hautement moral, de plus organisateur, dans le sens où il prône la vitalité et le goût du travail que les Allemands l’ont lu avec gourmandise. Gobineau disait pourtant régulièrement que les Allemands de son époque n’avaient plus rien de germanique, mais là, c’est son pessimisme qui s’exprimait.

Vous avez évoqué Chamberlain[6] ; en réalité, ce sont ses thèses (qu’on peut rattacher au darwinisme social) qui ont été retenues par Hitler. Mais l’Essai a été une source d’inspiration, très détournée. Schemann a écrit un livre intitulé Gobineau et la civilisation allemande (1910), qu’il a offert à Hitler, lequel lui a répondu par une lettre, aujourd’hui perdue, mais dont on peut imaginer le contenu. Gobineau a certainement aidé Hitler à façonner ses propres thèses ; des passages célèbres de Mein Kampf sont du Gobineau intégral. Par exemple, quand il parle du « désastre » qu’a constitué la rencontre entre les Aryens et les Sémites.
Il y a eu des tentatives de réhabilitation en France, par des chercheurs comme Jean Boissel ou Jean Gaulmier, lequel a d’ailleurs édité ses œuvres principales dans la Pléiade à partir de 1983. Croyez-vous en une réhabilitation de Gobineau ?
Actuellement, c’est impossible. Je me suis heurté à de nombreuses critiques et difficultés pour faire connaître mon ouvrage. Le contexte n’est pas propice à une réflexion apaisée sur le thème de l’identité. Faut-il pour autant une réhabilitation ? Dans l’esprit des lecteurs de Gobineau, le besoin ne se fait pas forcément sentir. Aujourd’hui, publier Gobineau dans la Pléiade ne serait plus possible. Il ne pourrait pas paraître dans cette collection. C’est le constat que j’ai dressé. J’ai donc voulu poser un jalon qui, peut-être, servira dans quelques années à d’autres chercheurs curieux.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
[1] L’essor du mouvement Black Lives Matter et les manifestations contre le racisme aux Etats-Unis et en France notamment.
[2] Gobineau s’est en effet arrogé le titre de comte et s’est inventé une généalogie fictive dans son étude historique l’Histoire d’Ottar Jarl (1879).
[3] Comme dit plus haut, Péguy édita l’ouvrage de Dreyfus sur Gobineau dans les Cahiers de la Quinzaine (ce qui provoqua des désabonnements en série, dont celui de l’helléniste Victor Bérard) et en envoya un exemplaire à l’empereur Guillaume II.
[4] Lecture des écritures cunéiformes (1858) et Traité des écritures cunéiformes (1864)
[5] L’Homme antédiluvien de Boucher de Perthes, qui fonde la science préhistorique en démontrant notamment la contemporanéité de l’Homme et de certains animaux disparus, à une époque antérieure au Déluge biblique, n’a été publié qu’en 1860.
[6] Qui a été président de la Gobineau Vereinigung.
