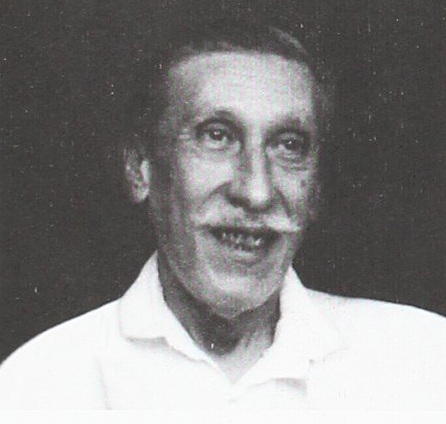Après sa monumentale étude Ésotérisme guénonien et mystère chrétien, Jean Borella publie, dans la même collection « Théôria » chez L’Harmattan, René Guénon et le guénonisme – enjeux et questionnements. À travers ce recueil de textes et d’articles, le philosophe chrétien propose d’examiner les rapports entre l’œuvre de Guénon et son héritage doctrinal, afin de mesurer le rôle joué par le métaphysicien dans la « réforme de la mentalité moderne » qu’il appelait de ses vœux.
« Pas facile d’être juste avec Guénon. L’œuvre semble exiger une adhésion totale tant son unité est forte. On l’accepte en bloc ou on la rejette de même. » Tel est le constat que formule Jean Borella en regardant les diverses réceptions passionnées dont l’œuvre de René Guénon fait l’objet, et qui lui valent d’un côté l’ostracisme, de l’autre une « mythologisation ». De ce point de vue, le travail de Borella fait exception : ce à quoi il s’emploie dans plusieurs de ses études, c’est un examen critique de l’œuvre de Guénon qui ne soit ni un rejet délirant, ni une adhésion passionnée. Son but est de discriminer ce qui, d’une part, relève dans son œuvre de la vérité pérenne et universelle, compatible avec la foi chrétienne à laquelle Guénon ne prétendait nullement s’opposer, et ce qui relève, d’autre part, des inévitables égarements d’un individu.
L’enjeu est rigoureusement spirituel : « “Si tu veux le noyau, brise l’écorce”. Ce précepte vaut pour l’œuvre guénonienne, comme pour toute autre. Si l’on veut atteindre la “substantifique moelle” qu’elle renferme, il faut rompre avec une certaine fascination qu’elle exerce sur son lecteur ». Or pour atteindre à la contemplation de cette dimension universellement véridique de l’œuvre de Guénon, il faut commencer par en connaître les contours. Ainsi Borella remarque que l’œuvre de Guénon s’articule autour de « cinq thèmes fondamentaux : un thème initial de réforme intellectuelle, la critique du monde moderne ; trois thèmes centraux […] : la métaphysique, la tradition et le symbolisme ; enfin un thème terminal d’accomplissement, celui de la réalisation spirituelle », qu’il expose après une impeccable biographie de l’« Ermite de Duqqi ».
L’esprit de l’antimodernité
Dans son quatrième chapitre, Borella se consacre à un important développement au sujet de la critique du monde moderne. Celle-ci joue le rôle chez Guénon d’une entreprise de « réforme intellectuelle », dont la fonction « négative » de destruction des idoles modernes soutient et prépare l’exposition, positive, des données traditionnelles de la science sacrée. Ses deux premiers livres proposent deux angles d’attaque différents : dans Orient et Occident en 1924, la critique de la modernité se fonde sur « l’opposition de l’espace » : à « l’espace occidental [qui] est un espace brouillé, dérangé, désordonné », s’y oppose « l’Orient [qui] vit dans l’équilibre et l’harmonie de principes régissant immémorialement la vie humaine ». Quant à La Crise du monde moderne (1927), il est « bâti sur l’opposition temporelle entre un passé traditionnel et une modernité anti-traditionnelle », qui apparaît comme correspondant en tous points à l’âge de fer ou l’âge sombre (Kali Yuga) dont parlent les cosmologies traditionnelles d’Orient et d’Occident.
Mais Borella remarque que ces deux livres, malgré leur puissance visionnaire et intellectuelle, « ne sont pas sans analogue dans la littérature [antimoderne] de l’époque. Si Guénon publie La Crise du monde moderne en 1927, c’est en 1928 que Freud écrit Malaise dans la civilisation, en 1931 que Valéry publie Regards sur le monde actuel et Bernanos La Grande peur des bien-pensants, enfin en 1935 que Husserl publie La Crise des sciences européennes, pour ne citer que quelques-uns des ouvrages où s’exprime la conscience vive d’une impasse pour toute la civilisation occidentale. » Ce qui distingue donc, de loin, la critique guénonienne de la modernité, c’est en fait son chef-d’œuvre Le Règne de la Quantité et les Signes des temps publié en 1945.
Dans Le Règne de la Quantité et les Signes des temps, Guénon envisage la crise de la modernité du point de vue de l’être, avec une rigueur conceptuelle toute scolastique. En exposant les « principes cosmologiques qui régissent notre monde et tout ce qu’il contient », il dévoile aux contemporains de la Seconde Guerre mondiale la logique qui préside à cette symptomatique tragédie : il s’agit de « la dialectique du pôle essentiel et du pôle substantiel de la Manifestation universelle, et plus particulièrement de la forme et de la matière, ou de la qualité et de la quantité, qui en sont l’expression au niveau du monde humain ». A travers des « aperçus sur le temps, sur l’espace, les métiers, la monnaie, la solidification du cosmos physique, les modes idéologiques, etc », Guénon montre dans son chef-œuvre visionnaire comment le monde moderne est devenu victime de ses propres choix : en se privant théoriquement et pratiquement des influences spirituelles nécessaires à son salut, le monde occidental s’est condamné à agoniser, dans son esprit et dans sa chair, des conséquences d’une vie sans Dieu. Le Règne de la quantité et les signes des temps occupe en ce sens une place unique et maîtresse dans toute la littérature antimoderne de son époque.
Cela étant dit, Borella nous avertit que la pars destruens de l’œuvre de Guénon ne prend sens qu’au regard de sa pars construens, qui se propose pour but l’édification spirituelle de l’homme. Guénon n’est ni un théoricien politique ni un polémiste : c’est un auteur spirituel, chez qui la critique de la modernité ne se présente que comme « le premier moment d’un jnâna-yoga », c’est-à-dire une simple préparation, certes indispensable, à la connaissance spirituelle nourrie des doctrines hindoues. En effet, les sagesses traditionnelles apprennent à « se déprendre de l’illusion d’un monde qui se donne pour la seule réalité » afin de connaître la réalité vraie et absolue, divine. Or la difficulté supplémentaire pour l’homme moderne c’est de procéder au dépassement de deux illusions : celle de ce monde moderne, mais aussi celle de ce monde traditionnel auxquels les saints depuis toujours ont dû également renoncer pour entrer dans la connaissance de ce qui transcende tout monde, Dieu. « Lorsque l’homme d’aujourd’hui entre dans la connaissance du monde moderne, ce qui reste, quand il a traversé l’illusion de la modernité, c’est encore le monde. Et trop souvent, oubliant que le voyage n’a pas commencé, et qu’il faut “laisser les morts enterrer les morts” [Mt VIII, 22], nous retournons vers cette modernité que nous venons de quitter pour l’accuser encore ».
Borella nous rappelle ainsi le sens exclusivement « spirituel » que Guénon a explicitement dévolu à sa critique de la modernité : celui de réformer notre mentalité générale, afin qu’ayant compris l’inanité de nos anciennes illusions, nous puissions enfin commencer à assentir à la conscience de l’éternité. « Autrement dit, ce qui nous est demandé, c’est un effort de discrimination objective et subjective : rejeter l’erreur sans haïr les hommes. Ce monde dont nous refusons les mensonges et les impostures, implacablement, c’est aussi le nôtre, c’est le temps de notre vie, celui que Dieu nous a donné pour notre bonheur et notre sanctification ». La critique du monde moderne ne se justifie donc que comme une propédeutique à la réalisation spirituelle. Le temps passé à seulement critiquer notre monde est un temps perdu pour les œuvres de sanctification et pour la connaissance de la vérité.
La justification traditionnelle des sciences
Selon René Guénon, les deux mamelles de la connaissance, au sens propre de ce mot, sont d’une part la métaphysique, qui est la connaissance de ce qui est « au-delà de la nature », c’est-à-dire des Principes universels, et d’autre part le symbolisme, entendu comme l’étude comparée des symboles sacrés qui sont communs aux différentes religions et traditions. Or ces deux sciences n’ont de sens selon lui qu’en tant que sciences traditionnelles. Il faut comprendre ici que « Guénon confère au mot tradition – de tradere : livrer, transmettre – son sens le plus rigoureux : est traditionnel ce que l’homme n’a pas inventé, mais reçu, et qui donc trouve son point de départ, en dernière analyse, dans l’Origine supra-humaine (autrement dit universelle, divine) de toutes choses. »
Ainsi Guénon propose de réformer notre épistémologie générale, c’est-à-dire notre conception de la connaissance. Par opposition aux sciences modernes, les sciences traditionnelles ont donc ceci de caractéristique qu’elles ne prétendent pas être construites par la raison immanente, mais reçues transcendantalement par l’intellect. Or les symboles sacrés communs aux diverses traditions jouent un rôle capital ici, parce que leur réseau prouve, pour ainsi dire empiriquement, l’existence de cette vérité divine connaissable par l’Homme. Les symboles éveillent celui qui entreprend de les connaître à une nouvelle perception du monde. Dans son très important article sur « La Réforme de la mentalité moderne », René Guénon écrit que « le symbolisme est le moyen le plus adapté à l’enseignement des vérités d’ordre supérieur, religieuses et métaphysiques, c’est-à-dire tout ce que repousse ou néglige l’esprit moderne ». Les mythes, les temples, les cathédrales et les textes sacrés traditionnels sont en effet saturés de symboles, et la méthode proposée par Guénon consiste à comparer leurs significations respectives afin de s’apercevoir de leurs enseignements communs, à travers la diversité des formes culturelles dans lesquelles ils apparaissent.
La conversion au symbole
Dans cette perspective, la réforme de la mentalité moderne ne peut que coïncider avec une conversion du regard, où « l’œil du cœur » devient capable de discerner « la nature théophanique du cosmos : le monde révèle Dieu ». L’intelligence agrandie et rouverte à l’universel, chaque chose se montre à elle comme un symbole, c’est-à-dire comme une « participation de la chose à son archétype ». En quoi consiste donc cette « conversion au symbole » dont Borella fait la « tâche » caractéristique de son entreprise philosophique, dans l’héritage intellectuel de René Guénon ? Elle consiste en « l’ordination de l’intelligence à l’altérité de l’être » (La Crise du symbolisme religieux). Le symbole, selon sa signification sacrale, est conçu comme la présentification sensible de réalités supérieures. Ainsi, voir les choses dans leur signification symbolique revient à ne jamais les idolâtrer, c’est-à-dire à ne jamais arrêter le mouvement de l’intelligence sur un objet fini : individu, nation, race, monde. Convertie au symbole, l’intelligence se trouve désencombrée de ce qui arrêtait et limitait passionnément son attention ; elle retrouve sa respiration, en s’élançant vers la contemplation de l’Ouverture infinie du réel, qui se dérobe, dans sa divine absoluité, à toute tentative de capture superstitieuse.
Si la conversion de l’intelligence au symbole doit s’appliquer à tous les objets qui se donnent à elle, elle doit aussi s’appliquer à l’œuvre de Guénon, afin de voir ce qu’il y a, en elle, de symbolique, c’est-à-dire de référent à un ensemble de vérités d’ordre métaphysique, et ce qu’il y a, en elle, de limité, de contradictoire, c’est-à-dire d’humain. Selon Borella, il faut sortir du « système » de Guénon pour atteindre la vérité qu’il fut capable d’exposer, en prenant conscience du fait que les erreurs sont inévitables dès lors que la vérité est exposée par un individu humain, dont la science ne peut être exhaustive et dont les stratégies d’écriture rendent parfois l’œuvre partiale. Borella se fait ainsi fidèle à l’enseignement de l’Ermite de Duqqi, selon lequel « l’individualité ne compte pas au regard de la doctrine » traditionnelle et impersonnelle : ce qu’il y a d’universellement vrai chez Guénon, n’est logiquement pas la vérité de Guénon. « C’est pourquoi ce savoir ne saurait être soustrait à tout examen critique, chaque fois que cela s’impose et qu’on en a la possibilité ».
Ainsi, Guénon lui-même a corrigé ses vues sur le bouddhisme grâce aux critiques apportées par son savant ami Ananda K. Coomaraswamy. Mais un tel examen restait à faire concernant l’initiation chrétienne, et Borella s’y emploie en démontrant rigoureusement, après Frithjof Schuon, le caractère initiatique des sacrements chrétiens, et les propos contradictoires de Guénon sur ce sujet. Borella avertit gravement que là où Guénon laisse subsister une contradiction entre ses affirmations et celles du Christ et de son Eglise, l’alternative doit être assumée : « est-ce que je crois Guénon, ou Jésus-Christ ? » Si Borella se méfie donc des hagiographies de Guénon en déplorant la « mythologisation » dont il fait l’objet – mais n’est-ce pas méconnaître la nature traditionnelle de l’hagiographie que d’y voir une entreprise d’embellissement falsificateur ? –, il ne s’interdit en revanche pas, conformément à sa propre tâche philosophique, de voir dans cette œuvre un symbole, à la fois « signe des temps » et « manifestation d’un Ordre pérenne universel dont elle pourrait être l’ultime flamboiement ». Finalement, en renonçant au caractère systématique de l’œuvre de Guénon, Borella en révèle mieux le caractère programmatique pour le destin intellectuel de notre monde, elle qui contribue en effet, sans l’épuiser, à la réforme spirituelle de la mentalité moderne.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.