À l’heure où beaucoup se plaisent à raconter le moindre détail insignifiant de leur vie, dans une langue aussi indigente que l’expérience témoignée, la lecture de Pierre Boutang fait l’effet d’une gifle, énorme et salutaire. Son roman Le Purgatoire, d’abord paru en 1976 et fraîchement réédité aux provinciales, est effectivement le contraire de la mode actuelle : quand l’écrivaillon contemporain tire vanité de ses traumatismes en surfant sur la vague idéologique, Boutang extrait les leçons théologiques de ses fautes. Ou la littérature de la vente contre celle du rachat.

Il faut tout de même prévenir le lecteur : la philosophie de Pierre Boutang est réputée ardue, et sa littérature ne l’est pas moins. Il faut être prêt à affronter de fréquentes citations italiennes ou latines, des mots d’ancien français ou de dialectes régionaux, ainsi que de continuelles allusions, plus ou moins explicites, à des œuvres, plus ou moins connues, de littérature, philosophie ou théologie. Auxquelles s’ajoutent, dans le cas de ce roman semi-autobiographique, certaines anecdotes personnelles, ou relatives à son contexte historique immédiat, qui ne sont pas toujours évidentes à saisir. C’est que l’esprit de Boutang est bouillonnant, les idées se pressent au bout de sa langue, et on le sent écrire dans une espèce d’urgence : s’efforçant d’en dire le plus possible le plus rapidement possible, de faire entrer le maximum de contenu et de profondeur dans le minimum de mots, au risque de perdre en clarté. Enragé d’avoir « renoncé à l’ancienne aventure de la parole, pour ce supplice des signes », il déverse sa pensée à la manière du stream of consciousness de Joyce. D’où un style vif, dense et ramassé, au rythme quasi télégraphique parfois, et pourtant jamais strictement fonctionnel, souvent imagé au contraire, et même chantant. Voyons plutôt comment il raconte le départ, hors du foyer terrestre : « Sentier, rien de sentir, comme croit Urs von Balthazar : semita, pas semer, non plus ; hélas qui sème en pleurs recueille en heur, speïrontes én dakrusi ; qui sème espine n’aille deschaux ! Chaque matin, d’une fontaine sienne à la fontaine commune, la lointaine ; quitter Celse jamais facile, déjà de son absence il apaise la maison ; veille au mur le plus informe Christ, hasard de souche d’olivier, croix plus secrète que lit d’Ulysse, mais il n’a rien fallu tailler, rien façonner. Quitter Celse, peine quotidienne, avant la chaleur du jour. »[1]
Il faut donc s’armer de courage… mais le jeu en vaut la chandelle. Et il faut dire que nous sommes bien aidés, par le préfacier Ghislain Chaufour et Olivier Véron l’éditeur, qui ont assuré ensemble l’appareil critique de cette republication. Comme nous en avertit Chaufour, le relatif ésotérisme du texte est conforme à sa philosophie, à la conviction que « nous parlons par emprunt aux paroles des autres », et que « d’ailleurs nul n’est tenu de tout comprendre ; souhaiter épuiser, achever, totaliser, pervertit la volonté et appartient à l’illusion de la force. » Aussi faut-il s’engager dans ce Purgatoire comme en une aventure, en acceptant de ne pas tout comprendre, mais dans l’espoir d’y trouver quelque lumière.
Un roman théologique
Concrètement, le roman raconte le Purgatoire d’un certain Montalte (sorte d’alter ego de l’auteur, qui s’est choisi le même pseudonyme que Pascal signant Les Provinciales). Or ce Purgatoire a la particularité de se dérouler sur Terre, de reconduire le défunt « en divers lieux de ses fautes passées », extrapolant par licence poétique l’idée thomiste d’une potentielle purification terrestre. Ainsi Montalte va-t-il non « revivre mais revenir » (il n’a plus de corps !), ou « survenir », retrouvant sur son chemin, errant comme lui, les voix et les visages qui l’ont guidé dans cette vie révolue comme ils continuent de le faire au seuil de l’autre, ces compagnons qu’il a trop aimés ou pas assez, et qui viennent lui dire un dernier et littéral adieu. Il croisera son père, bien sûr, figure centrale comme on sait dans la vie et l’œuvre de Boutang, premier à lui indiquer la voie, puisque là-bas encore « le père vient au devant ». Mais aussi Roger Nimier, « prince négligent », fauché avant d’avoir eu le temps de se réconcilier à Dieu. Maurras, évidemment, qui le rappelle à leur espoir commun d’une « arche nouvelle, catholique, classique, hiérarchique, humaine », attestant « face au triomphe du pire et des pires, une primauté invincible de l’ordre et du bien ». Claire, également, l’épouse discrète, presque secrète, souvent délaissée et gardant pourtant, conjointement à son mari, « l’espérance jamais reniée dans la douce clôture des bras ». Et toutes sortes de personnages, plus ou moins connus, plus ou moins clairement identifiés, y compris Jean Ruo et René Dorlinde, les plus proches amis de Montalte, révélant chacun une facette du visage trinitaire de l’auteur.

Autant dire que ce roman n’a rien d’une autobiographie ordinaire, et que « ce serait une belle lourderie, comme le dit son préfacier, que de prendre pour des transcriptions de la vie les épisodes qu’invente Boutang », à l’image de sa rencontre fictive avec Wittgenstein. Le roman, davantage qu’autobiographique, pourrait être qualifié de « théologique » selon le mot même de l’écrivain[2]. Plus qu’un simple aveu personnel, c’est une plongée dans le mystère du péché et de la rédemption, une confession au sens de saint Augustin. Son modèle direct n’est autre que la Divine Comédie de Dante, dont les citations sont omniprésentes, et dont il imite le plan. De même que le poète italien doit traverser les cercles des sept péchés capitaux, Montalte affronte et expie ses fautes : la superbe, la luxure, l’acédie, etc. Bien que la liste et l’ordre ne soient pas exactement identiques, le voyage est le même. Chaque étape est l’occasion de méditer un péché, son origine dans l’enfance, et son ambivalence, ainsi de la colère oscillant entre la juste révolte et la haine : « parmi les fureurs qu’il a cru saintes, une jouissance que l’amertume n’ôtait jamais – presque jamais – tout entière ». De sorte que le pénitent se révèle peu à peu et douloureusement à ses propres yeux, lui qui « ne connaissait même pas ses actes fautifs ». La tribulation, nous rappelle Boutang, signifiait « le broiement du blé par la herse ». Il faut une telle violence pour que le grain se libère de l’épi.
Boutang contre Goulavare
Le dernier péché sur la route de Montalte se nomme « Goulavare », mal typiquement moderne, croisement inédit et monstrueux des antiques péchés de gourmandise et d’avarice, « la rencontre des deux idolâtries, jusque-là plus que séparées, ennemies, de l’animal qui s’empiffre et de celui qui s’enivre de la possession des biens ». L’individu moderne est possédé par cette double soif de consommer et d’accumuler, de consommer autant qu’il peut en payant le moins possible, retirant à la gourmandise l’excuse de sa générosité et à l’avarice celle de sa sobriété, glouton calculateur qui « grapille et gaspille ». Péché qui est au cœur de la logique capitaliste : non pas thésauriser, mais investir, dépenser pour être récompensé, donner uniquement pour gagner plus, contrefaçon démoniaque de « la charité qui d’être consommée s’accroît, elle, effectivement ». Et Boutang de déceler, à la racine de Goulavare, le vieux crime un peu oublié de l’usure, « la griffe sociale du diable que le moyen-âge chrétien avait exactement reconnue et que le temps ultérieur a masquée, tenté d’effacer par tous moyens et mensonges ». Crime laissé impuni par les chrétiens d’aujourd’hui, qui « sont massivement allés coucher avec Mammon ; se sont bouchés les oreilles sur l’enseignement très clair de leurs docteurs et de leurs saints », ne veulent point entendre les impérissables avertissements de Thomas d’Aquin et de Bossuet, ni les cris plus proches de Bloy, Bernanos ou Simone Weil. A tel point que c’est du « fasciste » Ezra Pound et de ses Cantos qu’est désormais lancée une des rares, et la plus vaillante, offensives contre l’usure.
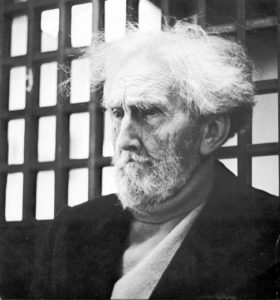
Oh il y en a, certes, qui fustigent l’usure, mais gare à ceux qui font de cette condamnation l’alibi de leur antisémitisme. Si les Juifs ont leur part de responsabilité dans Goulavare, c’est dans l’exacte mesure où ils s’éloignent de leur judéité, où ils renient leur élection, sombrant dans « l’abjecte youtrerie déjudaïsée, et moderne ». Il faut donc « être idiot comme un antisémite ordinaire, et fermé au mystère d’Israël, pour mettre au compte des Juifs la civilisation de l’usure. De qui les chrétiens ont-ils reçu la loi interdisant le prêt à intérêt entre frères, sinon le Pentateuque ? » On le voit, sur cette question décisive, Boutang s’est fortement démarqué d’une fâcheuse tendance répandue chez les nationalistes du début XXe, tant que « la guerre des Six Jours a brouillé Dorlinde, en 1967, avec presque tous ses amis ». Loin par conséquent de répéter les faciles accusations antisémites, qui nous dédouanent de notre propre complicité dans Goulavare (toutes ces fois où Montalte, malgré sa réputation d’insurgé, « a permis, n’a pas bougé […] Si les tièdes sont vomis, s’il était mort à cette minute de lâche silence… »), Boutang finit par voir en Israël une planche de salut, une forme de résistance à la modernité. Même s’il est conscient que la fragile pureté des kibboutz ne tient que par « le Veau d’or yanki »… Qu’en penserait-il aujourd’hui ? Une chose est sûre, c’est qu’il continuerait à guetter, de Jérusalem ou du Royaume de France, la venue d’un « nouvel âge des héros » succédant à la décadence de « l’âge des hommes », selon le modèle des ricorsi de Vico.
Montalte s’en va sans l’avoir connu, mais en s’étant battu. Il poursuit ailleurs son chemin. Nous le quittons au jardin d’éden, seuil du Paradis selon Dante, et là déjà les mots manquent, la prose est trop grossière. Seule la vox cordis peut balbutier ce que l’œil ébloui devine, et Boutang conclue son Purgatoire par un poème.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
[1] Boutang, quoique réactionnaire, avait des goûts très modernes en littérature, et allait jusqu’à imputer la défaite du nationalisme à son manque d’ouverture esthétique : « L’échec de l’Action Française est issu de son esthétique en défaut, d’une erreur pseudo-classique sur le langage ; pendant que le monarchiste T.S. Eliot, et le fasciste Ezra Pound inventent, à la proue du navire Argo, les mesures soudaines du poème futur, des rimeurs d’arrière-garde à forme fixe, des peintres de Salon, des architectes de bonbonnière, s’interposent entre la prophétie héroïque de Maurras et le futur prochain. »
[2] Propos recueillis par Gérard Leclerc dans La Nouvelle Action Française (1976)
Crédit photo : Louis Monier
