Antoine Arjakovsky dirige le pôle « Politique et religion » au Collège des Bernardins à Paris. Il est également directeur émérite de l’Institut d’études œcuméniques de l’Université Catholique Ukrainienne. Ses recherches portent en particulier sur la philosophie religieuse russe (Boulgakov, Berdiaev, Chestov), ainsi que sur des problématiques de théologie du politique telles que la démocratie, la justice ou encore la fraternité (Votez Fraternité ! Trente propositions pour une société plus juste, Hermann, 2021). Il vient de publier au Cerf un Éssai de métaphysique œcuménique dans lequel il analyse notre époque troublée, et surtout propose une nouvelle épistémologie fondée sur la science œcuménique.
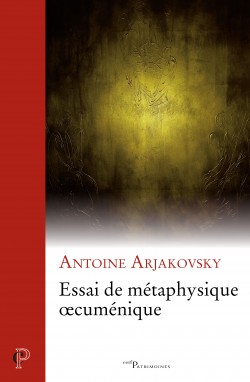
PHILITT : Dans l’introduction de votre livre, vous commencez par poser un constat. À rebours de ceux qui disent que notre monde va bien, et que l’impression du contraire n’est qu’un effet de distorsion propre à une conscience occidentale hantée depuis toujours par l’idée de décadence, vous affirmez qu’au contraire nos sociétés affrontent une « poly-crise ».
Antoine Arjakovsky : Oui, mais ce n’est pas être très grand prophète que de le constater. Il suffit de se reporter à quantité de rapports des Nations Unies ou du GIEC sur ce sujet. Par exemple, le dernier rapport d’Oxfam paru en janvier 2022 explique que la pandémie sanitaire a considérablement aggravé les inégalités sociales en France et dans le monde. Ainsi les cinq premières fortunes de France ont doublé leur richesse depuis le début de la pandémie. Elles possèdent à elles seules autant que les 40% les plus pauvres en France. Depuis mars 2020, le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, alors que, au même moment, 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté.
Tout ce qui formait un tout cohérent dans les années 1990 s’est désintégré en moins de vingt ans. Il y a bien sûr la crise climatique et la crise de la biodiversité avec les conséquences dramatiques que l’on connaît, avec la pandémie du coronavirus. Mais il y a également la crise des relations internationales, la montée de la violence sociale, etc. Certains considèrent que ces crises ont toujours existé, qu’il y a toujours eu de la guerre, de la violence, de l’injustice. Mais la vérité est que ces inégalités et cette dévastation des forêts et des océans ont pris des proportions inconnues dans le passé. Ajoutez à cela la progression, à la vitesse d’un cheval au galop, du paradigme postmoderne au sein de la plupart des élites politiques ou médiatiques – c’est-à-dire d’une vision du monde selon laquelle il n’y a pas de vérité mais seulement des interprétations – alors vous comprenez pourquoi cette poly-crise est profonde, durable et, pour tout dire, assez inquiétante.
On pourrait vous rétorquer que cette triple crise économique, écologique et philosophique est purement conjoncturelle, liée à certaines mutations contemporaines du marché, de la technologie et des modes de pensée, et que le système va finir par la résorber.
La poly-crise actuelle a des causes profondes, qui tiennent au fait que la pensée postmoderne prive l’homme de l’énergie spirituelle qui lui permettrait d’agir véritablement sur le monde. En effet, dans celle-là, seul l’individu est censé disposer de ressources suffisantes pour survivre et transformer un monde caractérisé par ses rapports de force, son caractère insensé et sa violence. Mais ce n’est évidemment pas le cas. On constate au contraire que cette conception rend l’homme tout à fait impuissant. Il est temps de retrouver la vérité élémentaire selon laquelle les budgets sont des documents moraux. C’est le gage que de nouvelles politiques publiques sont possibles pour construire non plus, selon la vision des Modernes, un État souverain et tout-puissant, mais, de façon plus spirituelle, un État au service de la fraternité.
Si je vous suis, la crise ayant pour origine une vision du monde et une épistémologie à la fois utilitaristes et individualistes, sa solution ne peut consister qu’à revenir à une épistémologie plus spirituelle.
À côté du paradigme postmoderne, il existe une autre cristallisation de la conscience, qu’on peut qualifier de spirituelle, qui a été portée au XXᵉ siècle par des penseurs très différents tels que Nicolas Berdiaev et Kate Raworth, Victor Frankl et Karol Wojtyla (devenu Jean-Paul II). Celle-ci a remis en cause non seulement la vision du monde classique et moderne mais également sa conception postmoderne.
Je ne prendrai ici que l’exemple de la prise de conscience qui s’est opérée chez le psychiatre autrichien et juif Viktor Frankl. Le 19 octobre 1944, il fut déporté à Auschwitz par le pouvoir nazi. De retour de déportation, il prononça une conférence célèbre à Vienne au cours de laquelle il expliqua que la psychanalyse moderne échouait à comprendre le monde en raison d’une épistémologie erronée :
« Disposant d’un concept atomiste, énergétique et mécaniste de l’Homme, la psychanalyse le voit en dernière analyse comme l’automate d’un appareil psychique. Et c’est précisément là qu’intervient l’analyse existentielle. Elle oppose un concept différent de l’homme au concept psychanalytique. Il ne se concentre pas sur l’automate d’un appareil psychique mais plutôt sur l’autonomie de l’existence spirituelle. « Spirituel » est utilisé ici sans aucune connotation religieuse, bien sûr, mais plutôt simplement pour indiquer que nous avons affaire à un phénomène spécifiquement humain, contrairement aux phénomènes que nous partageons avec d’autres animaux. En d’autres termes le spirituel est ce qui est humain dans l’Homme ».
Cette évolution de la conscience, d’une conception postmoderne à une vision spirituelle du monde, s’est produite de façon souvent discrète à peu près dans toutes les disciplines aux XXᵉ et au XXIᵉ siècles. Aujourd’hui des philosophes agnostiques, tels que Dany Robert Dufour par exemple, n’hésitent pas à remonter des manifestations de l’esprit dans la vie du monde, à la figure métaphysique et théologique de la Trinité. Voici la conclusion d’une de ses conférences récentes au Collège des Bernardins : « Je suis un athée misant sur un nouvel œcuménisme (le convivialisme) et invoquant la Trinité pour conjurer le diable. »
Cette nouvelle vision spirituelle du monde doit, selon vous être élaborée dans ce que vous appelez une « métaphysique œcuménique ». Cependant, ce terme semble au premier abord peu compréhensible. En effet, le terme « métaphysique » n’a pas aujourd’hui très bonne presse, et renverrait depuis Kant à l’idée d’une philosophie dépassée, voire dévoyée.
Il est urgent de sortir de la schizophrénie actuelle de l’université qui consiste à séparer les deux sphères de la croyance et de la rationalité. Kant lui-même dans Le Conflit des facultés s’opposait à un tel partage. Lui, le philosophe de la raison pure, expliquait à la fin de sa vie qu’il était aussi un croyant luthérien qui aimerait bien pouvoir discuter avec les théologiens… Le malheur fut qu’à son époque la rationalité théologique était entièrement dépendante du pouvoir politique. Aujourd’hui nous n’en sommes plus là. Au contraire, on voit combien la rationalité théologique et la rationalité philosophique ont des choses à se dire au même titre que la foi catholique a compris qu’elle pouvait s’enrichir au contact de la foi protestante et orthodoxe. D’où l’intérêt pour moi de penser aujourd’hui les bases d’une métaphysique œcuménique capable de penser ensemble l’universel et le personnel, mais aussi le monde réel et le monde spirituel.
En réalité la métaphysique œcuménique est une vision du monde globale qui cherche à comprendre tout le réel et à y participer. Ici le terme œcuménique est compris comme le Royaume de Dieu qui vient sur la terre à chaque fois que les êtres humains actualisent la justice divine. Cette conception de l’universalité devient personnelle et communautaire. Elle fait aussi éclater la représentation antique de l’espace-temps. L’histoire n’est ni cyclique ni un long couloir vide. Elle a un sens vertical pourrait-on dire. Le royaume de Dieu sur la terre est plénitude en esprit et en vérité. C’est pourquoi j’explique dans mon essai que Wilhelm Visser’t Hooft avait vu juste en expliquant dans son livre The Meaning of Ecumenical qu’il existe un sens quelque peu oublié au terme œcuménique, celui d’une universalité donnant accès au réel de façon méta-confessionnelle, méta-religieuse et méta-convictionnelle. Du point de vue chrétien cela peut se justifier parfaitement par le fait que le Christ lui-même a annoncé à ses disciples ceci : « Et moi quand j’aurais été élevé de terre j’attirerai tous les hommes à moi » (Jn 12, 32). Mais bien entendu ce sens personnel de l’universalité doit être compris aussi dans sa dimension sapientielle, sa dimension de sagesse.
Vous insistez d’ailleurs à de nombreuses reprises sur le fait que cette métaphysique œcuménique doit être « sapientielle », mais également « personnaliste ».
La métaphysique pour Aristote devait être katholou, c’est-à-dire qu’elle devait être capable de prendre la chose en son entier. La métaphysique, lorsqu’elle redécouvre ses sources spirituelles, de façon sapientielle et personnaliste, devient justement pleinement œcuménique. Il s’agit de tenir ensemble en son entier et Dieu, et le monde et l’être humain en tant qu’il pense. C’est pourquoi il convient d’appréhender l’individu dans sa dignité infinie comme personne, à la fois microcosme et macrocosme. Il s’agit de retrouver aussi les intuitions de figures aussi différentes que l’auteur du Livre des Proverbes, de Rûmi, de Paracelse ou de Shankara pour saisir l’être dans toute sa profondeur sapientielle, à la fois inobjectivable et néanmoins dicible. Ceci aboutit à comprendre le monde de façon non-duelle comme dans les religions orientales mais aussi comme chez les grands mystiques occidentaux.
Cette métaphysique, parce qu’elle pose une tension entre le monde créé et le monde incréé, permet de réconcilier quatre compréhensions majeures de la vérité dans l’histoire de la philosophie : la vérité comme correspondance entre la chose et l’intellect (Aristote), la vérité comme fidélité à une promesse (Augustin), la vérité comme cohérence entre ce que l’on dit et ce que l’on fait (Rescher), enfin la vérité comme consensus entre les membres d’une communauté (Peirce). Cette conception existentielle et « en tension » de la vérité s’oppose en ce sens à la vision volontariste de la vérité, dominante aujourd’hui, qui ne la conçoit plus que comme ce qui fonctionne par rapport à ce qui est (Bacon), c’est-à-dire de façon technocentrique, ce qui aboutit à l’utopie transhumaniste comme l’a bien montré Franck Damour.
Cette métaphysique œcuménique apparaît comme un aboutissement de vos travaux, en particulier ceux portant sur les philosophes religieux russes, tels que Berdiaev, Boulgakov ou Chestov, que vous citez d’ailleurs beaucoup dans votre ouvrage.
Les penseurs religieux russes du XXe siècle, comme Nicolas Berdiaev, Serge Boulgakov ou Léon Chestov, ont été parmi les premiers à comprendre qu’il était possible de comprendre l’universel comme une réalité personnelle et symbolique. Ces penseurs connaissaient très bien la pensée allemande, de Kant à Marx. Ils comprenaient avec Nietzsche que la métaphysique moderne qui séparait le domaine du « pourquoi » (qui était réservé à la métaphysique spéciale) du domaine du « comment » (qui était réservé à la métaphysique générale) était absurde. Ils reconnaissaient avec Heidegger que la pensée rationaliste occidentale avait enfermé l’être dans des concepts objectivants et qu’il s’agissait désormais d’en retrouver toute la profondeur et toute la liberté. Pour les penseurs religieux russes, sans qu’ils ne soient toujours allés au bout de leurs intuitions, il convient d’associer la logique du sujet comme Personne (Berdiaev), la logique du verbe comme Sagesse (Boulgakov), enfin la logique du prédicat comme conscience de soi (Chestov). Cette vision du monde post-idéaliste et post-phénoménologique a pour grand mérite de renouveler la métaphysique dès lors qu’on saisit la complémentarité entre ces pensées comme je tente de le montrer dans mon livre.
Ainsi par exemple Chestov a montré en quoi la pensée rationnelle était, depuis Aristote, fondée sur les principes d’identité, de non contradiction et du tiers exclus. Cela signifiait que toute réalité était égale à elle-même, qu’on ne pouvait pas dire une chose et son contraire et qu’il n’existait pas de troisième terme qui soit à la fois A et non-A. La pensée rationnelle binaire, fondée sur ces principes, s’appuyait donc, pour comprendre le monde, sur l’adéquation entre la chose et l’intellect. Et elle définissait la « preuve » comme l’explication d’un phénomène par sa répétition universalisable. Mais c’est une vision du monde dont les différentes traditions religieuses, d’Orient et d’Occident, disent qu’elle est une forme de naïveté par rapport à l’organisation non-duelle du réel. L’homme, qui dispose pourtant d’une dignité infinie, doit dans cette conception rationaliste se soumettre à l’ordre et à l’apparence que les phénomènes veulent bien donner d’eux-mêmes. C’est, selon Chestov, une forme de passivité qui conduit au fatalisme ou à la guerre. Cette forme de pensée aboutit aux jugements a priori qui obligent à comprendre tout le réel comme une chose abstraite et uniforme. Elle interdit par conséquent de penser la vérité comme le fruit d’une expérience personnelle.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.



