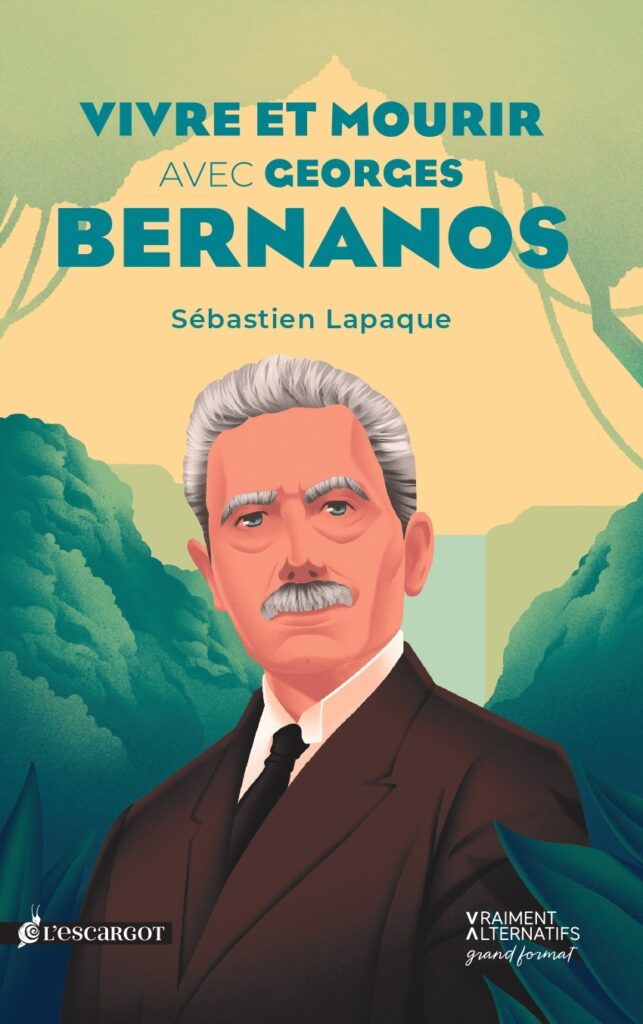La publication récente de Vivre et mourir avec Georges Bernanos de Sébastien Lapaque (Éditions de l’Escargot, 2022) nous invite à méditer la question de la relecture, laquelle se trouve contenue dans une questionnement plus vaste, qui est celui de la « réception » : à quelle condition une parole peut-elle être éprouvée dans toute la plénitude de sa réalité ?
Dans l’article qui inaugure Les Chemins actuels de la critique, Georges Poulet affirme la chose suivante : « Comprendre, c’est lire, mais lire, c’est relire […] ; et l’acte critique par excellence est celui par lequel, à travers la totalité d’une œuvre relue, on découvre rétrospectivement les fréquences significatives et les obsessions révélatrices. Critiquer, c’est donc se souvenir »[1]. Cette démarche itérative, qui s’accomplit dans le ressassement et l’approfondissement d’une parole, est identiquement l’acte par lequel le lecteur remonte à la loi qui commande le déploiement de cette parole – c’est-à-dire : à l’origine de cette parole. Cette démarche est celle de Sébastien Lapaque, fervent relecteur de Bernanos depuis le début de sa propre œuvre. Œuvre qui peut d’ailleurs être relue, à son tour, comme une méditation du souvenir de l’évènement de lecture à la faveur duquel le mystère de la parole bernanosienne lui fut révélé, à l’automne 1988 : « [J]’ignorais que j’absorbais l’antidote en même temps que le poison », raconte-t-il dans son dernier ouvrage, Vivre et mourir avec Georges Bernanos, paru en septembre 2022 aux Éditions de l’Escargot.
Que se passe-t-il, alors, lorsqu’on relit Bernanos encore une fois ? Que découvre-t-on que n’aient pas déjà découvert les lecteurs qui nous ont précédés, ou le lecteur que nous fûmes ? Pour répondre à ces questions, il nous faut d’abord interroger brièvement le mode de donation à l’intérieur duquel la lecture advient toujours déjà comme relecture, et qui est celui de la répétition – ou, pour parler comme Kierkegaard, de la reprise[2]. Selon Kierkegaard, la vérité nous est donnée d’emblée comme reprise, c’est-à-dire qu’elle nous est d’emblée redonnée. Cependant, cette reprise n’est pas à comprendre comme une simple répétition du passé qui adviendrait dans l’horizon de temporalité du monde : « la vraie reprise », c’est « l’éternité »[3]. L’éternité, c’est la dimension intérieure de la vie – ce que Bernanos appelle, quant à lui, la vie intérieure. C’est dans la vie intérieure qui nous est donnée de toute éternité, et seulement en elle, que nous pouvons recevoir la vérité. Aussi la littérature – dès lors qu’on ne la comprend pas simplement comme une parole du monde – est-elle la réponse à un appel qui nous précède infiniment.
C’est pourquoi nous ne pouvons que relire Bernanos : parce que l’appel auquel il répond, et qui habite cette réponse, nous l’avons déjà entendu en nous-même. Il est significatif, à cet égard, que le premier essai publié par Sébastien Lapaque soit intitulé : Georges Bernanos, encore une fois. Dès le début, il relisait Bernanos. Il est significatif, également, que l’un des chapitres centraux de son dernier ouvrage soit intitulé « Pourquoi je ne relirai pas Charles Maurras ». Dans ce chapitre, Lapaque affirme que la parole maurrassienne est une parole fondamentalement lacunaire. Ce qui lui manque, ce sont des « racines spirituelles »[4]. Autrement dit, ce qui manque à cette parole, c’est précisément d’avoir conscience que « quelque chose » lui manque, c’est-à-dire : d’avoir conscience qu’elle ne s’est pas donnée à elle-même[5]. D’où cet archi-évènement qui troue « l’architecture maurrassienne » : « l’absence […] du Christ »[6]. Qu’est-ce à dire ? C’est dire que la parole maurrassienne, étant une parole absente de Christ, est de fond en comble une parole du monde[7]. Lire une parole du monde, c’est la déchiffrer. La parole du monde est une parole que l’on déchiffre et dont le déchiffrement nous donne accès à la représentation en quoi repose sa vérité mondaine. Que l’on y revienne, et c’est toujours la même chose que l’on retrouve. Une parole qui est à elle-même son propre code n’a rien d’autre à offrir au-delà de son décodage : la relire, ce n’est rien d’autre que la déchiffrer de nouveau, identiquement. En somme, bien qu’on puisse la lire plusieurs fois, on ne relit jamais une parole du monde.
Ainsi, on ne peut que relire Bernanos. Lorsqu’on le relit, pourtant, le texte bernanosien ne se trouve pas élucidé, rendu plus familier par une fréquentation répétée au terme de laquelle on disposerait de lui sous toutes ses coutures. Bien au contraire, il se trouve obscurci – et c’est seulement dans l’épaisseur de cet obscurcissement, qui est sa dimension propre, que la vérité de l’œuvre se donne à nous. Cependant, cet obscurcissement ne doit pas être pensé comme le contrepoint axiologique de la clarté cartésienne : il ne s’agit surtout pas de dire que le texte nous devient de plus en plus incompréhensible à mesure qu’on le relit. Cet obscurcissement n’est pas non plus une pirouette conceptuelle qui permettrait au critique de s’accommoder des choix idéologiques que l’on reproche à Bernanos – autrement dit, de fermer les yeux sciemment sur telle ou telle partie de son œuvre. Bien plutôt, c’est cet obscurcissement, vécu par Bernanos lui-même, qui le dérobe à la froide clarté de la métaphysique maurrassienne. Pour le dire avec Michel Henry : « La lumière universelle n’est pas le séjour de tous les phénomènes. L’‘‘invivisble’’ est le mode d’une révélation positive et, à vrai dire, fondamentale. L’ambiguïté d’une philosophie de la Nuit se dissout devant le regard de la réflexion qui distingue de l’obscurité qui est le partage de la transcendance, le premier frémissement intérieur du savoir où, en deçà de la lumière, celui-ci se révèle d’abord à lui-même »[8].
Relire Bernanos ne consiste donc pas à l’excuser en rappelant le contexte historique dans lequel il vécut. Relire Bernanos, c’est prendre avec lui le chemin de l’humiliation, qui est, pour parler comme le curé de Torcy, le seul chemin capable « de replacer chacun de nous à sa vraie place, dans l’Évangile »[9]. Dans l’Évangile, c’est-à-dire non pas dans la dimension qui est celle de la représentation historique et de ses lois, mais dans la dimension qui est celle de la parole et de la vie intérieure. Ainsi et ainsi seulement peut-on sortir, avec Bernanos, de la logique « contre-révolutionnaire »[10] qui a présidé initialement au déploiement de son œuvre. On peut même aller jusqu’à affirmer que, dès lors que sa vocation lui est révélée dans toute sa plénitude et dans toute sa radicalité, cette logique devient proprement intenable, c’est-à-dire : impossible. De nombreuses pages du dernier ouvrage de Sébastien Lapaque sont consacrées à la révocation, par Bernanos, de son appartenance au maurrassisme[11]. Qu’est-ce que « révoquer » veut dire ? Révoquer quelque chose, cela veut dire : annuler quelque chose, le renvoyer au néant. Or, conformément à l’ontologie bernanosienne, ne peut être renvoyé au néant que ce qui en vient déjà. Que Bernanos révoque son maurrassisme, cela veut dire qu’à Bernanos se trouve révélée l’indigence ontologique du maurrassisme au moment même où lui est révélée la vérité de la condition humaine dans sa dimension la plus irréductible. Contrairement à celle de Maurras, l’idéologie réactionnaire de Bernanos n’avait aucune portée métaphysique : elle était une humeur historique qui lui barrait l’accès à sa propre parole. Entendons-nous : établir cette distinction n’a certainement pas pour but de minimiser le caractère scandaleux des prises de position[12] de Bernanos. Bien au contraire, c’est au cœur même de ce scandale qu’il nous faut désormais nous rendre pour comprendre la nature ultime de la révélation qui lui a été faite.
C’est à la relecture de Charles Péguy et de Léon Bloy que la parole de Bernanos se révèle à elle-même comme ce qu’elle est : « Aux Baléares, puis au Brésil, l’auteur de L’Imposture a eu l’occasion de lire Le Salut par les Juifs de Léon Bloy et Notre jeunesse de Charles Péguy avec davantage d’attention qu’auparavant »[13]. Quel est le contenu de cette révélation ? En relisant Charles Péguy et Léon Bloy, Bernanos réalise que l’idéologie réactionnaire trouve son fondement dans la confusion des ordres. Sur quoi repose une telle confusion ? Elle repose sur la traduction ontique à la lettre d’une parole qui se situe et s’origine sur le plan ontologique. Ainsi traduite, l’œuvre de Bernanos est comprise littéralement comme un manifeste politique, comme un programme à appliquer. Pour le dire d’un trait : un politique estime le mal une maladie du monde ; un mystique estime le mal une maladie de la vie. Le politique nomme cette maladie « la décadence » : le mal, c’est pour lui le monde en tant que celui-ci entraîne nécessairement une dégénérescence de la vie. Le mystique nomme cette maladie « l’automutilation » : le mal, c’est pour lui la vie en tant que celle-ci trébuche en dehors d’elle-même – puisque rien d’extérieur à la vie ne peut atteindre la vie[14].
Cette confusion, Bernanos en est la première dupe, qui croit pouvoir déduire d’une mystique une politique – c’est le cas, notamment, dans La Grande Peur des bien-pensants. La politique serait ainsi la manifestation de l’esprit dans la matière, comme si le monde et la vie étaient deux réalités du même ordre et que la seconde trouvait à se réaliser uniformément et continûment dans le premier. Or, précisément, ce qui est révélé à Bernanos, c’est l’hétérogénéité ontologique radicale du monde et de la vie, de la politique et de la mystique. Autrement dit, ce qui lui est révélé, c’est ce que Sébastien Lapaque nomme « la double réalité de l’appel »[15], avant de citer ce texte essentiel de Bernanos, extrait de la Lettre aux anglais : « Ce que nous faisons de grand se fait d’abord en nous, presque à notre insu, par cette force intérieure qui semble répondre à un appel mystérieux – tel est le sens, pour les peuples comme pour les hommes, du mot de vocation, vocatus, appelé. Il ne dépend pas de nous d’être appelés, mais il dépend de nous de ne pas répondre à l’appel. »
En quoi consiste, alors, la double réalité de l’appel, qui est aussi bien son péril et son scandale ? Le scandale de la double réalité de l’appel consiste en ceci qu’on croit pouvoir donner une réponse du monde à un appel de la vie. C’est à ce type de réponse asymétrique que l’on donne, traditionnellement, le nom d’« engagement »[16]. Or, c’est là comprendre l’appel de l’extérieur – confusion entretenue par la dernière phrase de la citation ci-dessus. En effet, s’« il dépend de nous de ne pas répondre à l’appel », ce n’est pas en vertu d’un choix qui serait le produit d’une volonté, laquelle s’orienterait vers un objet qu’elle privilégierait à un autre. Cela, le philosophe Jan Patočka le dit très bien : « L’homme ne peut pas être dans l’évidence propre aux étants extra-humains ; il doit accomplir, porter sa vie, en ‘‘venir à bout’’, ‘‘s’expliquer avec elle’’. Cela dit, on peut avoir l’impression qu’il se trouve placé toujours entre deux possibilités équivalentes. Ce n’est pourtant pas le cas. L’aliénation signifie qu’il n’y a pas équivalence, mais que seule l’une des vies possibles est la ‘‘vraie’’, la vie propre, irremplaçable, que nous seuls pouvons accomplir en ce sens que nous la portons effectivement, que nous nous identifions avec le poids dont elle nous charge – l’autre possibilité est, au contraire, une dérobade, une fuite qui cherche refuge dans l’inauthentique et l’allégement. C’est pourquoi le point de vue du ‘‘choix’’, le décisionnisme, est toujours déjà un regard faux, objectivé et objectiviste, un regard de l’extérieur. Le vrai ‘‘regard’’, c’est la non-équivalence pour laquelle il y a une différence d’essence entre la responsabilité qui porte et ‘‘s’expose’’, d’une part, et l’allègement et la fuite, d’autre part[17]. »
Aussi la vérité de l’appel s’énonce-t-elle en ces termes : qu’il dépende de nous d’y répondre, cela ne signifie pas que le choix nous revient de le recevoir ou non, puisque nous le portons toujours déjà en nous et que nous n’existons que comme la réponse à cet appel ; qu’il dépende de nous d’y répondre, cela signifie que nous sommes l’occasion, pour lui, d’atterrir au mauvais endroit, c’est-à-dire : en dehors de lui-même. Autrement dit : nous sommes le péril de l’appel, ceux contre qui l’occasion lui est donnée de trébucher hors de sa vérité – ceux par qui le scandale arrive. Traduire le mystique en politique, c’est faire advenir la vie comme le contraire d’elle-même, ou encore : organiser l’impossibilité de son séjour parmi nous. C’est là précisément ce qu’entend Bernanos, lorsqu’il dit, citant Chesterton, que nous vivons « dans un monde saturé d’idées chrétiennes amoindries, déformées, dégradées, rajustées à la mesure des médiocres – ou parfois même détournées de leur sens, ‘‘devenues folles’’ […] »[18].
Ainsi, interpréter la parole de Bernanos comme réactionnaire donne lieu à des considérations catastrophiques, et qui sont bien plus souvent imputables à ses suiveurs qu’à ses détracteurs. Une telle interprétation de sa parole conduit à en sous-estimer la radicalité, et aboutit à organiser l’impossibilité de son entente véritable – rappelons-le, Bernanos fut l’un des premiers organisateurs d’une telle impossibilité, avant de s’écarter définitivement de Charles Maurras. Ce qui ne veut pas dire, cependant, que l’œuvre de Bernanos peut être scindée en deux parties chronologiques commodément distinctes : une première partie qui serait peu recommandable, et une seconde partie qui serait plus recommandable. Cela veut dire qu’avant la révélation qui lui est faite, Bernanos se contente de lire sa propre œuvre comme une œuvre « engagée », participant de quelque héroïsme temporel ; et qu’après la révélation, il la relit comme ce qu’elle fut toujours déjà, et qu’au regard de cela, ses prises de position réactionnaire se trouvent proprement impardonnables. Aussi la parole bernanosienne est-elle proprement scandaleuse, au sens biblique qu’il convient de donner à ce terme : antidote en même temps que poison.
En prenant le chemin de la relecture, on se prépare à entendre cette parole, pour la première fois et de nouveau, dans toute l’ampleur de sa radicalité inouïe. Au bout de ce chemin, il nous apparaîtra alors que les catégories génériques traditionnellement utilisées pour lire Bernanos, qui sont les catégories de « littérature engagée », de « littérature pamphlétaire »[19] ou d’« écrit de combat », ne sont d’aucun secours pour accéder à sa parole.
[1] Georges Poulet, « Une critique d’identification », Les Chemins actuels de la critique, Paris, Plon, 1967, p. 22.
[2] Cette brève interrogation, qui sera malheureusement menée au pas de course, s’inspire, nous le verrons, de Kierkegaard, mais aussi de la dernière partie de l’ouvrage de Jérôme Thélot, Au commencement était la faim (La Versanne, Encre Marine, 2005, p. 139-175).
[3] Søren Kierkegaard, La Reprise, Paris, GF, 2008.
[4] Sébastien Lapaque, Vivre et mourir avec Georges Bernanos, Paris, Éditions de l’Escargot, 2002, p. 39.
[5] En toute rigueur kierkegaardienne, il faut donc appeler Maurras un désespéré qui s’ignore : « Tout homme qui ne se connaît pas comme esprit ou dont le moi intérieur n’a pas pris en Dieu conscience de lui-même, toute existence humaine qui ne plonge pas ainsi limpidement en Dieu, mais se fonde nébuleusement sur quelque abstraction universelle et s’y ramène (État, Nation, etc.), ou qui, aveugle sur elle-même, ne voit dans ses facultés que des énergies de source mal explicable, et accepte son moi comme une énigme rebelle à toute introspection – toute existence de ce genre, quoi qu’elle réalise d’étonnant, quoi qu’elle explique, même l’univers, quelque intensément qu’elle jouisse de la vie en esthète : même telle, elle est du désespoir » (Søren Kierkegaard, Miettes philosophies. Le concept de l’angoisse. Traité du désespoir, Paris, Gallimard, « Tel », 1990, p. 393).
[6] Ibid. p. 41.
[7] La distinction que nous opérerons à partir de maintenant entre parole du monde et parole de la vie, et que nous n’avons évidemment pas le temps de développer, est une distinction fondamentale, qui se trouve explicitée au douzième chapitre de l’ouvrage du philosophe Michel Henry C’est moi la vérité, « La Parole de Dieu, les Écritures » (Paris, Seuil, 1996, p. 269-291).
[8] Michel Henry, L’Essence de la manifestation, Paris, PUF, p. 57.
[9] Georges Bernanos, Journal d’un curé de campagne, in Œuvres romanesques complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2015, p. 349.
[10] Sébastien Lapaque, Vivre et mourir avec Georges Bernanos, op. cit., p. 113.
[11] Révocation datable officiellement, et qui a lieu le 15 mai 1932 (Voir Georges Bernanos, « Un adieu », Textes non rassemblés par Bernanos (1909-1939), in Essais et écrits de combat, I, Paris Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1971, p. 1254-1258.
[12] C’est précisément en tant qu’il a voulu « prendre position » dans l’horizon de positionnement du monde qu’il a fait trébucher sa pensée hors de sa dimension d’origine. Ce prendre-position s’appelle aussi, nous aurons l’occasion d’en reparler, l’engagement.
[13] Idem.
[14] Le mystère sur quoi repose la parole de Bernanos, qui est celui du mal, s’énonce sous la forme d’une question, que Michel Henry formule ainsi : « « Comment comprendre alors, à partir de la vie elle-même, l’émergence du processus dont elle va être chassée […] ? » (Michel Henry, La Barbarie, Paris, Grasset, 1987, p. 80).
[15] Sébastien Lapaque, Vivre et mourir avec Georges Bernanos, op. cit., p. 59. Nous soulignons.
[16] Voir Littérature et engagement. De Pascal à Sartre, Benoît Denis, Paris, Seuil, 2000.
[17] Jan Patočka, Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Paris, Verdier, 2007, p. 128-129.
[18] Georges Bernanos, Textes non rassemblés par Georges Bernanos (1938-1945), in Essais et écrits de combat, II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1995, p. 795.
[19] Voir Marc Angenot, La Parole pamphlétaire, Paris, Payot, 1982 ; ou Vincent Berthelier, Le Style réactionnaire. De Maurras à Houellebecq, Paris, Éditions Amsterdam, 2022.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.