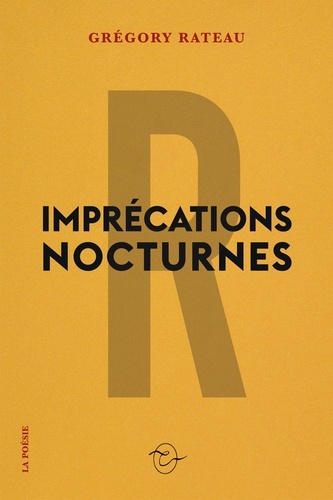Bien souvent, de nos jours, ce qui s’efforce de se présenter sous l’étiquette de poésie surjoue tellement cette appartenance qu’il y a là comme un théâtre de poses forcées, une véritable scène sur laquelle chaque grimace, chaque mimique, chaque geste sursignifie en permanence son appartenance au champ (censément divin, céleste, transgressif, rebelle) de la poésie. Conséquence inévitable : pour le lecteur qui ne fait pas partie de la « famille », il y aurait presque comme une impolitesse à demeurer en présence de pareilles splendeurs. C’est-à-dire, en somme, de poursuivre sa lecture…
Un exemple ? Un court recueil récemment paru, Imprécations nocturnes, signé Grégory Rateau (Éditions Conspiration, 2022). Déjà, il faut passer la préface, signée par un dénommé Jean-Louis Kuffer. Le type, en seulement sept pages, trouve le moyen de s’exciter cinq ou six fois (j’ai renoncé à compter) contre les « poéticiens en place » et leur « poésie poétique ». Moi je veux bien, je ne les connais pas. Mais je ne peux pas m’empêcher de penser que je suis tombé au milieu d’une bagarre entre deux bandes rivales, passablement bourrées, et dont je n’ai pas grand-chose à faire. J’en retiens tout de même qu’en poésie comme avec les chasseurs, il y a la bonne et la mauvaise, et que celles-ci n’ont rien à voir l’une avec l’autre.
Je poursuis. En exergue, une citation des Vies minuscules de Pierre Michon. Quelques lignes, quelques mots, dont celui de « rémiges » (le dictionnaire m’apprend qu’il s’agit d’un certain type de plume). Bon. Le type joue avec notre patience, à mon avis c’est délibéré. Mais je m’accroche, après tout je ne l’ai toujours pas lu, lui. Me revient à l’esprit la définition de la poésie par Paul Valéry : « La poésie est l’ambition d’un discours qui soit chargé de plus de sens, et mêlé de plus de musique que le langage ordinaire n’en porte et n’en peut porter » (« Passage de Verlaine », Variété II). Valéry en soulignait immédiatement les risques : obscurité, inanité, vague excessif. Il n’avait pas tort. On pourrait presque proposer une nouvelle définition, qui complète plutôt qu’elle n’annule la sienne. Poésie : discours capable de pousser le lecteur de bonne volonté à reposer l’ouvrage au bout de deux pages, même s’il n’en comporte que dix.
Mais je ne me laisse toujours pas décourager. Comme souvent avec ce que je n’aime pas, je veux comprendre pourquoi ça m’agace. On m’objectera que ce que je dis ne vaut peut-être que pour le susnommé Rateau, et l’on aura certainement raison. Gageons pourtant qu’il y en a bien un ou deux autres qui lui ressemblent, que l’on pourrait rassembler sous l’étiquette du style Rateau. Je parlerai donc aussi pour eux.
Trucs et astuces
Le procédé le plus évident du style Rateau, c’est l’ellipse permanente, combinée à l’évanescence programmée. On lit innocemment. Nulle aspérité pour arrêter l’avancée du lecteur, car les fragments s’enchaînent avec une apparence de sens. On pose le livre. Quelqu’un nous demande ce qu’on lit. Et, là, on est bien en peine de répondre. Alors on dit : de la poésie. Chaque petit morceau, oui, cela va, mais cet enchaînement ? Hmm… C’est comme si, derrière une apparence de sens vague, il n’y avait plus rien. (De ce point de vue, l’absence de titres, tout au long du recueil, n’aide assurément pas.)
Parfois on s’arrête, mais là c’est encore pire. Au hasard (p. 23) :
« la cendre de tes cigarillos
qui enlumine ton visage de vieux bonze »
(On notera au passage que l’auteur ne ponctue pas ses phrases la plupart du temps, mais qu’il y a quand même des virgules et des points d’exclamation de temps en temps. Il faudrait savoir !)
Feu mon ami François Ricard m’avait un jour expliqué que, du temps qu’il dirigeait la revue Liberté, il avait obtenu la chose suivante (c’était une revue québécoise subventionnée, et donc dans l’obligation de rémunérer ses contributeurs) : pour la poésie, les pages seraient payées moitié moins que pour un texte en prose. Pourquoi cela ? Eh bien parce que le vide papier que sa blancheur défend, les trois ou quatre mots émiettés sur une page entière, c’était bien gentil, et oui bien sûr ça faisait partie du discours forcément inspiré de l’auteur, de même que le silence qui suit la dernière note est encore du Mozart, etc., etc., mais enfin, on n’allait quand même pas payer pour du vide enveloppé dans du rien. Donc acte.
Et j’ai souvent repensé à cette anecdote en lisant mon Rateau. Ainsi p. 67 :
« parti
à la dérive »
Ou p. 68 :
« elle
et
moi
seuls
contre tout un chacun »
Vous l’avez entendu, vous aussi ? Le subtil coup de cymbales, à chaque blanc ? L’effet poétique sublime, le pas suspendu de la cigogne, la baguette du chef d’orchestre qui reste en l’air, captant l’attention de tous ? Pfff…
Pour finir, il y a aussi cette inévitable propension, aussi enfantine qu’irritante, à aligner des jolis mots, à inventer des périphrases, parce que c’est cela, semblerait-il, la poésie (la philosophie invente des concepts, la poésie des périphrases et des métaphores). Parfois je les comprends : « succubes du net », bon, pourquoi pas. Mais au vers suivant je tombe sur des « cloisons de la miséricorde », et là, à part si c’est pour faire son malin, franchement, je ne vois pas.
Soyons injustes : comparons
Vous me direz qu’on peut dézinguer n’importe quel texte en le citant ainsi par petits fragments (à quoi je répondrais : ne serait-il pas encore plus malhonnête de ne pas le citer du tout ?). Prenons donc un poème un peu plus long, histoire de faire preuve d’équité.
Dans ce dernier, Rateau entend un couple en train de baiser (p. 54). Il écrit :
« Du bruit, toujours du bruit
mais quand vont-ils cesser
taire leurs postillons
tout ce bonheur suppurant à travers ma cloison
plus aucune pudeur
leur enthousiasme se doit d’être partagé
et si possible à la seconde
sans égard pour mon ombre
même aux confins du cosmos
les deux oreilles percées
par l’absence de gravité
j’entends leurs gémissements (…) »
Je vous épargne les deux dernières strophes. Bon, déjà, il y a ce « bonheur suppurant » : typiquement le genre de trouvaille qu’il vaut mieux garder pour soi, la fausse bonne idée qui tire le lecteur par la manche pour bien faire voir combien elle est poétique.
Mais surtout : à titre de comparaison, je me permets de citer cette jolie prose de Petr Kral, parue il y a quelques années, à peu près sur le même sujet. Cela s’appelle « La femme inconnue » (c’était dans un recueil intitulé Notions de base) :
« Quand une femme inconnue, la nuit, se met à hurler sous le corps inconnu d’un homme, à l’étage de dessus ou en face, elle veut montrer combien elle est contente et nous rendre jaloux, mais elle s’offre tout autant à nous, du même élan. Le cri qu’elle fait jaillir en plein silence nous révèle en même temps la nuit, alentour, comme une étendue dont nous faisons partie et où nous-mêmes pratiquons la chose au milieu des autres, comme dans un dortoir commun. Le cri, en apparence adressé au seul amant, échappe à son étreinte et se tourne inexorablement vers nous – ou plutôt vers personne, pas plus vers nous que vers l’amant, seulement vers l’omniprésent cosmos. »
Rigolo, tiens, on retrouve le cosmos dans les deux poèmes. À une différence près : chez Rateau, la pénible recherche du style et de l’originalité (« taire leurs postillons », « sans égard pour mon ombre », etc.) ne débouche sur aucune découverte, aucune connaissance, face à cette situation si banale, si excitante et agaçante à la fois. On assiste juste aux efforts d’un type qui veut à tout prix faire poétique. Chez Kral à l’inverse, la recherche stylistique à tout crin disparaît. Et la situation humaine se dévoile. Sans effort, elle est là : palpable, audible, sensible. Surtout, une signification émerge. La trouvaille n’est plus tant verbale qu’existentielle. Poésie poéticienne, dirait Kuffer ? Peut-être. En tout cas je m’en souviens encore, des années après l’avoir lue. Pas sûr que le style Rateau produise le même effet.
De l’avantage des petits ouvrages
Mais l’on me trouvera bien vain de m’acharner ainsi sur un petit ouvrage qui, somme toute, ne m’a rien fait. Un ouvrage si peu épais (80 pages) que, s’il devait par malheur m’échapper des mains, il ne pourrait guère me faire de mal en me tombant sur l’orteil. Il faut dire que j’ai eu la curiosité de survoler, avant d’en attaquer la lecture, les critiques dithyrambiques auxquelles il a déjà eu droit. Imaginez ma déception, ensuite !
Et puis, dans le fond, qui publie s’expose à la critique, et c’est faire preuve d’amour pour la poésie que de la croire capable de mieux que cela, capable aussi d’être louée quand elle le mérite, et blâmée quand elle ne vaut pas grand-chose. Le vague, le faussement inspiré, les mots-pour-faire-joli, tout cela ressemble trop à une caricature de poésie adolescente pour qu’on n’en fasse pas la remarque.
Une note positive pour terminer, tout de même ? Oui. Rateau a l’air d’aimer les cendriers, il en parle à deux ou trois reprises. Un bon point pour lui : il a laissé la porte ouverte à un peu de concret. Il devrait effacer tout le reste, et repartir de là.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.