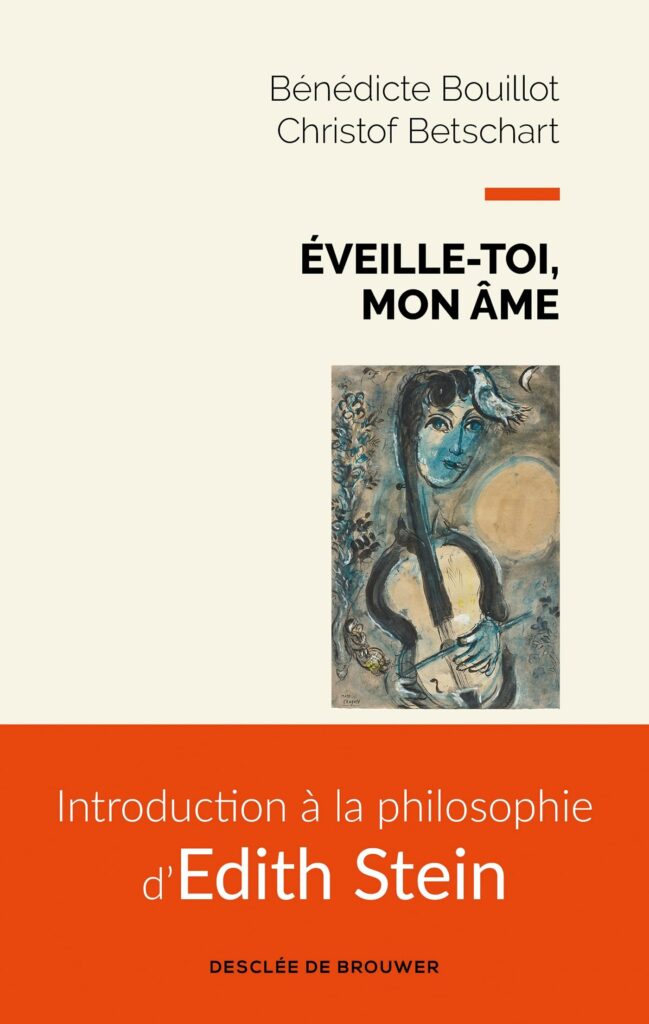Le 11 août 1998, le pape Jean-Paul II déclarait sainte la philosophe Edith Stein. Marquée à la fois par la phénoménologie de Husserl et la théologie de saint Thomas d’Aquin, cette dernière fut également un témoin des convulsions du XXe siècle, qui la mèneront jusqu’à Auschwitz. Bénédicte Bouillot, professeur de philosophie aux Facultés Loyola Paris et spécialiste de Stein, nous explique comment celle-ci a défendu une métaphysique de l’âme, alors même que triomphaient ses négations totalitaires.
PHILITT : En 2023, vous avez publié un livre consacré à Edith Stein, intitulé Éveille-toi, mon âme. Qu’est-ce qui vous a attiré dans la vie et la pensée de cette intellectuelle, à la fois philosophe et religieuse ?
Bénédicte Bouillot : Edith Stein naît en 1891 en Prusse, dans une famille juive. Son intérêt pour l’âme s’éveille dès l’enfance : dans son autobiographie, Vie d’une famille juive, elle raconte avoir été sensible très jeune à ce monde caché au plus profond d’elle-même, et évoque ce désir qui l’a animée très tôt de connaître l’âme humaine, celle des individus et celle des peuples. Elle s’oriente ainsi d’abord vers des études d’histoire et de psychologie, puis découvre la phénoménologie à travers la lecture du 2e volume des Recherches logiques d’Edmund Husserl. Immédiatement séduite par cette nouvelle démarche philosophique consistant à « revenir aux choses mêmes », et convaincue que Husserl est « le philosophe de son temps », elle décide de le rejoindre à Göttingen où il a sa chaire de philosophie, laissant sa famille et la thèse de psychologie qu’elle avait entreprise.
Cette décision est très caractéristique de la liberté intérieure qui motive ses choix tout au long de sa vie : de cette capacité qu’a Edith Stein à sentir intérieurement un appel à travers les événements, et à y répondre avec une grande détermination. « À ce moment, comme si souvent plus tard, dit-elle, je pus d’un léger mouvement secouer les attaches les plus fortes en apparence, et m’envoler comme un oiseau qui a échappé au piège ». L’appel de la vérité n’a rien chez elle de purement théorique ou abstrait, mais la conduit à des décisions qui engagent concrètement son existence.
Stein choisit donc de faire sa thèse avec Husserl, qui est l’un des grands philosophes du XXe siècle. Quelle influence la phénoménologie husserlienne a-t-elle eu sur elle, en particulier sur sa conversion au catholicisme ?
Quand elle rejoint Husserl à Göttingen en 1913, Stein a pris ses distances par rapport à la foi juive ; ce qu’elle en avait alors perçu ne comblait pas ses attentes intellectuelles ni spirituelles. Elle n’en poursuit pas moins sa quête de sens et de vérité, à travers la psychologie notamment. Mais déçue par cette science encore toute récente, qui lui semble manquer de rigueur et de fondement, elle s’enthousiasme pour l’entreprise de refondation radicale du savoir engagée par Husserl par la démarche phénoménologique qui a pour principe de s’en tenir à la description rigoureuse du donné. Il s’agit en effet de se soumettre aux phénomènes sans a priori ; d’accueillir ce qui se donne sans imposer sa loi aux choses, mais en recevant cette loi des choses mêmes. Edith Stein a été fortement impressionnée par la manière dont Husserl mettait en œuvre ces exigences, dans une attention sans concession au réel. Il « se donnait le plus grand mal, rapporte-t-elle, pour inculquer [à ses étudiants] une objectivité rigoureuse qui allait au fond des problèmes, une “honnêteté radicale” » ; cette rigueur a permis à beaucoup d’entre eux de « se libérer des préjugés », de « se désentraver de ce qui rendait insensible à des intuitions nouvelles » et « [les] a rendus disponibles pour la vérité religieuse ».
Lui offrant des yeux neufs pour regarder le réel, la phénoménologie amène donc aussi Stein à découvrir la foi comme phénomène auquel, par probité intellectuelle, le phénoménologue ne peut pas ne pas prêter attention, quoi qu’il en soit de sa foi personnelle. À propos des cours de Max Scheler, elle témoigne de la manière dont la phénoménologie l’a « contrainte » à s’ouvrir à une région de phénomènes auxquels elle était totalement indifférente jusqu’alors : « Cela ne me conduisit pas encore à la foi, mais ouvrit pour moi un domaine de “phénomènes” devant lesquels désormais je ne pouvais plus passer en aveugle. […] Les barrières des préjugés rationalistes dans lesquels j’avais grandi sans le savoir tombèrent et l’univers de la foi apparut soudain devant moi ». Edith Stein s’engage donc dans la lecture des mystiques, pour comprendre phénoménologiquement le vécu de foi, ce qui la conduira, une nuit de juin 1921, à la lecture de l’autobiographie de Thérèse d’Avila : l’événement décisif qui l’incite à demander le baptême.
Comment Stein passe-t-elle alors de Husserl à la scolastique et à la métaphysique?
Son adhésion au catholicisme introduit ipso facto Stein dans un milieu intellectuel marqué à cette époque par la scolastique et la pensée de Thomas d’Aquin. Dans les années 30, notamment dans L’Être fini et l’être éternel, elle élabore ainsi une ontologie originale, à travers une confrontation avec Aristote et Thomas d’Aquin, mais aussi Husserl et Heidegger. Si le point de départ de sa démarche est bien phénoménologique, Stein établit la nécessité, en partant de l’être immanent du moi, d’une « percée »vers différents niveaux de transcendance, jusqu’à la transcendance absolue de Dieu, plénitude de sens et d’existence. La démarche philosophique se voit ainsi reconfigurée : d’« égocentrique », elle devient théocentrique, son centre n’étant plus le « je suis » transcendantal, mais le « Je suis » divin, clé de déchiffrement du réel.
Une telle démarche ne consiste en rien en un retour à une « métaphysique naïve », puisqu’elle cherche à établir un lien de continuité entre phénoménologie et métaphysique, à travers une « hyperphénoménologie » qui, loin de se fonder sur des spéculations purement abstraites, vient prolonger la démarche initiée par la phénoménologie : elle poursuit l’étude des objets et problèmes auxquels la phénoménologie a elle-même mené, sans pouvoir les épuiser. Une telle démarche renouvelle profondément la métaphysique en préservant ce contact immédiat avec les choses qui est « l’air vital » de la phénoménologie. C’est par ce retour au sens vécu que la démarche d’Edith Stein vient renouveler l’appréhension des notions de la scolastique.
Mais cette lecture renouvelée de la scolastique s’accompagne également chez Stein d’un grand intérêt pour la mystique. Comment concilie-t-elle cet intérêt avec sa démarche philosophique ? On a plutôt tendance en effet à opposer philosophie et mystique.
C’est encore ce souci de se laisser instruire par l’expérience qui conduit Edith Stein à accorder une place de choix à la mystique à l’intérieur de la conception originale qu’elle élabore de la philosophie chrétienne. Elle juge en effet que la philosophie peut s’autoriser à prendre ponctuellement en considération les données révélées quand, ayant épuisé ses ressources, elle se heurte aux limites du pensable. La Révélation ouvre alors un horizon de pensée qui relance la dynamique philosophique, sans la transformer en théologie : « la philosophie s’accomplit par la théologie et non comme théologie ». Car bien que rationnelle, la proposition de foi ne s’impose pas philosophiquement comme une « intellection nécessaire et contraignante ». Elle ouvre simplement « les perspectives d’une solution possible au-delà des bornes philosophiques ». Les données révélées se présentent ainsi, non comme des données de foi, mais comme des « hypothèses », des possibilités de sens auxquelles il est possible de reconnaître une rationalité et une fécondité philosophiques. Pour qui ne considère pas ces données de foi comme révélées, celles-ci peuvent être révélantes, donnant davantage à penser.
Or Edith Stein effectue, à l’intérieur de la Révélation, une distinction entre foi et mystique. Si la foi est une connaissance encore obscure, l’expérience mystique apparaît comme « la confirmation expérimentale de ce qu’enseigne la foi » : « la présence de Dieu dans l’âme ». Ainsi envisagée, elle peut être comprise comme le remplissement de ce que la foi vise sur le mode d’une attente encore vide. En ce sens, il est légitime, selon Edith Stein, de parler d’une « science expérimentale des saints », correspondant au savoir le plus élevé que l’homme puisse atteindre. La considération de ce savoir constitue alors un « auxiliaire puissant de la recherche philosophique » selon la formule de Bergson.
Votre livre porte sur la défense qu’a faite Stein de la notion traditionnelle d’âme. Pourtant, s’il y a bien une notion de la pensée ancienne qui semble aujourd’hui archaïque, c’est bien celle-là !
La notion d’âme, au XXe siècle, a été remise en cause aussi bien par des courants matérialistes ou réductionnistes cherchant à ramener le psychisme à des conditionnements (neuronaux ou autres), que par des pensées existentialistes soucieuses au contraire de valoriser la spécificité de la subjectivité humaine. Il a ainsi été reproché à la notion d’âme d’être déduite d’une métaphysique abstraite ne rendant pas compte de l’existence réelle.
De ce point de vue, l’intérêt de l’approche steinienne est de repartir de l’expérience et de faire apparaître en quoi l’âme n’est pas « une inconnue X », mais au contraire « quelque chose qui peut nous apparaître et se faire sentir, tout en restant toujours plein de mystère ». Elle met ainsi en lumière la réalité de l’âme à partir d’une attention particulière à la dimension affective de notre rapport au monde. Dans le sentiment, à la différence de la simple perception ou de la connaissance pure, le “Je” ne peut pas s’oublier : il se sent impliqué. En sentant quelque chose, “Je” me sens moi-même être affecté. Or le sentiment est toujours aussi le sentir d’une valeur, et les valeurs sont elles-mêmes corrélées à des couches de profondeurs en nous. Nous sentons que la douleur liée à une perte, par exemple, émane de couches intérieures plus ou moins profondes selon la valeur de l’objet disparu : la perte d’un bijou affecte une couche intérieure moins profonde que s’il s’agit d’un bijou offert par un être cher, et a fortiori si cet être cher a disparu. Se découvre ainsi un « espace intérieur », formé de couches de profondeur qui se dévoilent à nous à la faveur de nos expériences, à condition d’être dans une disposition d’ouverture et d’accueil.
Il a aussi été reproché à l’âme de favoriser, dans son opposition au corps, un dualisme qui empêcherait de penser la vie humaine dans son unité concrète. Or Edith Stein, précisément, ne pense pas en termes d’âme et de corps, mais selon une triade corps/âme/esprit, l’âme assurant précisément l’unité des trois : si le corps (par les sens) et l’esprit (comme « sortie en dehors de soi», ouverture à une altérité : celle du monde objectif, d’autrui, etc.) nous ouvrent à la réalité extérieure, par l’âme, cette réalité est ressentie, intériorisée, faite « chair et sang ». Or c’est dans ce double mouvement d’ouverture au monde et d’intériorisation que se déchiffre le sens du monde qui s’offre à nous, et que l’on peut ainsi y exercer sa liberté, à partir d’une volonté qui se creuse dans cet espace intérieur. C’est dans ce processus dynamique que la personnalité se façonne.
Stein a vu la république de Weimar devenir le IIIe Reich. Cette expérience directe de l’émergence du totalitarisme a-t-elle pu jouer un rôle dans son intérêt pour l’âme ?
Dans l’âme se discerne le sens et la valeur de ce qui se présente, et cela d’une manière qui, tout en impliquant le raisonnement, engage aussi l’affectivité profonde. L’on peut en effet être très informé, ou raisonner de manière très rigoureuse et objective sur les événements, sans pourtant se laisser toucher personnellement par eux, sans s’ouvrir véritablement à leur présence, sans les accueillir comme ils le méritent, ni donc y répondre de manière ajustée. Un discernement libre n’est pas un algorithme, c’est-à-dire un simple calcul capable de prendre en compte tous les paramètres possibles d’une situation.
C’est ainsi à partir de l’âme que les situations et les relations peuvent être vécues au niveau de profondeur qu’elles méritent. Cela, chacun à sa manière propre. Car si les valeurs possèdent une objectivité – par quoi un partage et une éthique sont possibles –, le rapport entretenu avec elles est marqué par la singularité propre de chacun – le noyau de l’âme. L’accueil des valeurs dans l’âme, la signification qu’elles revêtent, la manière dont elles sont assumées et attestées dans une existence, le type d’action et de création qu’elles suscitent, tout cela est irréductiblement marqué par une couleur propre – ce qui confère à chacun une place et une responsabilité uniques dans le monde. « Ce n’est qu’à partir [de son point le plus profond] que l’âme peut se “rassembler”, écrit-elle, car il n’existe pas d’autre point à partir duquel elle pourrait s’embrasser entièrement. Ce n’est qu’à partir de là qu’elle peut prendre des décisions importantes, qu’elle peut s’engager pour quelque chose, qu’elle peut s’abandonner, se donner. Autant d’actes de la personne. C’est moi qui dois prendre des décisions, m’engager, etc ».
Toute la vie de Stein témoigne de cette recherche inlassable, libre et sans concession de la vérité ; son parcours reflète une unité profonde entre la pensée et la vie – unité qui est précisément l’expression de cette vie de l’âme, au cœur de sa réflexion : « Mes travaux ne sont jamais que des précipités de ce qui m’a occupée dans la vie, car je suis ainsi faite qu’il me faut réfléchir à ce qui fait ma vie. » La vie alimente la réflexion, qui permet en retour d’éclairer le sens des choses et de trouver des chemins de vie, d’espérance et de liberté, y compris dans les situations tragiques qu’elle a pu connaître : la Première guerre mondiale, qui la voit s’engager comme infirmière, au risque de sa vie, auprès de soldats malades du typhus ; la montée du nazisme qui la conduit à écrire au pape Pie XI en 1933, pour dénoncer l’ « hérésie ouverte » et l’« idolâtrie » que représente l’idéologie nazie, après avoir clairement critiqué l’anthropologie nazie dans ses cours ; la Deuxième guerre mondiale, qui entraînera sa disparition tragique dans les chambres à gaz d’Auschwitz, mais sans que, d’une certaine manière, elle subisse son sort, elle qui, à la question : « Qui changera cette faute effroyable du peuple allemand contre le peuple juif, en bénédiction pour les deux peuples ? » répondit : « Ceux qui ne permettent pas que les blessures ouvertes par la haine donnent naissance à une haine nouvelle, mais qui, bien qu’ils en soient eux-mêmes victimes, prendront sur eux la souffrance de ceux que frappe la haine et celle de ceux qui haïssent ».
La canonisation de Stein en 1998 a entériné son importance dans la pensée catholique contemporaine. Mais a-t-elle eu le même impact dans le champ philosophique ?
Il est difficile encore d’évaluer l’influence de la pensée d’Edith Stein en philosophie. Dans le contexte français de laïcité, sa canonisation a incontestablement été un frein à son étude dans l’université plutôt qu’un encouragement. Aujourd’hui, sa pensée suscite un intérêt croissant, à en croire le nombre de doctorats qui lui sont consacrés. L’originalité de sa démarche qui croise avec rigueur et audace les disciplines, comme les thèmes qu’elle a abordés souvent en avant-gardiste (la question du prolongement herméneutique et métaphysique de la phénoménologie, la critique philosophique de Heidegger, le renouvellement de l’articulation entre philosophie et théologie par rapport au modèle thomasien, la question du fondement et du sens de la différence sexuée, etc.) trouvent une résonance extrêmement actuelle y compris dans les milieux universitaires où elle a longtemps été ignorée.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.