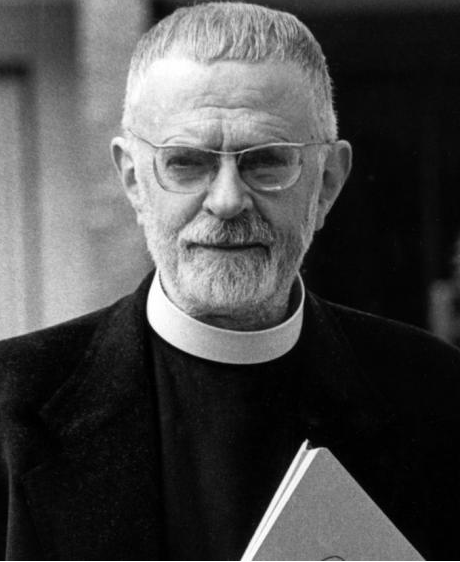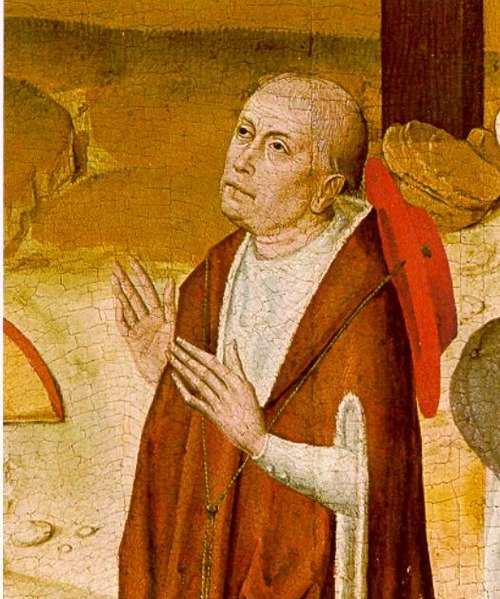Un pontificat s’est achevé, un autre s’est ouvert, inaugurant une page nouvelle de la grande histoire d’une Église catholique à la croisée des chemins. À une institution aux fondements ébranlés par le déploiement d’une modernité déjà sur le déclin, mais produisant dans son agonie ses ultimes effets destructeurs, semble être aujourd’hui proposée une voie ecclésiale se présentant comme une synthèse : l’harmonie entre transcendance et immanence, c’est-à-dire entre la sacralité du culte liturgique et le souci pour les pauvres et pour la Création, dans la continuité avec l’antique esprit de saint Paul centré sur le Christ total.
L’histoire du catholicisme moderne telle qu’il se présente depuis la période dite « Renaissance », peut être décrite en utilisant différentes analogies. Dans son pamphlet décapant, au titre volontairement provocateur, La Décomposition du catholicisme, publié en 1968, le grand théologien Louis Bouyer, oratorien converti du luthéranisme et ami proche du pape Paul VI, dressait un diagnostic implacable de ce qu’était devenu l’Église catholique depuis la fin du Moyen Âge. La profonde crise religieuse que connut l’Occident à partir du XIVe siècle suscita en effet selon lui une double réaction : d’une part, la Réforme protestante inaugura une recomposition radicale des formes religieuses, sur la base d’une mentalité moderne marquée par le subjectivisme, l’individualisme et le primat de la conscience individuelle sur l’autorité.
D’autre part, à ce mouvement de recomposition répondit la Réforme catholique, qui, elle, engagea l’institution catholique dans une voie qui, tout en se donnant pour objectif de préserver l’essentiel des données de la Révélation, l’éloigna des subtils équilibres que l’âge patristique et le Moyen Âge avaient, sur la base de la plénitude originelle de la ferveur apostolique, su développer et faire parvenir à maturation. À l’esprit moderne de contestation et de libre-examen, répondit peu à peu, dans une Église se raidissant progressivement sous les coups de boutoir de la Réforme puis des remises en cause des Lumières, de la Révolution et du modernisme prétendument scientifique, un juridisme non moins moderne et sclérosant pour la vie de l’Esprit, un moralisme étouffant pour celle de l’âme, ainsi qu’une « absolutisation de l’autorité » sur la base d’une « ecclésiologie de pouvoir » dont la Papauté, ultra-centralisatrice, devenait progressivement la clé de voûte et le verrou ultime. Ce processus de réaction, malgré toutes les richesses authentiquement religieuses qui l’ont accompagné et dont la valeur est indéniable, n’en a pas moins opéré la transformation progressive de l’Ecclesia patristique et médiévale, fondée sur une ecclésiologie de communion dans la foi et la charité, en un catholicisme (terme dont Bouyer relève bien l’apparition tardive dans l’histoire, à partir du XVIIe siècle) moderne, c’est-à-dire en un système religieux rigide, artificiel et vide, dont la sécheresse dissimulait de plus en plus mal un affaissement profond de l’authentique spiritualité chrétienne.
Vers une troisième voie
En provoquant l’évaporation brutale du « corset » qui enserrait artificiellement le corps ecclésial depuis la Contre-Réforme, la réforme de Vatican II, au milieu des années 1960, n’a fait que révéler au grand jour la vacuité et l’impasse du modèle post-tridentin. À la rigidité cadavérique du système « catholiciste » moderne succéda la décomposition post-moderne véhiculée par le progressisme ecclésial, qui, s’inscrivant dans un contexte plus global de liquéfaction des sociétés occidentales (cf. le concept de « société liquide » analysé par Zygmunt Bauman), se révéla être un puissant agent dissolvant des structures rigides de la modernité religieuse.
Cet effondrement, qu’il n’est pas exagéré de qualifier « d’apocalyptique » tellement il est révélateur d’une très profonde crise de l’institution ecclésiale, a selon Bouyer puissamment contribué à « polariser » toute la vie ecclésiale entre deux tendances apparemment contraires. À un conservatisme traditionaliste nostalgique des structures rigides de la modernité post-tridentine, dont Bouyer ne percevait que vaguement qu’elles avaient su, sous une forme anémiée et sclérosée, préserver « quelque chose » de la foi vivante des premiers siècles, s’oppose un progressisme de plus en plus radical, car trop conscient de l’impossibilité de continuer à tenir pour immuables certaines réalités institutionnelles dont les développements de la démarche historico-critique ont largement démontré l’apparition tardive. C’est dans le contexte de cette impasse, apparemment insoluble, entre un conservatisme sclérosé et un progressisme dissolvant qu’une « troisième voie » s’avère nécessaire. Comme l’écrivait Carl Joseph Jung dans son ouvrage Synchronicité et Paracelsica, « tous les problèmes les plus importants de la vie sont fondamentalement insolubles. […] Ils ne peuvent jamais être résolus mais seulement surpassés. Ce “surpassement” montre, après un examen plus attentif, qu’ils nécessitent un nouveau niveau de conscience. […] Il n’est pas résolu logiquement en ses propres termes, mais disparaît lorsqu’il est confronté à une force de vie nouvelle et plus puissante ». En se présentant comme un pape de synthèse entre le souci de la tradition qui a caractérisé le pontificat de Benoit XVI, et la sollicitude pastorale vers les « périphéries » qui fut la marque de celui de François, le nouveau pape Léon XIV semble résolument engager l’Église dans cette troisième voie.
Le premier millénaire, nous l’avons évoqué, constitue une période fondatrice pour le christianisme. Ayant reçu par tradition la révélation christique dans sa plénitude de la bouche même des apôtres, les Pères apostoliques, puis à leur suite les grands docteurs d’Orient et d’Occident qui se sont succédés dans les siècles qui ont suivi, ont peu à peu fait fructifier le dépôt originel, sachant en tirer de riches potentialités et d’audacieux développements, tout en s’inscrivant dans une parfaite fidélité avec l’esprit des origines. Ce christianisme ancien n’était certes pas partout vécu dans toute son orthodoxie, mais, sans représenter « l’âge d’or » décrit par certains, il constituait une doctrine complète, cohérente, équilibrée et unifiée, ignorant les absurdes polarisations ultérieures entre droite et gauche, entre progressisme et conservatisme. Le symbolisme cosmique vécu dans le culte, qui, notamment par l’orientation de la prière, unifiait la louange humaine aux rythmes naturels de la Création, nourrissait une spiritualité aussi simple que profonde, intégrant l’homme dans son cadre naturel, loin de la piété artificielle, psychique et de plus en plus coupée de la nature qui apparut – en Occident seulement – à partir de la désacralisation du Cosmos accompagnant la révolution copernico-galiléenne.
Pour Dieu, pour les pauvres
L’enseignement de saint Paul faisant de l’homme lui-même le temple et le sanctuaire du culte nouveau se manifestait à la fois dans la splendeur de la liturgie, et en même temps et sans contradiction à travers le service des démunis et la lutte contre les injustices ; sur le plan ecclésiologique, l’Église universelle se présentait comme une communion d’Églises locales possédant chacune sa tradition liturgique et théologique propre, sa propre consistance et sa propre vie communautaire : unité vivante de la foi dans la diversité des communautés, des traditions et des usages, bien loin de l’uniformité purement extérieure, administrative et centralisatrice qui prévaut toujours aujourd’hui. Ainsi, l’équilibre patristique porte en germe la conjugaison harmonieuse du souci de la vérité doctrinale avec la préoccupation écologique, du culte rendu à la transcendance divine avec le soin du pauvre et le combat en faveur des exclus.
Le retour, sous une forme sans doute nouvelle, à ces équilibres antiques, que la modernité occidentale a peu à peu détruits, pourrait bien constituer l’objectif du nouveau pontificat. La restauration des ornements symbolisant la fonction pétrinienne, largement abandonnés par le pontificat précédent, l’ouverture prudente sur une synodalité bien comprise, la mise sur un pied d’égalité protocolaire de l’Évêque de Rome avec les patriarches catholiques Orientaux sur le tombeau de l’apôtre Pierre le jour de l’inauguration du pontificat, illustrant le retour à une ecclésiologie de communion, le discours aux Églises orientales louant leur approche liturgique axée sur la mystagogie et le mystère, présentés comme exemplaires et nécessaires pour revitaliser un Occident chrétien spirituellement anémié, enfin et surtout le christocentrisme des premières homélies – faisant par ailleurs de fréquentes références aux Pères de l’Église ancienne, notamment saint Ignace d’Antioche et saint Augustin –, semblent bien révéler la conscience, chez le pape Léon XIV, de la nécessité pour l’Église de retrouver « cette force de vie nouvelle et plus puissante » évoquée par Jung, qui déjà avait expliqué la croissance rapide du christianisme primitif, et seule susceptible de faire sortir le corps ecclésial, par un « surpassement » dépassant les oppositions artificielles, de l’impasse dans lequel il semble irrémédiablement plongé.
Ce « surpassement » est d’abord et surtout un recentrement, d’où l’importance décisive de cette restauration du christocentrisme dans la prédication pontificale. La symbolique du cercle et de son Centre, largement développée par certains auteurs comme Frithjof Schuon, permet de comprendre cette question absolument cruciale. Le Centre du cercle, c’est à la fois le noyau primordial, l’Origine et la Source de la Révélation : le Christ, c’est-à-dire, selon la théologie catholique la plus orthodoxe, le Verbe de Dieu tel qu’il est entré dans notre monde, illuminant l’espace, le temps et l’histoire. Toute l’histoire de l’Eglise, et plus globalement du christianisme, n’est que l’histoire des développements issus de ce centre primordial. Mais l’histoire de ces développements est aussi l’histoire d’un éloignement croissant de la Source originelle. Le phénomène de polarisation croissante de la vie ecclésiale entre progressisme et conservatisme que nous constatons depuis plus d’un demi-siècle ne s’explique que par l’éloignement toujours plus croissant du corps ecclésial par rapport à ce centre qu’est le Christ, ayant pour effet d’accroitre toujours l’opposition entre ces pôles antagonistes.
Revenir au Centre
Loin de relever d’un symbolisme artificiel extrinsèque au vocabulaire de la théologie chrétienne traditionnelle, ce symbolisme était déjà au cœur de l’enseignement des Pères du premier millénaire. Ainsi, au VIe siècle, saint Dorothée de Gaza écrivait dans ces Instructions : « Imaginez que le monde soit un cercle, que le centre soit Dieu, et que les rayons soient les différentes manières de vivre des hommes. Quand ceux qui, désirant approcher Dieu, marchent vers le milieu du cercle, ils se rapprochent les uns des autres en même temps que de Dieu. Plus ils s’approchent de Dieu, plus ils s’approchent les uns des autres. Et plus ils s’approchent les uns des autres, plus ils s’approchent de Dieu ». Au centre, c’est-à-dire dans le Christ, est l’unité et la communion, et toute l’histoire de l’Église, et plus globalement du christianisme, n’est que l’histoire des développements issus de ce centre primordial. Mais l’histoire de ces développements est aussi, surtout à partir de l’avènement de la Modernité à la fin du Moyen Âge, l’histoire d’un éloignement croissant de la Source primordiale et des équilibres patristiques. Le phénomène de polarisation croissante de la vie ecclésiale, d’abord entre « Orient » et « Occident », puis entre « protestantisme » et « catholicisme », enfin à l’intérieur même de ce dernier entre « progressisme » et « conservatisme » que nous constatons depuis plus d’un demi-siècle, ne s’explique que par l’éloignement toujours plus croissant du corps ecclésial par rapport à ce centre qu’est la Révélation christique, éloignement ayant pour effet d’accroitre toujours l’opposition entre ces pôles antagonistes, au point de les rendre radicalement incompatibles.
Loin d’être un « centrisme » au sens bassement politique du terme, ce Centre, en effet, est le lieu où tout se réconcilie et où tout se réunifie, il est le lieu de cette coincidentia oppositorum dont la philosophie antique avec Platon et les Pythagoriciens, puis la pensée médiévale avec Nicolas de Cues, avait déjà eu l’intuition fondamentale. Ainsi, c’est dans, et uniquement dans son Centre, sa Source, son Origine, c’est-à-dire dans le Christ, alpha et omega, origine et accomplissement de tout, plénitude originelle qui, après s’être divisée, se rejoint ultimement dans la plénitude eschatologique, qu’une Église fracturée et anémiée pourra trouver la force de vie créatrice qui lui permettra de se restaurer et de poursuivre sa mission à travers les vicissitudes de l’histoire.
Or, c’est bien cette notion de plénitude, bien plus que celle d’une simple étiquette confessionnelle, que recouvre l’appellation « catholique ». Catholicus en latin, Katholikos en grec, signifie « général, universel » ; l’adjectif est dérivé de l’adverbe katholon, « d’ensemble, en général », formé sur holos, « qui forme un tout, entier, tout entier ». Loin d’être l’affirmation aveugle de certitudes factices et d’une vérité partielle et donc partiale, la vérité catholique est donc une vérité de plénitude. Cette vérité de plénitude suppose l’ouverture sur la vérité universelle telle qu’elle s’exprime, à des degrés divers, dans toutes les traditions religieuses, et, en même temps, dans le même mouvement, réaffirmation sereine et radicale de cette « plénitude de la vie religieuse » qu’a inauguré le Christ, et dont l’Église revendique légitimement le monopole depuis vingt siècles.
« À qui veut régénérer une société en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines », écrivait en 1891 le pape Léon XIII, dans son encyclique Rerum Novarum. Le 31 octobre 1517, Martin Luther, alors religieux de l’ordre mendiant des Augustins, placardait sur les portes de l’église de Wittemberg ses 95 thèses, inaugurant ainsi un processus de révolution religieuse qui allait polariser la vie de l’Occident durant plus de cinq cent ans. Nous ne pouvons-nous empêcher de voir, dans l’élection au souverain pontificat, cinq siècles après la Réforme, d’un homme appartenant à la même famille religieuse augustinienne, plus qu’une coïncidence. Le moine augustin Luther fut celui qui brisa l’unité de la Chrétienté médiévale, inaugurant la modernité religieuse. Puisse le moine augustin devenu le pape Léon XIV aider l’Église et le monde, par le dépassement catholique des contraires, à retrouver l’unité perdue des origines.
Georges Alswiller
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.