Économiste et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Jacques Sapir est un spécialiste de la Russie contemporaine. Connu pour ses positions contre la monnaie unique et pour la démondialisation, il est l’auteur de l’influent blog RussEurope, où il développe notamment, au gré de notes théoriques et de billets politiques, une réflexion sur l’État et la souveraineté au XXIe siècle.
PHILITT : La Russie post-soviétique retrouve, à la faveur de la guerre en Syrie, une certaine prépondérance dans les affaires internationales. Comment analysez-vous cette évolution, d’un point de vue historique ?
Jacques Sapir : Deux approches sont possibles : la première consiste à dire que la géographie impose à un pays sa politique étrangère. Dans la mesure où la Russie est un pays-continent, elle est partie prenante aux affaires européennes, à celles du Moyen-Orient via le Caucase et à celles de l’Asie du Sud-Est. Il convient de savoir que sa frontière en Asie est stabilisée depuis Ivan le Terrible et la Russie a été impliquée, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans toute une série de conflits comme la guerre russo-japonaise de 1904-1905 par exemple. Au Moyen-Orient, les liens avec les régions russes du Nord-Caucase sont importants, d’un point de vue historique, politique ou religieux. La géographie impose à la Russie un certain type de politique étrangère. Il y a bien un déterminisme géographique. Il y a également un déterminisme politique : la Russie a toujours voulu être présente à la fois en Europe, au Proche-Orient et plus tardivement en Extrême-Orient. La flotte russe était présente en Méditerranée au moment de la Révolution française puis des guerres napoléoniennes, avec pour base la Crète. Elle s’est beaucoup tournée vers la Palestine au XIXe siècle, quand le pèlerinage à Jérusalem a pris de l’importance dans la religion orthodoxe, auquel plusieurs grands auteurs ont participé d’ailleurs. Une pesanteur historique attire la Russie vers ces régions.
Maintenant, quand on observe la politique de ces dernières années, il faut comprendre que l’effacement de la Russie que l’on a connu de la fin des années 1980 à la fin des années 1990 était une période anormale : la Russie a toujours été naturellement présente dans les affaires internationales, rappelons-nous qu’elle était présente en Italie de 1798 à 1901 ! On est en train de revenir à la normale, dans la mesure où la Russie n’est que l’une des puissances du monde et n’aspire plus à être dans un duopole avec les États-Unis, pas plus que la Chine d’ailleurs. Les dirigeants russes l’ont bien compris, ils ont été vaccinés par ce qu’il s’est passé dans les années 1970, quand, on le sait aujourd’hui, on n’est pas passé loin d’une nouvelle guerre mondiale. Voilà pourquoi ils parlent aujourd’hui d’un monde multipolaire. La Russie revient donc, peut-être sans en avoir complètement conscience, à une situation analogue à celle de la fin du XIXe siècle : elle est une des grandes puissances, elle n’est certainement pas une hyperpuissance, et elle n’a aucun désir de se poser en alternative aux États-Unis.
Quel est le rôle de Vladimir Poutine dans cette évolution ?
Il faut distinguer trois Poutine: le symbole, le dirigeant, et l’homme. On a toujours tendance, hors de Russie, à confondre les trois, alors que les Russes savent très bien les distinguer. L’homme Poutine est un dirigeant occidentalisé, qui a eu une expérience importante de vie et de travail hors de Russie, en tant qu’agent du KGB en RDA ayant fait des missions en RFA. Il a donc vu le monde hors du système soviétique, ce qui est très rare pour des hommes de sa génération. Il s’est d’ailleurs entouré de gens qui ont justement cette expérience, tel Igor Setchine. Poutine est en réalité probablement le plus pro-occidental de tous les dirigeants de la Russie.
Le dirigeant Poutine est, quant à lui, amené à passer des compromis avec les différentes forces politiques qui existent en Russie. L’image d’un Poutine tout-puissant est une aberration, qui ne correspond pas à la réalité. Il défend bien sûr une ligne politique, mais comprend qu’il doit par moment passer des compromis plus ou moins importants, avec des groupes sociaux ou au sein de son parti, entre la tendance libérale et la tendance dite « eurasienne ». Poutine est constamment en négociation, il est un vrai dirigeant politique qui sait qu’il doit construire et sans cesse reconstruire sa légitimité. Il sait qu’une réaffirmation raisonnable du rôle de la Russie lui confère une légitimité particulière, mais il comprend également le fait que la politique internationale a besoin de normes. Or le grand souci aujourd’hui est la destruction progressive des normes qui vient notamment de la politique américaine. Cela pose un vrai problème aux Russes ; toute personne proche de la diplomatie russe vous dira à un moment donné qu’on ne peut pas gérer les affaires internationales sans règles.
Il y a enfin le Poutine symbole, assez différent de l’homme et du dirigeant. Il représente la rupture de la Russie avec le libéralisme et avec l’Occident. Il doit gérer le fait d’être devenu symboliquement un anti-Eltsine, celui qui incarne la renaissance de la Russie, même si spontanément sa trajectoire l’amènerait à être beaucoup plus sur le versant libéral que sur le versant autoritaire.
« La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République », écrivait Jean Bodin, au XVIe siècle, dans ses fameux Six Livres de la République (1576). La Russie de Vladimir Poutine réintroduit-elle en Europe la notion politique de puissance souveraine, à rebours de l’évolution des nations d’Europe occidentale ?
La Russie revient en effet à un modèle d’État-nation très européen, très ancré dans l’histoire française notamment, et elle le fait avec difficulté, pour des raisons matérielles mais surtout parce que le système soviétique n’était pas le développement de l’État mais plutôt sa dissolution à cause du pouvoir du parti. Dans la mesure où les dirigeants russes ont liquidé l’appareil du parti, ils ont dû faire face à la nécessité de reconstruire un État. Une partie des difficultés rencontrées aujourd’hui par la Russie, et probablement pour les vingt années à venir, est liée à cette nécessité.
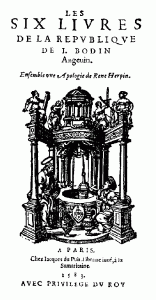 Sur la construction de cet État dans la période moderne, il y a eu un tropisme américain, présent en Russie depuis les années 1830. Les intellectuels russes tiennent l’abolition du servage pour l’équivalent de l’abolition de l’esclavage par exemple, et considèrent que les États-Unis seraient naturellement un allié de la Russie. Ils aiment rappeler que la Russie a été la seule puissance européenne à soutenir d’emblée l’Union contre la Confédération lors de la Guerre de Sécession, et qu’il y avait de très bon liens entre les États-Unis et le gouvernement tsariste jusqu’au début du XXe siècle. La Russie étant elle aussi un État vaste, il y a eu l’idée d’adopter le modèle fédéral américain, mais les Russes ont compris les immenses difficultés qu’il y aurait à l’importer. Face à ce modèle, il y avait le modèle français. Quel pouvoir pour les gouverneurs en Russie ? Doivent-ils être élus, comme dans le système américain, ou être nommés, à la française ? La Russie est aujourd’hui dans un entre-deux, puisque les gouverneurs sont élus sur la base d’une présélection faite par le président. Cela pose d’évidents problèmes, et je me suis fait personnellement l’avocat du système français. Les Russes sont attirés par ce modèle, d’autant plus qu’il revient par l’Orient : les Russes constatent que les Japonais l’ont adopté, avec une organisation administrative en préfectures. L’enjeu de la reconstruction de l’État russe est donc central.
Sur la construction de cet État dans la période moderne, il y a eu un tropisme américain, présent en Russie depuis les années 1830. Les intellectuels russes tiennent l’abolition du servage pour l’équivalent de l’abolition de l’esclavage par exemple, et considèrent que les États-Unis seraient naturellement un allié de la Russie. Ils aiment rappeler que la Russie a été la seule puissance européenne à soutenir d’emblée l’Union contre la Confédération lors de la Guerre de Sécession, et qu’il y avait de très bon liens entre les États-Unis et le gouvernement tsariste jusqu’au début du XXe siècle. La Russie étant elle aussi un État vaste, il y a eu l’idée d’adopter le modèle fédéral américain, mais les Russes ont compris les immenses difficultés qu’il y aurait à l’importer. Face à ce modèle, il y avait le modèle français. Quel pouvoir pour les gouverneurs en Russie ? Doivent-ils être élus, comme dans le système américain, ou être nommés, à la française ? La Russie est aujourd’hui dans un entre-deux, puisque les gouverneurs sont élus sur la base d’une présélection faite par le président. Cela pose d’évidents problèmes, et je me suis fait personnellement l’avocat du système français. Les Russes sont attirés par ce modèle, d’autant plus qu’il revient par l’Orient : les Russes constatent que les Japonais l’ont adopté, avec une organisation administrative en préfectures. L’enjeu de la reconstruction de l’État russe est donc central.
Aujourd’hui, les Russes sont probablement et consciemment ceux qui sont le plus proche du modèle de Jean Bodin, par rapport à l’expérience européenne. On s’interroge en Russie sur ce qui fait cause commune dans une nation, sur ce qui permet à l’État de manifester sa souveraineté. La question est donc de savoir pourquoi les États européens tournent le dos à l’idée de puissance souveraine. Certains pensent qu’il faut être dans le post-Bodin et qu’aujourd’hui les pays ne se définissent plus par la souveraineté. C’est une position très minoritaire. La position majoritaire, mais qui n’ose pas s’assumer en Europe, serait ce que j’appellerai le « bodinisme modéré » : on a besoin de coopération entre nous, mais il n’est pas question de toucher à la souveraineté des États. On le voit dans la construction européenne, qui connaît des poussées vers un fédéralisme non assumé, aspirant à créer un super-État, mais à chaque fois contrecarrées par la volonté des États de garder leurs attributs.
On est donc dans un entre-deux, théorisé par des gens comme José Manuel Barroso, pour qui la construction européenne est sui generis, un modèle en construction. Une vision plus pessimiste voit dans cette construction une indétermination : on devrait logiquement aller vers l’Europe-puissance mais on ne le peut pas car toute une série de pays n’en veulent pas, soit parce qu’ils ne se pensent pas dans cette notion de puissance, soit parce qu’ils craignent qu’une Europe-puissance soit une Europe soit allemande soit française. Le pessimisme autour de cette notion de modèle indéterminé vient du fait que l’on sait que, historiquement, ces modèles n’ont pas d’avenir. Si l’Europe n’est pas capable de faire le saut vers l’Europe-puissance, elle se défera, et c’est un peu ce à quoi nous assistons aujourd’hui.
Vos travaux portent essentiellement sur les questions monétaires et de souveraineté économique, liées au rôle des États dans l’économie. À notre époque, quelle place et quelle pertinence pour l’interventionnisme ?
La situation actuelle n’est pas, en réalité, différente de celle de la fin du XIXe siècle, même si celle-ci était très différente selon que l’on passait du centre du système capitaliste à sa périphérie. Il y avait déjà une forme de globalisation économique et financière. Ce qui est propre à notre époque, c’est que l’Europe, historiquement le centre du système capitaliste au XIXe et au début du XXe siècles, glisse aujourd’hui à sa périphérie. Dans ce contexte, un interventionnisme est d’autant plus nécessaire que ce glissement est effectif. Cet interventionnisme devrait avoir pour objectif la construction et la modernisation d’un modèle économique national. Mais l’idée de développer un interventionnisme étatique se heurte immédiatement aux intérêts d’une partie des classes dominantes, ce qui était déjà vrai pour les pays de la périphérie du système capitaliste dans les années 1890-1900.
L’image qui illustre cela est celle des communistes chinois qui distinguaient la bourgeoisie nationale et la bourgeoisie comprador : il y a aujourd’hui toute une partie de la grande bourgeoisie européenne qui s’est internationalisée et qui a perdu toute relation avec les systèmes productifs nationaux. Se pose d’ailleurs à l’occasion la question suivante : quelle serait, dans la France, l’Italie ou l’Espagne d’aujourd’hui, l’équivalent d’un « bloc des quatre classes » ? Et qui pourrait le réaliser ? On voit bien qu’aujourd’hui, il y a une césure de plus en plus profonde et ressentie, en particulier dans la société française, entre une élite internationalisée – 7 à 8 millions de personnes en France, environ 12% de la population, dont le mode de vie se détache de la réalité du reste de la population, dont les revenus sont liés, de près ou de loin, à des sociétés internationales – et 80 à 90% des Français, intégrés dans le système productif et administratif national et qui vont assez peu à l’étranger. Il y a là un grand risque – ou un grand espoir, selon les points de vue – que se reconstitue le discours de la Révolution française, contre la « noblesse apatride » et pour les forces de la Nation.
À ce propos, vous êtes reconnu comme un théoricien de la démondialisation. Pouvez-vous revenir sur ses modalités ? Comment se traduirait-elle en termes politiques ?
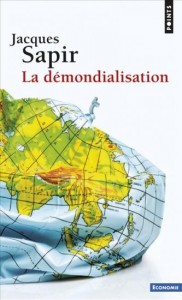 D’abord, précisons que ce que l’on appelle la mondialisation, c’est l’alliance entre les globalisations marchande et financière. On voit aujourd’hui que cette globalisation marchande est de plus en plus remise en cause : il est frappant de voir se développer un discours sur le « produire français », « produire local », sur la « souveraineté alimentaire », discours qui fait de facto référence à des processus de démondialisation. Mais ces processus restent embryonnaires dans la mesure où il n’existe pas, concomitamment, de pensée politique sur ce que serait une dé-globalisation financière. Or le véritable problème aujourd’hui est de penser cette dé-globalisation financière.
D’abord, précisons que ce que l’on appelle la mondialisation, c’est l’alliance entre les globalisations marchande et financière. On voit aujourd’hui que cette globalisation marchande est de plus en plus remise en cause : il est frappant de voir se développer un discours sur le « produire français », « produire local », sur la « souveraineté alimentaire », discours qui fait de facto référence à des processus de démondialisation. Mais ces processus restent embryonnaires dans la mesure où il n’existe pas, concomitamment, de pensée politique sur ce que serait une dé-globalisation financière. Or le véritable problème aujourd’hui est de penser cette dé-globalisation financière.
Sur un plan politique, les différents partis français semblent comprendre que la population est de plus en plus sensible à la question de savoir qui décide. Est-ce elle pour elle-même, ou sont-ce d’autres qui décident à sa place ? Se pose ainsi la question, tant à gauche avec Arnaud Montebourg par exemple, qu’à droite au sein de la « Droite populaire » notamment, de produire français afin de redonner à la population un certain pouvoir sur sa propre situation. Le Front national a compris très vite tout ce qu’il y a de porteur dans cette idée. Le personnel politique français tourne donc autour du pot. Il sent que la question : « qui décide et pour quoi ? » est essentielle, que la réponse à cette question dépend largement des formes de la production et de l’échange, et qu’à un moment se posera le problème du protectionnisme et de la dé-globalisation financière. Mais il hésite toujours à affronter cette question, parce qu’il y a là une vraie césure entre l’élite mondialisée et le reste de la population, et qu’il y a une crainte de guerre civile. J’entends parfaitement cette idée, à laquelle je suis moi aussi réceptif. Mais pour éviter la guerre civile, il faut être deux. Or, l’élite mondialisée n’est pas prête à faire les concessions significatives nécessaires pour qu’émerge un nouveau type de consensus : c’est ce qui m’inquiète dans la situation politique actuelle.
La notion de frontières revient souvent dans vos réflexions, économiques ou politiques. Elles servent à « faire corps » selon Régis Debray. Dans un billet récent, vous les avez même qualifiées de « condition de la démocratie ». Dans quelles mesures ?
Une des conditions de la démocratie, au niveau national ou à celui d’une organisation, c’est la définition d’une limite entre qui fait partie et qui ne fait pas partie du corps politique ou de l’organisation. L’on sait par exemple qu’une des meilleures façons de tuer la démocratie dans une organisation, c’est de dire que tout le monde peut voter. La démocratie, c’est fonctionnellement l’alliance de la possibilité de décider et de la responsabilité de la décision. Or cette notion de responsabilité est complètement diluée dès lors que l’on reconnaît à tout le monde voix au chapitre. Dans ce cas, on peut décider sans porter la responsabilité, et ce n’est plus la démocratie. La notion de limite, de frontière, est donc tout à fait impérative. Ce qui m’amuse beaucoup, en tant qu’ancien militant de l’extrême-gauche, c’est que les organisations de ce courant politique sont les premières à hurler contre les frontières, mais aussi les premières à refuser à toute personne extérieure la possibilité de participer à un vote en leur sein pour la définition de leur ligne politique. Ce refus est légitime, mais il faut en tirer les conséquences sur l’existence des frontières nationales. Ce qui se joue autour de la notion de frontière, c’est-à-dire le fait de faire partie ou non d’un corps politique, est donc constitutif de la notion de démocratie.
Quelle serait l’actualité de la notion de frontière dans l’Union européenne d’aujourd’hui ?
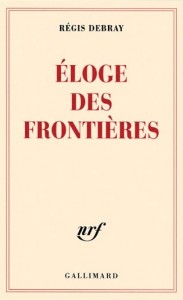 Nous sommes déjà en train d’y revenir. Le système Schengen sera très probablement abandonné, cela se fera progressivement et sans être dit ouvertement. Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, vient d’annoncer le retour des contrôles aux frontières pendant le mois du sommet de Paris pour le climat : s’il s’agit de protéger quelques dirigeants, c’est évidemment excessif. C’est donc un prétexte, dans le contexte actuel, pour revenir à la maîtrise des frontières. Il faut en prendre acte. Je pense, dans la ligne de Régis Debray, que les frontières sont un point essentiel dans la civilisation moderne. L’existence de frontières nationales permet et invite à une certaine forme de modestie : elle évite l’idée de la toute-puissance impériale, et de ce point de vue elle est extrêmement positive.
Nous sommes déjà en train d’y revenir. Le système Schengen sera très probablement abandonné, cela se fera progressivement et sans être dit ouvertement. Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, vient d’annoncer le retour des contrôles aux frontières pendant le mois du sommet de Paris pour le climat : s’il s’agit de protéger quelques dirigeants, c’est évidemment excessif. C’est donc un prétexte, dans le contexte actuel, pour revenir à la maîtrise des frontières. Il faut en prendre acte. Je pense, dans la ligne de Régis Debray, que les frontières sont un point essentiel dans la civilisation moderne. L’existence de frontières nationales permet et invite à une certaine forme de modestie : elle évite l’idée de la toute-puissance impériale, et de ce point de vue elle est extrêmement positive.
Les exemples ne manquent pas pour illustrer les entorses faites par les institutions européennes aux démocraties nationales quand celles-ci se montrent rétives à leurs desseins. Comment expliquer le caractère post- ou a-démocratique de la construction européenne ?
L’analyse de ce phénomène a été faite dès les années 1920, quand Carl Schmitt critiquait la démocratie parlementaire. Il faut entendre ce qui est fondamental dans la pensée de Schmitt : la démocratie parlementaire, parce qu’elle établit un pouvoir où la légalité supplante la légitimité, aboutit à un système où la décision politique se réduit à l’énonciation et l’application de normes et de règles. Ce point était en germe depuis un siècle, mais sa force actuelle provient du fait qu’une partie de la politique touche à des questions économiques. La politique économique, qui n’a rien à voir avec l’économie politique, pose la question de savoir si elle est menée du point de vue des intérêts économiques ou de ceux de la Nation. Le simple fait que le personnel politique ait à prendre des décisions de plus en plus complexes d’un point de vue économique, implique qu’il cède une partie de son pouvoir à des experts pour qui il existe des règles et normes au-dessus de la politique. Ce qui amène au débat, très important en économie, de savoir ce qui importe le plus, entre la règle et la décision.
Aujourd’hui, on voit chez les économistes un basculement : des années 1970 jusqu’au début des années 2000, l’accent était mis sur la règle contre la décision. Et aujourd’hui, des économistes remettent en cause cette prédominance de la règle, au nom de l’incertitude radicale. Vouloir établir les règles de manière intangible, c’est dire que l’on est capable de prédire l’avenir. Or nous savons que nous ne savons pas, il faut donc que l’instance politique retrouve cette capacité de décision, la décision discrète. Je crois qu’aujourd’hui, une partie du discours politique est pris à contre-pied par cette évolution du discours économique, alors qu’il continuait de privilégier jusqu’à présent la règle. Il y a là potentiellement un conflit très important : dès lors que l’on revient en politique à la notion de décision, se pose la question d’au nom de qui celle-ci est prise. Se pose alors la question de la légitimité, et in fine de la souveraineté.
Vos interventions contre la monnaie unique et pour la souveraineté des États européens vous placent de fait, sur le terrain politique, dans un camp souverainiste dont l’existence et les aspirations politiques restent néanmoins à définir. Pourquoi et comment un « front de libération nationale », pour reprendre l’aspiration de Stefano Fassina, devrait-il se constituer en France ?

Cette notion découle de l’analyse que je porte depuis longtemps sur l’incompatibilité qu’il y a entre la population qui reste enracinée dans un système productif et administratif français, et l’élite mondialisée. La question du « front de libération nationale » se pose du fait de la nécessité de trouver la traduction politique de cette incompatibilité. Ce front implique que des gens qui sont – et resteront – très différents parviennent à se parler et à s’unir autour de l’idée de retrouver la souveraineté. L’un des exemples que je prends pour illustrer cette idée est celui du Front uni japonais. C’est un exemple extrême, j’en ai conscience. Après l’échec de la révolution de Shanghai, le Kuomintang et le Parti communiste chinois (PCC) ont trouvé un modus vivendi face à la menace japonaise, alors que du sang les séparait. Ils l’ont fait car la menace extérieure amène les uns les autres à discuter, alors qu’ils sont complètement opposés, et à se rejoindre sur quelques points. Je tiens à la notion de « front de libération nationale » parce qu’elle dit bien qu’il ne s’agit pas d’alliance, qui induirait des accords de programme. Elle signifie qu’un objectif politique, à un moment concret, prend le pas sur d’autres et permet l’avènement de formes politiques propres à atteindre cet objectif. Je constate cependant que beaucoup ignorent cette notion et délirent sur une éventuelle grande alliance. Dans un front, les partis et mouvements gardent leur autonomie entière. La gestion de ce front peut d’ailleurs être assez chaotique et conflictuelle. Je ne me fais pas d’illusion, mes parents m’ont assez parlé des problèmes dans la Résistance, entre le mouvement Combat d’Henri Frenay, celui de Marie-Madeleine Fourcade, les communistes ou les socialisants, il y avait d’énormes différences qui ne les ont néanmoins pas empêchés, à un moment donné, de surmonter leurs divergences.
Plusieurs pistes politiques sont à explorer : une des mises en forme de ce front pourrait être un pacte de non-agression entre ses composantes sur différents points essentiels, bien identifiés, liés à l’objectif poursuivi. Une autre serait des accords électoraux ponctuels lors de batailles électorales, distinguant nettement ceux à l’intérieur du front, et ceux qui lui sont opposés. On peut également penser à des votes communs, tel que celui du référendum de 2005, ou celui contre la ratification du traité de la Communauté européenne de Défense (CED) en 1954, sous Mendès France. A l’époque, les communistes, une partie des socialistes et le RPF ont voté ensemble.
Les billets de votre carnet RussEurope et vos interventions sont marqués par un souci de clarté didactique et de pédagogie. Quel rôle entendez-vous jouer dans le débat public ?

J’aimerais d’abord dire le rôle que je ne veux pas jouer : je ne suis pas un parti politique à moi tout seul. Je ne suis pas non plus un journaliste, même s’il est clair que mon carnet joue aujourd’hui, de facto, le rôle d’un journal. J’ai découvert cela depuis 2012 : à l’époque, des collègues de la plateforme Hypothèses m’ont proposé de tenir un carnet en ligne. J’ai accepté, en imaginant avoir 500 voire 1000 connexions par jour, tout au plus. Je constate aujourd’hui que je suis près de dix fois au-dessus en moyenne, avec parfois des pics de connexion très importants. Je constate également que je ne suis pas le seul : il arrive la même chose au blog de Paul Jorion, qui compte plusieurs contributeurs, ou à celui d’Olivier Berruyer. Ceci nécessite, de ma part et des autres, une vraie réflexion sur le rôle que nous sommes amenés à jouer, à notre corps défendant peut-être.
Je pense que mon rôle est celui d’un intellectuel et d’un chercheur : je dis des choses qui ne sont pas nécessairement faciles à entendre, mais je m’interdis de dire des choses pour le plaisir que l’on aurait de les entendre. Je ne dis pas forcément tout ce que je pense, mais je pense tout ce que je dis. Cela me met ainsi à côté de la politique : si j’avais voulu en faire, j’en aurais fait. J’en ai fait d’ailleurs, humblement, en tant que militant politique pendant une dizaine d’années. Mais lorsqu’en 1980, on m’a proposé d’entrer au PS, j’y ai réfléchi et j’ai décliné, car je vois mon rôle beaucoup plus en tant que chercheur que militant. Cela reste aujourd’hui ma position.
En tant qu’intellectuel, comment expliquez-vous le degré de tension voire de violence qui caractérise le débat public en France aujourd’hui ?
Ce n’est pas nouveau, cette situation existe depuis vingt-cinq ou trente ans. Des responsables politiques et des journalistes ont créé des tabous auxquels, par définition, l’on ne peut toucher sans susciter de violentes controverses. C’est un des aspects les plus déplaisants de la politique française. Par exemple, aux États-Unis, en Italie ou en Grande-Bretagne, dès lors que ce que vous dites est fondé sur un raisonnement construit, sur des faits expliqués, on écoute votre opinion. Le cas particulier de la France me semble tenir de la déliquescence de la figure de l’intellectuel français. Des gens parlent aujourd’hui sur des sujets sans les maîtriser. Il n’y a plus cette nécessité de connaître son sujet pour en parler. Personnellement, je n’interviens pas sur des sujets pour lesquels je ne me sens pas du tout compétent. Je peux avoir une opinion, mais elle est personnelle et n’est que celle d’un Français parmi d’autres.
Depuis vingt ou trente ans, le débat intellectuel en France tend à dégénérer en une question religieuse. Les causes de cette évolution sont complexes ; il y a certainement l’influence tardive d’un stalinisme non pas idéologique mais comportemental. Il y a également le fait que, la société française étant aujourd’hui dans une position très instable, avec la césure nette et sensible dont j’ai parlé plus tôt, la situation actuelle soit propice à des affrontements politiques de plus en plus violents. La violence de certaines attaques traduit l’isolement croissant de l’élite mondialisée. Dans des pays où ce phénomène est moins marqué, comme l’Italie, on peut discuter de sujets considérés comme tabous en France, tels que l’euro par exemple. En France, l’élite mondialisée, coupée du reste de la population, prend conscience de cette césure, d’où le raidissement dont elle fait preuve. Cela pose évidemment, si les choses continuent ainsi, le problème de la guerre civile comme une des issues possibles de la situation actuelle.
