Pour la seconde partie de son entretien accordé à PHILITT, Michel Déon a choisi de revenir sur ses années de journalisme à l’Action française auprès de Charles Maurras et ses relations avec les autres membres du groupe des Hussards, pour terminer sur un constat désabusé de la production littéraire française actuelle.
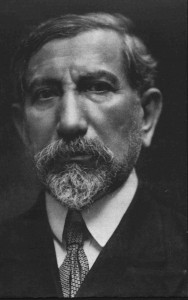
PHILITT : Avant d’être romancier, vous avez été journaliste. Vous avez commencé votre carrière à L’Action française en 1942…
Michel Déon : Même avant la déclaration de guerre, quand je faisais mon droit à Paris. J’avais opté pour le droit par facilité, en pensant que ce serait une partie de plaisir mais cela s’est révélé très ennuyeux et je n’y accordais pas beaucoup d’importance. Grâce à quelques relations, j’ai obtenu un petit travail de nuit à L’Action française. En journée, je suivais quelques cours à la faculté pour la forme ou j’allais au cinéma ; la nuit, j’étais au journal. J’ai beaucoup apprécié la mécanique de l’imprimerie : je venais pour choisir les titres des articles, corriger les épreuves… On se retrouvait seul la nuit avec les ouvriers de l’imprimerie, qui étaient tous d’ailleurs intéressants et cultivés. Ils travaillaient même le 1er mai, la Fête du Travail n’avait pas encore été instituée. J’en garde un souvenir qui m’émeut toujours.
Vous avez évoqué cette période, notamment dans votre livre d’entretiens Parlons-en. Pourriez-vous nous décrire l’état d’esprit du jeune journaliste Édouard Michel [vrai nom de Michel Déon] à l’époque ? Quelle idée vous faisiez-vous du journalisme ? Pensiez-vous y faire carrière ou songiez-vous déjà à un éventuel avenir de romancier, comme le Stanislas Beren d’Un déjeuner de soleil ?
À 18 ans, après mon bac, je n’avais pas tellement d’idées sur ce que je souhaitais faire par la suite, contrairement à mes camarades qui voulaient être avocats, médecins ou autres. Pendant mon temps libre, je lisais, j’allais au cinéma, je fréquentais mes amis, comme François Daudet [le fils de Léon], Pierre Boutang, Jacques Laurent… que j’ai connus à la faculté de droit.
L’université ne m’a rien apporté. Je le décris d’ailleurs effectivement dans Un déjeuner de soleil, où les jeunes Stanislas Beren et André Garrett évitent de s’y rendre pour ne pas y perdre leur temps. Je me rendais également à des conférences à Sciences Po où j’avais l’impression qu’on maniait à longueur de journée des lieux communs. Je me suis dirigé vers le journalisme un peu par hasard, par le jeu des relations, par goût.
Vous avez été secrétaire de rédaction à L’Action française et vous avez côtoyé Charles Maurras, dont vous avez même été épisodiquement le chauffeur. Pourriez-vous nous décrire votre quotidien avec Maurras ? A-t-il influencé en quelque manière que ce soit votre future carrière de romancier ?

Rédiger des articles de presse, à L’Action française mais aussi dans d’autres journaux étudiants, était un bonheur fou. Je portais un grand intérêt à l’actualité et cela me permettait de rencontrer beaucoup de monde. Je soumettais mes articles à Maurras et il me les rendait avec ses corrections.
Il m’a inspiré pour toujours un grand respect, du commencement à la fin. J’ai admiré en lui le polémiste, l’helléniste… et j’ai eu beaucoup de moments merveilleux avec lui. Il a pu commettre des erreurs, comme son antisémitisme, qui m’agaçait. J’avais des amis juifs avec qui je m’entendais très bien et qui ne m’en ont pas voulu de travailler dans un journal très marqué par cela.
Il faut évoquer aussi le contexte. La défaite brève et honteuse de la France m’avait beaucoup fait douter de son armée. Elle avait été lamentablement commandée en 1940. C’était la disgrâce totale, qui ne s’est arrêtée qu’en 1942 quand les Américains ont envahi l’Afrique du Nord. C’est à ce moment-là que j’ai beaucoup travaillé et appris le métier : j’ai fait des « petites choses barbantes » mais j’ai également assisté aux conférences de Maurras qu’il donnait dans toute une moitié de la France.
J’ai également fait quelquefois le chauffeur car j’étais le plus jeune de l’équipe, donc c’est à moi qu’on demandait d’exécuter cette tâche, assez dangereuse au demeurant, le premier ayant été blessé par des terroristes.
Vous vous êtes engagé très tôt à l’Action française, juste après le 6 février 1934. Cela révélait-il une sincère adhésion aux thèses monarchistes ? Ou s’agissait-il plutôt d’une réaction de dégoût inspirée par la culture bourgeoise de la IIIe République ?
Pas la culture mais plutôt le social et l’attitude du gouvernement et des élites de l’époque qui rêvaient d’un État idéal où tout le monde serait égal et heureux. Ils promettaient une France de 40 millions de fonctionnaires, dépendant complètement de l’État. On privait les gens du sens de l’initiative, de la faculté de création, de l’aspiration à l’enrichissement personnel comme intellectuel. La guerre de 39-40 a été une guerre surtout sociale. Aujourd’hui, on déclenche les guerres sur la base d’idéaux, comme la liberté, la démocratie etc., ce qui a conduit à la guerre totalement injustifiée d’Irak en 2003 et déstabilisé l’ensemble de la région, sinon le monde. Avant, la situation était stable car la région était soumise à une certaine autorité. Or, on a voulu obliger les pays arabes à être démocrates. Maintenant, c’est le chaos : guerres, massacres, déplacements de populations qui fuient ces zones sinistrées. Ce sont les fameux migrants, que décrivait déjà il y a 40 ans Jean Raspail dans Le Camp des saints.
Est-ce par goût d’anticonformisme que vous vous érigez, à partir des années 50, contre la littérature engagée des Sartre et Beauvoir et que vous vous rapprochez du fameux groupe des Hussards ?
Il y a deux façons de voir les choses. Tout d’abord, la littérature, et en particulier le roman, n’est pas là pour militer pour des idées à la mode qui deviennent désuètes au bout de quelque temps, elle n’a pas à s’engager pour quelque cause que ce soit. Au contraire, elle a une ambition beaucoup plus vaste, c’est celle d’être le visage d’un pays – peut-être moins maintenant en France, heureusement (rires) – et sert aussi à poser les bases d’une civilisation, d’une culture. Ce refus de l’engagement n’est donc pas simplement de l’anticonformisme ; il part d’une conception radicalement différente du rôle et de la place de la littérature.

Sur quoi était fondé le groupe des Hussards, qui n’existait pas officiellement en tant que tel comme courant littéraire ? Une franche camaraderie ? Des affinités électives qui vous ont conduits à vous poser en fervents des Morand ou Chardonne… ? Quel était votre lien ?
La camaraderie jouait énormément, dans le bon sens du terme. Mais également des sentiments comme la liberté, le goût de l’indépendance etc. Il faut avouer que Nimier, qui est peut-être le membre le plus renommé, n’y est pour rien dans la formation puis la pérennité de ce groupe ; il ne visait en effet que son propre personnage, sa drôlerie, ses blagues… Il n’y a pas un livre de Nimier qui résiste à l’épreuve du temps. Y a-t-il encore beaucoup de jeunes lecteurs fous d’un livre de Nimier de nos jours ? Non. Alors qu’il critiquait tout son entourage, particulièrement dans la correspondance qu’il entretenait avec Morand et Chardonne auprès de qui il s’était introduit. Il jugeait ainsi, dans cette correspondance, un de mes livres « lamentable » alors que rien ou presque ne subsiste de lui qui soit d’une qualité insurpassable. Au moment de sa mort, en 1962, il écrivait un livre intitulé D’Artagnan amoureux. Laudenbach [Roland Laudenbach, éditeur, fondateur de la Table ronde] m’avait alors demandé de donner une critique à la radio à ce sujet. Je l’ai lu et j’ai eu l’impression qu’il avait été écrit par un enfant de cinq ans. Un drame, une catastrophe. Il était inconcevable qu’un homme d’une telle trempe et avec une telle réputation (en raison de sa précocité, son succès, ses blagues, ses liaisons dangereuses, ses voitures…) ait pu commettre une chose pareille. En fait, il s’agissait du vrai Nimier, Nimier révélé. Il était très intelligent et avait écrit de belles choses sur les écrivains du 17ème siècle mais n’était pas lui-même un romancier.
Pour clore ce chapitre, je le soupçonne de s’être suicidé. J’en suis persuadé. Il avait passé le volant à cette fille un peu dingue et écervelée [Sunsiaré de Larcône] mais plutôt jolie – elle avait publié chez Gallimard un livre qu’un sous-éditeur de province n’aurait jamais accepté mais comme elle n’était pas farouche… – alors que la voiture était lancée à 130 km/heure. Cela laisse peu de chances de s’en sortir…
L’étude de l’œuvre des Hussards semble un peu négligée de nos jours, à l’école ou à l’université. Peu de colloques ont pour thème l’œuvre de Nimier, Blondin, Laurent et vous-même. Comment l’expliquer ? Est-ce également une littérature dépassée ?
Je ne suis pas étudié en France, vous vous en doutez. Ni Blondin ou Laurent. Mais les choses commencent cependant à changer. Cette année, par exemple, une demi-douzaine de thésards de France et d’autres pays dans le monde sont venus me voir pour préparer leur travail ; la presse étrangère n’est pas foncièrement hostile non plus. Mais les auteurs de notre sensibilité ont toujours traîné un boulet qui est l’antisémitisme alors qu’il n’a plus de raison d’être. Nous sommes marqués pour la vie par nos choix de jeunesse. On cherche la moindre dose de fascisme dans mes œuvres, alors que c’est totalement injustifié. Mais il faut faire avec.
Y a-t-il toujours une littérature de droite ?
On peut mettre à droite une littérature qui croit qu’un homme providentiel sauvera la civilisation, celle qui croit toujours en un sens de l’honneur, du sacrifice, des causes perdues. Les livres de Raspail le sont indéniablement, par exemple. Il est important d’essayer de redonner de l’honneur à nos actions et nos choix politiques. Pour ma part, je ne pense pas avoir écrit spécialement « des livres de droite ». Les Poneys sauvages est un livre très ouvert aux idées politiques, les communistes n’y sont pas antipathiques, on y trouve des personnages juifs, notamment le personnage touchant de Sarah, inspiré d’une de mes amies, mais on continuera sans cesse à me reprocher des choses qu’on m’imputait déjà il y a 50 ans.
Que pensez-vous des rentrées littéraires (la prochaine approchant). Trouvez-vous qu’il y a surabondance d’ouvrages ? La qualité n’est plus au rendez-vous ?
J’ai reçu 300 services de presse. La plupart sont des livres de 500 pages, cela demande beaucoup de temps pour les lire. Il y a en effet surabondance. Je ne veux pas jeter la pierre aux éditeurs mais ils cherchent quand même la rentabilité, avec la mise en avant de best-sellers sans aucune qualité littéraire. La question de l’argent joue beaucoup et incite les auteurs et les éditeurs à écrire et publier des livres qui n’en valent pas la peine et ne dureront pas plus de quinze jours. Et pendant ce temps, les petites maisons d’édition ont du mal à survivre et les librairies indépendantes ferment.

Prenons l’exemple de Jacques Laurent lui-même : il a écrit de très bons livres pour dames, à l’américaine, sous un pseudonyme [Cecil Saint-Laurent] qui n’arrivent pas à la cheville de ce qu’il produisait sous son vrai nom mais qui se sont vendus à 300 000 exemplaires. Grâce à cela, il a fondé la revue La Parisienne, a dépensé tout son argent dans la revue Arts et a mené la belle vie. Je ne l’ai jamais critiqué là-dessus car, comme c’était un homme de droite, il se faisait déjà suffisamment démolir par la critique (et encore aujourd’hui d’ailleurs). J’ai remarqué que ses héritiers publiaient toujours sa série populaire Caroline chérie… À chaque fois qu’on me parle de Laurent, on l’appelle « l’auteur de Caroline chérie ». Mais Laurent, ce n’est pas cela ! C’est l’auteur du Petit Canard et bien d’autres.
Pour conclure, la situation est très confuse. Il est difficile de savoir vers quoi la production littéraire se dirige. D’autant plus qu’on n’a aucun contrôle sur les livres du fait de la radio ou de la télévision, qui peuvent vendre vos ouvrages à 200 000 exemplaires sur lesquels vous ne toucherez pas un centime. Je déplore également la disparition des clubs, qui réalisaient de très belles éditions, comme le Club de l’Honnête homme. Maintenant, les beaux livres sont remplacés par le numérique et on les lit sur des tablettes. C’est incontrôlable. La littérature devient réservée à une élite, celle qui prend encore la peine de lire des livres en version papier. Il y a de moins en moins de livres dont il faut couper les pages par exemple, hormis les éditions José Corti. Il faut tout faciliter, a fortiori pour les membres de jurys littéraires. Viendra un temps où les livres tiendront dans une pilule (rires). Cela fait un beau sujet de roman, néanmoins. Mais la situation, pour de nombreux éditeurs, est assez tragique.
