Dorian Astor est normalien, philosophe, agrégé d’allemand. Spécialiste reconnu de Nietzsche dont il a rédigé une biographie, auteur de Nietzsche. La détresse du présent , il publie en mars 2017 un Dictionnaire Nietzsche, faisant intervenir plus de trente spécialistes français et internationaux. Unique par son ampleur et la diversité de ses entrées, ce dictionnaire permet de rappeler le lien particulier que Nietzsche entretenait avec les mots et la langue.

PHILITT : Nietzsche était avant tout philologue. Quelle conception avait-il du langage, et notamment, que pensait-il de l’exercice de traduction ?
Dorian Astor : La question de la traduction est importante pour Nietzsche, qui en éprouve la difficulté notamment pendant ses études, lorsqu’il travaille sur des textes anciens, écrits dans une langue morte et présentant souvent d’importantes lacunes. Le déchiffrement d’un texte nécessite du temps et de la prudence. C’est ce que Nietzsche tire de son expérience de philologue : il faut se méfier de ce que l’on croit avoir compris. Il a beaucoup travaillé sur les versions, les leçons, les interpolations des textes antiques, et il se pose la question suivante : que rajoute-t-on à un texte là où il y a une lacune ? La réalité, dit Nietzsche, est elle-même un texte lacunaire à déchiffrer et à traduire. Il y a toujours le danger d’interpoler nos propres croyances et préjugés, c’est presque une fatalité. Dans Vérité et mensonge au sens extra-moral, il explique que chaque mot, chaque désignation, chaque concept a d’abord été une métaphore, une création en quelque sorte artistique. Ensuite, la métaphore se fixe, on oublie qu’elle est une invention et on en fait un concept abstrait et général, qui écrase les singularités. Par exemple, le mot « feuille » est la désignation unique pour toutes les feuilles singulières que l’on peut voir dans une forêt, et pour toutes les feuilles du monde. Idéalement, il faudrait autant de mots qu’il y a de feuilles, et même des mots différents pour cette même feuille qui se transforme au fil des jours. Le langage ne peut saisir ni le multiple, ni le singulier, ni le devenir. Il ne sait dire que l’identité, la généralité et l’être. Il simplifie le monde et falsifie le réel. Tout langage est une traduction, et toute traduction est traduction de traduction, mais chaque fois par sauts entre sphères hétérogènes. Ainsi, on n’atteint jamais la chose en elle-même. Connaître, c’est toujours interpréter et chercher à dominer le chaos de l’apparence. D’une certaine manière, Nietzsche hérite de Kant (du moins, celui de La Critique de la raison pure) l’idée qu’on ne peut connaître la chose en soi et que nous ne cessons d’outrepasser illégitimement les limites constitutives de notre appareil cognitif, qui n’est qu’une perspective sur le monde. Nietzsche traque partout ces interpolations abusives qui sont la source de tout dogmatisme.
Comme vous le notez dans l’avant-propos du Dictionnaire Nietzsche, l’écriture de Nietzsche donne des marques abondantes de sa méfiance envers le langage (des mises à distance permanentes comme les guillemets ou des accentuations énergiques comme les soulignements et les tirets). Ces procédés forcent le lecteur à suspecter la langue d’être toujours paradoxale. Les mésinterprétations dont la pensée de Nietzsche a été victime ne sont-elles pas une preuve de notre incapacité à maintenir ensemble les contradictions ?
C’est juste, même si je préfère le terme de paradoxe à celui de contradiction, car ces tensions propres à la pensée de Nietzsche visent à empêcher toute fixation d’une doxa et à dépasser l’idée que les « contradictions » opposeraient des principes ontologiquement contraires (l’être et le non-être, le vrai et le faux, le bien et le mal, etc.). Le risque d’être mal compris, Nietzsche l’a éprouvé de son vivant, par exemple dans les milieux wagnériens, pangermanistes, antisémites, qui ont cru, au grand dam du philosophe, pouvoir se réclamer de lui. Mais c’est un risque qu’il a pris délibérément : Nietzsche tend des pièges, afin de nous forcer à pratiquer cette prudence philologique, cette lente retenue dans l’interprétation. Malheureusement, il ne pouvait mesurer l’étendue de ce risque. Il a conçu la modernité comme une époque de grand épuisement des instincts vitaux (c’est notamment la figure du dernier homme dans Ainsi parlait Zarathoustra, qui n’aspire qu’à la paix et à la sécurité) et a voulu réveiller ses contemporains en employant toujours davantage le lexique du danger, de la guerre, du sacrifice — dans sa solitude, il a peut-être parfois armé à trop grand bruit. Il a sous-estimé la violence pulsionnelle qui pouvait sourdre dans la modernité épuisée, et qui s’est déchaînée au XXe siècle de manière terrifiante, parfois même en son nom. Nietzsche n’a jamais exalté la barbarie ou la cruauté. Ces pulsions ancestrales, originaires de la vie animale lui ont permis d’établir une généalogie des processus historiques et moraux même dans leur manifestations les plus spiritualisées. Lorsqu’il en appelle à un autodépassement de l’homme dans la figure du surhumain, il réclame un type d’individu plus libre, plus puissant, plus créateur — et non pas la domination totalitaire d’une caste animée d’une soif de vengeance et d’extermination. De manière générale, il fallait se rendre sourd et aveugle à la fine complexité de la pensée nietzschéenne : « Malheur à moi ! Je suis une nuance ! », peut-on lire dans Ecce Homo. Ou encore, dans le Zarathoustra : « Ce sont les paroles les moins tapageuses qui apportent la tempête, et les pensées qui mènent le monde viennent sur des pattes de colombe ».
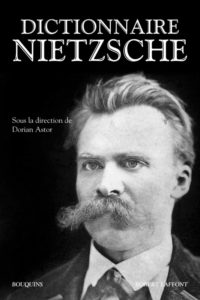
Certains travaux montrent les liens entre Nietzsche et la pensée juive — l’alphabet hébreu étant, comme la pensée de Nietzsche, structuré pour être mobile et produire une dynamique exégétique. L’œuvre globale de Nietzsche se prête-t-elle à une interprétation par analogie ou par concordance à de nombreux niveaux de sens, à la manière du Midrash ?
Je ne suis pas spécialiste de la pensée juive mais cette idée d’un système d’analogies et de concordances est intéressante parce qu’elle pourrait renvoyer à la notion philosophique de perspectivisme, que Nietzsche revendiquait. Dans une philosophie du point de vue telle qu’on la trouve chez Leibniz, le sens est conçu comme une immense combinatoire qui permet à des réalités ou multiplicités très diverses de se renvoyer infiniment les unes aux autres par analogie. Les différents points de vue s’expriment tous mutuellement, leur infinité forme un seul monde. Mais chez Leibniz, et c’est ce qui le sépare de Nietzsche, ce qui fonde cette correspondance générale est une harmonie universelle conçue et voulue par Dieu, qui est le grand maître de l’art combinatoire. Or, Nietzsche ne peut accepter un tel présupposé : le monde est fondamentalement chaos, il ne peut y avoir aucune concordance supérieure des perspectives singulières, fondamentalement divergentes et même en lutte. J’imagine que la possibilité, dans l’exégèse juive, de superposer des niveaux ou séries de sens, suppose une forme d’harmonie qui rende raison de leur convergence. Cela nous renverrait à Deleuze et à ses analyses des perspectivismes de Leibniz, de Nietzsche et de Whitehead : là où Leibniz fait converger toutes les séries dans un même monde (des séries divergentes entraînant d’autres mondes possibles mais exclusifs les uns des autres, c’est-à-dire « incompossibles », comme dit Leibniz), Nietzsche et, autrement, Whitehead ramènent toutes les divergences dans un seul monde, dans la pure immanence. Ce qui permet à Deleuze de défendre un concept de différence pure, notamment sous le terme paradoxal de « synthèse disjonctive ».
Il est devenu courant de citer Nietzsche comme l’un des auteurs qui a permis au transhumanisme de trouver son lexique (surhomme, dépassement, volonté de puissance). C’est pourtant Nietzsche, lecteur du biologiste Rudolf Virchow, qui évoque contre l’hygiénisme bourgeois une « grande santé », une santé faisant l’épreuve de la maladie et de la souffrance. Que pensez-vous de la nature de cet héritage ?
Je répondrai d’abord en rappelant la polémique qui a eu lieu entre Peter Sloterdijk et Jürgen Habermas au sujet des biotechnologies. Dans L’avenir de la nature humaine – Vers un eugénisme libéral ? Habermas dénonce les manipulations techniques de la reproduction humaine au nom d’un humanisme qui défend la dignité, la liberté et l’égalité de tous les hommes en naissant. Cet ouvrage était une réponse polémique à celui de Sloterdijk, Règles pour le parc humain, d’inspiration nettement nietzschéenne. L’auteur y montrait que toute culture — et en premier lieu l’humanisme lui-même — est une forme d’eugénisme, c’est-à-dire d’ « élevage » volontariste d’un type d’homme. Avec l’effondrement de la culture humaniste, la postmodernité flirte avec d’autres types d’élevage, conçu comme une prestation de service visant à plus de « bonheur ». Habermas n’a pas vu que Sloterdijk était tout autant que lui un adversaire d’un tel eugénisme libéral. Comme Nietzsche, comme Foucault, Sloterdijk accorde toute leur importance aux différents types d’ascèse spirituelle dans « l’élevage » de l’homme. Nombre de transhumanistes contemporains se croient autorisés de Nietzsche pour défendre une optimisation volontaire des caractères biologiques. Ce qu’ils oublient, c’est que Nietzsche conçoit l’élevage de types humains comme combinaison de deux grands processus indissociables : la spiritualisation de pulsions vitales en systèmes de valeurs, et l’incorporation de valeurs en système pulsionnel. Un certain type de vie produit un certain type de valeurs ; un certain système de valeurs reproduit et perfectionne une certaine forme de vie et de mode d’existence. Le transhumanisme n’en finit pas avec le vieux dualisme de l’âme et du corps. Pour Nietzsche, les types humains « forts » se distinguent par leur manière d’affirmer et de transfigurer la souffrance, tandis que les types « faibles » cherchent toujours à la supprimer. Nietzsche reprochaient déjà aux épicuriens leur idéal d’aponie et d’ataraxie, symptôme d’une faiblesse toute nihiliste. Une chose est certaine : le transhumanisme est un utilitarisme et un eudémonisme, deux courants de pensée complémentaires que Nietzsche a condamnés sans appel.

Dans ses Conférences de Bâle, Nietzsche disait que « le journaliste, le maître de l’instant, a pris la place du grand génie, du guide établi pour toujours, de celui qui délivre de l’instant ». Quel est pour Nietzsche le statut du journalisme dans nos civilisations ?
Il est clair que Nietzsche n’aime pas les journalistes. Avant tout parce qu’il est un penseur du temps long, du développement historique sur de très grandes périodes. La probité exige patience et hauteur de vue. Le journalisme, par définition, n’en est pas capable : il est moins le maître de l’instant que son esclave. Pour Nietzsche, on ne peut interpréter le présent qu’en considérant ce qui le lie profondément au passé et même à l’avenir — c’est-à-dire au devenir. Un instant en lui-même n’a aucun sens s’il n’est replacé dans cette trame serrée qui lui permet d’émerger. Ce que Nietzsche appelle les « génies » sont de tels événements reliés entre eux par-dessus les siècles, au-dessus de véritables périodes de désert. C’est un des aspects de cette « inactualité » que revendique Nietzsche : il s’agit d’une attitude critique et polémique consistant à repérer ce qui est anhistorique dans l’histoire, ce qui est durable dans le fugitif, ce qui est encore ancestral dans le nouveau. Il est le premier à savoir ce qu’une telle posture, cherchant à fixer le temps qui passe, peut avoir de conservateur, voire de réactionnaire. Mais ce n’est pas parce que le temps se meut lentement qu’il est immuable… Quelle différence entre une mentalité journalistique et un esprit historien ? L’historien voit dans les événements, présents ou passés, des symptômes de processus profonds dont il doit faire la généalogie ; le journaliste au contraire est lui-même un symptôme du présent, et non son interprète ; il est malade de l’instant. L’historien du temps présent, placé en perpétuelle concurrence avec les journalistes, est toujours désavantagé dans la course par le nécessaire et salutaire retard de ses hypothèses et conclusions interprétatives. Mais nous n’avons pas besoin de Nietzsche pour comprendre cette course dérisoire et tragique : analyser et expliquer est incompatible avec le temps du journalisme. Je rêverais d’un journalisme sceptique qui pratiquerait ce que Nietzsche appelait l’ephexis, cette retenue hésitante dans l’interprétation. Peut-être les grands reporters de guerre s’approchent-ils de cette qualité : eux-mêmes pris dans les tourbillons nébuleux qui enveloppent les conflits, ils ont l’honnêteté de dire : « Je ne sais pas ce qui se passe, mais voici ce que je vois ». Ils sont alors le relais de nos yeux, pas de nos jugements.
Sans nommer explicitement la langue anglaise, Nietzsche avait prophétisé l’apparition d’une langue unique « pour tout le monde », propagée et imposée par le commerce planétaire. Que nous apporte Nietzsche pour comprendre l’état actuel de notre langue ?
Nietzsche critique toutes les formes d’utilitarisme, l’utilité amputant les phénomènes de leur riche complexité. Il redoute par-dessus tout les processus d’homogénéisation et de standardisation, parce que c’est un penseur de la différence hiérarchique. Que la globalisation du commerce entraîne celle d’une langue de communication, ce n’est ni surprenant ni nouveau. A titre personnel, je ne suis pas très inquiet : une langue ne se réduit pas à ses usages commerciaux, même mondialisés. Permettez-moi de citer un peu longuement un fragment posthume qui me paraît absolument essentiel et qui répond à votre question, notamment contre tout soupçon de décadentisme chez Nietzsche : « Une époque de transition : c’est ainsi que tout le monde appelle notre époque, et tout le monde a raison. Mais non dans le sens où ce terme conviendrait mieux à notre époque qu’à n’importe quelle autre. Où que nous prenions pied dans l’histoire, partout nous rencontrons la fermentation, les concepts anciens en lutte avec les nouveaux, et des hommes doués d’une intuition subtile que l’on appelait autrefois prophètes mais qui se contentaient de ressentir et de voir ce qui se passait en eux — le savaient et s’en effrayaient d’ordinaire beaucoup. Si cela continue ainsi, tout va tomber en morceaux, et le monde devra périr. Mais il n’a pas péri, dans la forêt les vieux fûts se sont brisés mais une nouvelle forêt a toujours repoussé : à chaque époque il y eut un monde en décomposition et un monde en devenir » (FP 4 [212], été 1880).

Votre dictionnaire contient une entrée originale sur la « bibliothèque de Nietzsche ». De manière générale, quel lien entretenait Nietzsche avec les livres ?
Nietzsche a un rapport ambivalent aux livres. Souvent, il lit des livres pour y trouver ce qu’il cherche. De par sa formation classique, il a beaucoup de lacunes en philosophie moderne, qu’il compense par la lecture d’ouvrages de littérature secondaire, histoires de la philosophie ou monographies, etc. Il lit davantage de littérature, mais aussi beaucoup d’ouvrages scientifiques et historiques. Il a un usage ciblé de ses lectures, et quand il trouve ce dont il a besoin, il se l’approprie rapidement. Il omet d’ailleurs parfois de nommer les auteurs qu’il cite ou dont il s’inspire. Par ailleurs, ses problèmes céphalalgiques et ophtalmiques lui ont peu à peu interdit de longues séances de lecture et sa vie nomade ne lui permettait pas de faire suivre une vaste bibliothèque. Mais il considère également que trop de lectures nuisent à la créativité et confinent à l’indigestion. C’est grâce à trois des auteurs (italiens) de notre Dictionnaire qu’a pu être scientifiquement établi (en allemand) le catalogue de la « Bibliothèque personnelle de Nietzsche » : Giuliano Campioni, Paolo D’Iorio et Maria Cristina Fornari. Une preuve supplémentaire que les philosophes doivent être aussi des philologues.
