On aurait voulu l’oublier, le laisser croupir avec les rebuts de l’histoire. Pourtant, cent cinquante ans après sa naissance, Charles Maurras est de retour. Grâce à sa récente réédition dans la collection Bouquins, nous sont restitués l’essentiel de sa pensée politique, ainsi que son œuvre littéraire, trop souvent négligée. L’occasion de découvrir, derrière l’affreux pétainiste et l’austère théoricien, le philosophe et l’esthète.
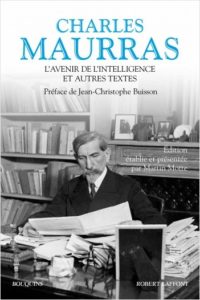
Qui n’a pas senti sur son visage la fraîche caresse de la brise, charriant les embruns de la mer, qui ne s’est pas promené, sous la chaude clarté du Midi, bercé par le refrain des cigales, à l’ombre des oliviers, qui ne connaît ces villages provençaux cerclés de lavandes, parsemés de lauriers roses, l’accent chantant des gens du pays à l’heure du pastis, sur la place où s’élève le clocher en campanile, qui ne devine cette paisible gaieté ne pourra jamais comprendre Charles Maurras. Car Maurras, avant tout, est un provençau. « Quelques lieux que je coure, c’est toujours à celui-là que je reviendrai ; c’est là que tout me ramènera mort ou vif » [1], confiait celui qui repose avec les siens à Roquevaire, et dont le cœur est enterré dans son jardin de Martigues. C’est là qu’il grandit, que sa mère aimante le mena à l’église, qu’il s’imprégna de la sagesse populaire de sa vieille bonne, c’est dans cette vivante et bigarrée foire aux santons qu’il vit se côtoyer noblesse désargentée, pécheurs de l’étang de Berre, paysans de Camargue, et belles arlésiennes dansant dans leurs robes soyeuses. C’est là, aussi, qu’il devint sourd à l’âge de quatorze ans, se réfugia dans les livres, perdit la foi, songea au suicide, préféra la vie. C’est là, également, qu’il s’éprit de poésie : « La poésie emportait et sublimait tout, de sorte que je finissais par ne plus distinguer si tout n’était pas rêverie. » [2] Lui-même reconnaîtra plus tard que « peut-être ne serais-je ni royaliste, ni traditionniste, ni nationaliste, ni même patriote sans les enseignements donnés dans cette langue par le chant divin de Mistral » [3]. N’oublions jamais que quand Maurras s’exclame « vive le roi », c’est fondamentalement pour que vive la poésie.
L’amour du classicisme
Ce que le jeune Charles a reçu de sa Provence natale, sur les rives de la Méditerranée, c’est aussi la remembrance des grâces helléniques. Si bien qu’il vit son voyage en Grèce, en 1896, comme un véritable retour aux sources. Il y est fasciné par les beautés de l’Attique, par les lignes droites, pures et harmonieuses de ses impérissables monuments, au point d’embrasser physiquement, sur l’Acropole, les augustes Propylées. C’est de cette juvénile exaltation, de cette païenne ivresse que procède chez lui le goût du classicisme et l’amour de l’ordre. Celui auquel on a reproché son rationalisme excessif, son positivisme comtien, son « empirisme organisateur », cherche à imiter par la rigueur de son raisonnement le parfait équilibre de la statuaire dorique. Son esprit est géomètre par esthétisme.

C’est mal connaître Maurras que de le croire sans passion, lui qui fut toute sa vie intérieurement dévoré par la double volupté de la chair et de l’intelligence. Ce à quoi il s’oppose, c’est à la passion débridée, érigée en absolu, qui s’étiole en croyant s’affranchir des contraintes, c’est l’éréthisme fiévreux et « efféminé » du romantisme qu’il combat. Il comprend que les plus sévères exigences sont nécessaires aux plus hautes élévations, car « la liberté posa son trône au fond des lieux inférieurs, près du chaos et des forces élémentaires : ce qui travaille et croît, ce qui monte et s’ordonne, ce qui prend figure de perfection est aussi ce qui consentit à l’entrave et à la mesure, ce qui s’est présenté au sublime frein de la loi » [4]. Il faut un tuteur pour que la passion grandisse, une digue pour que son flot monte, un solide obstacle pour que brûle sa flamme, tandis que l’amour de l’amour romantique se consume dans son propre narcissisme. « À force de poursuivre l’occasion de l’amour, d’en entretenir le désir et d’en cultiver les mélancolies et le désespoir, ils ont plutôt voilé qu’enflammé et plutôt abaissé que sublimé l’image de l’antique démon. » [5] Ceux qui croiraient encore le Martégal impassible n’ont qu’à lire sa propre poésie, où il dévoile l’intimité de son être, ses doutes et ses blessures, où se murmure la « musique intérieure » d’une âme tourmentée, tiraillée entre le ciel et la terre, en quête d’une foi inaccessible, comme en témoigne sa magnifique Prière pour la fin écrite en prison peu avant sa mort.
Comment croire, Seigneur, pour une âme que traîne
Son obscur appétit des lumières du jour ?
Seigneur, endormez-la dans votre paix certaine
Entre les bras de l’Espérance et de l’Amour.
Ce que Maurras chérit dans le classicisme, finalement, c’est sa portée universelle. Il y trouve l’expression la plus entière de l’être humain, la tonalité qui fait vibrer toutes les âmes à l’unisson. « N’en croyez jamais les pauvres esprits qui accusent de froideur et d’aridité soit la haute philosophie, soit la grande poésie, et nommez insensé quiconque se refuse à comprendre ou hésite à sentir comment c’est là et non ailleurs que bat le cœur du monde et flambe ce qu’il a d’amour. » [6] Son attachement à la Grèce, à Rome, à la culture française ne tient donc pas uniquement à ses racines personnelles, n’est pas simplement le symptôme d’un sentimentalisme chauvin, il y perçoit l’aboutissement de l’humanité. « Par ce trésor dont elle a reçu d’Athènes et transmis le dépôt à notre Paris, Rome signifie sans conteste la civilisation et l’humanité. Je suis Romain, je suis humain : deux propositions identiques. » [7] Et c’est du haut du Parthénon, ému à la vue de ces glorieux vestiges, que le jeune homme, tel Scipion pleurant sur les ruines de Carthage, réalise à quel point une civilisation est fragile. De son périple au berceau de la démocratie, constatant l’effrayante promptitude avec laquelle celle-ci put faire chuter une si riche cité, Maurras revient royaliste.
Du Félibrige à la monarchie
Cette révélation athénienne vient conclure un long cheminement intérieur initié au sein du Félibrige, l’association fondée par Frédéric Mistral pour défendre la langue d’oc et ses traditions. Maurras intègre le cénacle en 1888, suite à son premier livre, consacré au poète provençal Théodore Aubanel. Dès 1892, il rédige La déclaration des félibres fédéralistes où toute sa pensée politique est annoncée. Il y pourfend la centralisation parisienne, exige « la liberté de nos communes », appelle à « délivrer de leurs cages départementales les âmes des provinces ». Déjà il énonce ce qui deviendra un de ses plus récurrents théorèmes : « Nous ne nous bornons pas à réclamer pour notre langue et pour nos écrivains les droits et les devoirs de la liberté : nous croyons que ces biens ne feront pas notre autonomie politique, ils en découleront. » Ce qu’il résumera plus tard dans la formule « politique d’abord », signifiant non pas la prééminence de la politique sur toute chose, mais sa nécessaire antériorité dans la pratique. De même qu’il faut être nourri et logé pour s’adonner librement aux plaisirs de l’esprit, une nation doit être suffisamment prospère et ordonnée pour qu’y fleurisse la culture. « Quand nous disons ‘politique d’abord’, nous disons la politique la première, la première dans l’ordre du temps, nullement dans l’ordre de la dignité. »[9]

La splendeur du classicisme gréco-romain, les sérénades des troubadours médiévaux, les chefs-d’œuvre de la littérature française doivent être défendus politiquement, et ces beautés universelles ne peuvent être gardées vivantes que si elles s’enracinent dans d’ancestrales coutumes provinciales, telle est la conviction de Maurras. Et c’est en creusant cette idée, notamment sous l’influence du Barrès des Déracinés, qu’il va progressivement en venir au royalisme. Il comprend que la France, « hérissée de libertés » sous l’Ancien Régime, périt du centralisme jacobin et des institutions de l’an VIII. Il comprend que la décentralisation, loin de diviser et d’affaiblir la nation, est la seule façon de lui redonner un ordre organique et conforme à sa nature historique. Il comprend qu’il n’y a d’engagement que local, de libertés que concrètes, que les citoyens doivent s’investir dans les affaires qui les concernent directement, au quotidien, et non être consultés occasionnellement sur des problèmes qui les dépassent. Et c’est, soit dit en passant, ce fédéralisme qui le distingue profondément du fascisme qu’il fut le premier à dénoncer et dont on voudrait aujourd’hui le rendre complice. Celui qui se rapprocha des syndicalistes révolutionnaires à travers l’audacieuse expérience, trop vite abandonnée, du Cercle Proudhon, n’eut jamais la moindre affinité avec les régimes totalitaires.
Si Maurras est royaliste, en fin de compte, c’est parce qu’il est, au vrai sens du terme, républicain : « L’autorité en haut, en bas les libertés, voilà la formule des constitutions royalistes. L’absurde République une et indivisible ne sera plus la proie de dix mille petits tyrans invisibles et insaisissables ; mais des milliers de petites républiques de toute sorte, républiques domestiques comme les familles, républiques locales comme les communes et les provinces, républiques morales et professionnelles comme les associations, s’administreront librement, garanties, coordonnées et dirigées dans leur ensemble par un pouvoir unique et permanent, c’est-à-dire personnel et héréditaire, par là même puissant et sage, étant intéressé au maintien et au développement infini de l’État. » [10]
L’Or, le Sang et l’Espérance

Et si la démocratie est incapable de réaliser cette décentralisation, c’est qu’un tel État ne peut se maintenir qu’en gardant le contrôle de ses électeurs, donc au prix d’une administration et d’une bureaucratie centralisées. Et c’est aussi, plus fondamentalement, parce que la démocratie est inéluctablement le règne de l’argent. Le pouvoir du nombre induit celui de la quantité, la foule étant systématiquement manipulée par les médias, eux-mêmes détenus par les puissances financières. Ainsi, à l’empire de l’Or, Maurras oppose la force du Sang. « De l’autorité des princes de notre race, nous avons passé sous la verge des marchands d’or. » [11] Le monarque héréditaire, parce que sa position ne dépend pas des aléas de l’opinion, parce qu’aucune fortune ne saurait usurper son trône, parce que son intérêt personnel se confond avec celui de la nation qu’il incarne, parce que la lignée dont il n’est qu’un maillon lui fait éprouver dans la chair la valeur des siècles, s’avère le meilleur rempart, si ce n’est le seul, à la domination de l’argent. La monarchie trace un cercle lilial, trempé du sang des rois, où l’or ne pénètre pas.
Ce diagnostic est, à bien des égards, toujours d’actualité. La République peut lui refuser les commémorations, le patriarche de l’Action Française demeure, et sa voix résonne que l’on ne saurait taire, comme une irréductible accusation face aux mensonges de la démocratie. Certes, direz-vous, mais pourquoi s’obstiner à réclamer un Roi, alors que rien ne paraît pouvoir entraver la marche forcée du Progrès ? Charles Maurras vous répondrait que « tout désespoir est une sottise absolue ». Et que le rêve n’est invraisemblable que pour ceux qui n’ont pas une âme de poète. « Puisque nos crimes vont effrayants, puisque vos yeux sont courts, et puisqu’il est des repentirs sublimes. »
Notes
[1] Anthinéa
[2] Quatre nuits en Provence
[3] Enquête sur la monarchie
[4] L’ordre et le désordre
[5] Les amants de Venise
[6] Sans la muraille des cyprès
[7] La démocratie religieuse
[8] La déclaration des félibres fédéralistes
[9] Mes idées politiques
[10] Enquête sur la monarchie
[11] L’avenir de l’Intelligence
