Enfant terrible du fascisme, qu’il a embrassé autant par fascination que par opportunisme, Malaparte cultive l’ambiguïté jusqu’à sa mort. Courtisant autant que courtisé, par les communistes autant que la droite chrétienne, remaniant sa propre histoire sans jamais se renier, il aborde la fin des années 1940 avec le souci de se refaire une virginité, indispensable condition à la gloire littéraire qu’il désire tant.

Dès avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, Curzio Malaparte, qui a senti le vent tourner depuis plusieurs années, se prépare à affronter une période qu’il sait par avance délicate. Au prix d’un long travail de réécriture flirtant parfois avec la falsification, toujours dans le goût du mensonge qui est le sien, il a savamment réagencé les épisodes de son existence qui, depuis une vingtaine d’années, témoignent de sa proximité non pas seulement avec le fascisme mais avec les dignitaires du parti. Preuve de l’habileté de l’écrivain : aujourd’hui encore, certains faits biographiques sont présentés comme avérés alors qu’ils ont été inventés de toutes pièces par Malaparte lui-même. Il est ainsi courant de lire que celui-ci se serait attiré les foudres du régime après la parution dès 1929 de Monsieur Caméléon, un pamphlet dénonçant les dérives mussoliniennes, avant d’être confiné sur l’île de Lipari quelques années plus tard.
Si cette version promise à la postérité a de quoi lui apporter des gages d’antifascisme bien précieux à la veille de la Libération, elle n’en demeure pas moins fausse. Monsieur Caméléon est une satire certes virulente mais dirigée contre Mussolini personnellement, accusé de s’être embourgeoisé. Ce texte d’un partisan plus fasciste que le Duce sera évidemment profondément remanié par Malaparte après la guerre, afin de lui donner une coloration plus sulfureuse sur le plan politique. À l’en croire, le manuscrit aurait été séquestré sur ordre de Mussolini en personne et la revue dans laquelle le texte avait paru aurait été fermée en représailles. En réalité, le texte a été publié sans aucune censure, des extraits reparaissant même dans la foulée dans une autre revue. L’ambition de Malaparte, à qui le Duce a promis un poste de diplomate, n’est pas de faire de l’agitation politique mais d’obtenir satisfaction auprès d’un Mussolini qui s’obstine à l’ignorer, en dépit de l’estime réelle que l’écrivain lui inspire. Quant à la condamnation au confinement, elle est due aux calomnies proférées par Malaparte à l’encontre d’un dignitaire du régime, qui exige aussitôt de Mussolini une punition.
Tous ces éléments ne sont pas si confus pour les contemporains de Malaparte, qui sont nombreux à se rappeler le rôle joué par l’écrivain dans la machine fasciste, notamment au moment de l’affaire Matteotti – il a témoigné en faveur des assassins présumés pour rendre service à Mussolini. Craint-il une épuration comme celle qui sévira en France ? Quoi qu’il en soit, dès le débarquement dans le Sud de l’Italie, Malaparte se tourne vers les libérateurs britanniques et américains. Dans une note à leur adresse, il s’invente une arrestation par la Gestapo en Ukraine en 1941 et transforme son expulsion du Parti national fasciste en 1933 en un départ assumé et grandiloquent, dont il modifie au passage la date pour le situer deux ans plus tôt – il ira même jusqu’à parler de « démission » par la suite. Si les Anglais se méfient de ce personnage labile et exubérant, les Américains lui font confiance, d’autant que Malaparte avait effectué pendant près de 20 ans de mystérieuses missions d’espionnage pour le compte de Washington… L’écrivain rêve déjà d’un triomphe outre-Atlantique, chez ces futurs vainqueurs dont il écrit dans La Peau : « J’aime les Américains parce qu’ils sont bons chrétiens, sincèrement chrétiens. Parce qu’ils crient que le Christ est toujours du côté de ceux qui ont raison. Parce qu’ils croient que c’est une faute d’avoir tort, que c’est une chose immorale d’avoir tort. » Comme l’a très bien montré Maurizio Serra dans sa biographie de l’écrivain, ces louanges sont sincères et ne sauraient être réduites, comme elles tendent à l’être par de nombreux lecteurs de Malaparte, à une ironie grinçante d’un homme du Vieux Continent contemplant l’invasion des Américains triomphants.
Entre Washington et Moscou
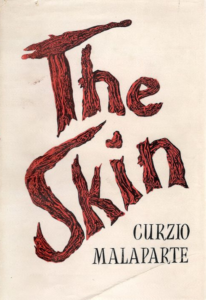
Le pari américain de Malaparte est d’autant plus important à ses yeux que La Peau a considérablement froissé les Italiens, qui se voient administrer de désagréables leçons de morale de la part d’un fasciste doublé (peut-être est-ce pire encore à leurs yeux) d’un opportuniste. Le conseil municipal de Naples le bannit symboliquement de la ville en 1945. Cinq ans plus tard, sur fond de polémiques incessantes dans les journaux de la péninsule, le Vatican met le roman à l’Index. En 1952, lorsqu’il paraît aux États-Unis, l’ouvrage jouit d’une réputation sulfureuse dont Malaparte espère qu’elle suscitera la curiosité du public. En vain : la critique américaine préfère condamner l’homme au passé douteux et les ventes restent bien en-deçà des attentes d’un écrivain qui s’indigne alors auprès de son éditeur, dans une mauvaise foi aux accents très italiens : « Qu’est-ce que le New York Times attend de moi ? Que j’aille tuer Mussolini ? »
Malaparte vit de plus en plus mal les reproches qui lui sont adressés, parfois excessivement au regard de son implication réelle dans le régime fasciste. À ses yeux, il n’est pas plus coupable qu’un autre. Difficile en effet de trouver des intellectuels n’ayant pas frayé, au cours des deux décennies écoulées, avec une idéologie à la fois inévitable puisque totalitaire et cependant assez conciliante, notamment vis-à-vis des artistes. Voir la critique italienne, européenne et américaine porter aux nues Alberto Moravia, qu’il estime au moins autant compromis que lui, plonge Malaparte dans un réel désarroi. De quel mérite jouit ce jeune romancier en vogue, qui fut jadis son bras droit à la direction de la revue Prospettive ? La réponse lui semble évidente : Moravia manifeste publiquement ses sympathies communistes, à l’heure où l’Italie est plus rouge que jamais. Soucieux de relancer sa carrière, Malaparte prend alors conscience de ce que pourrait lui apporter un rapprochement avec le PCI de Palmiro Togliatti, par ailleurs numéro deux de l’Internationale communiste.
Pour mener à bien cette nouvelle contorsion, Malaparte peut compter sur ses écrits pro-soviétiques qui, dès les années 1930, témoignaient de son admiration pour l’URSS, la grandeur de son projet civilisationnel et le destin du peuple russe. Il peut même se targuer d’avoir été publiquement attaqué par Léon Trotsky en 1932 – un avantage certain dans cette période où Staline apparaît comme le nouvel homme fort de l’Europe. Togliatti apprécie le talent autant que la personnalité de Malaparte, à qui il rend visite dans sa villa de Capri. Les deux hommes partagent un certain élitisme intellectuel qui facilite une convergence de nature toutefois stratégique. Les communistes italiens sont en effet engagés, avec l’aval de Staline, dans un processus de normalisation qui doit les conduire à transformer le PCI en parti de gouvernement et à abandonner toute velléité révolutionnaire. La conversion d’un repenti comme Malaparte serait un coup d’éclat dont Togliatti mesure tous les avantages qu’elle pourrait apporter à sa formation politique dans le cadre de la bataille politique contre la Démocratie chrétienne. L’écrivain devient même brièvement correspondant pour L’Unità, le journal du PCI fondé par Antonio Gramsci 20 ans plus tôt. Mais sa présence dans le giron communiste indigne de nombreux militants, notamment parmi les anciens résistants, qui obtiennent bientôt son expulsion du quotidien et sa disgrâce. Togliatti viendra tout de même témoigner au procès de Malaparte pendant l’épuration qui débuta 1945 – une aide précieuse qui lui permit d’être définitivement blanchi en 1947.
La désillusion parisienne

En 1947, Malaparte monte à Paris, bien décidé à trouver enfin la reconnaissance qui lui est due. Il compte parmi ses plus grands amis et défenseurs Daniel Halévy et son épouse Marianne, ainsi que l’éditeur Bernard Grasset. Louis-Ferdinand Céline, à qui il a envoyé de l’argent dans sa prison danoise, Blaise Cendrars, qui lui adresse une lettre élogieuse, ou encore Jean Cocteau font également partie de ses admirateurs. Il sait en outre qu’il peut compter sur son excellente maîtrise du français, en lecteur avide de Chateaubriand qu’il adule, et plus encore sur sa connaissance intime d’un pays où il a héroïquement combattu contre les Allemands en juillet lors de la Première Guerre mondiale, sans pressentir l’illusion dont il se berce et qui ne manquera pas de le décevoir. Le pays qu’il aimait tant a changé. Il n’y retrouve plus « ces hommes d’une race plus dure, qui s’habillent plus simplement, demeurés fidèles à la casquette, aux souliers à lourde semelles, au pantalon de velours serré à la cheville, à la cravate nouée sur une chemise de toile écrue, leur moustache retombant des deux côtés de la bouche, une bouche marquée par les coups de rouge, par les pernods et les absinthes d’autrefois, par l’éternel mégot de caporal au coin des lèvres ».
Pire encore pour lui : la scène parisienne est désormais dominée par l’existentialisme, les intellectuels médiatiques et la musique américaine. Là non plus, nul ne semble prêt à lui pardonner son passé sulfureux. Cette hypocrisie l’exaspère d’autant plus qu’il assiste au triomphe de Sartre, « mignon des Allemands en 1940-1944 [qui] chante également la liberté dans les miroirs poussiéreux du café de Flore » et à celui d’Aragon ou d’Eluard, chantres cyniques d’un nouveau monde où fleurissent pourtant dans l’ombre les goulags et les camps de concentration. Le Figaro se lance, sous la plume d’un journaliste que Malaparte finira par défier en duel, dans une campagne virulente à son encontre, levant le voile sur plusieurs mensonges grâce auxquels l’écrivain espérait se refaire un honneur. Le climat hostile ne le dissuade toutefois pas d’écrire, et c’est par commodité autant que par réel intérêt qu’il décide alors de se tourner vers le théâtre. Das Kapital et Du côté de chez Proust, ces deux pièces aujourd’hui encore relativement méconnues, ne suscitent que de tièdes réactions d’un public nouveau à qui le nom de Malaparte est à peine connu.
« La France me manque beaucoup. Mais vous avez certainement deviné que les méchancetés, les calomnies ignobles, les lâchetés que je ne méritais pas, et dont on m’a accablé en France, m’ont affreusement fait souffrir. Pour ne pas être poussé, par réaction, à en vouloir à la France, que j’aime et que j’ai toujours aimée, j’ai décidé de me tenir loin, pour quelque temps », écrit-t-il à Marianne Halévy en 1952, soit trois ans après avoir quitté la capitale. Ce qu’il dit de la France pourrait tout aussi bien s’appliquer à l’Italie ou au monde, dont il finit par se retirer, d’abord dans la solitude altière de sa villa à Capri, puis définitivement, dans sa chambre d’hôpital, en juillet 1957. Sur son lit de mort, pontes communistes et membres du clergé se disputent une ultime conversion. Le PCI assure qu’il a reçu avec émotion et fierté sa carte de membre juste avant de rendre l’âme ; l’Église assure qu’il s’est converti in extremis, après avoir déchiré sa carte du parti et renié La Peau. Soixante ans plus tard, l’une comme l’autre n’ont plus que faire de ce génie encombrant, ce perturbateur irrécupérable, tout entier dévoué à lui même et à ses mensonges, et qui s’offre désormais le luxe ultime de ne plus appartenir à personne, pas même à ses lecteurs.
