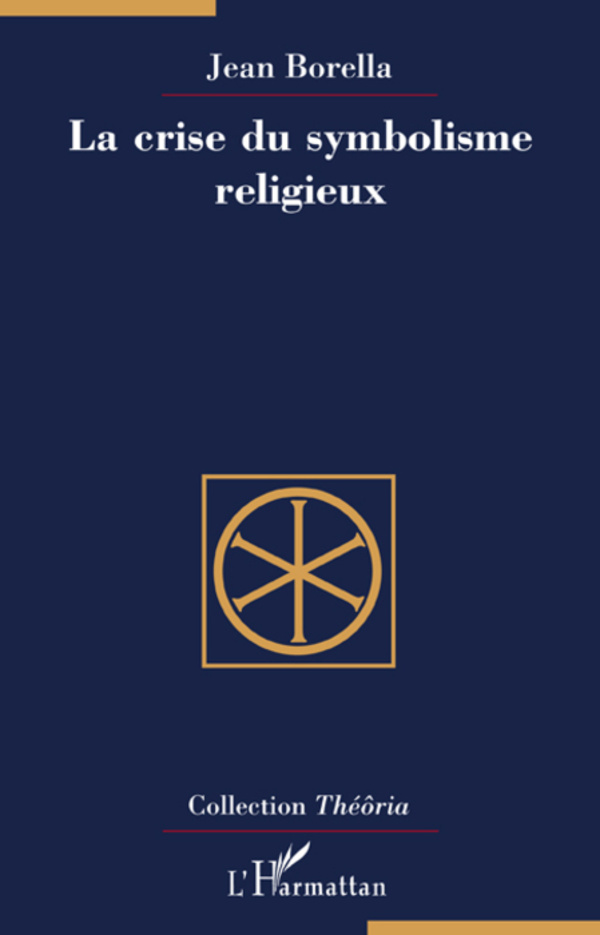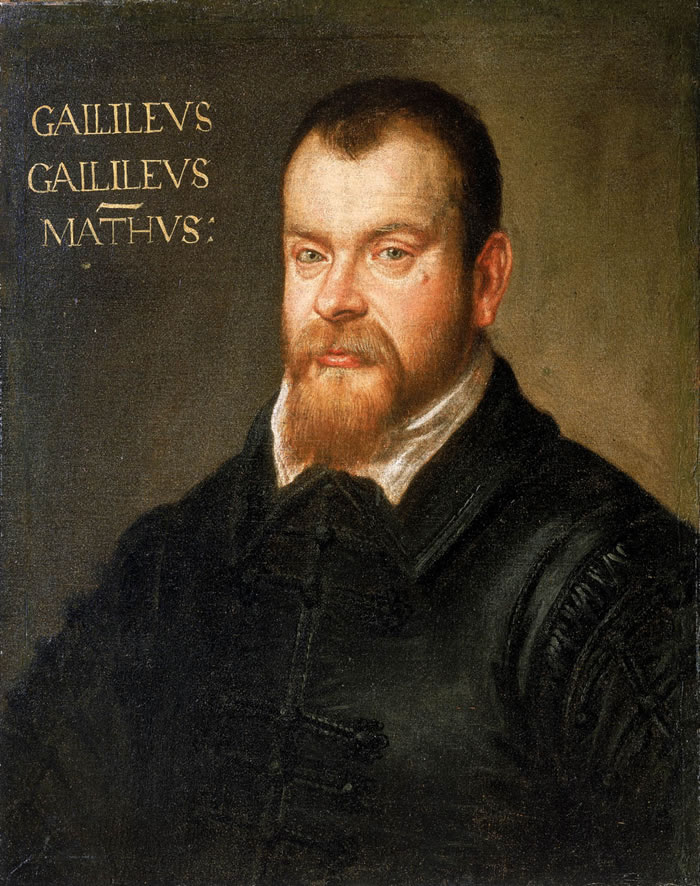Jean Borella, philosophe chrétien, a enseigné la métaphysique et l’histoire ancienne et médiévale à l’Université de Nancy II jusqu’en 1995. Sous la direction de Paul Ricœur, il soutint une thèse sur le symbolisme religieux qui a donné lieu à deux études majeures : Histoire et théorie du symbole et La Crise du symbolisme religieux, réédités chez L’Harmattan (collection Théôria). Après avoir présenté la nature objective du symbole sacré, il propose de retracer sa déchéance tout au long de l’histoire moderne, marquée par un processus systématique de sécularisation.
Dans La Crise du symbolisme religieux, Jean Borella prolonge et applique les analyses rigoureuses de son Histoire et théorie du symbole à l’élaboration d’une généalogie de la mentalité moderne, de la révolution galiléenne au structuralisme. Cette mentalité se caractérise par ce que nous appelons aujourd’hui la « sécularisation », que Borella interprète sous l’angle du symbolisme : l’éviction de la vie religieuse hors de la cité occidentale réside précisément dans la destitution de la « mentalité symbolique », qui, dans la société traditionnelle, faisait monde. Ce monde, alors, constituait ce que Borella qualifie de « mythocosme ».
Pour bon nombre de contemporains, il est patent que le symbole ne désigne qu’un substitut fictif. Ce mot de « symbole » est régulièrement mobilisé pour désigner une « entité non réelle ». Or les travaux de Borella montrent que non seulement cela ne va pas de soi, mais qu’une telle vue est très conditionnée historiquement : seul un moderne vivant en dehors de la mentalité symbolique traditionnelle en vient à déprécier d’une telle façon le symbole. Jadis et essentiellement, le symbole a au contraire une valeur de réalité indiscutable, ainsi que le montre Borella dans toute la première partie de son Histoire et théorie du symbole. Des Pères de l’Eglise jusque chez Goethe et Schelling en passant par le Concile de Trente, le symbole, lorsqu’il fonctionne dans le cadre d’une herméneutique sacrale, désigne systématiquement une réalité sensible qui est le signe d’une réalité supérieure, invisible.
Une révolution cosmologique : l’espace galiléen
Borella rappelle et montre que le symbole est constitué par deux aspects essentiels, l’un sensible et l’autre métaphysique. Sans le premier, il cesserait d’être un signe pour s’identifier purement et simplement à la réalité qu’il devait symboliser. Sans le second, il cesserait d’être un signe symbolique car il ne réfèrerait plus à rien. L’eau baptismale par exemple, n’est symbole qu’à condition qu’il y ait d’abord la chose « eau » (la substance liquide), qui est son signifiant, ensuite l’idée de l’eau comme substance protoplasmique, qui est son sens, et enfin la régénération de l’âme, qui est son référent particulier. Ces trois termes constituent le « triangle sémantique », dont l’unité est assurée par l’existence d’un quatrième terme, le référent métaphysique, qui est dans notre exemple la Possibilité universelle, dont la régénération de l’âme n’est qu’un mode de manifestation parmi d’autres dans le symbolisme de l’eau (l’eau peut en effet désigner, aussi, la « formation du monde », dans le livre de la Genèse, I, 2). Par conséquent, « tout symbole ne signifie que par présentification, c’est-à-dire que par correspondance participative avec les réalités qu’il symbolise ».
Ainsi, la nature sensible du symbole fait qu’il dépend d’une « ontologie de référence », c’est-à-dire d’une doctrine commune portant sur la nature de l’être. Or avec la révolution galiléenne, plus physique qu’astronomique en réalité, le monde se réduit, s’enferme dans la seule modalité corporelle et quantitative : les êtres naturels changent de statut, parce qu’ils ne peuvent plus être compris « objectivement » comme les signes tout qualitatifs d’un ordre de réalité supérieur, spirituel. En réduisant le réel à la seule dimension spatiale (dont le temps n’est plus qu’une modalité), « la physique mécaniciste a détruit l’ontologie référentielle d’un cosmos ouvert au spirituel, et, réciproquement, d’un spirituel et d’un divin qui ne refusent pas de s’incarner dans des formes cosmiques ». En rendant impossible, par la constitution de la nouvelle ontologie physiciste, la manière dont le signe symbolique se rapportait à son référent invisible ou métaphysique, la révolution galiléenne prive le symbole de sa dimension essentielle. Selon les Modernes, le symbole ne peut plus rendre présent le supérieur dans l’inférieur, mais seulement, au mieux, indiquer privativement et séparativement quelque chose perçu comme absent, dont l’homme ne saisit plus la réalité immanente. Le symbole ne peut plus véritablement présentifier le divin, mais il ne peut que le représenter en l’indiquant de l’extérieur : l’acte de signification n’est plus objectif mais intersubjectif.
La subversion feuerbachienne du sens
Amputé de son référent, le symbole n’est plus compris comme une réalité sensible qui s’identifie, par voie de participation, à la réalité d’ordre supérieur qu’elle a pour fonction propre de « présentifier ». Le symbole perd alors sa raison d’être pour ne devenir qu’un signe ordinaire, que la philosophie athée de Ludwig Feuerbach s’empresse d’enfermer dans son processus spéculaire. Le point de gravité du symbole, en effet, n’est plus le référent objectif, qui a disparu dans l’inintelligibilité moderne, mais le cadre subjectif dans lequel il est produit et interprété. Ce n’est plus Dieu ou la réalité que l’on voit dans et à travers le symbole, mais nous-même, c’est-à-dire nos propres projections humaines. Le doigt qui pointe la lune est vu maintenant comme pointant vers l’homme : dans L’Essence du christianisme (1841), Feuerbach élabore un « renversement » (umkehren) des rapports religieux en se proposant d’ « interpréter toujours comme fin, ce que la religion pose comme moyen » et d’évacuer « l’essence inhumaine de la religion », c’est-à-dire son essence théologique, au profit de son « essence humaine », c’est-à-dire anthropologique. Il s’agit de concevoir la religion comme un pur produit humain, qui répond à un besoin de l’homme pour l’homme — position athéiste devenue fameuse et incontournable.
La suppression physiciste du référent symbolique fait alors place, selon Borella, à la subversion du sens dans la « philosophie nouvelle » dont Feuerbach fournit la matrice « génético-critique ». Il ne s’agit plus, pour le philosophe, de voir dans la religion quelque erreur, mais de voir en elle sa matière illusoire. Les contenus symboliques de la religion ne sont appréhendés que comme le résultat d’un processus de réflexion par lequel, selon Feuerbach, l’homme individuel projette au-dehors de lui-même ce qu’il idéalise dans l’amour de sa propre espèce, qui est son « essence générique ». L’homme « hypostasie » sa propre essence en l’adorant sous ses formes religieuses. Il pose en dehors de lui les caractéristiques essentielles de son humanité et les prend ensuite pour des choses autonomes, qu’il vénère. L’homme s’aliène alors à ses propres représentations en les prenant pour des choses en soi, indépendantes de lui, alors qu’elles ne sont que le produit de son mental.
Le sens du surnaturel inhérent à la religion est ainsi subverti : Feuerbach naturalise l’Esprit hégélien en faisant de lui l’espèce humaine elle-même. Cette naturalisation consiste ainsi en une double réduction : d’une part, réduire le sujet « Dieu » à ses prédicats (bonté, miséricorde, toute-puissance…), sans lesquels, dit Feuerbach, il ne saurait être Dieu ; d’autre part, réduire à leur tour ces prédicats « divins » aux prédicats de l’essence humaine. L’homme, en effet, n’adore en Dieu que ce qui n’est conforme qu’à l’idéal humain, en particulier l’amour : il ne vénère en fait que l’homme à travers son dieu. L’homme, explique Feuerbach, est incapable d’adorer un Dieu inhumain, ou à tout le moins, il faut que la divinité partage d’une certaine façon la condition humaine pour qu’un culte puisse s’instaurer. Les prétendus symboles de la religion ne sont plus, pour l’athée, que les représentations par l’homme de ses propres déterminations naturelles. « Réduites à leur cause productrice, les idées religieuses révèlent leur inanité ».
Illusions et contradictions de l’athéisme
La religion serait donc une réponse viciée à un besoin humain (besoin dont il faut préciser la nature…), un besoin de consolation dira plus tard Freud. Mais pour asseoir un tel argument, il a fallu rendre compte de la façon dont l’homme prend ses « besoins » pour des réalités autonomes : d’où le caractère central du thème de la représentation. Or Borella, en s’inspirant de Frithjof Schuon, soutient que cette argumentation se heurte à des problèmes graves voire insurmontables. Le premier est herméneutique : « En posant la religion comme une illusion, on s’interdit à tout jamais d’en réaliser une herméneutique, et donc une science véritablement intégrale, puisque cette herméneutique commence par refuser, de cette religion, son affirmation essentielle, en la dénonçant précisément comme illusion ». Le « pari » athée de Feuerbach et de tous ses successeurs est malhonnête du point de vue de l’interprétation du contenu religieux, car il se base sur une inattention à ce que la religion dit d’elle-même. De sorte que « l’athéisme est une proposition extra-herméneutique qui détermine, de l’extérieur, le sens athéiste de cette herméneutique ». Point d’interprétation possible d’un contenu dont on refuse a priori le discours positif.
Il s’ensuit que le second problème est méthodologique : il concerne la démarche même de ce criticisme. L’aveuglement que Kant, en épistémologie, que Feuerbach, en « anthropologie », que Marx, en économie ou que Freud, en psychanalyse, entendent mettre au jour, est connaturel à l’intelligence : il ne s’agit pas simplement de faire l’expérience de l’erreur ou d’une « illusion externe » résidant non dans la perversion de l’intellect, mais dans l’inexpérience d’autres objets. Ce qu’il y a de mauvais de la religion serait ainsi accidentel, non essentiel. Or chez nos philosophes athéistes, il s’agit bien plutôt d’une « illusion interne » par laquelle l’homme, pour diverses raisons, est amené à prendre ses propres représentations pour des choses autonomes : c’est pourquoi il y aurait un problème essentiel à la religion. Or le souci est qu’ « on ne peut avoir conscience d’une illusion que par accession à un degré supérieur de réalité, et non par une seule mutation à l’intérieur d’une même conscience » : c’est en prenant connaissance d’une réalité supérieure (exemple : les lois de la réfraction en milieu aquatique) que l’on peut découvrir le caractère relativement illusoire d’une réalité inférieure (le bâton tordu dans l’eau). Une herméneutique de l’illusion implique donc, au moins implicitement, une doctrine métaphysique des degrés de réalité, celle-là même que, précisément, ces philosophes modernes ont dû rejeter, puisqu’elle fondait l’architecture traditionnelle du symbolisme religieux !
Il faut aussi et surtout expliquer par quel miracle un Feuerbach ou un Freud, pour ne citer qu’eux, peuvent accéder à la conscience de l’illusion, si elle est interne à l’intelligence : la découverte de cette illusion rend contradictoire la thèse alors défendue ! A moins de penser que, par exemple, ce sont les conditions objectives d’une époque (d’ordre économiques chez Marx) qui rendent possibles un tel « éveil ». Mais un autre problème insoluble se pose alors, inhérent à la réduction « culturaliste » : si une doctrine, comme dit Feuerbach, n’est qu’une « pure conséquence nécessaire de l’histoire », qu’il n’y a pas de référent fixe, transcendant, immuable (Dieu) pour assurer sa prétention à l’universalité, qu’est-ce qui interdit qu’une telle doctrine soit à son tour illusoire ou fausse ? S’il n’existe pas de Principe unique de la réalité (qu’est Dieu), qui transcende toutes les situations culturelles et les déterminations naturelles, la vérité n’est-elle pas réduite à l’ordre des simples conventions sociales ? « Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà », et vice-versa ? L’athée aurait donc raison en France et tort en Espagne ? La prétention de tout discours de vérité à l’universalité contredit évidemment une telle absence de principe ultime.
Borella soulève ainsi un ensemble de problèmes inhérents aux philosophies athées, qui butent toutes sur une même impasse : celle de leur circularité herméneutique. Ces « philosophies » posent contradictoirement la religion comme à la fois la cause et l’effet de l’illusion, en même temps qu’elles prétendent révéler le vrai sens des formes culturelles sans s’enraciner dans aucune instance ontologique qui soit irréductible à ces formes-là afin de les englober et fixer leur sens, c’est-à-dire une instance qui soit, essentiellement, transcendante. Ainsi, « toute herméneutique démystifiante, c’est-à-dire qui repose sur une illusion intérieure à la conscience, en fin de compte ne pouvant plus sortir de la sphère herméneutique dans laquelle elle s’est méthodologiquement enfermée, ne trouve de déterminations que dans les formes culturelles dont elle prétend révéler le vrai sens, tout le reste n’étant jamais qu’un jeu réciproque de significations ». Voilà la pure contradiction à laquelle la critique athéiste du symbole a conduit la pensée d’Occident, ce qui prouve néanmoins par l’absurde, la nécessité pour l’intelligence de se (re)convertir au symbole, afin d’assumer son désir de connaître. Retourner à Dieu, pour l’intelligence, ce n’est finalement pas autre chose que de retourner à son propre foyer, à l’image du fils prodigue se repentant auprès de son père (Lc XV, 11-32), qui est l’auteur de sa vie et la racine de son épanouissement.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.