Jean Leclercq est professeur de philosophie à l’Université de Louvain-la-Neuve et membre de l’Académie Royale de Belgique. Ses travaux et ses recherches portent sur la philosophie d’expression française, du XIXe siècle à nos jours, et sur la philosophie de la religion et de la laïcité. Directeur scientifique du Fonds d’archives Michel Henry – qu’il a créé en 2006 – il a dirigé le Dossier H Michel Henry (L’Âge d’Homme, 2009) et créé la Revue internationale Michel Henry.

PHILITT : Dominique Janicaud estimait qu’un « tournant théologique de la phénoménologie française » s’était opéré notamment avec Lévinas. Quel est le sens de cette affirmation et dans quelle mesure l’œuvre de Michel Henry est-elle aussi visée ?
Jean Leclercq : Tout ceci est le fruit d’une longue histoire, complexe et liée à plusieurs événements concomitants. À l’époque, un séminaire de recherche qui réunissait des philosophes français appartenant au « second spiritualisme » (au sens technique du terme) à tendance réflexive ou phénoménologique (Jean-François Courtine, Jean-Luc Marion, le regretté Jean-Louis Chrétien, Paul Ricœur), avait abouti à un petit ouvrage portant sur des questions de phénoménologie et d’herméneutique de la religion. Et, de son côté, Dominique Janicaud faisait son propre travail de compréhension de ces incursions de la méthode phénoménologique dans des domaines afférents à la religiosité voire la spiritualité et, au nom du paradigme de « l’athéisme méthodologique », il leur a reproché de confondre le théologique et le phénoménologique. Plusieurs étaient en ligne de mire, mais celui qu’il visait plus particulièrement était Jean-Louis Chrétien.
Michel Henry relativisait très fort les propos de Dominique Janicaud, comme Paul Ricœur qui avait fait connaître sa protestation en disant qu’il en avait assez de cette forme de censure, dans la mesure où, selon lui, un intellectuel avait le droit de mener son propre chemin, d’autant qu’en « professeur de la République », il avait toujours séparé la critique et la conviction.
Idem, en quelque sorte, pour Michel Henry qui a commencé à « toucher » aux choses du christianisme, une fois parti à la retraite. Dans ses enseignements, il n’abordait pas trop ces questions-là. Mais, en réalité, on sait que son cheminement l’avait conduit à la problématique phénoménologique de l’intersubjectivité, dans la pure lignée husserlienne. Avec la phénoménologie matérielle comme méthode, il voulait repenser cette question de l’intersubjectivité pathétique. Michel s’est alors rappelé ses lectures bibliques et singulièrement celles qui mettaient en œuvre l’idée d’un corps dit « mystique », en sorte de penser le particulier et l’universel, mais aussi la présence invisible d’un corps et ses effets en matière de possibilités de gouvernance et d’intersubjectivité.
Son point d’entrée fut Paul de Tarse et sa théorie de la communauté mystique, c’est-à-dire une théorie de l’absence des corps physiques et de l’émergence d’un corps transcendantal commun, partagé et partageable, un « corps » qui devait permettre une unité nouvelle et assurer un flux participatif. Par ce biais, Henry a aussi repris sa lecture des Évangiles. Il a alors arrêté le projet de recherche phénoménologique et a littéralement basculé dans une étude très originale du christianisme, et plus exactement dans l’étude du phénomène « Jésus ».
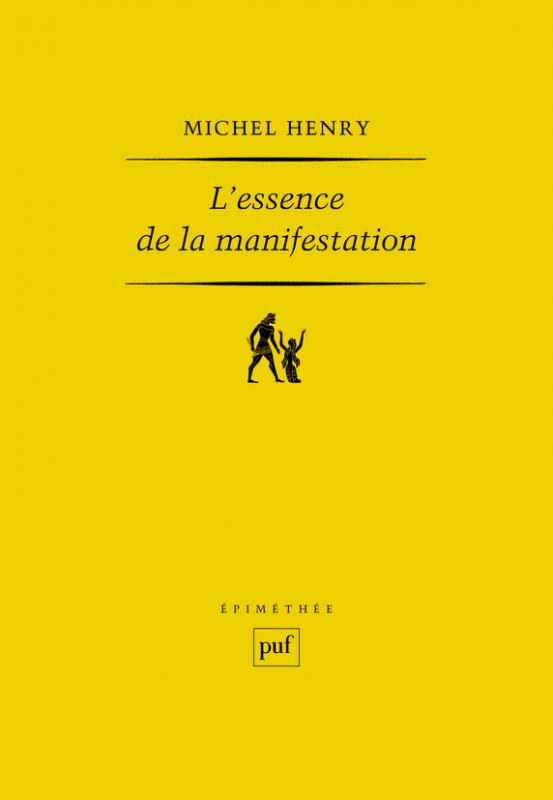
À aucun moment il n’abandonne la phénoménologie pour la théologie ?
Jamais. C’est pour cela que la thèse de Janicaud n’est pas juste ou, à tout le moins, appropriée au travail spécifique de Henry. Et l’idée d’un « tournant » de la phénoménologie n’était pas heureuse. Ou alors, il y a eu, comme j’en avais fait l’hypothèse à mon ami Jean Greisch, lecteur attentif de Henry, un « tournant français », mais pas avec les effets ou enjeux pointés par Janicaud. Mais Par contre, il y a bel et bien eu, en réalité, un tournant phénoménologique de la théologie. Les philosophes dont j’ai parlé plus haut (Marion, Chrétien, Ricœur etc.) ont rendu un service considérable à la théologie moderne. De la même façon qu’à une autre époque, un Bultmann a reçu énormément de Heidegger. Michel Henry voulait appliquer sa méthode phénoménologique à cet objet d’étude particulier et évoquer, comme le fait souvent le philosophe, les figures de l’absolu. Il a donc relu les lettres de Paul, Jacques pour la question du langage et, bien sûr, Jean qu’il connaissait très bien, depuis le début. Dans ses Carnets de guerre que nous allons édités, les allusions à la figure de Jean sont très nombreuses.
Mais pourquoi dis-je que Michel Henry ne confond pas phénoménologie et théologie ? Pour la simple et bonne raison qu’il ne connaît absolument pas la théologie, en tant que discipline rigoureuse. J’avais personnellement fait ma thèse de doctorat sur la philosophie fin XIXe d’expression française et j’avais beaucoup travaillé Bergson et surtout Maurice Blondel. J’avais expliqué à Michel Henry que certains, notamment des henryens, soutenaient qu’il était une sorte de « nouveau Blondel », qu’il entendait penser la venue de « dieu » dans l’action ou qu’il avait réintroduit Dieu dans la systématique philosophique, voire que lui aussi avait développé une « pensée du seuil », c’est-à-dire une pensée qui articule le théologique et le philosophique, une pensée qui estime que tous les instruments philosophiques sont prêts pour accepter l’existence de Dieu. Eh bien, je me souviens que Michel Henry avait ri, tellement ri, en me disant qu’il ne venait pas de ce monde-là et qu’il n’avait jamais lu Blondel. Et qu’il ne le lirait jamais… Mais sa femme Anne, elle, l’avait lu, pour ses recherches sur Schopenhauer. Henry était au cœur du moment husserlien de la philosophie et pas ailleurs.
Certes, Henry connaissait bien le spiritualisme français (Ravaisson, Lachelier, Bergson, Boutroux). Mais il était arrivé à un moment où l’on s’intéressait surtout à la phénoménologie et en particulier à la phénoménologie husserlienne dans toute sa technicité. Michel Henry a d’ailleurs très peu d’ouvrages de théologie dans sa bibliothèque. C’est parce qu’on lui conseille de lire Irénée qu’il lit Irénée. Il va d’ailleurs focaliser sur deux trois choses chez Irénée (notamment le problème de la gnose ou celui de la chair), deux trois choses chez Tertullien (problème de la chair, encore, et celui de la naissance divine), mais seulement quand ça l’intéresse.
Finalement, ce qui est important à ses yeux, c’est le phénomène « Jésus » qui va devenir « Christ » et dont il convient de retrouver la parole originaire. Il utilise d’ailleurs, comme boussole, Claude Tresmontant… Et Tresmontant comme outil exégétique et pas celui de la métaphysique. Quel choix totalement hétérodoxe qui prouve, s’il le faut, qu’il ne connaît pas la théologie et singulièrement la méthode exégétique. Car s’il y a bien un penseur qui est très critiqué pour ses thèses exégétiques sur le Christ hébreux, c’est Tresmontant. En revanche, il s’amusait du Tresmontant métaphysicien qui représentait, pour lui, la Sorbonne traditionnelle, prise dans les affres de la représentation. Il s’intéresse surtout à l’idée d’un Christ hébreux et à la radicalité de l’histoire du Christ. Michel Henry veut retrouver la parole originaire, c’est son grand fantasme. C’est pour cela que j’ai toujours pensé qu’il y avait une proximité de méthode entre Pascal Quignard et Michel Henry : on recherche les origines et le commencement.
Ensuite, comme Michel Henry est un penseur de l’affectivité, il pense l’expérience religieuse comme un sentiment, d’où son intérêt pour Novalis et le romantisme. Michel Henry est d’ailleurs un romantique en ce sens là. Pour lui, la religiosité est un sentiment, un affect. Cela provoque la rencontre de deux méthodologies : la méthodologie de la recherche d’une parole originaire et la méthodologie de la phénoménologie matérielle. Michel Henry était fasciné par la parole de Jésus « C’est Moi la Vérité ». Sur le plan philosophique, c’est, selon lui, l’écrasement de la subjectivité sur la vérité et réciproquement. Il se passe donc cette chose inouïe, sur le plan de l’histoire des idées, qu’un homme ose dire : « La Vérité, c’est Moi. »
Il d’ailleurs étonnant de voir que Michel Henry est aujourd’hui plutôt récupéré par des chrétiens traditionalistes et assez réactionnaires. En effet, son approche des Écritures est quasi-protestante, quasi-luthérienne : il n’y a rien entre la parole et celui qui l’étudie, si ce n’est l’immédiation d’une rencontre affective. En termes philosophiques, on dira qu’il est kierkegaardien. On trouve, chez ce dernier, cette idée fondamentale qu’il n’est pas nécessaire de s’encombrer de la littérature critique car s’il fallait lire toutes les bibliothèques pour comprendre le phénomène chrétien, on en viendrait à mourir, avant toute connaissance. C’est cette posture de Kierkegaard qu’il ne cesse constamment de répéter. Sa phénoménologie atemporelle et acosmique affirme qu’entre le Christ et lui-même, il n’y a ni espace ni temps. Mais il n’en demeure pas moins du langage.
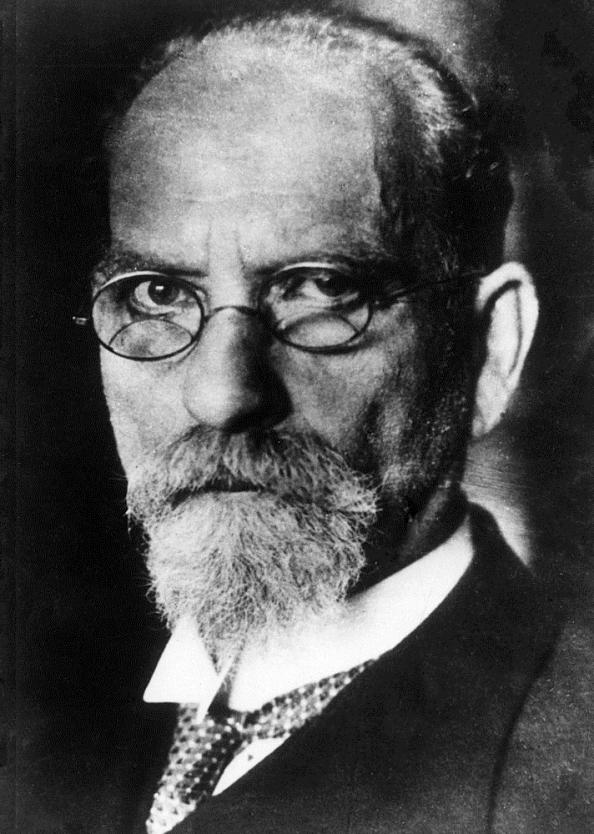
L’œuvre fondatrice de la philosophie de Michel Henry, L’essence de la manifestation, se présente avant tout comme une œuvre profane, comme une recherche sur la nature de l’ego dans la lignée de Husserl et de Heidegger. Pourtant le vocabulaire utilisé est souvent chargé sémantiquement et renvoie à des notions sacrées : absolu, révélation, parousie… Est-ce que cela nous dit quelque chose de l’approche si particulière de Michel Henry ?
La théologie, au sens chrétien du terme, est une invention tardive, médiévale. Michel Henry, lui, comprend la théologie d’un point de vue philosophique, c’est-à-dire au sens platonicien du terme, un logos portant sur les activités des dieux. Il est donc très au clair sur la sémantique que la philosophie mobilise. Pour Henry, dire « révélation », dire « manifestation » ne revient pas à tourner le dos à la philosophie. Mais c’est aussi savoir que la théologie a transféré tous ces concepts et les a utilisés, comme le fait Jean-Luc Marion. Dans L’essence de la manifestation, Henry, qui est un esprit libre, ne dialogue pas seulement avec Husserl, Heidegger, Sartre ou Bergson, mais aussi avec Eckhart et Augustin. Pourquoi ? Parce qu’il s’inscrit dans une grande tradition qui sait que la question de Dieu appartient à la philosophie. Elle lui appartient radicalement et dans d’autres contextes épistémiques que le contexte théologique. J’avais, par exemple, organisé à l’université de Louvain-la-Neuve un séminaire sur les interprétations du Prologue de Jean en philosophie : c’est gigantesque (Augustin, Eckhart, Maine de Biran, Fichte, Schelling, etc) ! Le programme était passionnant mais l’échec pédagogique fut total… Aujourd’hui, nous sommes dans une situation philosophique absolument disséminée. Dès que le mot « Dieu » apparaît, nous sommes aux abois. Or un philosophe travaille « d/Dieu » comme un concept, tandis que le théologien travaille Dieu comme une personne, c’est totalement différent. Mais aujourd’hui, celui qui parle de Dieu en philosophie est souvent considéré comme peu sérieux… On ironisera lors des diners mondains ou, au contraire, on tentera de le récupérer dans des mouvements apologétiques.
Michel Henry soutient que Dieu ne peut pas se manifester dans le monde et que dans cette impossibilité s’enracine « l’essence originelle de sa déité ». Comment peut-on dès lors comprendre la venue du Christ sur terre et le fait même de son incarnation ?
La « déité », la deitas, renvoie au langage eckhartien. C’est une lecture qui a marqué en profondeur Michel Henry. Stanislas Breton me disait que le fait même d’utiliser Eckhart en philosophie est un message latent pour dire que l’on entretient une certaine distance ironique ou dubitative, avec la dimension convictionnelle. Il faut prendre cela en compte : Michel Henry a mobilisé une parole des marges pour travailler le théologique.
Il faut comprendre que Henry applique tout le problème de la dualité phénoménologique de l’apparaître à l’histoire de Jésus qui devient un Christ et d’un Christ qu’il faut faire retourner à un Jésus. Il faut bien comprendre qu’il a trouvé dans le christianisme à la fois le monde et la vie. Pour Henry, la vie est bien un contre-monde et ce n’est que dans un contre-monde qu’il peut y avoir la révélation plénière de l’homme. Chez Henry, ce n’est pas le devenir Dieu qui est le plus important. Il ne cherche pas à expliciter la christologisation de l’homme, mais bien plutôt l’humanisation de l’homme. D’où la métaphore henryenne des silhouettes que nous sommes et qui errons sans avoir accès à la plénitude de la vie.
Encore une fois, Henry n’est pas théologien mais bien phénoménologue. Il lit tous les textes selon sa théorie de la duplicité phénoménologique de l’apparaître et au gré de sa théorie de l’affectivité. Il y a une très grande prétention ici chez Henry, la même qui est à l’œuvre dans la Généalogie de la psychanalyse : avant il y a eu Maine de Biran, Schopenhauer, Nietzsche et Freud, puis : « il y a moi » qui accomplit le geste d’une phénoménologie matérielle. C’est assez typique d’un grand philosophe. Il a d’ailleurs fait la même chose avec sa lecture du christianisme. Il prétend être le premier à comprendre, dans sa plénitude, le message chrétien qui s’accorde parfaitement à sa phénoménologie matérielle dont la vision n’est pas duelle, mais duale, avec un principe d’inversion de type alchimique, c’est-à-dire qu’une entité dans sa dimension affective peut être à la fois jouir et souffrir. Pourquoi la Croix est une jouissance ? Parce que la Croix est le salut des humains.
Dans Paroles du Christ, Michel Henry a montré que le christianisme marquait l’avènement d’un nouveau Logos, différent de celui des grecs. Quelle est la nature de cette parole révolutionnaire ? En quoi ébranle-t-elle le sens commun ?

Les théologiens ont apporté dans leur domaine des notions philosophiques, comme s’il y avait un manque sémantique et épistémologique dans le corpus même des Écritures. À cet égard, Henry ne prend pas du tout la même posture. Il n’a pas besoin de la Grèce pour faire le travail qui est le sien. Henry pense que ce texte-là vaut par lui-même et possède ses propres ressources. Et pourquoi n’est-il pas nécessaire de passer par la Grèce pour comprendre ces textes ? Précisément parce qu’ils sont anti-grecs, aux yeux de Henry et de sa compréhension de la philosophie grecque qu’il réduit à des systèmes de la représentation, de la visibilité, de la dimension extatique du monde… Henry a, en réalité, trouvé dans les Écritures un logos anti-grec. Cela le ravit sur le plan de l’histoire des idées. Là est toute son intelligence dans la lecture du christianisme. Les théologiens devraient d’ailleurs revisiter cette invitation henryenne. Pourquoi avoir toujours besoin de Paul Ricœur, d’Emmanuel Levinas et de Jean-Luc Marion pour « faire » la théologie ? La théologie a en elle-même ses propres ressources, ses propres forces, sa propre energeia. Henry l’a montré, à sa façon.
Le fait que la Révélation ne se soit pas faite aux puissants mais aux tous petits est quelque chose qui a beaucoup marqué Henry. Il ne faut pas comprendre les petits sur le plan moral, voire économique. Les petits ne sont pas dans une dimension d’infériorité mais sont ceux qui se positionnent d’emblée sur le plan de l’expérience affective, c’est-à-dire qui n’approchent pas la Révélation par la vie de l’esprit mais par l’action.
Michel Henry affirme à plusieurs reprises (dans Incarnation et C’est Moi la Vérité notamment) que la Vérité du christianisme n’est pas de l’ordre de la pensée, de la connaissance ou de la science. Par conséquent, à quel domaine appartient-elle ?
Pour lui, le christianisme n’est pas une expérience de la pensée ou de l’esprit, mais une expérience affective d’un sujet qui peut écraser en lui la subjectivité et la vérité. L’expérience chrétienne n’est pas une expérience de connaissance mais d’action : ce que vous avez fait à ces fameux petits, c’est à moi que vous l’avez fait. Derrière cela, il y a l’idée fondamentale de l’intersubjectivité pathétique : « qui touche à un vivant touche à la vie », « qui m’a vu a vu le Père », « qui a vu le vivant a vu la vie » etc. Henry oppose à la problématique de l’intersubjectivité – il y a ici une pointe contre Lévinas : l’essentiel n’est pas la responsabilité éthique dans l’interobjectivité des corps, des individus et des personnes – celle de l’infra-réciprocité. Ce qui est sacré, c’est la vie en nous car nous sommes dans une intersubjectivité pathétique. En revanche, la Trinité ne l’intéresse pas, ce sont des élucubrations postérieures. Ce qui compte pour lui c’est l’idée de l’intromission des subjectivités entre elles.
Michel Henry n’est pas non plus un « philosophe chrétien ». Il a fait une phénoménologie du christianisme. C’est un philosophe du Christ, non pas subjectivement, mais objectivement. C’est-à-dire qu’il entend prendre cet épisode de l’histoire des humains au sérieux. Il ne faut pas commettre l’erreur qui consiste à séparer l’œuvre de Michel Henry en deux. D’un côté, le philosophe très sérieux et, de l’autre, à partir de 1996 une œuvre qui n’est plus utilisable. L’œuvre est un tout et est faite d’une même matière. Tout fonctionne. C’est une œuvre qui est extrêmement construite. Henry s’est emparé du personnage Christ et a voulu en faire une lecture. C’est une attitude très moderne. Il y a une immédiateté d’accès pour celui qui veut rentrer dans cette narratologie de l’histoire de Jésus. C’est très typique du geste henryen, c’est très affectif, très sentimental, très kierkegaardien. C’est presque même romanesque. D’ailleurs la narration du « Fils du roi » pose aussi la question de la manifestation de la folie…
Pourquoi Michel Henry trouve-t-il absurde le fait de réclamer une preuve de l’existence de Dieu ? N’y a-t-il pas un risque à invalider tout un pan de la théologie ?

La preuve intellectuelle est une réduction objective. Le fait de la réserver pour la raison pure est une manière de ne pas saisir Dieu. Michel Henry dit aussi qu’un Dieu qui aurait besoin d’être prouvé est un Dieu qui n’aurait pas besoin d’exister. Mais c’est aussi dire ce que ne sera pas la phénoménologie matérielle, à savoir une apologétique. Elle n’a rien à prouver ou démontrer. Elle ne donnera aucune raison de croire. Ce travail de la preuve est un travail inutile. Michel Henry est fidèle à ce grand paradigme de L’essence de la manifestation : à la raison, je substitue l’affectivité. Ce n’est donc pas la rationalité du christianisme qui l’intéresse, c’est son schématisme affectif, cette expérience narratologique de l’affectivité dans la figure christologique.
Encore une preuve que la théologie n’est pas son sujet…
Sa bibliothèque est pauvre en littérature théologique. ça lui tombait des mains ! Il a commencé la lecture de Fides et Ratio de Jean Paul II, il a lu dix pages ! Il a refusé de faire partie de Communio, la revue des intellectuels chrétiens autour de Jean-Luc Marion et du cardinal Lustiger. Il n’a pas voulu appartenir à l’intelligentsia catholique. Michel Henry était un homme seul, qui vivait sur les marges et qui était dans la voie érémitique plutôt que dans la voie mondaine des cercles intellectuels chrétiens. Il était en dehors de tout ça. C’est pourquoi j’ai toujours dit que c’était un mystique sauvage.
La philosophie de Michel Henry a souvent été taxée d’acosmisme. Pourtant, il n’a cessé d’affirmer son souci du monde et d’autrui, en prenant le Christ comme modèle. Comment réconcilie-t-il cette dénonciation du monde comme lieu des apparences et des faux-semblants et cette exigence éthique consistant à prendre soin des hommes ?
N’oublions jamais que Michel Henry est dans la Résistance, dans le Maquis, que c’est un homme engagé. Sur le plan de la biographie philosophique, cela invalide tellement le reproche d’un acosmisme ou d’un hyper-transcendantalisme (Laoureux). Il n’aurait jamais produit une philosophie de l’affectivité s’il n’était pas un homme de l’incorporation. Il n’aurait jamais fait une thèse secondaire sur Maine de Biran s’il n’avait ce goût philosophique pour l’immanence.
Passer dix ans de sa vie à travailler Marx et écrire un ouvrage considérable qu’on est en ce moment en train de redécouvrir. Passer son temps à faire une esthétique à partir de Kandinsky. Passer son temps à faire un essai culturel sur la barbarie. Faire une thèse secondaire sur la question du corps. S’intéresser à la problématique du conscient et de l’inconscient à travers la psychanalyse. Comment peut-on encore dire qu’il y a un hyper-transcendantalisme et un acosmisme chez Michel Henry ? C’est faux. Attribuer à Henry cette attitude-là, c’est mal comprendre la structuration phénoménologique de sa méthode. L’outillage phénoménologique lui permet d’éviter l’unilatéralisme. Il est parvenu à bien dialectiser les usages des concepts. Henry n’est pas un duelliste, il est dual. Michel Henry n’a pas créé de dichotomie entre le monde et la vie. C’est une articulation constante qui produit quelque chose épistémiquement parlant. C’est pour cela aussi qu’il n’a jamais voulu être considéré comme un gnostique. Que veut dire la philosophie de Michel Henry sur le plan de l’usage personnel ? Cela veut dire : nous savons très bien que nous sommes mondains et en capacité de mentir. Mais si nous voulons opérer cette métamorphose interne, subjective, et devenir des vivants, nous savons dès lors que dans ce monde-là, sans distance, il nous est impossible de mentir. La chair ne ment pas.
Photo ©Coll. UCLouvain, Fonds Michel Henry
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
