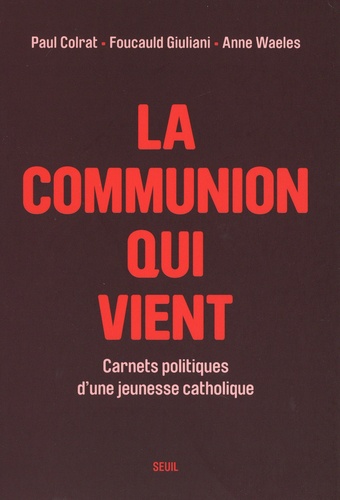Jeunes professeurs de philosophie et membres des cafés associatifs Le Dorothy (Paris) et Le Simone (Lyon), Paul Colrat, Foucauld Giuliani et Anne Waeles proposent dans La Communion qui vient une réflexion originale sur le sens de l’engagement politique d’un point de vue chrétien, en refusant autant le dévoiement identitaire que le repli individualiste.
PHILITT : Le livre s’ouvre sur le constat d’une « surpolitisation » de la société, que vous opposez à la prétendue « dépolitisation » dont on parle si souvent. Faut-il s’éloigner de la politique, voire la rejeter ?
Foucauld Giuliani : Il est courant d’entendre dire ou de lire que les citoyens contemporains seraient « dépolitisés ». Ce constat est souvent invoqué pour leur faire la morale, comme s’ils étaient indifférents au destin collectif. Nous nous opposons à cette idée en tentant de montrer qu’elle ne repose sur aucune conceptualisation solide de la politique. Penser la politique en termes d’élection, de représentation ou encore de « domaine » dans lequel nous pourrions choisir ou bien refuser de nous engager conduit toujours à croire que la politique est extérieure à nous, ce qui est une illusion libérale reproduite par de nombreux chrétiens.
Cette illusion fonctionne ainsi : on distingue strictement sphère privée et sphère publique et on postule que la première est imperméable aux forces qui structurent la seconde. Or, les conditions de la vie personnelle, donc les conditions concrètes et mondialisées où s’exerce notre liberté, sont configurées par différents pouvoirs : politiques, économiques, juridiques, idéologiques… Il faut donc penser la politique à partir du concept de pouvoir car c’est cela qui est déterminant. Ce faisant, on arrive au constat que les vies contemporaines sont surpolitisées dans le sens où elles sont rendues conformes aux intérêts et aux injonctions du marché et de l’État. La surpolitisation, autrement dit, c’est l’enrôlement dans des mécanismes de pouvoir absolument gigantesques, qui façonnent l’individu contemporain et le déterminent jusque dans son intimité.
Face à ce constat, nous avons besoin d’un double mouvement. D’abord, de ce qu’on appelle dans le livre un effort de dégagement : c’est une prise de conscience et une mise à distance des différents types et mécanismes de pouvoir, suivi d’une création d’alternatives concrètes au sein de la société, laissant entrevoir de nouvelles manières de s’organiser collectivement et d’initier de nouvelles formes de vie libérées du capitalisme surpolitisant. Ensuite, d’une capacité à discerner à quelles conditions et au nom de quelles finalités, une logique de participation au pouvoir institutionnel et étatique est légitime. Car boycotter les élections serait sans doute oublier un peu vite que si son principe et son fonctionnement posent de nombreux problèmes, la démocratie représentative a cependant des effets concrets bien que limités sur nos existences. L’essentiel est de ne pas projeter sur la démocratie représentative l’espoir d’une promesse d’une révolution qu’elle ne peut pas tenir.
Il y aurait, à l’inverse, un potentiel politique inscrit dans les Évangiles et qui, lui, serait en mesure de produire de vrais changements ?
Bien plus que des changements : de véritables bouleversements. Pour le comprendre, il faut d’abord rompre avec l’idée confortable selon laquelle la « religion », conçue comme un secteur de la vie humaine parmi d’autres, relèverait fondamentalement du domaine privé et spirituel – à la rigueur social. Ce discours-là est en partie entretenu par les chrétiens eux-mêmes, qui se satisfont parfois d’une séparation nette entre le message du Christ d’un côté et leurs convictions politiques de l’autre. Sous prétexte de « rendre à César ce qui est à César », une parole du Christ dont on fait souvent une interprétation arrangeante, on se dispense d’écouter son message politique.
Certes, le Christ n’a pas conquis le pouvoir institutionnel, ni épousé le mode de pensée et d’action des rebelles zélotes, bien décidés à combattre par tous les moyens l’occupant romain. Cependant, s’il n’avait pas eu d’effet politique, c’est-à-dire s’il n’avait pas, par sa parole et par ses actes, mis en question les pouvoirs en place, l’organisation collective et les relations entre les personnes de la société, il n’aurait pas été condamné à mort par les autorités spirituelle et temporelle représentées par Caïphe et par Ponce Pilate. On peut même faire l’hypothèse suivante : une existence est politique lorsque les pouvoirs en place ne peuvent pas faire montre d’indifférence à son égard. Ce que les pouvoirs ne peuvent ignorer, voilà ce qui est politique, c’est-à-dire ce qui interroge et met en tension le fondement même de la société, ainsi que son fonctionnement et ses finalités. En ce sens, l’existence du Christ est profondément politique. Car que fait le Christ, notamment ? Il met en lumière que le fondement de l’ordre social et politique est la contrainte et la violence. Autrement dit, il désacralise et démystifie et propose une inversion normative totale : à la place de la force de la contrainte et de la violence, la force de la charité ; à la place du pouvoir, le service ; à la place de l’intérêt, le don… Par son appel et par ses actes, le Christ devient puissance de contradiction instillée au cœur de tous les régimes, les sociétés, les civilisations… Être principe de contradiction et non se complaire dans le rôle de moyen de cohésion culturelle, voici le rôle des chrétiens. Ce rôle n’est pas seulement négatif. Il peut s’agir de combattre, politiquement et spirituellement, pour une vie libérée des différentes formes de mal (péchés, injustices etc) et d’extorquer au pouvoir institutionnel des lois justes.
Au-delà du message, comment penser concrètement la politique d’un point de vue chrétien ?
À vrai dire, le cadre dans lequel un chrétien peut s’inscrire politiquement existe déjà : il s’agit de ce qu’on appelle la paroisse. Dans le catholicisme, il existe en effet une véritable articulation entre le local et l’universel. C’est à l’échelle de la paroisse que ces deux échelles, pourtant a priori inconciliables, se voient réunies. Encore faut-il comprendre que la paroisse n’est pas réductible au lieu de culte : c’est toute communauté qui tente de vivre selon les principes de l’Évangile et de les mettre en pratique concrètement, ce qui implique une sortie de soi.
Par ailleurs, l’Église catholique ouvre une voie qu’il faut considérer attentivement. Elle contient le ferment d’un discours et d’actes qui se proposent de remettre l’Histoire à l’endroit. Prenons deux exemples : tout d’abord, le concept de « civilisation de l’amour » développée par le pape Paul VI, qui se traduit par un certain internationalisme, dont la dimension politique est indéniable pour qui le prend au sérieux puisqu’il propose un horizon politique nouveau, qui échappe à trois écueils majeurs auxquels nous sommes confrontés depuis le XXe siècle. Tout d’abord, celui de la mondialisation promue par le capitalisme contemporain ; celui de l’internationalisme abstrait déracinant ; et enfin, celui du souverainisme obtus. Autre exemple : le concept de « destination universelle des biens », notion essentielle de la doctrine sociale catholique et dont les implications politiques sont très concrètes puisqu’elle signifie que les biens vitaux sont avant tout des dons divins qui ne peuvent pas être objets d’appropriation. Nul ne peut en être légitimement privé. Autrement dit, la privatisation des biens communs est dite contraire à la volonté de Dieu. Dans la doctrine catholique officielle (Compendium de la Doctrine sociale de l’Église), la propriété privée est clairement subordonnée à la destination universelle des biens. On mesure la portée révolutionnaire d’une telle pensée théologico-politique…
Vous parlez de « souverainisme » plutôt que de « nationalisme » ?
Oui, car nous pensons qu’au fond une critique radicale de la souveraineté est nécessaire du point de vue chrétien, à partir de la critique que l’on peut faire du concept d’identité. Il ne s’agit évidemment pas tant de renier l’idée de nation que de tirer toutes ses conséquences de l’approche théologique selon laquelle « on ne se possède pas » : Saint Paul appelle à un effort spirituel visant à se déposséder, non pas pour laisser place au néant, mais pour se laisser posséder par la grâce. C’est une remise en question de l’ego et de l’identité qui a pour but de les réorienter, de les rediriger vers un but qui est une transformation de soi. « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » s’écrie-t-il dans l’épître aux Galates.
Tout chrétien est appelé à suivre cette voie, qui n’est pas réservée à une quelconque minorité éclairée. L’appel à la divinisation et à la sainteté est universel et il est la promesse d’une vie recrée de fond en comble. Nul ne peut affirmer qu’il est parvenu à accomplir parfaitement cette dépossession : c’est un cheminement constant vers un but, vers une incarnation qui modifie en profondeur notre rapport avec les autres, avec soi-même, et avec notre action.
Qui ne voit qu’une telle approche anthropologique ouvre nécessairement à une critique profonde et créatrice de l’idée si politique de souveraineté ?
N’y a-t-il pas une tendance à considérer que le christianisme, au fond, appelle à se détourner de la politique, le Christ lui-même semblant se désintéresser de ces questions ?
Ce serait oublier que les Évangiles contiennent un appel à se rendre aux quatre coins du monde pour délivrer un message. Ce serait oublier aussi ce que je disais précédemment sur l’Évangile comme principe de contradiction. Mais plus encore : le Christ nous parle du « règne de Dieu ».
Cette idée du règne de Dieu, qui n’emploie pas par hasard un terme éminemment politique, pose de nombreuses questions, car elle se heurte à une évidente contradiction : manifestement Dieu ne règne pas puisque l’injustice domine. Faut-il comprendre que ce règne n’est pas encore advenu et qu’il est pour l’avenir ? Ou que c’est un règne limité, qui ne s’exerce qu’en certains endroits, pour certaines personnes, ou dans certains aspects de nos vies ?
À moins d’admettre que Dieu ne règne pas de la même manière que l’on règne ordinairement selon nos conceptions politiques. Dieu ne règne pas avec les armes habituellement utilisées en politique. Il règne par la faiblesse, pour reprendre le titre du bel ouvrage du philosophe et théologien américain John D. Caputo. Cela rejoint encore une fois saint Paul et son apologie de la faiblesse dans le deuxième épître aux Corinthiens. Dieu règne par la charité, par le don de soi, autant de modalités dans lesquelles nous ne sommes pas habitués à voir des instruments de règne politique. C’est là tout l’enjeu pour nous : par ces modalités d’action, subvertir le domaine de la politique. Quand nous disons « Que ton règne vienne », nous ne disons pas : « Ton règne n’est pas là, donc qu’il vienne ! » Nous disons : « Fais que je sache voir ton règne et que je sois associé à son extension. »
Saint Paul n’est-il pas à l’origine de cette ambigüité fondamentale quant aux rapports qu’entretient le christianisme avec le pouvoir ?
Vous faites référence à un passage bien connu des Évangiles : « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi. » (Épître aux Romains) Ces mots ont été abondamment commentés par les penseurs chrétiens, qui en ont livré des interprétations très diverses. L’une de ces lectures a donné naissance à l’augustinisme politique, dont la postérité est importante. Elle consiste à dire qu’un chrétien doit se conformer aux lois et, dans notre histoire française, elle a sans doute trouvé sa synthèse la plus forte dans le principe de la monarchie absolue. Elle a eu de vilains rejetons puisqu’elle a justifié la passivité presque totale de l’Église de France face au gouvernement de Vichy et ses diverses abjections durant la Deuxième Guerre Mondiale. Au point que les évêques français ont solennellement déclaré à ce sujet, en 1997, que « dans leur majorité, les autorités spirituelles, empêtrées dans un loyalisme et une docilité allant bien au-delà de l’obéissance traditionnelle au pouvoir établi, sont restées cantonnées dans une attitude de conformisme, de prudence et d’abstention (…) »
On peut faire une lecture différente de ce passage de l’épître aux Romains : toute autorité tire sa légitimité du fait de réaliser la volonté de Dieu. Dès lors, l’esprit critique est aiguisé et on est forcément conduit à se poser la question suivante : y-a-t-il des autorités qui font la volonté de Dieu ? Sur quels critères juger ? Comment procéder avec celles qui violent cette volonté de Dieu ? Dans ces questions prend racine l’anarchisme chrétien, présent aussi bien chez Dorothy Day que chez Jacques Ellul. Dans tous les cas, les Évangiles nous incitent à adopter un regard critique sur l’autorité. Souvenons-nous de saint Augustin qui s’interrogeait dans La Cité de Dieu : « Sans la justice, les États sont-ils autre chose que de grandes troupes de brigands ? ».
L’État pose-t-il alors un problème insoluble ?
Il faut porter au moins un triple regard sur l’État.
L’État moderne est d’abord une forme de rationalité qui réduit le divers à l’un et qui substitue à la libre délibération entre hommes des règles de fonctionnement rigides et impersonnelles. L’État uniformise et homogénéise. Et cela non pas par plaisir, mais par nécessité : il a besoin d’uniformité pour administrer. Face à cette tendance, nous opposons la communion, qui repose au contraire sur la reconnaissance de la diversité des hommes, sur leur irréductible singularité et sur l’idée que la véritable unité ne s’atteint que dans la transfiguration de la liberté individuelle en charité.
L’État est aussi un rouage essentiel dans le fonctionnement de l’économie. Sans État moderne, l’économie capitaliste que nous connaissons aujourd’hui n’aurait ni pu naître ni perdurer. Toute initiative libérale sur le plan économique repose sur des lois, des institutions et des décisions pour l’existence desquelles l’État est indispensable. Même l’Union Européenne, dans laquelle certains veulent voir une négation de l’État, ne repose in fine que sur un fonctionnement interétatique visant à favoriser telle ou telle politique économique. Donc si on veut mettre à bas le capitalisme, il importe d’opérer une critique de l’État.
Enfin, l’État possède une troisième fonction : conserver et réaliser le bien commun à travers certaines institutions. Comme l’Éducation Nationale, par exemple. De telles institutions, c’est ce qu’on peut appeler « l’État social ». Sur ce point, il est nécessaire de se poser la question de la finalité et de juger au cas par cas. Si on prend l’exemple de l’éducation, personne ne nie l’intérêt de fournir aux enfants une instruction gratuite de qualité mais néanmoins des questions cruciales se posent : l’institution scolaire répond-elle aux exigences d’une vie heureuse pour les étudiants ? Leur permet-elle réellement de se découvrir capable de penser et de créer ? Il est patent qu’en introduisant rationalité économique dans l’école, par la promotion de l’utilitarisme sélectif et de la compétition, l’État empêche un rapport libre et désintéressé au savoir.
En résumé, on a sans doute besoin d’État au sens d’une loi commune et au sens d’un moyen de coordination entre des institutions ayant des finalités positives pour la société. Mais l’État répond bien souvent à d’autres logiques contraires au bien commun.
Le christianisme n’est donc pas un anarchisme ?
Cela dépend ce qu’on entend par « anarchisme ». Le christianisme dit que « Dieu seul est maître », ce qui suppose de porter un regard critique sur les autorités humaines mais non pas de refuser toute forme de vie collective, ce qui serait idiot. Le meilleur de la tradition anarchiste, d’ailleurs, est profondément soucieux d’organisations réfléchies où les décisions se fondent sur l’exercice du discernement collectif et où l’on vise la coïncidence entre libertés et bien commun.
C’est en cela que l’Église est une institution importante, c’est ce que nous appelons dans le livre une institution destituante, en nous appuyant sur l’œuvre du philosophe italien Giorgio Agamben. De par le fait qu’elle est fondée par le Christ et que sa principale finalité est la charité, l’Église est en tension permanente avec les autres institutions qui ont souvent pour loi la maximisation de leur puissance. Mais l’Église est surtout en tension avec elle-même, avec la menace de devenir une institution « comme une autre », ayant pour seul but la puissance. La façon dont les victimes d’abus sexuels ont été traités est un exemple parfait de cette possibilité d’auto-défiguration de l’Église.
Nous sommes favorables à la laïcité en ceci que nous ne pensons pas que l’Église a vocation à prendre l’État et à copier le pouvoir étatique mais nous réfutons pour autant l’idée d’une séparation nette entre politique et religion, car la religion suppose de prendre en charge la question de l’organisation de la vie collective, d’où l’intérêt que nous avons pour l’ouverture de lieux de vie associatif, comme par exemple Le Dorothy, café-atelier associatif ouvert à Paris avec des amis en 2017.
À l’heure où certains hommes politiques parlent volontiers d’identité chrétienne ou de racines chrétiennes, pourquoi jugez-vous important de rejeter ces notions ?
Nous sommes tous indiscutablement façonnés par des traditions, par des identités etc. Nous ne pensons pas qu’il faille tirer un trait dessus mais nous disons que toute identité humaine demande à être convertie par Dieu, c’est-à-dire réorientée par lui. Le christianisme n’est pas une racine, mais une greffe. Il naît et s’implante sur un socle culturel déjà présent, qu’il guérit, façonne, réoriente… Il est un retournement de l’intérieur qui bouleverse les cultures, les hommes et les pensées. Le chrétien ne dit pas « sum » mais « credo » : il ne se définit pas par son identité mais par sa vocation à la charité.
Les identités existent, mais elles sont toujours relatives comparativement à l’Absolu qui nous réclame tout entier. Dès lors, nos identités (nationales, sociales, psychologiques…) doivent se confronter à l’exigence de la conversion. En d’autres termes, il ne s’agit plus de penser l’homme dans la catégorie de l’être, mais dans celle de l’appel. Le but pour tout chrétien est de faire de sa vie une prière et de s’enraciner, terme particulièrement galvaudé, non pas dans un enclos, mais dans une expérience concrète et quotidienne de la charité. C’est la leçon de tous les grands saints. Le lieu importe moins que la manière de l’habiter. Il n’y a pas de profane ou de sacré dans l’absolu. Sacraliser l’État nation est non seulement un non-sens, mais c’est aussi une drôle d’ironie quand on pense que l’État nation est aujourd’hui, à l’ère de la mondialisation capitaliste, le premier acteur du déracinement spirituel.
Sur la question de la GPA, vous formulez une critique qui ne se satisfait pas des arguments traditionnellement avancés par les chrétiens qui s’y opposent…
Notre critique se situe sur plusieurs plans. Nous voyons d’abord la GPA comme l’extension du capitalisme au niveau le plus intime : celui de la fonction reproductrice. Cette violence capitaliste correspond à la logique de l’appropriation du corps d’autrui et à celle de la marchandisation de la procréation. Elle nous semble aller contre la dignité des personnes et l’égalité entre personnes. Tout comme nous ne croyons pas à l’idée d’une prostitution libre, nous ne croyons pas à l’idée d’une GPA librement consentie et conforme au bonheur des personnes. Cela nous oppose à un certain libéralisme de gauche.
Nous critiquons ensuite la GPA du point de vue féministe, en prenant en compte ses effets profondément destructeurs pour les femmes : perception de son corps comme un simple outil, dissociation de soi-même induite par l’idée de porter un enfant « cédé » ensuite à d’autres personnes…
Enfin, notre pensée de la GPA tente de s’inscrire dans le cadre plus large d’une réflexion sur notre rapport avec les réalités non maîtrisables, les enfants symbolisant au plus haut point ce « non maîtrisable », puisqu’on ne peut pas savoir à l’avance à quoi ressemblera et vers quoi s’orientera un enfant, et cela quels que soient les procédés éducatifs mis en place. L’enfant nous échappe. Il faut casser l’idée selon laquelle on « ferait » des enfants comme l’on fait un objet, or la GPA porte dans son sillon le fantasme d’une procréation entièrement maîtrisée. On le voit bien avec le retour en force des tentatives eugénistes qui travaillent à réduire la procréation d’enfant à un travail de calcul et de paramétrage.
Enfin, alors que nos amis chrétiens diplômés d’écoles de commerce s’insurgent contre la GPA en disant qu’elle implique la « marchandisation du corps de la femme », mariant habilement le programme d’Alliance Vita avec le discours du NPA, nous disons que la mère porteuse n’est pas une dérive de l’époque, mais qu’elle en est le paradigme car elle en éclaire la tendance – généralisée – à la réquisition des corps et au contrôle de leurs processus vitaux, ce qui renvoie au concept de surpolitisation développée au début de notre échange.
Vous manifestez un intérêt pour certaines expériences politiques, comme les ZAD, qui ne se revendiquent pourtant pas du christianisme, loin s’en faut…
C’est vrai, et ce n’est aucunement un problème à nos yeux. Il y a un réel mystère de la présence de Dieu dans l’Histoire, auquel nous sommes particulièrement sensibles. On ne peut jamais parfaitement identifier le christianisme à un courant, à une action ou à des gens. Il transcende littéralement les cultures et les dépasse les barrières érigées entre les mouvements ou les groupes humaines. Une personne peut tout à fait s’inscrire dans la logique de communion dont nous parlons, tout en refusant l’étiquette de chrétien.
Nous pouvons avoir de sincères affinités avec certaines initiatives qui sont pourtant éloignées de la question religieuse ou du moins qui ne revendiquent pas cette question. Nous ne cherchons pas à les réintégrer ou à les attirer, car nous préférons être attentifs à ce qu’elles ont de chrétien dans leur manifestation : nous avons de nombreux amis non-chrétiens qui cheminent dans une direction qui nous surprend nous-mêmes, tant elle entre en résonance avec l’Évangile.
À l’inverse, le monde « authentiquement chrétien » et qui se revendique comme tel ne réussit pas toujours à s’opposer aux tendances destructrices pour l’être humain. L’Église n’a eu qu’une faible voix pendant les deux premiers conflits mondiaux, et face à la vague consumériste et capitaliste et aux violences de la mondialisation, les chrétiens ont du mal à se faire entendre en temps voulu… Si nous nous réjouissons du message fort du pape François en faveur de l’écologie, lancé en 2015 dans son encyclique Laudato Si’, il faut bien reconnaître que cela est venu tard.
Il y a donc une vraie nécessité à apprendre les uns des autres et à nouer des alliances. Nous rejetons tout exclusivisme, toute tendance à confisquer ce qui nous paraît bon comme si nous étions les seules personnes légitimes à pouvoir faire le bien. Ceci étant, nous pensons qu’une action politique qui se coupe de la prière et de la quête de foi est très menacée de dérives multiples. Et cela explique que nous pensons qu’il urge de réconcilier théologie et politique. C’est précisément le chantier de La Communion qui vient.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.