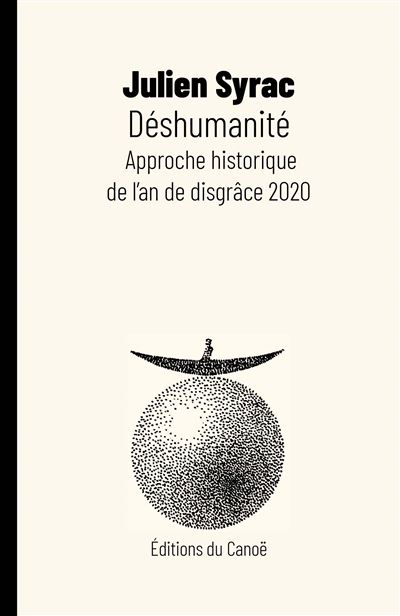Déshumanité, imposant premier essai de Julien Syrac, romancier, poète et traducteur de 32 ans, est le portrait de notre société libérale contemporaine à l’heure du Covid, tout autant qu’un exposé nourri d’idées fusantes autour d’une thèse principale : la lutte entre réalisme et romantisme politique, de Pascal et Rousseau à Houellebecq, Wohlleben et Alice Coffin. Déshumanité est comme une pelote qui se déroule en même temps que ce long phénomène de déliaison des êtres prend de la vigueur, jusqu’à la crise sanitaire de 2020 qui en est non le point d’orgue mais le révélateur. L’essai pose la question de savoir en quoi le Covid, cette guerre Potemkine, ce non-événement de la post-histoire érigé par réflexe total (totalitaire ?) en Événement historique mondial, a illustré et révélé cet antagonisme pluriséculaire. Julien Syrac, Philippe Muray des années 2020 ? Oui incontestablement et non bien sûr, car cela serait nier sa singularité qui s’impose à chaque ligne de ce livre génial et clivant, contestable et fulgurant, produit d’un homme de son temps, conscient d’être moderne mais critique face au discours remâché et béat du Progrès idéologique.
PHILITT : Déshumanité est un état des lieux que vous dressez de la Modernité à l’heure de la crise sanitaire. Vous écrivez que la rédaction de cet ouvrage est venue de la colère. Par quoi cette colère a-t-elle été déclenchée et en quoi la crise du Covid est-elle représentative de ce « lourd fardeau d’être moderne », pour reprendre votre expression ?
Julien Syrac : Colère, oui, mêlée de désarroi, de tristes pressentiments, deuxième quinzaine de mars 2020, à l’heure où commençait concrètement, pour chacun de nous, moins la pandémie que la ci-devant « crise sanitaire », par cette chose inouïe qu’était le confinement : l’interdiction de sortir librement de chez soi sous peine de sanction policière – qu’on songe, je vous prie, à l’énormité de l’énoncé –, et ce sur l’intégralité du territoire national, aux Champs-Élysées comme à Sainte-Eulalie d’Olt et dans les campagnes désertes du Morvan nivernais (rappelons que des malheureux ont fini derrière les barreaux parce qu’ils ont été pris quatre ou cinq fois dans la rue sans le fameux papier…). Chose surréaliste, inimaginable jusqu’alors, dont le scandale, dans sa fraîcheur d’à peine deux ans, nous apparaît déjà terriblement affadi, blanchi, périmé, affaire classée – ce qui est peut-être le plus effrayant. Mais cela eût encore été supportable, et le fut pour un temps (parce qu’il y avait la peur du virus, réelle au début, et l’espèce de solidarité basse, mais consolante, du tous dans la même galère, et aussi, quand même, la possibilité de resquiller), si le discours public, le discours officiel – médiatique, présidentiel, gouvernemental – n’avait pas été aussi stupidement martial, aussi performativement dramatique, aussi férocement univoque, aussi monstrueusement déraisonnable. Je ne vois guère comment l’on pouvait réagir, face à cela, face à cet étau de fait qui s’annonçait durable, autrement que par la colère, ou du moins l’inquiétude.
Quant au « lourd fardeau d’être moderne », comme j’ai sous-titré au début de Déshumanité, un peu par opportunisme ou défaut, il est vrai, parce qu’il fallait bien mettre des titres, je dirais simplement que c’est le fait de croire à l’Histoire. Le fait que chaque individu moderne, consciemment ou non, se sache matériau de l’Histoire, et sente le besoin d’accrocher son être et son action – son destin – à des mythes historiques (mythe de l’Ordre, mythe de la Liberté, mythe du Progrès, etc.), autrement dit le besoin de se mettre au service d’une bannière humaine flottant au vent de l’Histoire, à laquelle il reconnaît un sens (direction et morale, prospective et rétrospective), un sens qui éclaire la vie de chaque homme. Dans un sens ou l’autre, notez, progrès ou déclin, aurore ou crépuscule, lendemains qui chantent ou chant du cygne (le réactionnaire me paraît être le double du progressiste, et tous deux des figures éminemment modernes). Être moderne, c’est être enrôlé, enrégimenté, incorporé dans l’Histoire. C’était… En tel sens, la « crise du Covid » est représentative, sur un mode mineur, dégradé, de ce fardeau : un accident arbitraire, « naturel », d’assez faible intensité du reste, s’impose à nous, et nous voulons croire qu’il fait événement historique, qu’il fait aventure collective, mouvement général, et que ce mouvement a une nécessité, une raison. Mais est-ce encore de l’histoire ? Ou seulement le désir au rabais qu’on a de cette peau morte ? L’empressement à s’en revêtir est troublant. Croire à l’Histoire, c’est au fond accepter la légitimation de l’arbitraire – chose insoutenable pour la raison humaine – c’est approuver le mythe, dans le sens que René Girard en a donné : approuver le récit collectif, le discours de nécessité, approuver le sacrifice de victimes innocentes.
Votre ouvrage se compose de deux parties d’égale longueur : la généalogie de la Modernité, depuis les théories contractualistes jusqu’à la révolution néolibérale contemporaine, et l’illustration de cette Modernité par l’exemple le plus actuel : la crise du Covid. Peut-on voir en cette dernière le point d’orgue d’un long processus qui débute au xviie siècle et qui a vu la victoire d’un capitalisme libéral tout-puissant ?
Non, je ne crois pas, ce serait tomber dans le piège de l’historicisme, de la téléologie, négative et rétrospective si l’on veut, mais téléologie quand même. Si mon livre peut laisser l’impression que la « crise du Covid » est l’aboutissement fatal ou le point d’orgue parfait de, disons, la libéralisation moderne des sociétés, alors c’est un malentendu, dont je suis certainement responsable. Néanmoins, l’impression de paroxysme, de pic, de pompon, est bien là, comme si nous assistions à une sorte d’apothéose négative, tantôt burlesque, tantôt glaçante ; la période, à l’évidence, va constituer un précédent, faire jurisprudence, la grande inquiétude vient de là. Certains reliquats d’un état d’exception surgonflé et indégonflable entreront dans les mœurs. Globalement pour le pire, cela semble acquis.
Par rapport à l’histoire, à l’examen des durées causales, je crois qu’il vaut mieux dire ainsi : la « crise » est un révélateur, comme on dit en chimie photographique, qui nous offre un arrêt sur image assez caricatural (c’est son intérêt, son charme presque) de processus qui jusque-là faisaient papier blanc, toile de fond. À savoir surtout, il me semble, ce phénomène de déliaison des êtres dont je parle abondamment, et dont on peut en effet considérer, en grossissant le trait pour les besoins de la démonstration (ce qui est, je le reconnais, assez typique de la méthode employée dans ce livre), qu’il est en germe, en puissance, dans les théories libérales des XVII-XVIIIe siècles, en particulier dans la théorie contractualiste (le contrat est le moyen, non pas suffisant mais optimal de réunir et d’unir les hommes – au sens de l’union comme concorde, comme paix, qui est la grande obsession libérale, la raison d’être du libéralisme, et tant mieux). Cette théorie du contrat – ou théorème, voire – possède, par la clarté logique de son énoncé, la noblesse et l’universalité de ses intentions (la liberté, la paix), une puissance de séduction telle qu’on peut vite en faire une devise idéologique, dogmatique, et partant, en dépit de l’examen réaliste des choses et en toute inconscience des effets, le principe actif d’une mutation métaphysique, d’une transformation lente, graduée mais radicale des sociétés humaines. Transformation qui n’a jamais été vraiment théorisée ni même imaginée en tant que telle, mais que l’histoire nous donne à constater en partie, oui. C’est pourquoi il faut regarder l’histoire, non pas lyriquement, comme épopée glorieuse ou funeste, mais froidement, comme suite de changements, de disparitions de choses qui étaient et ne sont plus, et inversement. Et se demander, comme le médecin légiste devant le cadavre : où ? comment ? à quelle heure ? Puis, comme l’inspecteur de police : qui ? quels complices ? pourquoi ? Jouer ensuite le procureur ou l’avocat est une tentation, mais cela ne me paraît pas le plus excitant dans l’affaire. L’Histoire est une science assez morbide, morbide et policière.
Si l’on se concentre là-dessus, si l’on prend les choses par cette hypothèse-là d’une « révolution anthropologique libérale » (je laisse de côté le « capitalisme » pour des raisons d’efficacité stratégique, le terme me paraissant trop grevé de matérialisme, trop imprégné d’économie, trop mythologique presque, trop associé à un imaginaire Compagnie des Indes, banquier de Daumier, gratte-ciels émiratis, enfants d’Asie cousant des Nike, traders sous cocaïne et pétrodollars en évasion fiscale – et du côté de sa critique, trop préempté par Marx et tout ce qui sort de son ombre énorme), alors on verra que la « crise du Covid » nous présente des manifestations aggravées de cette déliaison des êtres au nom même de leur cohabitation idéale, au nom même du lien social, de ce qui fait tenir ensemble la société… Avouez que le paradoxe est massif, et c’est sans doute pourquoi il n’est pas tellement vu ; il y a là une absurdité devant laquelle, comme souvent face à l’absurde, l’esprit détourne instinctivement l’œil. De cette déliaison la « distanciation sociale », etc., est bien sûr l’aspect le plus grossier, pittoresque, conjoncturel, quoique ses effets asocialisants soient réels et durables, chacun l’aura constaté. Beaucoup plus puissant et inquiétant est le phénomène aux allures d’irréversible que j’appelle la « télévie », auquel le confinement et ses suites ont donné un coup de boost spectaculaire, à savoir simplement : le retrait de plus en plus total de chaque individu dans sa cellule personnelle (domestique ou itinérante) connectée au Réseau, connectée à d’autres par le Réseau, et la substitution massive, parfois complète, des relations et interactions traditionnelles par des interactions et relations « virtuelles », jusqu’à rendre les premières obsolètes : achats en ligne, commandes de nourriture, « réseaux sociaux », « applis de rencontres », télétravail, online gaming, etc. Les conséquences de ce phénomène, s’il devait devenir la normalité et la norme, et ce moment semble approcher, sont proprement indescriptibles. Et désastreuses. Or cela marche, la mayonnaise prend, sans trop user le coude ni la fourchette, et sans doute moins en raison d’une espèce de fatalité technologique (les outils sont là, donc on s’en sert, et, mimétisme oblige, tout le monde s’en sert – même si c’est évidemment un aspect du problème), que parce que le modèle de la « télévie » répond admirablement, au fond (et ici nous bouclons la boucle), à ce que promeut et promet la maxime libérale du contrat, à savoir une vie sociale essentiellement sinon exclusivement fondée sur des transactions entre individus suivant leur fameux intérêt égoïste bien compris (quelqu’un a-t-il jamais vraiment bien compris son intérêt égoïste ?). Une vie sociale où les êtres doivent pouvoir se libérer les uns des autres aussi vite et aisément qu’ils se sont liés (ce que permet l’interface numérique, sorte de facilitateur transactionnel désocialisant), une vie sociale où l’attachement (liens familiaux, conjugaux, fidélité amicale, etc.) et le frottement humains (l’interaction accidentelle, indésirée, pas ou trop peu rentable) sont sentis comme inutiles, nuisibles, détestables, ramenés au minimum syndical et, idéalement, abolis. Le tout évidemment emballé dans de sermonnants discours de « vivre-ensemble », de « prendre soin », de « solidarité », de « sauvez… », etc., comme une grosse coque vide et épineuse que boursoufle le néant qu’elle a pour fonction d’occulter. Une vie parfaitement irréelle, très déprimante, très peu civilisée par définition – à peine une vie. Si déshumanité il y a, elle est ici.
Vous semblez vous apparenter au courant de pensée antimoderne (nostalgie de la perte ou de ce qui manque, conscience du déclin spirituel, critique du pouvoir de l’argent et du matériel…) bien que vous ne vous en réclamiez pas ouvertement. Vous vous en détacheriez même en le qualifiant de « nouveau dogme » au même titre que la réaction. En quoi ne serait-il pas une bonne clef de lecture pour dresser le constat de notre Modernité ?
Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par « courant de pensée antimoderne », expression qui me paraît recouvrir un champ intellectuel suffisamment vaste et contrasté pour être inopérant (entend-on par là en même temps Alain de Benoist, Renaud Camus, Baudouin de Bodinat, Jean-Claude Michéa, Philippe Muray, Ivan Illich, Jacques Ellul, Joseph de Maistre, Peter Sloterdijk, l’Action française, les gens de la deep ecology, les mormons et les islamistes intégristes, ou alors quoi ?), mais je vous répondrais, d’instinct : que d’une part non, je ne me réclame d’aucun courant, et que d’autre part, quitte à vous décevoir, non, je ne suis pas « antimoderne », même pas réactionnaire… Je ne m’endors pas le soir en rêvant de ressusciter en masse les marquis à perruque de 1760 ou les messalisantes bretonnes de la France de De Gaulle, si en vogue aujourd’hui, ni même d’une restauration monarchique ou, mettons, de l’abolition du droit de vote féminin – si vous voulez tout savoir. C’est grave, docteur ? À l’évidence, j’ai des affinités, parfois grandes, avec des penseurs réactionnaires ou jugés tels, ce livre pourrait en attester. J’ai aussi comme vous, devant le néolibéralisme appliqué, mettons, devant la surenchère technologique, devant un certain langage qu’il est de bon ton d’appeler managérial, face encore à certains discours et habitus dits de progrès dont je subis la bêtise carnivore, l’érosive laideur, une position critique, incrédulité, rejet ou exécration, qu’on pourrait associer à une posture réactionnaire. Il y a aussi des pudeurs virginales qui s’éventent avec l’âge, un pessimisme, un regret qui se creusent et s’acceptent : à 32 ans, j’ai vu la vie quotidienne changer, à vive allure, et je peux dire, assez systématiquement, « cela était mieux avant » (c’était notamment mieux sans smartphones). Et comme tout être humain, tout écrivain surtout, je suis traversé par la nostalgie, la sensation du manque et de la perte, les craintes pour l’avenir. Mais cela n’est pas politique, c’est en deçà et au-delà de la politique, et n’a pas tant à voir avec un « courant de pensée » qu’avec le tempérament, la sensibilité, passés au tamis ou sous les fourches caudines de l’expérience. La pensée vient après, qui lui donne des soutiens, des confirmations, du carburant. La suite, si suite il y a, c’est une question d’adhésion, d’« enthousiasme militant », dirait Konrad Lorenz, et c’est encore une question de tempérament.
Non, la réaction stricte, politisée, idéologisée, grégarisée, comme volonté d’agir pour restaurer des mœurs et formes mortes (de plus en plus mortes que leur modèle s’éloigne dans le temps), cela me laisse froid, inquiet ou ricaneur, me paraît une chimère, une bêtise, une impasse, et ce pour les raisons que l’admirable Marien Defalvard a très bien exposées ici même. Si maintenant être « antimoderne » c’est vouloir moins de survêtements en polyester et plus de rempailleurs de chaises, moins de pluies acides et plus de bals musettes, moins d’écrans numériques et plus de terrine du terroir, va bene, va benissimo, mais alors c’est comme « antifasciste », ça se porte en bandoulière dans les pique-niques et n’en faisons pas tout un pâté. Mais vouloir être radicalement « antimoderne », c’est une puérilité, plus stupide encore que celle de vouloir être « absolument moderne » ; la Modernité a ses grandeurs, ses excellences objectives, nombreuses, innombrables, dans les idées, les mœurs, les objets, la mode, en art, en littérature, en architecture, bien aveugle qui ne le pourrait voir, bien malhonnête qui ne saurait le dire… Le problème est ailleurs, doit être formulé autrement.
Je vais vous paraître froid, austère, moral, mais je crois que pour dresser le constat, faire le bilan, accuser ce qui doit l’être, moins d’ailleurs dans la Modernité que dans la postmodernité (j’insiste sur ce « retournement » dans le livre), le contemporain, le présent, il faut se défaire de tout historicisme et simplement épingler, très précisément, très concrètement, ce qui n’est pas « bon », au sens platonicien où : bon = beau = vrai = un. C’est un principe de raison morale – de raison morale réaliste : qui n’ignore pas les paradoxes des hommes, leur grandeur et leur misère – mêlé de sens esthétique, d’aspiration presque érotique au beau, au plaisir du beau (mais sans esthétisme, sans dandysme), qui devrait guider le jugement historico-politique, le jugement sur les axiomes, les formes, le mouvement de la société vécue. Cela est-il bel et bon ? Cela est-il mieux ? Cela est-il juste ? Au nom de quelle idée ? Cette idée est-elle vraie ? Est-elle bonne ? Cela mérite-t-il de changer ? Cela mérite-t-il d’être conservé ? Cela n’est-il pas la même chose sous un autre habillage ? L’habillage vaut-il mieux ? etc. Le problème étant qu’il faille, pour ce faire, avoir une conception ferme du Bien (dont le mal n’est que le négatif ; c’est un peu facile, le mal). Il faudrait, en d’autres termes, moins une religion au sens du culte que d’une transcendance morale commune, universelle, sacrée, bonne, sérieuse, exaltante, inattaquable, ne souffrant aucune relativisation, aucun marchandage historique. Il faudrait peut-être un Dieu, oui – la phrase finale de Heidegger, comme un aveu, un regret au seuil de la mort : « Seul un Dieu peut nous sauver. » Ici les problèmes commencent, puisque la Modernité, ce serait simplement et de plus en plus irréversiblement : la mort de Dieu. Mais tout ce qui meurt avec Dieu, le sait-on ? Le saura-t-on jamais ? Il y a eu appel d’air, mais pas vide, par définition (j’ai essayé de pointer ce vide dans Déshumanité, le vide sous l’illusion du plein, sous la satisfaction mensongère de l’étant tel qu’il se mire dans lui-même, cet orgueil narcissique du devenir, du progrès et de sa forme dégradée la nouveauté, qui serait le « chauvinisme du moderne », l’expression est de Muray). Dieu ne sera probablement pas ressuscité, mais pour interroger l’état des choses par le manque, l’absence (d’où l’importance de la connaissance historique, de ce qui a été, considéré comme pouvant être), l’absence et le manque de bien, de bon, peut-être faut-il faire comme si Dieu n’était pas mort. Peut-être devrions-nous laisser le souvenir de Dieu nous guider, le souvenir qu’un Dieu fut possible et donc le demeure – l’idée que nous sommes quand même des créatures à l’image de Dieu, dans un monde qui du reste n’est pas fait pour nous (pas plus hier que demain ; l’Éternité, plus solide étalon que l’Histoire), des créatures à l’innocence perdue, coupables mais habitées par la nécessité du bien, et pas un bien de pacotille. Il y aurait là un puissant principe de sérieux et d’espérance, et de joie, qui fait aujourd’hui largement défaut, convenez-en. Le nihilisme aujourd’hui est énorme, dévorateur.
Vous assimilez la période allant du XVIIe siècle, qui annonce le début du déclin du religieux, à nos jours avec l’aboutissement du capitalisme libéral à une longue lutte entre réalisme et romantisme. En quoi consiste-t-elle et quelles sont ses principales étapes et ses figures de proue ?
Vous touchez à la thèse (thèse au sens de proposition, j’insiste, plutôt descriptive d’ailleurs ; et non théorie, qui serait une explication) qui est à la fois la plus originale, la plus structurante, et la plus contestable de mon essai, la plus déformable aussi. Sans refaire ici le livre, je dirais, grosso modo : j’appelle « esprit romantique » (et non le romantisme en littérature, en musique, en peinture, que je mets très haut) le type d’esprit, de mentalité, d’« ontologie » le plus activement moderne, à partir du moment où la Modernité se réalise et s’universalise politiquement, avec la Révolution française – c’est-à-dire : le type d’esprit qui croit le plus fort en l’Histoire. Et lie le plus étroitement la substance du sujet, le Moi, à celle de l’Histoire, au Nous, comme passé ou devenir, matrice ou horizon, « racines » ou progrès, et parfois, souvent, les deux à la fois – c’est exemplairement le cas dans le nationalisme, qui est la grande passion politique moderne (aujourd’hui, Dieu merci, à peu près éteinte) et dont le spectaculaire avènement est contemporain du romantisme, s’il n’en est le produit. Mais à vrai dire, il y a quelque chose de réactionnaire, de viscéralement antimoderne dans l’esprit romantique… Considérons, hypothèse plausible, que le grand fait moderne, le génie et le malheur de fond de l’âme moderne, soit, corollaire de la fin de la croyance structurante dans l’Au-delà, prélude à la sécularisation générale : le doute ; et son antidote, très puissant mais très insuffisant : la raison. L’esprit romantique serait alors ce qui, reconnaissant ce malheur moderne mais sachant l’insuffisance de son remède, veut le dépasser dialectiquement, par le haut, par la croyance, mais dans le siècle, dans le monde, dans l’Homme et l’Histoire, dans un élan assez fou, assez sublime en vérité. C’est une tentative ambiguë, ouverte et fougueuse, d’être antimodernement moderne, d’être supra-moderne… C’est la passion se croyant raison, si vous voulez… Aboutissant à ce paradoxe, insoutenable pour l’époque dite des « Lumières » et du « rationalisme », que tout devient religieux. Et sans doute précisément parce que la religion dominante, le christianisme, n’a plus la belle rondeur enveloppante, la belle splendeur souveraine d’un Tout puissamment architecturé qui court sans rival du berceau à l’Éternité… Si vous permettez que je me cite : « Romantique donc est la foi moderne dans le dépassement du scepticisme moderne. Comme toute foi, c’est un sentiment dormant qui se manifeste par crises, dans la crise, quand le doute vous écrase ; alors c’est une foi d’autant plus violente qu’elle doit surmonter sa propre aporie de n’être foi en rien d’éternel. Romantique ainsi est la négation sublime des contradictions de l’ontologie moderne. » (p. 107)
Ses étapes et figures de proue ? Je parle beaucoup de Rousseau, qui cristallise à mon sens tout l’esprit romantique, qui en est le véritable père : le culte du Moi, le désir de Nous politique, d’anamorphose du Moi en Nous (la « volonté générale »), l’exaltation du naturel contre le social, l’importance donnée à l’émotion, l’imagination, la volonté, l’action contre la raison (voir : « l’homme qui médite est un animal dépravé »), le prophétisme révolutionnaire, etc. L’étape décisive, fondatrice, c’est évidemment la Révolution française, fille de Rousseau, matrice de notre « Époque », au sens hégélien. De là Napoléon, de là le nationalisme allemand, de là tout le reste. Herder, Fichte, Hegel, Marx après lui, Nietzsche ensuite, Wagner, sont des grandes figures romantiques… Mais aussi Hugo, Barrès bien sûr, Bakounine, Romain Rolland, Lénine, Maurras, Heidegger, par exemple. Étapes ? S’il y a Modernité et postmodernité, si ces termes ont une certaine efficacité descriptive, ce que je crois, il y aurait aussi romantisme et « néo-romantisme », la rupture se situant au lendemain du traumatisme des deux guerres mondiales, particulièrement la seconde. L’échec ambigu de « Mai 68 » serait une borne ultérieure, valant passage à la postmodernité complète, si l’on veut. J’ai glosé sur ces mutations de Zeitgeist dans une partie intitulée : « De l’après-guerre à nos jours : généalogie de l’ontologie néo-romantique ».

Entendons-nous bien : ce que j’accuse, dans le romantisme, c’est son versant politique, son irréalisme politique, toujours-déjà sacrificiel, pas la poésie ou la musique romantique. Qu’un créateur mégalomane sente et chante le monde à l’aune de son divin Moi, fort bien, cela a donné d’immenses œuvres et en donnera de très grandes. C’est le sommet de l’art, le sublime. Je ne plaide pas, devant le romantisme, pour un quelconque antidote en gelée froide, classique, vitrifiée, propre sur elle – au contraire. Mais il faut observer que le glissement d’un versant à l’autre, du Moi poétique au Nous politique, se produit facilement, souvent, sans cesse, comme Tocqueville l’a très tôt noté ; « l’esprit littéraire » (où l’on « se décide sur des impressions plutôt que des raisons ») a beaucoup déteint sur la politique aux deux derniers siècles, pour la contaminer, l’emphatiser, la faire déraisonner, en faire une mystique. On n’y comprend rien si l’on accorde un crédit exagéré à la petite opposition droite-gauche, ou réaction-progressisme, nationalisme-communisme, etc.
Ce que j’appelle réalisme n’affronte pas l’esprit romantique comme un courant de pensée un autre, les deux n’en étant pas à proprement parler. C’est plutôt affaire d’esprit, de tempérament, une fois encore, et pour le réalisme d’« art », éminemment moderne, essentiellement littéraire, que je vois en germe, condensé, chez les moralistes du Grand siècle. Un art qui tend naturellement à battre en brèche l’esprit romantique, à le déshabiller, à s’en faire le miroir moqueur, le memento mori. Figures de proue ? Je commence par Saint-Simon (le « premier romancier moderne », dixit Arendt), Saint-Simon mis en regard de Rousseau, Mémoires vs Confessions, duel peu canonique mais qui m’a paru plaisant, productif, je vous laisse juge. De là : Balzac, Stendhal, Flaubert, Dostoïevski, Proust, Céline, Houellebecq, Philip Roth, il y a un chapitre entier là-dessus, façon exercices d’admiration, un vrai-faux panthéon personnel, très grand public, réquisitionné pour les besoins de la démonstration – j’ai exagéré certains amours et en ai tus beaucoup… Enfin, vous aurez reconnu, derrière ces deux termes antagonistes, surtout le romantique, l’ombre railleuse de Philippe Muray (le Muray du XIXe siècle à travers les âges et du Céline, de l’« ocsoc » et du « vouloir-guérir », etc.) et celle, énorme, biblique, de René Girard – Girard qui est le vrai grand homme de Déshumanité, si cela peut dire d’où je parle. À un degré plus bas et de biais, mentionnons Peter Hacks, le kantien Cassirer, G. K. Chesterton ; et, allant dans le même sens, mais découvertes après l’écriture de Déshumanité, comme une heureuse confirmation, certaines réflexions de Kundera et surtout l’excellente analyse de Rüdiger Safranski dans Romantik. Eine deutsche Affäre (« Romantisme. Une histoire allemande »), hélas non traduit en français, qui annonce très bien, à la fin de son introduction : « Bon pour la poésie, mauvais pour la politique, si jamais le romantisme s’y égare. Ici commencent les problèmes que nous pose le romantique. »

Le réalisme serait davantage une « désacralisation » ou une « ironisation », que René Girard appelle « le romanesque ». La distanciation, sans mauvais jeu de mots, avec le Réel par le rire, la mise en évidence de l’absurde, comme a pu le faire Philippe Muray, est-elle le moyen, pour le réalisme, de confronter, voire de disqualifier efficacement, les idéaux romantiques ?
Oui, et cela se produit dès lors qu’on observe le réel d’un œil qui n’est pas vicié par l’illusion, le désir d’illusion, d’adhésion, d’illusoire fusion avec le monde (le « sentiment océanique » de R. Rolland), et dès lors qu’on le juge, le réel, avec un esprit teinté de pessimisme, un pessimisme légitime, fertile : conscience fondamentale, lancinante, du « néant du monde » et de la « vanité de toutes choses », comme disait Saint-Simon, ou bien, en généralisant l’expression que Muray applique au Houellebecq des Particules élémentaires, le don cruel de savoir« en tout, apercevoir la fin » (pessimisme « chrétien » qui m’a autorisé, entre autres éléments, à affilier, au sens propre, le réalisme aux moralistes à teinte janséniste du Grand siècle). Le comique, l’ironie, le rire, viennent alors d’eux-mêmes : par le flagrant délit des vanités, le décalage devenu criant entre l’apparence, l’illusion, la « grandeur d’établissement », et la banalité, la petitesse réelle, concrète, naturelle, des sujets mis sous la loupe (tout ensemble êtres, situations, discours). Décalage qui est la dialectique même de l’homme, et qu’on ne peut rendre qu’à condition de savoir finement observer et largement sentir – l’esprit de finesse, le talent du regard sont essentiels –, et merveilleusement rendre, sous une autre forme, une forme esthétique, un art, la réalité telle qu’elle s’est dénoncée, particulièrement la réalité « sociale », qui est la matière, l’obsession première du réaliste, son sein et sa névrose.
Pour arriver à ce que j’appelle réalisme (terme élu par commodité de langage, on m’en opposera volontiers de meilleurs), il ne suffit pas de voir et copier la réalité d’après nature, scolairement, platement ; les moyens seront au contraire baroques, expressionnistes, artistes, puisqu’il s’agit d’une sorte d’heuristique nécessitant d’accentuer les différences, les contrastes, les écarts, de renverser la topographie, d’aplanir ici, d’enfler là, de litoter ici, de monstruoser là ; il faut le sens de la couleur et des volumes, le génie du langage, et un tempérament de saboteur, oui, une volupté de marionnettiste, des élans de cœur déçu – de cœur exigeant, donc. On entre dans la psychologie, pourquoi pas, je lui donne toute sa place… Par rapport à l’esprit romantique, esprit de lyrisme et d’enthousiasme, esprit d’adhésion et d’anathème, esprit de grandeur sans contrepartie que ménage peu la tentation du rêve debout, le réalisme se pose naturellement en contradicteur, en rabat-joie, en « contre-pouvoir », si l’on veut. C’est ce qui m’a intéressé, par-delà toute question de littérature : les grandes œuvres réalistes comme contre-histoire, comme histoire non romantique, anti-mythologique, de l’époque moderne. Pour prendre un exemple facile, sinon caricatural, comparez ce qu’on peut faire en littérature de la bataille de Waterloo, dans le poème d’Hugo, « L’expiation », et dans Stendhal, La Chartreuse de Parme… Vous aurez deviné où est le romantique, où est le réaliste… Remplacez maintenant Waterloo par février 1848, Verdun, Quartier latin en mai 1968, Chute du Mur, forum de Davos, affaire Weinstein, crise du Covid ou soirée chez Mme Duchmolle, vous verrez que la viande est juteuse… Je précise aussi, pour adoucir les accusations – pas imméritées – de dichotomisme bovin et ordurier, que tout n’est pas « romantique ou réaliste » (même si le jeu des typologies au cordeau est un jeu plaisant, on se laisse vite prendre), et tous les écrivains fatalement logés avec armes et bagages dans l’une ou l’autre camisole, évidemment non ! Un écrivain comme Louis Calaferte, par exemple, absent de Déshumanité quoiqu’il ait été mon grand homme à vingt ans et le demeure encore, Calaferte présente des traits exemplairement romantiques, et pourtant il a en lui du réaliste bien trempé, du moraliste pur sucre, même (dualité dont il avait d’ailleurs une conscience aiguë, et qu’il n’aurait sans doute pas refusé de voir présentée en ces termes). Le cas de Maurice G. Dantec, écrivain peut-être apprécié dans vos colonnes, vaut également le détour. Au fond, j’ai proposé une grille de lecture par tempéraments, par humeurs comme l’entendait la médecine antique, en partant du produit fini et en réduisant la donne à deux fluides, sachant que l’un et l’autre cohabitent dans l’organisme, plus ou moins dominants, façonnants, mais jamais purs et constants, de même qu’il arrive à l’atrabilaire d’avoir des coups de sang et au sanguin de la mélancolie.
Dans ce cadre, votre récit à la première personne en « Annus Covidus », au style décalé, souvent humoristique, parfois « trivial », qui tranche avec l’exposé historique et philosophique en première partie, obéit-il à cette exigence de réalisme ironique et désacralisant ? Ou bien ce récit, au vu de l’absurde de la situation covidienne, ne pouvait-il être que burlesque ?
Le contraste entre les deux parties n’est pas aussi marqué qu’on l’a dit. Il y a certes une sorte de dichotomie thèse/illustration, mais l’esprit d’anecdote, de chronique, de vignettes d’« Annus Covidus » se retrouve dans certains passages de la première partie, et les analyses de texte, gloses et digressions générales de la première reviennent dans la seconde. Le ton, le style ne s’infléchissent que parce que le sujet change : l’histoire en I, le présent plus ou moins au fil du calendrier, de janvier 2020 au 1er janvier 2021, en II. Mais c’est plus littéraire, plus enlevé, oui. Dans le passage de l’un à l’autre il y a un geste libératoire, barda qu’on jette ou récré qui sonne ; quelque chose d’un « bien péroré, mon fils, maintenant il faut divertir » … L’idée était de raconter « l’année du Covid » telle que je l’avais vécue, entendue rapporter, méditée, dans un esprit de coq-à-l’âne, entre le journal, la chronique satirique et déjà les souvenirs, le témoignage pour mémoire… Car j’avais senti que l’amnésie, présent perpétuel oblige, recouvrirait assez vite d’une chape d’oubli cette période littéralement exceptionnelle, par certains côtés heureuse, grouillante de curiosités qui méritaient d’être fixées comme des papillons à l’épingle, et dont on n’allait plus retenir que le récit mythique, uniformisé, dramatisé et banalisant, avec situation initiale, événement perturbateur, péripéties et happy ending comme dans les mauvais romans. Il s’agissait d’être réaliste : partir du concret, du trivial, du vu et du manié, dirait Saint-Simon, jouer le point de vue du passant singulier contre le « niveau de la totalité », afin de refuser à la « crise sanitaire » la belle cohérence tragique qui l’élevait à la dignité d’Événement, et de sauver de l’oubli, d’autre part, ce que l’Événement, une fois romantiquement bétonné, ne manquerait pas d’oblitérer, à commencer par la bêtise des discours faiseurs d’Événement, et l’écart abyssal, souvent comique, entre ces discours, les drastiques mesures imposées et la réalité placide du terrain – où le malheur existait, mais diffus, singularisé, épars, obscurci, comme de tristes buissons muets tapis dans l’ombre énorme du drame officiel où ils croissaient et continuent de croître, semés à grandes brassées aveugles par le régime d’exception, la loi martiale.
Dans la composition en vignettes de la seconde partie, et dans le fait de partir souvent du discours pris comme cliché, du langage comme tissu de poncifs, il y a un côté Mythologies de Barthes, si vous voulez : « Panique au supermarché », « Le racisme anti-chinois », « Nous sommes en guerre », « La nature reprend ses droits », « Un nouveau CNR », « Ce que le virus nous apprend », « La grande réinvention », « La vie sans contact », « Le mal complotiste », « Le vaccin arrive ! », « Gare au taux d’incidence », « Le monde d’après », etc. – tels auraient pu être les titres de mes chapitres, ce qu’ils sont à peu près. J’avais aussi envie de tirer du côté stendhalien, égotiste, romanesque, en mettant en scène des choses personnelles dont je n’avais encore jamais fait un usage littéraire : ma ville natale, Compiègne, où j’ai passé le confinement, ma vie à Berlin, l’Italie, ma compagne, ma famille, certains amis, etc. C’est assez burlesque, oui, même s’il y a des passages graves, pathétiques, et des réflexions tout ce qu’il y a de sérieux, espérons-le.
La déshumanité s’accompagne d’une déréalisation que vous avez vécue en Bosnie, pays qui connaît un « hiver du Réel » et qui a été reconstruit après la guerre comme une « parodie » où tout est faux et où le vrai « est refait pour le faire ressembler au faux ». Nous avons vécu cette déréalisation plus généralement lors de la crise Covid et sa guerre d’opérette dans un champ de bataille Potemkine, que vous décrivez comme un anti-drame historique, un non-événement. La répétition de l’Histoire comme farce, pour reprendre Marx, serait-elle révélatrice de notre goût post-moderne pour l’ère du vide, comme vous le disiez plus haut, ou du faux, et n’y aurait-il pas d’échappatoire à cette « crise neutralisante » ?
J’ai évoqué la Bosnie parce que j’y étais en janvier 2020, juste avant le début de la « crise », et que j’y ai retrouvé incarnés, visibles, outrés – mais c’était plutôt dans l’autre sens : un point de départ, une « révélation » – nombre de phénomènes qui nourrissent la méditation en première partie de Déshumanité. Notamment, comme vous le soulignez, ce phénomène debordien de déréalisation parodique, du « vrai devenant un moment du faux », dans ce pays dévasté où l’on reconstruit en quantité, physiquement et idéologiquement (églises, mosquées, « identités », martyrologe), un passé que la guerre a détruit ou noirci de sang, et que l’après-guerre, à la fois honte, déni et continuation de la guerre, commande de ressusciter lavé, blanc comme neige, étincelant. C’est le pays de la compétition mémorielle et du révisionnisme communautaire par excellence, un pays girardien en diable, la Bosnie, incroyable cristal de mimétisme belliqueux et désormais victimaire (postmoderne, donc), une terre dont les hommes, réellement aimables, vivent et se vivent en victimes éternelles de « la politique », une terre que toutes les tragédies de l’histoire européenne ont labourée en long et en large, pour n’y laisser que cimetières et que ruines, un vide d’hommes et d’idées affreux, une mélancolie assourdissante, et l’étrange énergie, pourtant, l’étrange, virile et morbide énergie d’une passion de l’Histoire qui, vue de chez nous, de l’Occident sans guerre, a quelque chose d’exotique, d’inconvenant, d’archaïque, d’archaïquement moderne, si je puis dire. Telle était la Bosnie que j’ai vue, une parabole : ruine vivante de l’Histoire, fantôme pétrifié de l’avenir…
Quant à la formule de Marx, on l’a beaucoup entendue, elle a son charme, sa véracité, mais qu’est-ce à dire ici ? L’événement Covid n’a pas d’antécédent historique dramatique, sauf à considérer la peste noire du Moyen Âge ou la grippe espagnole de 1918, ce qui ne résiste pas une seconde à l’examen – mais on s’est empressé de vouloir faire ressembler « notre » pandémie à ces fléaux, rappelez-vous les ventes de La Peste qui explosent en mars 2020, etc. Bêtise romantique, nous voilà ! Non, l’événement Covid est une nouveauté, et c’est précisément cela qu’il fallait voir, dire. La nouveauté, c’est qu’un non-événement historique (au sens où l’événement historique par excellence c’est la guerre, or la « crise du Covid » était une guerre en négatif, un arrière à qui manque le front, une guerre Potemkine : pas d’ennemi, pas de mobilisation générale, pas de masses, pas de cadavres dans les rues, pas de destructions, pas d’engagement, pas de possibilité d’héroïsme, etc.) soit aussitôt élevé à la qualité de « guerre », d’Événement historique mondial, total. La seule publicité médiatique – publicité négative, propagande mortifère, dont le port du masque est en quelque sorte la diffusion sociale continue, transformant chaque individu en un homme-sandwich faisant de la réclame gratuite pour le virus, qui peut ainsi exister partout où il n’est pas et bien après qu’il ne soit plus –, la seule publicité a créé et recrée sans cesse l’Événement, voilà la nouveauté, le véritable événement historique. Or vous noterez que c’est bien la logique inverse de celle de la guerre, où la propagande a pour mission de rosir le tableau, de cacher l’horreur du front, de minimiser le nombre de morts, de déguiser les débâcles en « retraites tactiques », etc., afin qu’entre la peur et l’espoir, le mensonge fasse pencher la balance du second côté. Tout l’inverse de notre affaire, où la propagande s’est évertuée à terroriser les populations en bonne et due forme, sans rapport avec la gravité réelle du danger, constamment exagéré, et où même l’espoir était un gros mot (rappelez-vous qu’à une époque, le néologisme « rassuriste » signifiait à peu près factieux, sinon traître à la patrie – nous attendions l’espoir officiel, le vaccin, notre V2 à nous) ; une affaire où l’on a tout fait, précisément et quitte à sonner jüngérien, pour neutraliser l’ardeur guerrière d’un peuple soi-disant en guerre. La devise du petit soldat covidien fut donc : Je reste chez moi, je sauve des vies. L’antiphrase est presque sublime, elle dit tout ; qu’elle n’ait pas été démasquée dans un grand éclat de rire général est inquiétant.
Qu’est-ce que cela trahit ? D’abord, à mon avis, qu’une puissante nostalgie de l’Histoire traverse nos sociétés, nos âmes postmodernes, qui avouent par là qu’elles le sont : qu’elles ne croient plus en l’Histoire comme volonté, mais qu’elles en rêvent comme spectacle. Et qu’elles s’ennuient à mourir, du reste, parce que pour être tenu en haleine pendant deux ans par un virus aussi peu mortel, un divertissement aussi médiocre, et accepter de réformer – d’avilir, d’abdiquer – son existence et son intelligence en fonction, il faut quand même « se faire chier grave ». Ou non ? Ensuite, ce qui s’en déduit ou en procède, je ne sais, c’est qu’il existe, dans l’inconscient collectif, mettons, un puissant désir, non de vide (le vide n’est pas désirable), mais de ce qui nous arrache au vide par le plus court chemin : désir de panique, de drames, de catastrophes. Un désir ambigu, par la négative, faute de vrais désirs, mais bien authentique, chez l’homme, d’en finir avec la condition humaine, d’être le spectateur coupable et fasciné de sa propre chute collective, de « l’effondrement ». Désir de mortification, de châtiment et d’expiation, très religieux, qu’entretiennent avec un talent commercial sans rapport avec leur effarante médiocrité intellectuelle tous les vendeurs de fin du monde que nous voyons tenir la vedette de plus en plus officiellement, collapsologues, millénaristes écologistes, survivalistes, etc., etc. Le Covid, pour eux et surtout leurs sponsors, est une bonne affaire, ils ne l’ont pas caché, frétillants qu’ils étaient au printemps 2020. Le fléau n’était pas à la hauteur des attentes, hélas, la résolution bien à rebours des espoirs, deux fois hélas, mais la prochaine pandémie, qui sait ? Voilà ce qui m’a frappé, qui m’inquiète, contre quoi j’ai lancé les charges les plus violentes dans Déshumanité : la banalisation de discours millénaristes, puritains, morbides, culpabilisateurs, apocalyptiques, que leur délirante bêtise, leur irréalisme crasse rendent à la lettre caduques, mais qui, par le chantage à la rédemption qu’ils exercent, ouvrent grand les portes au vouloir-guérir, au messianisme thérapeutique, soit à un régime de barbarie sacrificielle hygiénisée, un régime totalitaire donc, tel que nos prophètes des dimanches de la vie, à l’évidence, n’en ont jamais rêvé dans leurs rustiques cahutes, dont ils ne seront évidemment pas les colonels, mais dont ils favorisent pourtant, malgré eux, le serein avènement. Je passe sur la question de « l’échappatoire », ma réponse est dans le texte.
Vous évoquez plusieurs fois la culpabilité (le bouc émissaire de Girard, généralement l’homme blanc et privilégié, voire la société humaine globale, d’où l’injonction du retour à la nature, à la mode de nos jours et que vous rappelez). Ne peut-on pourtant pas parler, à l’instar de Christopher Lasch dans La Culture du narcissisme, de déresponsabilisation de l’Homme par la crise Covid ; ce dernier, infantilisé (cf. les marquages au sol ou les panneaux signalétiques durant la crise, voire le confinement), est alors devenu un « patient inapte à diriger sa propre vie » ?
Culpabilité et déresponsabilisation vont ensemble : en affirmant que le coupable c’est l’Autre, et à la fin c’est toujours l’Autre, on s’en remet au récit mythique, au récit qui fabrique du bouc émissaire et nous le cache, on abdique sa propre responsabilité morale et intellectuelle, la plus haute qui soit, qui est de refuser le sacrifice de victimes innocentes. N’est-ce pas ce qui se produit en ce moment, au moment où l’interminable crise doit enfin se résoudre ? Quand le président Macron désigne froidement à la vindicte, tel un Poutine de sous-préfecture, le « non-vacciné », cet « irresponsable » qui « n’est plus un citoyen », comme l’ennemi public de l’immense majorité de la population, il fabrique littéralement du bouc émissaire, pour se déresponsabiliser lui-même, bien sûr, et pour déresponsabiliser la majorité du sort qui pourra être fait aux « non-vaccinés », ces Autres dont la culpabilité – fantasmée, mensongère – est désormais établie aux yeux de la foule prête à la lapidation, prête du moins à les fermer devant les pierres qui tombent. Évidemment, Dieu merci, ça ne marche pas tout à fait. Mais que ce soit tenté et accueilli avec tant de légèreté, sans qu’il en coûte même, peut-être, sa réélection au célèbre emmerdeur, en dit long sur l’archaïsme où nous nous abîmons.
Pour parler plus largement, il me semble que nous assistons, durant cette « crise » effectivement infantilisante, affreusement infantilisante, mais où le mot de « responsabilité » va pourtant brandi aux quatre vents comme un flambeau sous le soleil du désert, à l’espèce d’incarnation maximale, inouïe – point d’orgue, oui – d’un paradoxe doctrinal, aux effets sociaux désastreux, dans lequel nous baignons depuis longtemps. À savoir : que nous sommes entrés, depuis la mutation néolibérale engagée à partir des années 1980, dans ce que j’ai nommé le « stade austère du libéralisme » ou la « culpabilisation libérale de l’individu ». Nous vivons dans un système qui tend, et de plus en plus, à mélanger le pire du libéralisme idéologique au pire du socialisme d’État, le pire de l’individualisme procédurier au pire de l’égalitarisme fliqueur. Saisissant retournement de « l’esprit de 1945 » (programme du CNR, etc.), lorsque la refondation de la « morale de l’État » consécutive au désastre de la guerre avait pour mot d’ordre, aussitôt traduit dans les faits, de permettre au meilleur de l’individualisme libéral (habeas corpus, autonomie, dignité de la personne, etc.) de s’épanouir sous la tutelle exigeante mais plutôt bienveillante d’un État protecteur (sécurité sociale universelle, retraites, service public, conventions collectives, etc.). Peut-être que ce compromis assez idéal entre libéralisme et socialisme ne pouvait pas tenir, qui sait – mais qu’importe : aujourd’hui, ce « pacte » est rompu, sans que la rupture s’avoue. On le voit très bien dans la politique de la santé publique, qui est le cœur de notre sujet : d’un côté on promet au contribuable des soins gratuits, une prise en charge inconditionnelle, etc., mais de l’autre côté, comme on ne cesse de réduire les budgets de l’hôpital public, on ne souhaite plus guère que le contribuable y mette les pieds, et le meilleur moyen d’y parvenir, puisqu’on ne peut pas légalement lui claquer la porte au nez, c’est de l’inciter à éviter tout ce qui pourrait le conduire un jour à l’hôpital : cigarettes, voiture, gras manger, maladies en général, et en dernière instance : sa propre liberté. Si vous permettez que je me cite, longuement cette fois, puis on en terminera : « L’État « post-providence » cesse de vouloir financer un système de santé universel qui coûte cher et ne rapporte pas. Mais comme il conserve une responsabilité sur la santé et la vie des individus (c’est son « engagement » et ces choses sont sacrées), qui paient des impôts pour qu’il l’assume, il doit continuer de s’engager. Il le fera autrement : plutôt prévenir que guérir ; plutôt que de soigner les individus, les sermonner. Baisse des moyens, hausse des discours. Diminution de la prise de risques budgétaires, inflation de la communication sur le risque sanitaire. Le paternalisme en sort rhétoriquement grandi, mais il y manque assez l’amour, et beaucoup l’honnêteté. C’est un peu comme un père de famille qui, à force de jouer au casino et d’entretenir sa maîtresse, n’aurait plus les moyens de refaire la clôture du jardin qui s’écroule, ni le temps ni l’envie d’arracher les ronces qui l’envahissent, et répéterait vingt fois par jour à ses enfants que c’est dangereux de jouer dehors, qu’ils vont se faire renverser par une voiture, déchirer par les ronces, sucer le sang par les moustiques, dévorer par les bêtes, enfin qu’il ne faudra pas venir gémir auprès de papa en cas de bobo, il les aura prévenus. Il s’agit au fond d’organiser la terreur de vivre, au nom même de la protection de la vie. Ainsi, sous l’influence de puissantes associations et de lobbies qui ont désormais pignon sur rue, l’État organisera d’infinies « campagnes de prévention », dont le sous-texte est clair : il s’agit de « responsabiliser » l’individu en faisant par avance peser sur lui la faute de son mal et le remords du mal-être des Autres (c’est-à-dire des coûts que la société austère « ne peut plus se permettre »). Tout ça au nom sacré de la vie, et suivant le principe de coresponsabilité, déclinaison punitive du principe de solidarité. » (pp. 305-306.)
Il me semble que c’est ce puissant phénomène de chantage à la vie, au nom sacré de la « santé publique » (c’est-à-dire des limites d’un système de soins qu’on dépèce méthodiquement depuis des décennies, sans ralentissement notable même durant une crise sanitaire que d’aucuns appelaient une « guerre » et pour laquelle des centaines de milliards d’euros d’argent public, de dette publique, auront été dépensés pour tout et n’importe quoi sauf pour améliorer les hôpitaux – cas assez fabuleux d’hypocrisie démente et, si ce devait être le fin mot de l’affaire, exemple assez unique de drame historique par maquillage de cadavre), ce chantage à la vie que nous avons vu et voyons à l’œuvre, faisant devise, faisant loi, au cours de cette sinistre « crise du Covid ». Mais comme j’ai déjà trop bavardé, je vous laisse faire le lien avec la réponse précédente, et trouver la ténébreuse et orwellienne formule qui définira magistralement Homo Covidus, ce glorieux moins-vivant-pour-son-bien. Sur ce, merci de votre chaleureuse attention, Gute Nacht et joyeuse Saint-Valentin.
Julien Syrac, Déshumanité, éditions du Canoë, 2021 (https://www.editionsducanoe.fr/)
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.