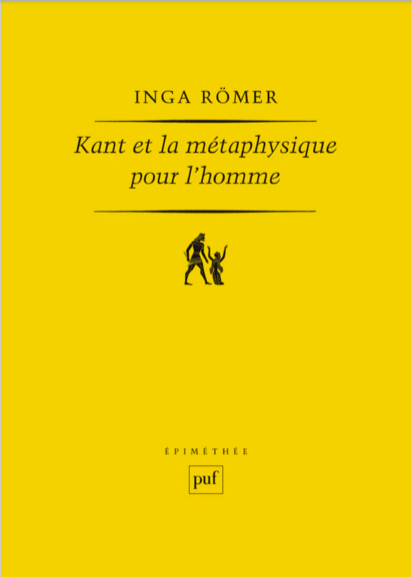L’opinion péguyste selon laquelle « Kant a les mains pures, mais n’a pas de mains » a la vie dure. Dans son dernier livre Kant et la métaphysique pour l’homme (Puf, coll. Épiméthée), Inga Römer, titulaire de la chaire d’herméneutique et de phénoménologie à l’Université de Fribourg-en-Brigsau, étudie au contraire la manière dont la métaphysique « pratico-dogmatique » de Kant cherche à s’accomplir dans la construction d’un monde meilleur. Bien qu’inachevé, mais trop souvent négligé, cet effort kantien résiderait dans le pari d’une autre modernité, au-delà d’une rationalité théorique oublieuse de l’homme.
PHILITT : Theodor W. Adorno a formulé au XXe siècle une grande objection à la métaphysique : après la catastrophe d’Auschwitz et de tous les massacres que le philosophe subsumait sous ce nom, il ne serait plus convenable de faire de la métaphysique dont la recherche des vérités absolues néglige les horreurs concrètes de l’histoire. Il soutient que la métaphysique abstraite échoue à intégrer les souffrances et les contradictions réelles du monde. La « métaphysique pour l’homme » que vous mettez au jour chez Kant est-elle une alternative à cette métaphysique stigmatisée par Adorno ?
Inga Römer : Vous avez effectivement repéré la perspective que j’ai choisi d’adopter au début du livre, qui part de la philosophie contemporaine où l’on assiste à deux renaissances de la métaphysique. Ces renaissances sont paradoxalement consécutives aux sévères critiques de Carnap et de Heidegger, l’un reprochant aux termes métaphysiques (Dieu, infini, absolu, inconditionné…) d’être « sans signification », et l’autre reprochant à la métaphysique de réduire la question de l’être à son explication par un étant suprême, Dieu. Mais en reposant la question de la métaphysique, de telles critiques ont en fait renouvelé les recherches à son sujet, qui, en nuançant voire en récusant les thèses de Carnap et Heidegger, ont engendré une renaissance de la métaphysique à la fois dans la philosophie analytique, à travers une métaphysique des sciences et une métaphysique spéculative, et dans le champ de la phénoménologie. Il y a eu cependant une troisième critique fondamentale de la métaphysique en général : ce type de connaissance serait devenue impossible depuis les catastrophes du XXe siècle, celle en particulier de la Shoah soulignée par Adorno.
Mon idée est qu’il est possible de penser une renaissance, ou du moins un renouvellement du problème de la métaphysique, en prenant sérieusement en compte cette objection éthico-politique d’Adorno. Pour ce faire, la méthodologie que j’adopte est celle d’une phénoménologie critico-herméneutique, c’est-à-dire une phénoménologie qui n’est pas naïve mais qui confronte nos expériences présentes à celles de grands auteurs du passé. En effet, pour ne pas se laisser illusionner ou impressionner par les normes et les concepts de notre époque, il convient de se confronter aux penseurs d’hier afin de pouvoir préciser avec lucidité ce que nous voyons et ce que nous expérimentons. Or, par rapport à la question éthico-politique d’Adorno, il m’est apparu que la figure la plus à même de pouvoir la penser est celle d’Emmanuel Kant. Il pense qu’à partir d’une critique de la métaphysique dans un premier temps, on pourrait, dans un deuxième temps, arriver à un renouvellement de la métaphysique consistant à reprendre les objets classiques de la « métaphysique spéciale », à savoir Dieu, l’âme et le monde (ou la liberté), en une métaphysique spéciale critique, fondée sur la philosophie morale.
En quoi consiste cette nouvelle « métaphysique pratique » que Kant ambitionne de construire ?
Pour examiner ce renouvellement kantien de la métaphysique, je m’appuie pour l’essentiel sur un texte inachevé de Kant, publié à titre posthume. Ce texte est la réponse à l’Académie de Berlin qui posait, en 1793, la question suivante : « Quels sont les progrès réels de la métaphysique en Allemagne depuis de la métaphysique le temps de Leibniz et de Wolff ? » Mais comme vous parlez de « métaphysique pratique », j’avertis sur l’importance de distinguer deux approches « pratiques » de la métaphysique chez Kant. La première est celle que Kant appelle la métaphysique pratico-dogmatique, et la seconde est la métaphysique des mœurs. Kant cherche à élaborer ces deux disciplines, mais elles ne sont nullement identiques. Je n’ai donc pas utilisé le terme de « métaphysique pratique » à propos de la métaphysique pratico-dogmatique, précisément pour ne pas la confondre avec la métaphysique des mœurs, à laquelle elle correspond davantage. Or, la métaphysique des mœurs pose la question des principes a priori de ce qu’il faut faire et ne pas faire, chose qui n’est pas visée par la question posée par l’Académie de Berlin. Celle-ci, en posant la question de la métaphysique, s’attend à avoir une réponse sur la possibilité de la connaissance de la chose en tant que chose en général, ainsi que des trois objets de la métaphysique spéciale : Dieu, l’âme et le monde. En ce sens, la métaphysique pratico-dogmatique est très particulière : son statut ambivalent la situe, d’un côté, dans la mesure où elle traite des trois objets de la métaphysique spéciale, dans le sillage la métaphysique traditionnelle ; mais d’un autre côté, elle s’appuie, avec son propre mode de justification, sur la philosophie morale critique. Elle est dans un entre-deux, consistant à fonder la connaissance de Dieu, de l’âme et du monde non pas sur la réalité objective au sens théorique de leurs concepts, dont Kant prétend avoir démontré l’inconnaissabilité pour la raison spéculative, mais sur des nécessités morales.
L’œuvre posthume de Kant, sur laquelle vous vous appuyez tant, n’a-t-elle pas été trop souvent négligée ? Allez-vous jusqu’à relire toute son œuvre à l’aune du texte des Progrès de la métaphysique ?
Effectivement, j’ai choisi pour le livre de prendre ce traité inachevé comme le fil conducteur de mes analyses. Bien qu’il soit un traité d’occasion, je trouvais intéressant de voir comment la pensée kantienne pourrait être organisée si on mettait en avant ce traité-là. Je ne dis pas qu’il faut absolument procéder de cette façon si l’on cherche à comprendre Kant, mais j’estime que sur le plan systématique, on apprend beaucoup à se servir de ce traité comme point nodal des thèses du philosophe de Königsberg. Assurément, ce traité ne constituait pas la ligne centrale des analyses classiques sur Kant. Pourquoi ? Parce que Kant avait d’abord l’idée de développer une critique de la raison humaine, afin de construire, sur cette base critique, une nouvelle métaphysique ; une fois qu’il s’était rendu compte qu’il fallait séparer la critique de la raison théorique pure de la critique de la (seule) raison pratique, il visait, sur la base de cette double critique, une métaphysique en deux parties. La première est une métaphysique de la nature, fondée sur les nouveaux principes critiques, et la seconde est une métaphysique des mœurs, également fondée sur les principes critiques. Telle est la ligne principale de Kant qu’ont alors suivi la plupart de ses commentateurs jusqu’ici. Cependant, il y a une autre ligne qui méritait d’être dégagée chez Kant, compatible avec la ligne dominante, mais non réductible à elle : cette ligne, c’est celle de la métaphysique pratico-dogmatique, qui se fonde en même temps sur l’une et l’autre des deux versants cités. Ce double fondement en fait toute l’originalité et toute la difficulté à la fois.
Précisément, Kant est généralement présenté comme le déconstructeur de la métaphysique. Son célèbre traducteur, Alain Renaut, a pu décrire ainsi le « kantisme » comme une « philosophie post-métaphysique » qui est la « première grande déconstruction des illusions de la raison spéculative ». Jürgen Habermas, également, a enfoncé le clou en reprenant cette expression de « post-métaphysique », pour désigner notamment la remise en cause du primat de la théorie sur la pratique. Pour vous au contraire, Kant serait-il le refondateur de la métaphysique (sur un terrain pratique) plutôt que son déconstructeur ?
On connaît en effet la célèbre phrase de Mendelssohn dans sa Préface aux Morgenstunden, en 1785 : « Kant est celui qui pulvérise tout. » Il suggérait par là que Kant détruisait la métaphysique. Certes, sous un certain rapport, cela est vrai : il détruit la métaphysique, dans sa forme pré-critique et en particulier dans sa forme rationaliste. Il déclare ainsi dans la Critique de la raison pure que la connaissance de la chose en tant que chose en générale ainsi que des trois objets de la métaphysique spéciale, Dieu, l’âme et le monde, est impossible sur le plan spéculatif. Évidemment, je ne remets nullement en cause ce constat à propos du premier geste kantien, qu’il faut cependant appeler « critique » plutôt que « déconstructeur ». Cependant, sur la base de cette critique, des auteurs comme ceux que vous soulignez, Alain Renaut et Habermas, ont affirmé que l’actualité de Kant ne serait par conséquent que d’ordre éthique et politique. Pour ma part, je pense en revanche que nous avons franchi une nouvelle étape, car nous vivons à une époque que Jean-François Courtine appelle « la fin de la fin de la métaphysique ». Nous voyons en effet renaître aujourd’hui non seulement les questions métaphysiques, mais également des réponses affirmatives aux questions que l’on se pose traditionnellement en métaphysique. Nous assistons non seulement à une renaissance du problème de la métaphysique, mais aussi à un renouvellement de la discipline. Je crois donc que Kant avait raison lorsqu’il disait qu’il y a une métaphysique naturelle (metaphysica naturalis) à l’homme : les êtres humains ne peuvent pas ne pas se poser les questions métaphysiques. Tout l’enjeu est donc, à mon sens, de savoir comment aborder la métaphysique dans une perspective critique, sans retomber dans une métaphysique pré-critique. Dans ce contexte contemporain, il peut être intéressant de penser ensemble la critique kantienne de la métaphysique et la philosophie morale, en montrant que Kant, sur la base de son entreprise critique, a développé une approche de la métaphysique tout à fait particulière qui s’appuie sur la critique de la raison pratique, mais s’inscrit dans le sillage de l’ancienne discipline de la métaphysique au sens théorique.
Vous donnez un exemple important de ce renouvellement kantien de la métaphysique, en abordant sa preuve morale de l’existence de Dieu. Celle-ci semble être bien moins connue que ses réfutations des démonstrations classiques. En quoi consiste cette nouvelle preuve ?
C’est un argument complexe, aux implications nombreuses. Pour faire simple, je peux commencer par dire que la première version de cette preuve se trouve dans la « doctrine des postulats » de la Critique de la raison pratique. L’idée est que, si nous ne pouvons pas connaître théorétiquement l’existence de Dieu par la voie des démonstrations spéculatives, nous sommes en revanche appelés par la loi morale de la raison pratique pure à suivre l’impératif catégorique, c’est-à-dire à respecter l’obligation d’agir d’une façon telle que nos maximes pourraient servir de principes pour une législation universelle. Or, le respect pour cet impératif catégorique implique pour Kant que nous voulons réaliser le « souverain Bien », c’est-à-dire le « lien nécessaire » (Verknüpfung) entre la bonté morale et le bonheur, non seulement dans la vie individuelle mais aussi collectivement. Pourtant, on ne fait pas l’expérience de ce lien nécessaire dans la nature, puisque la personne qui agit vertueusement et se comporte de manière moralement bonne ne devient pas nécessairement heureuse. Qui peut donc garantir ce lien nécessaire, sinon la nature ? Une réponse qui semble s’imposer est : c’est Dieu. Il est ainsi raisonnable pour l’être humain de croire à l’existence d’un tel être divin qui saurait établir ce lien nécessaire.
Dans la deuxième Critique, on peut certes avoir l’impression que Kant veut prouver, par cet argument, l’existence de Dieu comme être extérieur et transcendant qui établirait ce que nous ne pourrions pas établir nous-mêmes, à savoir, l’établissement du souverain Bien. Cependant, ma thèse est que cet argument n’est qu’une première formulation de la preuve par Kant qui cherche encore sa forme précise. Par comparaison, ce qui devient très intéressant dans son traité sur Les Progrès de la métaphysique, c’est qu’il se met à dire explicitement, à propos des objets de la métaphysique spéciale, que « nous nous faisons nous-mêmes ces objets » – et non seulement ces concepts –, et que « nous y croyons ». Au début des années 1790, Kant a donc approfondi sa preuve morale de l’existence de Dieu, comme une preuve pour l’homme, la preuve d’un objet que l’homme lui-même se forge sur le fondement de son obligation morale. Kant parle même d’une « connaissance pratico-dogmatique » de ces objets de la métaphysique spéciale critique, dont Dieu.
Mais n’est-il pas contradictoire chez Kant de parler d’une « connaissance » d’un objet que l’homme se forgerait lui-même ? En quoi est-ce qu’une preuve simplement « pour l’homme » demeure-t-elle une preuve ?
Cette question très délicate implique que nous revenions d’abord à la théorie kantienne de l’objet qu’il développe à propos de la connaissance théorique. Son idée est que nous pouvons avoir une connaissance a priori de l’objet, en tant qu’il est possible pour notre expérience. Pour cela, nous nous appuyons sur les douze catégories et sur les formes de l’intuition sensible, que sont le temps et l’espace. Or, pour Kant, l’objet a priori, c’est-à-dire indépendant de l’expérience empirique, n’est pas seulement un objet dont le concept est dépourvu de contradiction, comme se bornent à le penser les rationalistes, mais il doit aussi être présentable dans une intuition sensible. Pour un objet comme celui de Dieu, nous n’avons certes pas d’intuition sensible, mais nous avons en revanche la croyance raisonnable, qui joue par rapport à cet objet la même fonction que la présentabilité dans l’intuition par rapport aux objets de l’expérience. La foi raisonnable réalise ainsi le concept, non pas en découvrant une hypothétique réalité objective au sens théorique – cela est impossible pour Kant –, mais en lui conférant une réalité objective au sens pratique. Nous avons bel et bien affaire ici à un objet qui dépasse le simple concept, et c’est de cet objet a priori que nous avons ce que Kant appelle une « connaissance pratico-dogmatique ».
Si l’on passe maintenant de la question de Dieu à celle du monde, un autre problème se pose. Vous notez en effet que le monde devient chez Kant « un objet du plus haut point de la philosophie transcendantale », à condition de le concevoir comme l’« idée d’un monde administré par une république éthique et juridique ». Mais alors, la métaphysique visée par Kant ne se réduit-elle pas, comme Mme Claudine Tiercelin a pu le reprocher à Emmanuel Levinas, à un simple système éthique ?
Emmanuel Levinas a appelé l’éthique la Philosophie Première, en faisant usage d’un sens original du terme d’« éthique ». Kant ne dirait pas que l’éthique est la Philosophie Première ou la métaphysique tout court. Pour développer sa perspective nuancée sur cette question, j’aimerais évoquer trois points. Nous devons d’abord revenir à ce statut difficile de la métaphysique pratico-dogmatique, qui se fonde sur la philosophie morale, mais qui s’inscrit dans le sillage traditionnel de la métaphysique théorique. Cette métaphysique est théorique dans la mesure où elle concerne bel et bien la connaissance des objets, mais elle s’appuie aussi d’un autre côté sur la philosophie morale. Ensuite, il n’y a pas un « système éthique » pour Kant, il n’y a que des principes métaphysiques de la doctrine de la vertu, mais qui ne mènent pas à une véritable « métaphysique des mœurs ». Enfin, le « plus haut point de la philosophie transcendantale » que vous évoquez est une formule des liasses les plus tardives de l’Opus postumum. D’après ma lecture, elle peut être comprise comme une transformation tardive de l’idée d’une métaphysique pratico-dogmatique. « Le plus haut point de la philosophie transcendantale » est celui où l’homme tient le lieu d’un intermédiaire ou copule (copula) entre le monde et Dieu. Cela signifie que d’un côté, avec le cadre de l’objet « monde », l’homme explore scientifiquement la nature, jusqu’à la physique empirique, tandis que d’un autre côté, avec le cadre de l’objet « Dieu », l’homme acquiert la confiance en la possibilité de réaliser le souverain Bien dans le monde. Ce faisant, l’homme comprend sa tâche morale d’apporter, dans ce monde qu’il a scientifiquement exploré, des lois juridiques et des pratiques éthiques susceptibles de le rendre meilleur, conformément au souverain Bien. L’homme n’est donc pas la racine de cette entreprise éthico-juridique, mais la copule entre deux objets qu’il explore et réalise en usant de sa liberté.
Ce souverain Bien que Kant cherche à établir dans le monde relève-t-il de son idéal cosmopolitique ?
Effectivement. Dans la troisième partie de La Religion dans les limites de la simple raison, Kant formule le souhait d’une « république » juridique et éthique, consistant à instaurer dans le monde des règles juridiques, c’est-à-dire des règles qui suivent le principe suprême du droit détaillé dans la Métaphysique des mœurs, ainsi que des règles éthiques. La société juste permet alors, par des lois juridiques, une coordination égalitaire entre les libertés extérieures (ou libertés d’action). Mais cela ne suffit pas : le plan juridique doit être complété, selon Kant, par l’établissement d’une république éthique. Il y a une obligation éthique d’établir des pratiques qui, sans être traduisibles légalement, sont susceptibles de promouvoir un comportement moralement bon par ailleurs respectueux des lois juridiques. On pensera par exemple à des habitudes vertueuses comme celles de la politesse ou de la véracité, qui rendent les hommes bons sans pour autant être pourvues de l’autorité légale de la loi juridique. Leur non-respect n’implique aucune punition par l’État, mais leur obligation perdure pourtant. Kant cite ici l’Église comme institution éthique chargée d’assumer cette forme d’éducation à la vertu, mais je pense pour ma part qu’il pourrait aussi s’agir d’autres organisations non-gouvernementales (ONG), telles que les Nations Unies, l’Unesco, l’Unicef…, etc., à la condition bien sûr qu’elles respectent la loi morale de la raison pratique pure. Kant est un penseur du monde, lorsqu’il réfléchit sur les questions de la métaphysique tout aussi bien que lorsqu’il s’interroge sur la philosophie morale.
Michel Henry pensait que si la modernité avait suivi la voie du Descartes du traité des Passions de l’âme, plutôt que celle du Discours de la méthode, où la rationalité mène l’homme à se rendre « comme maître et possesseur de la nature », la face du monde eût été différente. Pareillement, chez Kant, cet « autrement qu’être de la raison pratique pure » que vous présentez dans votre livre représenterait-il pour vous une alternative à cette modernité, qui semble avoir culminé dans le déchaînement de la force matérielle au cours des guerres mondiales ?
Oui, je souscrirais entièrement à l’idée d’un tel parallèle structurel, sans évidemment vouloir rapprocher le Descartes du traité des Passions à la métaphysique pratico-dogmatique et la dernière philosophie transcendantale de Kant. Kant fait le pari qu’il y a une rationalité effectivement différente de celle du Discours de la méthode, qui est une rationalité de la connaissance théorique. Il y a une rationalité qualitativement différente de la force et du pouvoir. Kant a conscience que la force existe partout, mais il a aussi conscience d’une autre dimension de l’existence, qu’il appelle la raison pratique pure, qui devrait nous guider dans notre pratique morale et, sur le plan métaphysique, dans notre transformation du monde. Je trouve qu’à notre époque, par opposition à une certaine réception, elle-même discutable, de Nietzsche et de Michel Foucault, qui réduiraient l’analyse du réel au prisme de la volonté de puissance et du pouvoir, Kant semble représenter une véritable alternative. La question mérite en tout cas d’être posée : y a-t-il dans l’expérience une dimension qualitativement différente du pouvoir et de la force, ou faut-il dire au contraire que tout se réduit in fine à des gestes de pouvoir ? Pour poser la question en termes lévinassiens : y a-t-il un au-delà de l’être qui est un « autrement qu’être » ?
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.