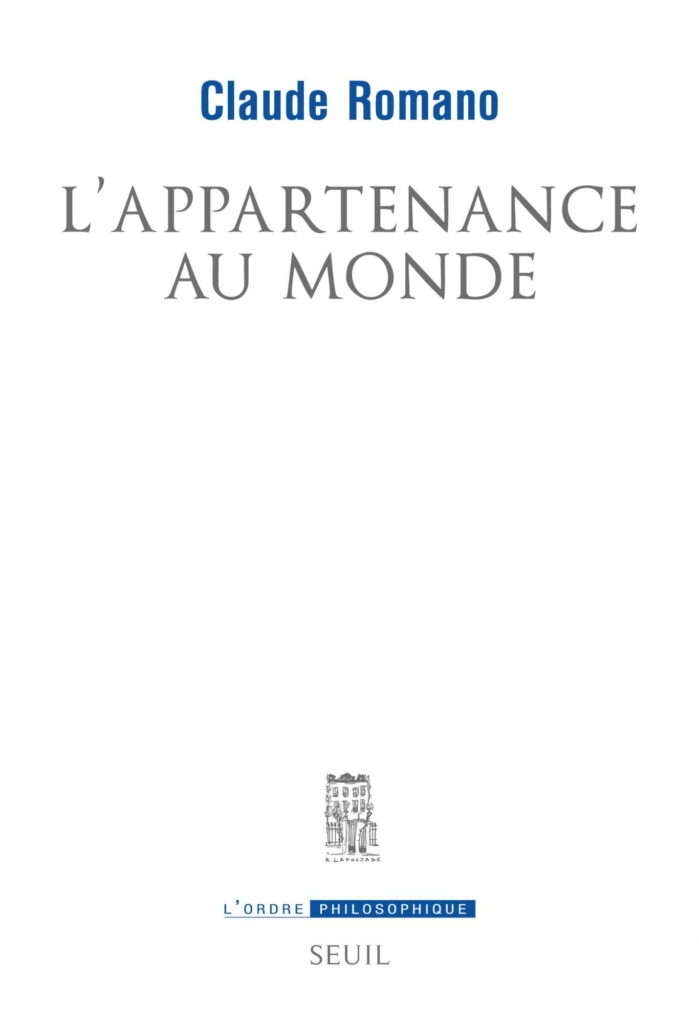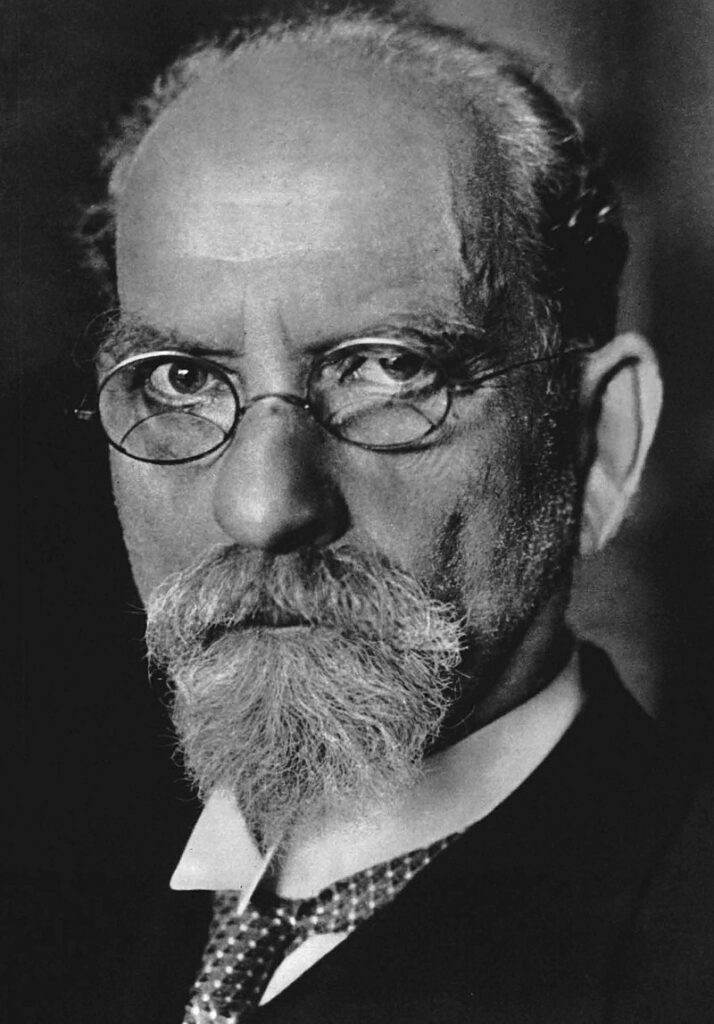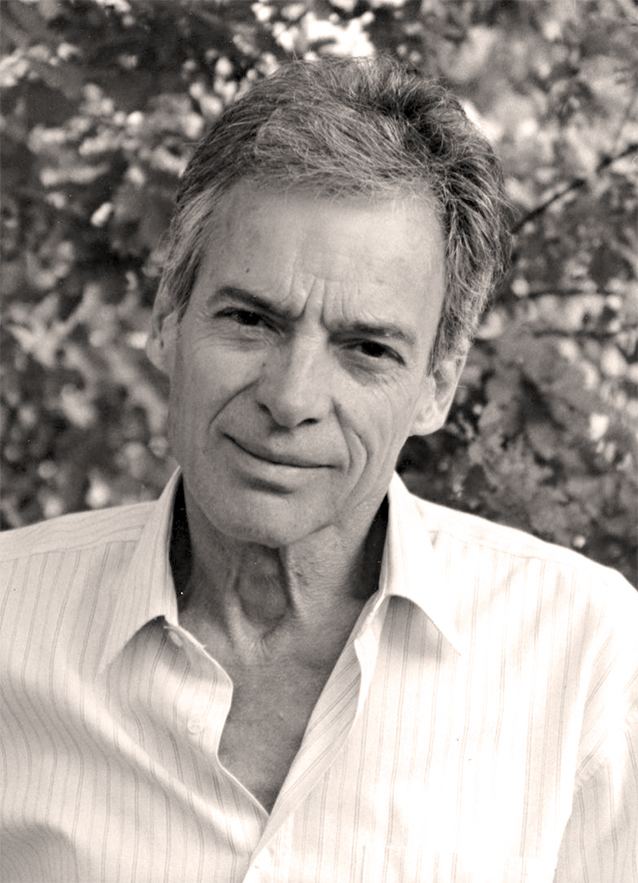Révélé en 1998 avec L’Événement et le monde (PUF, Épiméthée), le philosophe et professeur à la Sorbonne Claude Romano effectue depuis plusieurs décennies un travail phénoménologique exigeant. Après Être soi-même (Gallimard, 2019) et L’Identité humaine en dialogue (Seuil, 2022), il publie cette année L’Appartenance au monde (Seuil), ouvrage important dans lequel il explore, dans la lignée de Husserl et de Merleau-Ponty, la relation entre le corps et l’esprit, entre l’objectivité et la subjectivité et les différentes tentatives de cerner le statut de la réalité. Sur ces questions, Claude Romano invite à nous libérer de lourds préjugés hérités de l’idéalisme et du réalisme afin d’appréhender avec plus de justesse notre « appartenance au monde ».
PHILITT : Vous rappelez que l’image moderne de la nature a abouti à un dédoublement du monde : monde objectif et monde subjectif, qui selon certains seraient ontologiquement différents. En quoi une telle dichotomie pose-t-elle problème à vos yeux ?
Claude Romano : L’image d’un dédoublement du monde est déjà employée par Alexandre Koyré qui a été l’un des premiers à attirer l’attention sur cette conséquence de la révolution scientifique moderne dans ses Études galiléennes : d’un côté, nous trouvons une nature en soi, réduite à l’étendue, au mouvement, à la pesanteur, à l’ensemble des propriétés mathématisables du monde ; de l’autre, toutes les qualités sensibles des choses (couleur, solidité, goût, odeur, etc.) qui ne sont justement pas « écrites en langage mathématiques » et doivent être éliminées de la réalité telle qu’elle est en elle-même et reversées au compte de l’apparence. Il faut ajouter à ces qualités sensibles toutes les significations et tous les prédicats axiologiques qui s’attachent pour nous aux choses : beauté et laideur, utilité, etc. Il n’y a pas de place pour de telles valeurs et significations dans le monde physique. Dans l’interprétation de la physique galiléenne puis newtonienne qui s’est imposée à la quasi-totalité des esprits philosophiques, nous aboutissons ainsi à une espèce de schizophrénie : tout ce qui, du point de vue du sens commun, représente la nature même des choses se réduit à une illusion, tandis que tout ce qui est réel dans la nature se ramène à de l’invisible et à de l’imperceptible. Il ne peut plus exister que dans notre esprit et est ontologiquement dépendant de notre subjectivité. Aujourd’hui encore, ce préjugé reste très répandu chez les philosophes et les scientifiques : les uns clament que le monde dépend en son être de l’esprit : c’est ce qu’on appelle l’idéalisme (subjectif) ; les autres qu’il est une « création du cerveau ». L’objectivisme de la « nature en soi » entraîne ainsi un subjectivisme complet à propos des qualités sensibles dont le monde est constitué.
Bien des points sont gravement incohérents dans cette compréhension de la réalité. Tout d’abord, si expliquer, pour la science, c’est souvent réduire, par exemple réduire la couleur à une longueur d’onde du spectre électromagnétique, comme le propose l’optique de Newton, cette réduction ne peut pas consister en une élimination pure et simple du phénomène à expliquer (la couleur) et son remplacement par quelque chose d’autre (la longueur d’onde) : au contraire, pour qu’il y ait explication véritable, il faut que la couleur des choses possède son propre niveau de réalité et ne se ramène justement pas à une pure apparence. Autrement, l’explication physique détruirait son propre point de départ : il faut que les couleurs existent bel et bien au niveau du monde phénoménal comme des réalités stables, et donc indépendantes de leur perception contingente, pour que leur réduction au sens physique fasse sens.
Ensuite, si le monde n’était vraiment qu’une illusion partagée par notre espèce, il ne devrait y avoir en principe aucune différence de statut entre une couleur apparente (comme une image consécutive, une couleur qui n’est qu’un effet optique engendré par l’observation prolongée d’une source lumineuse) et une couleur objective : or cette différence existe et est d’une grande importance. Dans cette hypothèse, la distinction même entre apparence et réalité s’effondrerait. Enfin, si le monde réel se ramenait à une vaste illusion engendrée par nos propres particularités sensorielles, chacun de nous serait enfermé dans un « monde » absolument privée et idiosyncrasique : le solipsisme serait inévitable. Tout cela laisse penser que quelque chose ne va pas dans l’interprétation philosophique qui s’est imposée de la révolution scientifique moderne et de ses résultats. Sans nullement remettre en question ces résultats, il nous faut remettre en question le cadre philosophique tout entier qui a présidé à leur interprétation. C’est un des objets de ce livre.
La révolution galiléenne, qui propose une description seulement objective de la réalité, est souvent associée aux grandes avancées techniques du monde moderne. Un penseur comme Michel Henry avait pourtant vu dans ce congédiement de la subjectivité le triomphe d’une science inhumaine. Le rejoignez-vous sur ce point ?
Non, car parler d’une science « inhumaine », c’est se tromper de cible. Le problème n’est pas celui d’une science qui serait par elle-même pernicieuse ; le croire sérieusement, comme le faisait probablement Michel Henry, c’est céder aux préjugés antiscientifiques qui ont aveuglé tant de penseurs contemporains. Le problème est celui de l’interprétation philosophique ou métaphysique des résultats de la science – ce qui est fort différent. En réalité, une pensée comme celle de Michel Henry est le parfait sous-produit de l’interprétation métaphysique de la science moderne qui a été dominante jusqu’à nos jours et qui consiste à opposer la réalité objective (l’extériorité, comme il dit) à une subjectivité qui s’en excepterait (l’intériorité) et constituerait une forme d’absolu situé hors du monde. Il n’y a d’ailleurs guère de pensée qui ne soit plus solipsiste que celle de Michel Henry, avec sa surenchère permanente sur le caractère acosmique de la subjectivité…
Comme je le disais, ce n’est pas seulement un des aspects de « l’image moderne de la nature » qui doit être contesté, le pôle objectif de cette image, c’est tout autant sa contrepartie, la supposition d’une subjectivité qui ne fasse pas partie du monde, comme chez Michel Henry, ou, ce qui est tout aussi problématique, d’une subjectivité qui abrite en elle le monde de façon tout à fait mystérieuse, comme chez Husserl. Je cherche à déconstruire cette opposition.
En effet, la conséquence de l’hypothèse d’une nature en soi écrite en langage mathématique qui ne recèlerait aucune des caractéristiques que nous attribuons spontanément aux choses entraîne inévitablement une compréhension de l’esprit humain comme le lieu d’une reproduction du monde sous forme subjective, sous forme d’images mentales ou des représentations. C’est la métaphore de l’idée-tableau inaugurée par Descartes et qu’il lègue à toute la pensée moderne. Or cette métaphore, si on la prend à la lettre, ne laisse plus place qu’à deux conceptions rivales : un réalisme représentatif, c’est-à-dire la thèse selon laquelle la reproduction du monde dans l’intériorité sous forme de représentations est, au moins dans certains de ses aspects, semblable aux choses représentées, et l’idéalisme : le monde se réduit aux représentations que nous en avons, ou du moins en est ontologiquement dépendant. Or j’essaie d’expliquer que ces deux positions philosophiques sont des impasses. L’idéalisme dissout le monde dans la subjectivité et aboutit au solipsisme. Le réalisme représentatif nous sépare à jamais du monde en affirmant que notre accès à celui-ci ne peut être qu’indirect (via nos représentations), et à nouveau il nous confine dans l’espace « intérieur » de celles-ci. Il s’agit de deux conséquences peu plausibles d’une image également faussée du monde.
Husserl, en introduisant le concept de « monde de la vie » (Lebenswelt), a voulu redonner une dimension objective à l’expérience immédiate. Mais qu’est-ce qui caractérise une telle « objectivité » ?
Je crois en effet que Husserl, et une grande partie de la phénoménologie après lui, a été conscient de cette impasse. Il a fourni l’un des efforts philosophiques les plus considérables (avant Wittgenstein) pour sortir d’une théorie de l’esprit comme siège des représentations. Il a été l’un des promoteurs de ce qu’on pourrait appeler (bien que ce ne soit pas du tout son vocabulaire) un réalisme direct, en particulier en matière de perception, lequel affirme que, lorsque je perçois un arbre dans le jardin, je n’ai pas affaire à une représentation d’arbre mais à l’arbre lui-même, tel qu’il existe hors de mon esprit. Pour théoriser cette relation directe de l’esprit au monde, il a repris en le transformant le concept scolastique, puis brentanien, d’intentionnalité. Dire que la perception est intentionnelle, c’est dire que la conscience perceptive se rapporte au monde lui-même tel qu’il existe à l’extérieur d’elle, et aux choses qui peuplent ce monde. Il s’agit là de la rupture la plus nette avec le concept même de représentation mentale.
Husserl était donc sur la bonne voie. Et pourtant, il s’est arrêté à mi-chemin du fait de certains de ses autres préjugés. Qu’on relise par exemple les Ideen…I. Le phénoménologue commence par dire que la perception se rapporte au pommier en fleur lui-même tel qu’il se dresse dans le jardin, et non à une simple représentation de cet arbre. Et pourtant, à la stupéfaction du lecteur, il poursuit en disant que l’objet perçu, le perceptum du percipere, ne peut pas brûler, tandis que l’arbre physique le peut. C’est contradictoire : ou bien l’arbre perçu est l’arbre lui-même, celui qui se dresse dans le jardin, et il doit alors avoir toutes les propriétés de cet arbre (y compris celle de pouvoir brûler), ou bien cet arbre n’a pas toutes les propriétés de l’arbre réel, et il s’ensuit alors qu’il reste une espèce (aussi subtile qu’on voudra) de représentation. La critique de la pensée représentative tourne court !
Pourquoi Husserl, malgré sa compréhension lucide des impasses du cartésianisme et de la pensée représentative en général, ne parvient-il pas à en sortir, reste « bloqué dans l’immanence » de la conscience comme le dira à juste titre Heidegger dans son « Séminaire de Zähringen » ? Parce que, d’une certaine manière, Husserl ne s’attaque pas à ce que j’appelais précédemment le cadre métaphysique qui régit l’interprétation reçue de la physique mathématique : il continue à opposer une nature en soi à l’esprit conçu comme intériorité subjective ; il maintient le gouffre (ou « l’abîme de sens, comme il dit) qui les sépare. Dans ces conditions, même sa reprise de l’intentionnalité ne lui permet pas de sortir de la métaphysique cartésienne de l’esprit : il faut bien que l’arbre perçu demeure une espèce de réalité subjective ou purement mentale (ce qu’il appelle aussi un « noème »). Nous cherchons, par la perception, à atteindre la « chose même », mais nous échouons fatalement à l’atteindre. Nous restons confinés dans l’immanence de la conscience, même « élargie », même « intentionnelle ». En d’autres termes, Husserl reste prisonnier de l’alternative dont je parlais : réalisme représentatif versus idéalisme. Rejetant (à mon avis à juste titre) le réalisme représentatif, il n’a plus d’autre option que d’embrasser un idéalisme transcendantal, lequel affirme que l’être du monde est dépendant de la subjectivité. Si la subjectivité n’était pas là, le monde se dissoudrait dans le néant : il est de part en part « constitué » par cette subjectivité, ou, comme Husserl l’affirme dans un passage remarquable des Ideen…I, au-delà de ce système constitutif, il est « un rien (ein Nichts) ». Or c’est cette conséquence en réalité absurde qu’il s’agit d’éviter.
La philosophie a longtemps considéré que nos représentations du monde étaient différentes du monde lui-même. Pourquoi est-il crucial selon vous de combattre cet argument ?
Parce qu’il conduit à concevoir l’esprit comme une espèce de boîte ou de salle de projection privée dans laquelle le monde serait redoublé. Une fois adoptée cette image, il devient très difficile de comprendre comment sortir de cette salle pour confronter ces images avec la réalité. Or l’idée même de représentation ne fait sens que s’il est possible de confronter cette représentation à ce qu’elle représente, par exemple de mettre en rapport une photographie avec la chose même qu’elle reproduit. Il n’y a et il ne peut y avoir de représentation que de la chose telle qu’elle existe par-delà toutes ses représentations. L’idée même d’un enfermement dans l’espace de nos représentations sans possibilité d’en sortir enveloppe une grave contradiction.
En outre, cette façon de se représenter l’esprit et l’activité perceptive elle-même a tendance fatalement à dissocier la perception de ses bases corporelles. En vérité, la perception est indissociable du mouvement corporel et de l’exploration du monde. Ces mouvements exploratoires ne sont pas ajoutés après-coup à une perception qui serait de nature purement spirituelle ; ils font partie de ce que c’est que percevoir. Ainsi, une dissociation entre l’esprit et le corps rend incompréhensible l’essence même de la perception, qui doit être comprise au contraire comme une transaction corporelle continue du sujet avec son environnement.
Enfin, penser la perception comme une simple représentation conduit à rapprocher abusivement perception et hallucination, à les comprendre sur le même modèle. Toutes deux seraient des représentations qui ne différeraient l’une de l’autre que par le fait que, tandis que dans une représentation illusoire, il n’y a aucun objet réellement existant qui agisse sur nos sens, dans la perception, un tel objet existe. Or je défends l’idée que la perception et l’hallucination se distinguent de manière beaucoup plus nette que cela : la première n’est justement pas une représentation dans laquelle l’objet pourrait se révéler inexistant, mais une présentation de la chose dans laquelle l’existence de celle-ci dans l’environnement du sujet est nécessairement présupposée. Percevoir, par essence, c’est percevoir de l’existant. Il n’y a de perception que du monde et du monde pour autant qu’il existe indépendamment de toute perception.
Dès lors, faut-il abandonner le concept de représentation et lui préférer celui de perception ? Ou bien cela ne fait-il que déplacer le problème ?
L’alternative n’est pas entre user du concept de représentation ou lui préférer le concept de perception ; elle est entre concevoir la perception comme représentation ou comme présentation. La question véritable est : la perception est-elle ou n’est-elle pas une représentation ? Je réponds par la négative. Elle est une transaction corporelle avec la chose qui présuppose son existence, une épreuve de réalité.
Pour réfuter l’idée d’une perception qui aurait un accès direct aux choses-mêmes, certains penseurs convoquent l’argument de l’hallucination ou de l’illusion. En quoi ces objections sont-elles insuffisantes ?
L’argument de l’hallucination est très ancien et fait partie de l’arsenal du scepticisme. Son but est justement d’établir que la perception et l’hallucination sont de même nature, sont toutes deux des représentations, et pour y parvenir il affirme que perception et hallucination peuvent être indiscernables l’une de l’autre. Et puisque, dans l’hallucination, l’objet n’existe pas, on en infère qu’il peut aussi se révéler inexistant dans le cas de la perception. D’où le lien entre cet argument et le scepticisme : la perception ne permet jamais de s’assurer que l’objet existe avec une absolue certitude. Il existe de multiples versions de cet argument, mais à chaque fois il s’agit d’établir que l’existence de l’objet n’est pas nécessaire à la perception.
Si on concède ce point, il faut donc maintenir que la perception n’est pas une relation directe au monde mais une relation au monde médiée par une représentation. Et que, dans cette représentation, rien ne peut nous garantir absolument que son objet existe. Mais cet argument, bien qu’il ait été admis par une grande majorité des philosophes modernes, est-il valide ? Je crois que non, pour plusieurs raisons.
D’abord, pour pouvoir aligner la perception sur l’hallucination, il faut admettre que l’hallucination a un objet dans le même sens où la perception en possède un. Mais est-ce le cas ? Non, en réalité : l’hallucination n’a pas d’objet du tout dans le sens d’un objet extérieur à l’esprit, et partant, doté d’existence. L’analogie entre expérience perceptive et quasi-expérience hallucinatoire ne vaut pas. Ce ne sont pas des expériences dans le même sens. Qui plus est, on peut rejeter l’idée qu’une hallucination puisse être réellement indiscernable d’une perception. Indiscernable en quel sens ? Si l’on veut dire par là subjectivement indiscernable, c’est-à-dire indiscernable du point de vue du sujet, alors il ne s’ensuit pas que perception et hallucination aient la même nature, puisqu’on ne peut pas inférer de l’impossibilité subjective de discerner deux choses que ces deux choses, en elles-mêmes, sont indiscernables ; on ne peut pas en inférer que leur nature est identique. Il faudrait donc, pour que l’argument soit valide, qu’il s’agisse d’une indiscernabilité objective. Mais on peut nier une telle indiscernabilité objective qui entraînerait une identité de nature entre les deux expériences : une perception est une expérience de quelque chose, tandis que l’hallucination n’est qu’une pseudo-expérience ; la première est une présence corporelle à la chose qui existe indépendamment du sujet percevant ; la seconde est une simple apparence de présence corporelle à la chose. Leur nature reste entièrement différente.
La dichotomie entre le corps physique (objectif) et la chair du phénoménologue (subjective) est pour vous un lieu commun de la philosophie que la présence du corps d’autrui, ni objectif ni subjectif, vient bouleverser. De quelle nature est selon vous la connaissance que nous avons d’autrui ?
En effet, un des points sur lesquels j’insiste beaucoup dans ce livre est que la distinction entre corps-objet (Körper dans le vocabulaire de Husserl) et corps vécu ou corps propre (Leib) qui a été acceptée par l’ensemble des phénoménologues après Husserl, même s’ils l’ont conçue de manière différente, n’est pas tenable. Elle conduit en effet à affirmer que le sujet a deux corps bien distincts l’un de l’autre, puisque leurs propriétés sont différentes : l’un est matériel, étendu dans l’espace, pourvu de limites définies, de même nature que les corps physiques ; l’autre n’a pas de limites assignables, n’a pas de lieu déterminé dans l’espace, ne se donne que dans l’expérience de l’auto-contact. Cette distinction a tendance à déplacer au niveau du corps lui-même la vieille dichotomie corps-esprit. La chair ou le corps vécu est une espèce de « corps glorieux », comme dit Merleau-Ponty, ou de corps fantomatique qui ressemble à s’y méprendre à une âme, ou plutôt à l’âme pourvue d’extension (parce qu’unie au corps) supposée par Descartes dans une de ses lettres à la reine Elisabeth.
Je défends l’idée que, d’un point de vue strictement phénoménologique, cette distinction ne vaut pas : nous ne possédons qu’un seul et unique corps qui est à la fois étendu, matériel, doté de limites assignables dans l’espace, et expérimenté d’une façon singulière qui diffère de la manière dont nous expérimentons toutes les autres choses. Ce corps est donc dans le monde, il appartient à celui-ci par sa nature même, et néanmoins, parce qu’il est expérimenté d’une manière absolument singulière, au moyen d’une sensibilité spéciale (qui ne peut porter que sur lui), il est nous.
En quoi cela change-t-il la donne pour ce qui est de ce qu’on appelle classiquement « le problème d’autrui » ? Tant que l’on demeure captif de la distinction chair/corps-objet, le problème auquel on se mesure est qu’autrui n’est ni un simple corps-objet (sinon il serait une chose), ni un corps vécu ou propre, sinon il serait moi. Autrui ne peut donc avoir qu’un type de présence absolument énigmatique – et de fait, la cinquième Méditation cartésienne de Husserl se solde par un échec. Pour qu’autrui puisse être « constitué » par l’ego transcendantal,il faudrait qu’il puisse se présenter à moi comme une chair, or c’est ce que Husserl lui-même juge impossible, puisqu’une chair n’est constituée comme telle que par le contact redoublé qui prend place entre mes deux mains. Dans le monde primordial il ne peut y avoir qu’une seule chair par principe, et c’est la mienne !
En revanche, si on part, comme je le propose, d’une description du corps comme quelque chose qui est situé dans le monde, au même titre que toute autre réalité, et comme quelque chose qui ne se donne à expérimenter qu’au moyen d’une sensibilité spéciale, qui le distingue radicalement de tout le reste (mon corps est le seul lieu où je puisse ressentir de la douleur, la sensation d’avoir chaud ou froid, d’être chatouillé, et ainsi de suite), alors il est possible d’affirmer qu’autrui, lui aussi, est donné comme un corps dans le monde, et non comme une chair acosmique, tout en soutenant qu’il possède un accès particulier à ce corps mondain distinct du mien. Sans entrer ici dans le détail de la démonstration, on peut dire que le monde, dans sa nature même, doit inclure moi-même et autrui sur un pied d’égalité. Et on peut tenter une description du monde ainsi conçu comme neutre à l’égard de la différence moi-autrui, comme nous incluant nécessairement tous deux.
Le titre de votre ouvrage, L’Appartenance au monde, sonne comme une antithèse à la philosophie de Michel Henry qui postulait notre appartenance « à la vie » (à laquelle il opposait justement le monde). Estimez-vous, comme le pensent certains, que sa philosophie conduise à une forme d’acosmisme ?
Tout à fait. Je pense que Michel Henry a absolument tout faux, si je peux m’exprimer familièrement. Michel Henry est passé totalement à côté de tout ce qui s’est fait d’important en philosophie au XXe siècle, à commencer par la déconstruction du modèle cartésien de l’esprit telle qu’elle a été menée à bien conjointement par Husserl, Heidegger, Wittgenstein et certaines tendances du pragmatisme. Sa pensée est véritablement une régression, elle reproduit et aggrave toutes les apories que ces philosophes ont patiemment exposées et critiquées.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.