Pour des raisons historiques évidentes la France est encore aujourd’hui particulièrement sensible à l’antisémitisme. Si la réprobation morale et parfois juridique qui s’y attache n’a rien d’absurde en soi, elle peut néanmoins le devenir si l’on condamne par principe toutes formes de questionnement sur l’identité juive. Notre propos sera de restituer – sans prétendre à l’exhaustivité – les topoï du discours antisémite après avoir préalablement mis en question le Juif dans son identité.

L’antisémitisme ne peut s’expliquer en perdant de vue la fissure lointaine et toujours présente de l’identité juive. Pensons ici à l’extrême solitude de Franz Kafka – solitude qui lui arracha jusqu’à son identité d’homme solitaire – mise à jour par Gustav Janouch lors d’une conversation. À la question « êtes-vous à ce point seul (…) comme Kaspar Hauser ? » Kafka, après avoir esquissé un rire, répondit ceci : « Bien pire que cela. Je suis seul… comme Franz Kafka ». Seul… comme l’unique. L’exil intérieur qu’a vécu Kafka – un exemple parmi d’autres – relève, en partie, de ses origines juives et de la faille identitaire qu’elles renferment. Le jeune écrivain fut confronté – sous les feux bigarrés d’une capitale pluriethnique – à une disjonction douloureuse entre l’enracinement religieux et la quête d’intégration, de reconnaissance. Nous voyons se dessiner grossièrement deux pôles avec, d’un côté, la figure du Juif sans terre encore vivement imprégné de ses traditions ancestrales et, de l’autre, le Juif émancipé et/ou assimilé. Il y aurait comme une incohérence à vouloir les deux et comme une incomplétude à ne pas les obtenir ensemble. Ce n’est pas tant l’incompatibilité en soi de ces deux tendances mais bien davantage leur expression si caractéristique qui fut décisive car, malgré les efforts consentis par les parents de Kafka pour éponger la culture germanique – allant, pour d’autres, jusqu’à rompre totalement avec le judaïsme –, les élites en place verront toujours en eux des Juifs. Marthe Robert l’exprime ainsi : « assimilés, certes, ils le sont, mais uniquement dans l’espace clos de leur germanisme d’emprunt, ou si l’on veut, ils sont « assimilés » à leur propre déracinement ».
Néanmoins, l’antisémitisme ne constitue pas une charge contre le judaïsme à proprement parler. L’antisémite s’en prend au caractère Juif et, par conséquent, à un signe beaucoup plus volatil d’appartenance : la judéité ou le Juif « déjudaïsé » appréhendé sous la férule de son « attribut psychologique ». On passe désormais d’un antijudaïsme à un antisémitisme. Il va de soi que, sous ce rapport, l’émancipation du Juif – allant pourtant de pair, pourrait-on croire, avec sa parfaite intégration – produira, en réalité, une nouvelle matrice antijuive. Selon les mots d’Hannah Arendt, « l’assimilation, qu’elle fût ou non poussée jusqu’à la conversion, ne constitua jamais une menace sérieuse pour la survie des Juifs » ; « qu’ils fussent accueillis ou rejetés, c’était en tant que Juifs, et ils le savaient fort bien ». En réalité, si même la conversion ne pu défaire l’identité juive, c’est que, précisément, « les Juifs devinrent un groupe social qui ne se définissait pas par la nationalité ou la religion, mais par certaines caractéristiques psychologiques, par certaines réactions dont la somme était censée constituer la « judéité » ». Les Juifs peuvent aisément échapper au judaïsme par la conversion. En revanche, il est presque impossible pour eux d’échapper à la judéité.
Jean-Paul Sarte, dans ses Réflexions sur la question juive, tente une déconstruction un peu hâtive du caractère juif en lui déniant toute connexion avec une communauté historique concrète. Après avoir reconnu l’éviction d’une unité nationale et religieuse, il en déduit que, « s’ils ont un lien commun, s’ils méritent tous le nom de Juif, c’est qu’ils ont une situation commune de Juif, c’est-à-dire qu’ils vivent au sein d’une communauté qui les tient pour Juifs ». En d’autres termes, pour Sartre, la judéité ne serait qu’une construction du discours antisémite : « c’est l’antisémite qui fait le Juif ». Il suffirait donc de supprimer l’antisémitisme pour résoudre la question juive. Mais alors, dans ce cas, sur quoi se fonde l’antisémitisme si le Juif authentique (celui qui s’assume comme tel) ne fait, en réalité, que s’adapter à une situation déterminée, c’est-à-dire réagir aux signaux de ceux qui le considèrent comme Juif ? L’antisémitisme devient alors synonyme de passion irrationnelle ; « (…) l’antisémite adhère, au départ, à un irrationalisme de fait (…) il s’oppose au Juif comme le sentiment à l’intelligence (…) ». Sartre a négligé le phénomène de sécularisation. En effet, les anciens traits de la communauté juive se sont, en quelque sorte, prolongés et renouvelés sous une forme séculière qu’ Hannah Arendt illustre de cette façon : « l’assimilation des Juifs, avec ses corollaires (disparition de la conscience nationale, transformation d’une religion nationale en un simple culte confessionnel (…)), produisit un véritable chauvinisme juif, si du moins on entend par chauvinisme le nationalisme perverti dans lequel, selon les termes de Chesterton, « l’individu est lui même l’objet du culte ; l’individu est son propre idéal, et même sa propre idole » ». Il y a sécularisation en ce sens que « le vieux concept religieux d’élection cessa d’être l’essence du judaïsme pour devenir l’essence de la judéité ». On ne peut décemment pas imputer ce phénomène, en totalité, à l’imaginaire antisémite. Enfin, pour reprendre ce qui a été dit plus haut, l’assimilation poussée jusqu’à la conversion – cas, par exemple, de familles allemandes baptisées depuis des générations – n’a pas empêché les Juifs de se lover entre eux ; ainsi, « la famille juive se montra en fait une institution plus conservatrice du groupe que la religion elle-même ». Comment cette promiscuité d’esprit pourrait-elle sérieusement s’analyser comme une situation créée de toute pièce par le discours antisémite ? Mieux vaut admettre qu’un tel discours s’enracine dans le sol friable mais réel de l’identité juive ; identité elle-même alimentée et souvent déformée par une rhétorique du soupçon. L’antisémitisme pourrait se définir comme une interprétation tendancieuse, passionnée et hostile d’une réalité objective par extrapolation.
Antisémitisme et antijudaïsme

On pourrait bien sûr penser que le passage d’un antijudaïsme à un antisémitisme devrait logiquement conduire à une purge de tout grief en rapport avec la loi juive. En réalité, l’émancipation n’opéra pas toujours – mais cela est sans doute moins vrai aujourd’hui – sur le mode draconien de l’assimilation. Il subsistait encore (chez les parents de Kafka par exemple) un lien solide avec le religieux et, dans ce cas, le terme d’acculturation serait peut-être plus approprié. En ce qui concerne le Juif parfaitement assimilé, comme nous l’avons dit, l’identité juive ou la trace d’une histoire singulière, biblique et élective, persiste sous une forme larvée et séculière. Cela explique pourquoi certains auteurs ne cesseront d’utiliser des références religieuses pour peindre l’identité des Juifs acculturés ou assimilés. Au Moyen Âge , comme le précise Bernard Lazare dans L’antisémitisme : son histoire et ses causes, l’hostilité des chrétiens à l’encontre des Juifs s’appuyait sur les écrits (on relevait par exemple, dans le Talmud, des blasphèmes contre la religion chrétienne) alors qu’à l’époque moderne il s’agit d’insister sur le caractère « régressif » desdits écrits. C’est le cas chez Houston Stewart Chamberlain qui, contrairement à Renan, a refusé aux Juifs le génie religieux en remplaçant le terme de monothéisme par celui de « monôlatrie » (La genèse du XIXe siècle). Avec cette expression, Chamberlain entend signifier que le Dieu juif est celui d’un peuple élu dont les exigences spirituelles, la référence permanente au mystère propre à notre civilisation helléno-chrétienne, se résorbent dangereusement sous l’effet d’une « déification de la volonté », d’un fétichisme de la loi. « Le sémite bannit donc de la religion l’étonnement plein de pensées, tout sentiment d’un mystère dépassant l’entendement humain ; il en exclut de même l’imagination créatrice ».
Ainsi, dans le judaïsme, « (…) le vouloir s’est asservi l’intellect investigateur et la sensibilité imaginative » ; le sens profond des mythes bibliques se transforme en une simple donnée factuelle et historique : « voilà le matérialisme, ce matérialisme que nous rencontrons partout où souffla l’esprit sémitique ». En ce sens, l’incandescence de la foi juive – seul trait enviable – masque le funeste « (…) triomphe de la volonté, et si la volonté triomphe ainsi, (…) ce n’est pas seulement en raison de sa force extraordinaire, c’est aussi par suite de l’étiolement de l’intellect et de l’imagination : il y a d’un côté minimum de religion, il y a de l’autre maximum de capacité de croire – croire absolument, inébranlablement – maximum de besoin de foi – foi qui se tend comme une main avide, foi qui veut et qui doit donner au croyant, mais pour lui personnellement et uniquement, à l’exclusion de tout autre (…) ». On rencontre ici ce qui fait l’originalité du peuple juif et représente, d’une certaine manière, l’élément moteur de l’antisémitisme : le topos de l’élection à partir duquel gravite d’autres éléments. Ce fétichisme de la volonté institué par la révélation rendrait le Juif trop rigide, incapable de se déterminer autrement que par les écrits, complètement indifférent « (…) à tout le domaine de l’action humaine qui n’est pas réglementé par la loi » (Eric Voegelin, Race et État). Chamberlain présente le caractère juif comme spécifique à une configuration raciale et ne rattache donc pas l’esprit sémitique, pourtant fruit du judaïsme, au seul lien religieux.
L’auteur reconnaît en effet l’existence d’un « Juif intérieur » qui ne relève ni d’une ferveur religieuse, ni même d’un trait strictement héréditaire comme celui de la race, mais bien d’un pneuma Juif que tout le monde peut recevoir. « On a pas besoin, pour être Juif, de se signaler par un authentique nez hittie : ce mot « juif » désigne avant tout une façon spéciale de sentir et de penser. Un homme peut, sans être du tout israélite, devenir très rapidement juif : il en est qui, pour cela, n’ont qu’à fréquenter des Juifs, lire des journaux juifs, s’accoutumer à la conception juive de la vie, à la littérature juive, à l’art juif ». Une conversion à la judéité s’avère tout aussi possible que son contraire : un Juif « de l’extraction la plus pure » peut se défaire de sa coquille juive et, dans ce cas, il serait absurde de l’appeler « Juif ». Bien qu’il s’appuie strictement sur les écrits et la foi pour définir l’identité israélite, le philosophe et historien racialiste anglais admet que l’intériorité du Juif déborde sa race et son rapport direct à la révélation. Un Juif, même assimilé, peut donc, à la fois, conserver un esprit sémite ou bien s’en défaire complètement dans certains cas. On voit bien ici que l’assimilation du Juif ne signifie nullement la perte de son identité communautaire.
Une rhétorique antimoderne
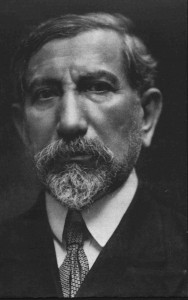
L’antisémitisme dirigé contre le Juif assimilé ne s’attaquera plus décisivement à la Thorah et/ou au Talmud mais utilisera davantage une rhétorique antimoderne déclinée en plusieurs branches que nous pouvons ramasser en un tronc commun déjà évoqué : le passage d’une élection d’essence religieuse et transcendante à une élection de nature sécularisée et immanente. Autrement dit, cette rhétorique antisémite repose sur l’idée que la communauté juive œuvre toujours, plus ou moins consciemment et comme si sa mission de peuple élu animait encore la volonté profonde de ses membres, pour asseoir sa suprématie. Paradoxalement, on reprochera au Juif assimilé son caractère inassimilable ; inassimilable avec la constitution organique de la vieille France à laquelle des personnes comme Charles Maurras et Xavier Vallat se raccrochent éperdument. En effet, l’antisémite se montre passablement antimoderne en voyant dans l’émancipation des Juifs – c’est-à-dire le fait pour eux d’incarner la pointe de la modernité en construction – comme un signe d’une impossible assimilation à l’esprit français. Il y aurait donc une bonne et une mauvaise assimilation susceptible de varier selon l’ancrage idéologique : les progressistes s’attacheront à mettre en lumière les restes du Juif talmudiste à l’inverse des antimodernes et/ou réactionnaires qui stigmatiseront le Juif moderniste. Les deux options sont envisageables mais la quintessence du discours antisémite se prélève sur les sensibilité antimodernes et/ou réactionnaires – l’émancipation des Juifs étant un fait incontestable. Le Juif serait donc inassimilable car révolutionnaire, défenseur de la liberté et de l’égalité, promoteur de la finance et de l’industrialisme, acteur du cosmopolitisme libéral et de l’anticléricalisme (ils soutiennent par exemple le Kulturkampf en Allemagne et les lois Ferry en France), déserteur du sentiment patriotique.
Quant au Marx de La question juive, il s’attelle – en bon philosophe du soupçon – à décrypter la matérialité insidieuse du judaïsme, c’est-à-dire à mettre en lumière le visage du Juif réel. Le grand promoteur de la lutte des classes pensait que le soubassement occulte (l’infrastructure) de la religion juive demeurait pérenne en dépit d’une assimilation enclenchée par la révolution. La rhétorique dialectique et matérialiste de Marx fournit l’exemple d’une continuité entre judaïsme et judéité, entre Juif talmudiste et Juif assimilé. Sous l’impulsion révolutionnaire le Juif casse sa coquille religieuse pour laisser transparaître ses manières d’égoïste bourgeois, son culte de l’argent. La société bourgeoise ne serait qu’un judaïsme enfin pleinement réalisé à travers le christianisme sécularisé des Lumières ; le christianisme n’étant lui-même que le prolongement du judaïsme. Seule une émancipation réelle de la société bourgeoise pourrait libérer les Juifs. En poussant la logique de la suspicion jusqu’au bout, l’antisémite est amené à combattre une communauté aspirant « (…) à prendre les commandes, à créer des réseaux et à constituer un « super-État dans l’État » » (Jacques Prévotat, L’Action Française). Si la théorie du complot reprend des couleurs sous les élucubrations d’Alain Soral, elle n’a pourtant rien d’inédit puisque, déjà sous la Révolution, des auteurs comme Eduard Emil Eckert et Dom Deschamps ont insisté sur le rôle des Juifs dans la constitution de sociétés secrètes – notamment sur le fait qu’ils ont « toujours été les inspirateurs, les guides et les maîtres de la Maçonnerie (…) » en poursuivant tenacement le but ultime d’une destruction de l’Église. Edouard Drumont, quant à lui, ne manquera pas de souligner la mainmise du peuple israélite sur presque tous les journaux. Cette rhétorique complotiste – autre visage du soupçon – fait de la communauté juive une secte œuvrant secrètement et consciemment pour assurer sa prééminence. La méthode ne consiste pas seulement à extrapoler ou à théoriser de manière excessive sur des données pourtant objectives (actions, paroles, écrits, etc…) mais à rechercher un intérêt dérobé derrière les faits.
À la différence des extravagances antisémites, Bernard Lazare reconnaît la participation du Juif à la marche de la modernité mais refuse de le rendre responsable de la décrépitude du catholicisme. Même analyse du côté de Brunetière ou Leroy-Beaulieu pour qui les Juifs étaient davantage des imitateurs que des initiateurs de la modernité : « ne renversons pas les rôles ; ce n’est pas le Juif qui a émancipé la pensée chrétienne et bouleversé les sociétés contemporaines, c’est la pensée chrétienne, ou mieux, la pensée moderne, qui a émancipé le Juif » (Leroy-Beaulieu, Les doctrines de la haine : l’antisémitisme, l’antiprotestantisme et l’anticléricalisme). Nous avons donc, d’une part, les antisémites qui voient le Juif en artificier sournois du changement d’époque et, d’autre part, les anti-antisémites qui, au contraire, minimisent le rôle des Juifs dans cette histoire tout en manifestant de la compassion et de la bienveillance à leur égard. Brunetière et Leroy-Beaulieu ou encore, dans une certaine mesure seulement, Sartre se range dans la seconde catégorie ; Maurras et Marx dans la première. Bernard Lazard adopte une position plus complexe et semble finalement rejeter ce schéma bipolaire (voir l’article d’Antoine Compagnon Antisémitisme ou antimodernisme, de Renan à Bloy).
Antisémitisme et anti-antisémitisme se recouperaient en un point : l’analogie du judaïsme et du modernisme. Pour les uns l’analogie est évidente et condamnable, pour les autres elle serait simplement présentée de manière spécieuse. L’anti-antisémitisme négligerait injustement, selon Lazare, la grandeur historique des Juifs en niant leur rôle de peuple élu. Une autre position existe néanmoins : le philosémitisme. Le philosémite accorde une réelle importance historique et spirituelle au peuple juif tout en mortifiant sa décadence actuelle. Lazard voyait chez Léon Bloy l’incarnation du philosémite « antijuif et prohébreu (…) ». La véhémence de Bloy à l’encontre de celui qu’il nomme le « youtre moderne » et le « (…) confluent de toutes les hideurs du monde » (Le Salut par les Juifs) se justifierait par un amour du peuple hébreux dont Jésus descend. Le Juif, aussi détestable soit-il par sa compromission avec le capital et par son émancipation vécue par Bloy comme une trahison, serait, malgré tout, toujours attaché à la pureté séminale de ses origines. Il faut sauver les Juifs eu égard à leur histoire : « Prions pour les perfides Juifs, pour que le Seigneur Notre Dieu enlève le voile de leurs cœurs et qu’ils reconnaissent, eux aussi, Notre Seigneur Jésus-Christ. Sempiternel Dieu Tout-Puissant, qui ne rejetez de votre miséricorde pas même la perfidie Juive, exaucez les prières que nous déférons à vous, à cause de l’aveuglement de ce peuple, pour qu’ayant connu la lumière de votre vérité qui est le Christ, il soit arraché de ses ténèbres.»
